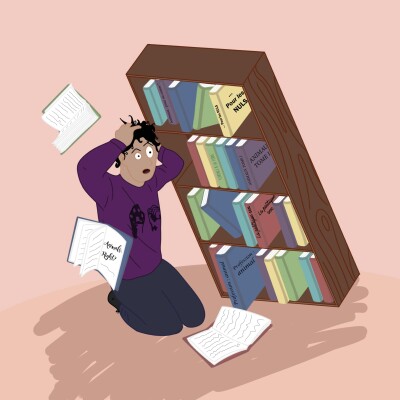Speaker #0Bienvenue dans les classiques de l'antispécisme dans le désordre. Pourquoi dans le désordre ? Parce qu'un ordre chronologique aurait été ultra compliqué, j'aurais passé ma vie à en oublier, un ordre thématique serait rapidement devenu redondant, et aurait été super chiant, et un ordre d'importance... Hey ! J'essaye de conserver des camarades. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Les animaux ont aussi les droits. Ce livre est écrit de manière intéressante. La véritable auteure, en ce sens aussi elle qui choisit les thèmes et qui les agence, est Karine Lou Matignon. Elle a été aidée dans ce travail par David Rosen, sans qu'on sache exactement... de quelle façon le travail s'est articulé. Il est ornithologue donc il a probablement participé à la relecture par rapport à l'aspect scientifique. Le livre prend la forme d'entretien avec trois auteurs célèbres du mouvement antispéciste, Boris Cyrulnik, Elisabeth de Fontenay et Peter Singer. Au travers de cet échange de questions, ouvertes mais orientées vers un but, l'auteur fait dialoguer artificiellement ces trois personnes pour mettre à jour, petit à petit, leur vision des droits des animaux. Déjà, il faut comprendre que ce livre parle des droits tels qu'ils devraient être et non pas des droits tels qu'ils sont actuellement. C'est probablement la raison pour laquelle elle n'a pas invité de juriste. Il s'agit d'une discussion philosophique sur ce que l'humanité doit à l'animalité. Je précise que ces mots n'ont pas été utilisés tel quel dans les discours. J'essaye d'homogéniser les discours de 4 personnes, donc je passe nécessairement par des raccourcis. De la même manière, je vais devoir expliquer plusieurs concepts clés et vous donner quelques grilles de lecture, parce que j'ai aucune envie de juste vous balancer les informations sur les gens et leurs positions sans être sûre que tout le monde pourra parfaitement comprendre de quoi je parle. L'auteur fait venir Boris Cyrulnik, un éthologue. c'est-à-dire un spécialiste des comportements sociaux et psychologiques des animaux. Boris Sironnik est particulièrement engagé pour l'étude des animaux en milieu naturel, et il a aussi beaucoup travaillé sur le développement de l'empathie chez les enfants. Il se rattache lui-même à l'école de France de Wall, un autre éthologue très connu. Puis Peter Singer, un philosophe analytique, plus précisément de l'école utilitariste. Elisabeth de Fontenay, elle, est une philosophe qu'on peut qualifier de continentale, inspirée de l'école de Francfort, et dont on peut considérer que le positionnement est post-humaniste. Vous noterez toutes les précautions que je prends, la vérité est qu'Elisabeth de Fontenay jette beaucoup de références, de noms et de citations, sans toujours dire si elle est d'accord avec la citation qu'elle donne, et se revendique de choses très vagues, comme la théorie de l'évolution. Je pense que certains diraient qu'elle n'a pas d'école, mais je ne dirais pas ça parce que je ne crois pas que ça existe. Je pense que c'est une posture particulière que de ne pas se rattacher à une école en particulier, sans chercher dans le même temps à en fonder une, et que c'est quelque chose que les philosophes continentaux font souvent. A ce stade, je dois expliciter la différence entre les deux. Quand, entre grosses guillemets que j'ai posées, Déjà les philosophes analytiques se revendiquent de l'analytique, tandis que les philosophes continentaux ne se revendiquent pas du continent. Les philosophes dits continentaux se revendiquent en général de leur école. Ce sont les philosophes analytiques qui ont créé cette distinction. Ce classement est donc habituellement utilisé dans un sens péjoratif par les analytiques. Vous vous demandez sûrement, mais de quel continent on parle enfin ? L'Europe évidemment. L'Europe par opposition à l'Angleterre. Et par l'Europe on veut surtout dire la France et l'Allemagne. Par extension, on a fini par parler de philosophie anglo-saxonne qui regroupe les USA et les autres pays de langue anglaise, tous occidentaux évidemment, mais à la base cette classification sert à dire l'Angleterre d'un côté et la France et l'Allemagne de l'autre. Évidemment, le reste du monde fait aussi de la philosophie, mais dans ce cadre-là on n'en parlera pas. Disons que les philosophies analytiques se revendiquent de la méthode scientifique et formulent ces questions sous forme d'hypothèses et de protocoles pour y répondre, tandis que la philosophie continentale s'autorise d'autres formes d'accès à la connaissance, C'est-à-dire qu'ils sont évidemment libres de formuler des hypothèses et de faire des protocoles, mais ils peuvent aussi avoir recours à l'art, aux jeux de langage, à la photographie. Pour un philosophe continental, il peut y avoir un continuum entre l'artiste, l'écrivain et le philosophe. Je dois le préciser parce qu'à ce stade du podcast, c'est impossible de ne pas me situer moi-même, je suis plutôt porté sur la philosophie analytique mais je ne suis pas utilitariste comme Beerslinger. Les auteurs, donc, ont tous une vision différente de ce que devraient être les droits des animaux. Dès qu'on parle des droits des animaux, il faut immédiatement répondre à la question Pourquoi les animaux n'ont-ils pas déjà des droits égaux aux humains ? Les auteurs font le tour des raisons potentielles, historiques, biologiques et sociales, et arrivent rapidement à l'autre question, est-ce qu'il existe un propre de l'homme qui justifie la différence de droit ? Peter Singer et Elisabeth de Fontenay ont tous les deux une réponse nette, et j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être moi, qu'on avait arraché une réponse à Boris Cyrulnik. Le propre de l'homme ne semble pas être son sujet de prédilection, et c'est compréhensible puisqu'il est éthologue et neuropsychiatre, et qu'historiquement le propre de l'homme est plutôt un sujet de philosophie. Personnellement, j'ai toujours trouvé ce concept un peu douteux et je connais même quelques blagues à ce sujet que vous pourrez ressortir en société. Le propre de l'homme, c'est toujours se demander ce qu'est le propre de l'homme. De tout temps, les hommes ont cherché le propre de l'homme. Plus sérieusement encore, il y a la réflexion de Thomas Nagel. Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ? Qui vient avec la question ? Si on demandait à une chauve-souris de définir ce qu'est un vrai être vivant, à qui il faut accorder de l'importance, de la considération et un maximum de droits, elle dirait quoi ? Elle donnerait probablement des réponses comme l'écolocalisation est le propre des êtres pensants Et bien sûr, manger des insectes et avoir des ailes. Peter Singer et Elisabeth de Fontenay connaissent cette question évidemment, et Elisabeth de Fontenay la cite même à un moment. Pourtant, ils répondent tous les deux à la question, de mon point de vue, comme une chauve-souris le ferait. Peter Singer pense que le propre de l'homme est de se représenter son propre avenir. Ça me semble aussi douteux que l'affirmation qui était encore en cours il y a 20 ans comme quoi l'homme est le seul animal à utiliser des outils. Elisabeth de Fontenay, elle, explique que le propre de l'homme c'est le langage performatif, c'est le fait que prononcer une parole soit aussi la réalisation d'une action. L'exemple d'Elisabeth de Fontenay, c'est un président de séance qui dit la séance est ouverte et qui ouvre du même coup la séance par sa parole. J'ai deux critiques à faire à ce sujet. Déjà, je ne vois pas en quoi ça pourrait justifier aucune différence de droit. Et Elisabeth de Fontenay est en faveur des différences de droit. Mais aussi, et ça je pense que c'est parfois difficile de le réaliser quand on a quelqu'un de très écouté, le fait d'avoir un langage performatif est une question de pouvoir plus qu'une question de capacité mentale. Pouvoir modifier la réalité par sa parole est un privilège. Pour reprendre l'exemple d'Elisabeth de Fontenay, quand un président de séance déclare la séance est ouverte elle n'est ouverte que parce que le reste de l'Assemblée accepte la valeur performative de la parole du président. Et pour prendre l'exemple des animaux, parfois un animal vous dit non, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter, parce que c'est vous le dominant. La performance de la parole est donc fondamentalement dans l'oreille de celui qui entend, et pas dans la capacité de celui qui s'exprime. Bruce Cyrulnik lui donne comme propre de l'homme la capacité à éprouver de l'empathie pour les autres animaux, non pas pour un individu, ça les animaux savent faire évidemment, mais pour les espèces comme concept abstrait. Pour le coup, je dirais que ça reste à prouver, mais comme Bruce Cyrulnik utilise cet argument pour encourager à une éthique de l'empathie, plutôt que pour justifier un droit supérieur pour les humains, je dirais que la charge de la preuve est évidemment moins forte. Les auteurs sont évidemment tous d'accord pour dire que la manière dont les animaux sont actuellement traités ne va pas, Je dis évidemment parce que c'est une base commune minimale pour essayer d'avoir une vraie conversation sur ce que devrait être une amélioration. Tous sont d'accord pour dénoncer l'élevage industriel, les pratiques de divertissement qui impliquent les animaux et évidemment les cruautés gratuites sur les animaux. Karen, Lou et Matignon les interrogent tous sur la question de l'évolution et de la même manière ils ont plusieurs opinions sur ce que signifie être soi-même en tant qu'humain un animal. Peter Singer utilise l'évolution comme une preuve que nos capacités de souffrance se placent sur le même spectre que ceux des animaux. Boris Cyrulnik l'utilise pour argumenter notre proximité mentale. Nous pensons et ressentons les choses similaires. Elisabeth de Fontenay aussi est consciente de la problématique de la souffrance et de ce qu'implique le fait que les animaux aient évolué à partir de la même base que nous. Mais elle refuse l'idée que l'homme serait un animal comme les autres. Des trois auteurs, c'est elle qui accorde le plus d'importance au propre de l'homme. Elle est d'ailleurs en faveur d'un droit par espèce plutôt qu'un droit global. Une citation d'elle m'a marqué. Les droits de ceux qui octroient des droits ne peuvent pas être de même nature que les droits de ceux à qui ils octroient des droits. C'est logique par certains aspects. Mais là encore, j'ai l'impression qu'on tournera sur cette question du pouvoir. Celui qui octroie les droits, c'est clairement celui qui peut matériellement refuser à l'autre de les prendre. C'est une question de pouvoir. C'est vrai que celui qui octroie les droits a plus de droits que les autres. Mais est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que parce qu'on a le pouvoir de octroyer plus de droits qu'aux animaux, on est essentiellement différent d'eux et que nos droits sont d'une nature supérieure et doivent rester supérieurs ? Ça me semble douté sur le plan éthique. Du coup, quand on en arrive à la question de jusqu'où ces droits doivent aller, Peter Singer argumente franchement en faveur de l'arrêt de toute forme d'exploitation animale, du coup quand on arrive à la question de jusqu'où c'est droit doit valer. Peter Singer argumente franchement en faveur de l'arrêt de toute forme d'exploitation animale, dans laquelle tous les animaux ont le droit à une vie sans souffrance et à la vie. On peut tourner la pensée de Peter Singer pour le forcer à dire que les animaux ont un droit à la vie inférieure au nôtre, rapport à ce truc comme quoi ils n'ont pas de pensée sur l'avenir, mais il s'agit là de pinaillage à mon avis. Peter Singer n'a jamais encouragé les fermes sans souffrance ou idées fantaisistes du même genre. et ça sert à rien de lui faire dire les trucs qu'il ne pense pas. Boris Cyrulnik aussi est en faveur d'un droit à la vie et à l'absence de souffrance pour tous les animaux, mais il rajoute un souci particulier sur le fait de pouvoir exprimer correctement ses émotions, d'avoir un environnement naturel enrichissant et conforme à ses besoins physiques et mentaux et même la possibilité, pour les animaux concernés, d'exprimer leur culture dans les bonnes conditions. Elisabeth de Fontenay part dans une direction très différente. Justement après avoir acté une différence fondamentale entre l'homme et l'animal, elle en arrive à cette conclusion que l'homme est un droit moral d'utiliser les animaux, mais... pas n'importe comment. Elle argumente en faveur de l'arrêt de l'exploitation industrielle et est très enthousiaste sur les travaux de Jocelyne Porchet, une sociologue qui présente les animaux comme partenaire des éleveurs. Pour Elisabeth de Fontenay, et Jocelyne Porchet du coup, il existe une bonne manière d'utiliser et de tuer l'animal. Elle parle d'ailleurs un peu de la valeur du sacrifice et d'une manière générale, encourage au retour de relations traditionnelles entre l'homme et l'animal, mélange de vie commune et de craintes religieuses animistes. Elle a son lot d'anecdotes plus ou moins vraies pour appuyer son propos. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle cite des mythes fondateurs romains comme si c'était des faits rigoureusement exacts, et des anecdotes sur les cultures disparues, qui bien qu'ayant laissé très peu de traces écrites, faisaient apparemment tout mieux que nous dans leur rapport aux animaux et dont on devrait s'inspirer. Désolé, mais j'y accorde pas beaucoup de crédit. On retrouve chez les trois auteurs cette idée que les droits suivent les avancées de la société et ne peuvent pas les devancer, mais permettent ensuite, une fois qu'ils sont acquis, de les préserver. Un exemple qu'on aime beaucoup à gauche, c'est l'abolition de la peine de mort. Il a fallu une évolution de société pour réussir à l'abolir. Mais effectivement, je suis content qu'on revoit pas ça toutes les semaines. parce que je suis vraiment pas sûr de ce qui se passerait. On retrouve la même problématique avec le mariage gay. Une évolution de société a permis sa légalisation, mais il reste encore énormément d'homophobes. S'il fallait que le gouvernement statue sur le mariage gay aujourd'hui, et ben je sais pas si le mariage pour tous existerait encore demain. Le droit est toujours modifiable évidemment, mais il permet une certaine inertie. L'inertie du droit est prévue à la base. Ce sont globalement les rôles du Sénat et du Conseil constitutionnel. Ceci dit, je vous dis ça, mais les auteurs ne le disent pas. Ils sont tous les droits à ces confiants, l'évolution positive des mœurs et des lois, et je sais pas pourquoi autant d'optimisme de leur part. Non mais je balance ça comme ça, mais faut le dire, parfois les droits reculent. Le droit à l'avortement fait des avancées et des reculs en permanence, de la même manière que le droit des homosexuels et des femmes, qu'on peut observer à divers endroits dans le monde depuis des milliers d'années. Non, je pense pas qu'une bonne loi règle l'affaire une bonne fois pour toutes. C'était légal d'être juif en Allemagne en 1930, tout comme l'esclavage avait été aboli dans les colonies françaises en 1794, avant d'être rétabli en 1802. Les droits sont jamais acquis et en général les militants savent ça. Malgré leur positivité globale, les trois auteurs ne peuvent que constater que les choses ne vont pas assez vite. L'auteur leur demande donc, pourquoi tant d'inertie ? Pourquoi les politiciens ne font pas passer des lois pour protéger les animaux ? Bon, c'est plutôt simple, ils sont tous d'accord, la raison pour laquelle les droits des animaux ne progressent pas, c'est les lobbies de la viande du divertissement, et l'Organisation Mondiale du Commerce. Ils rapportent plusieurs critiques habituelles. Dans le cadre de l'espace Schengen, on n'a pas le droit de mettre un embargo, c'est-à-dire une interdiction de passage de la frontière, sur un produit en particulier. Et dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, on peut, mais pour des critères de santé uniquement. C'est-à-dire que même si demain la France interdisait toute production de viande, nos accords avec l'Europe et l'Organisation Mondiale du Commerce ne nous autoriseraient pas à en interdire l'importation, sous peine de grosses sanctions. C'est un étrange jeu de déchet qui complique la vie de la plupart des pays quand ils veulent interdire une substance en particulier, ou une pratique en particulier telle que le gavage des oies. La Californie, par exemple, a interdit la production et la vente de faux gras, mais ne peut pas en interdire la circulation. Les Californiens peuvent donc en acheter sur Amazon. Les lois sur le commerce international sont compliquées et il semblerait qu'en l'absence de consensus, la liberté de commerce prime sur le reste. C'est quelque chose qui par ailleurs est souvent dénoncé par les militants écologistes aussi. Ceci dit, il ne faut pas surestimer le mal que se donnent les politiciens pour lutter contre la souffrance animale. Si vous ne connaissez pas déjà, vous pourrez faire un tour sur le site Politique et Animaux géré par le 214. C'est un catalogue exhaustif de toutes les déclarations et actions des politiciens en rapport avec les animaux. Le site existe depuis plus de 10 ans, il offre donc un... très très bon panorama des prises de position depuis un moment. Globalement, des politiciens qui réclament des mesures fortes pour les droits des animaux, il n'y en a pas beaucoup. C'est en partie lié au fait que les gens ne votent pas pour eux, ce ne sont pas des mesures populaires à ajouter sur un programme, et en partie lié au fait que le système de politique gouvernante fonctionne sur la cooptation et un entre-soi de la classe supérieure. L'auteur se demande finalement si la France ne serait pas en retard sur les droits des animaux, et j'ajouterais à cette question comment définir un retard dans ce contexte. Parce que les auteurs répondent globalement oui, la France est en retard. et leur critère c'est la législation sur les animaux de ferme, qui est plus protectrice dans les pays du nord, et les lois sur la reconnaissance des animaux comme personnes sensibles, plus avancées dans les pays asiatiques. Pourtant, on parle globalement là de détail. Les conditions matérielles des villes des animaux changent très peu, ce sont des différences de législation assez minimes, qui rendent peut-être la ville des animaux victime un tout petit peu moins difficile, mais qui n'empêche pas que le processus global est équivalent à de la torture partout dans le monde. C'est pas juste un problème de culture, en tout cas pas culture dans un sens aussi localisé qu'on l'entend là. Je reviens sur la question des critères, c'est que les mêmes auteurs utilisent d'autres critères pour justifier leur enthousiasme vis-à-vis de l'avenir, comme le fait que le mouvement pour les droits des animaux semble grandir, qu'il y a de plus en plus de véganes, qu'ils sont plus faciles de manger véganes, voire que les gens semblent subjectivement plus à l'écoute de leurs idées. Et je pense aussi que quand on a passé des dizaines d'années dans un certain entre-soi militant, en particulier quand on est un universitaire et qu'on est donc quelqu'un de très écouté, on ne réalise pas forcément qu'on est dans une chambre d'écho. De mon côté, si j'en reste au chiffre de l'exploitation animale qui grandisse d'année en année, Je suis vraiment pas aussi tranquille sur l'avenir des droits des animaux.