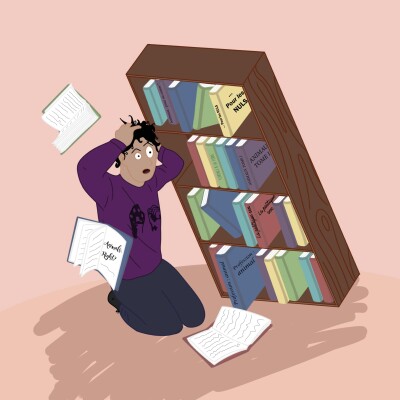Speaker #0Bienvenue dans ce nouvel épisode des classiques de l'antispécisme dans le désordre. Aujourd'hui, je vais vous présenter les droits des animaux en relation avec le progrès social. J'ai pas trouvé la version française, donc le titre original est Animal Rights, and relations with social progress. C'est un livre assez ancien dont la première publication date de 1892. L'auteur, Henri Assault, est un humaniste mais un avocat anglais. Il a été membre puis vice-président de la Vegetarian Society. Il est connu comme le premier juriste à avoir défendu les droits des animaux et comme proche de Gandhi, qu'il a convaincu de devenir végétarien éthique. Il était aussi engagé pour le droit de l'homme et le droit des femmes, et oui, cette phrase est un peu bizarre à dire à voix haute, mais vous avez compris l'idée. C'est le premier juriste à défendre le droit animalier, mais c'est évidemment pas la première personne à faire valoir que nous avons des obligations éthiques envers les animaux. En fait, c'est une discussion qui existe depuis des milliers d'années, et on ne retrouve pas l'origine. De tout temps, les êtres humains ont ressenti de l'empathie envers les animaux. Et il faut toujours se méfier quand on nous présente un gars comme ayant tout inventé et ayant changé le monde grâce à la seule force de son intellect et de son sens inné de la justice. Néanmoins, je pense que ce livre est le premier d'un genre particulier qui va avoir beaucoup de descendants. Le genre de livre qui essaye de te convaincre de devenir antispéciste. En fait, à un siècle près, j'ai eu l'impression de lire Animal Liberation de Peter Singer. Je savais qu'il y avait une inspiration, Peter Singer le dit. Mais à la lecture, c'est particulièrement frappant. Ce sont quasiment les mêmes ouvrages. C'est d'ailleurs le modèle de base de la plupart des livres d'introduction à l'antispécisme. Le mouvement antispéciste produit très régulièrement des livres de ce type. Ils servent à introduire de nouvelles personnes à notre vision de l'éthique. Lorsqu'une personnalité devient antispéciste et qu'elle commence à s'engager en faveur des animaux, elle écrit habituellement un livre comme ça. Lorsqu'un auteur antispéciste commence à acquérir un peu de popularité, ce livre est généralement sa meilleure vente. C'est le livre qu'on offre à Noël à ses parents frileux du véganisme, ou alors qu'on achète soi-même pour se convaincre de ce que notre intuition disait déjà. Voilà le modèle. L'auteur commence par une explication de pourquoi les animaux devraient avoir des droits, ou même les ont déjà, sur le plan moral. L'auteur explique habituellement ce qu'est la sentience, c'est-à-dire la capacité d'avoir des émotions subjectives, et en quoi c'est un critère significatif pour argumenter d'une obligation morale envers les animaux. La question est peuvent-ils souffrir, etc. etc. Puis l'auteur ajoute un chapitre sur chaque façon d'exploiter ou de maltraiter les animaux. Chaque chapitre contient une exposition de la cruauté particulière d'une pratique, une réponse aux arguments spécistes, quelques chiffres des années précédentes, quelques exemples, un aperçu rapide des lois en vigueur, et c'est bon, on passe au prochain chapitre. La viande pas nécessaire pour la santé, oui la maltraitance dans les abattoirs est toujours en vigueur, non les petits élevages c'est pas mieux, la chasse ne rigueur rien du tout, dangereuse et classiste, la fourrure absolument cruelle, dangereuse sur le plan sanitaire, absolument pas nécessaire, portez donc du coton, les cirques et les eaux inutiles et cruelles, achetez un livre à vos enfants. L'expérimentation animale ne fonctionne pas vraiment, chère et traumatisante, et questionne intensément sur est-ce que la faim justifie les moyens, short version, la réponse est non. Habituellement, on ajoute un chapitre sur le lait et les oeufs, mais ce livre n'en contient pas. A l'époque de Henry Salt, les industries alimentaires n'étaient pas aussi développées, donc l'exploitation non létale était moins visiblement néfaste pour les animaux. Ce genre de livre est donc une nécessité du mouvement, on a besoin d'en avoir régulièrement, qui nous viennent de tous les côtés de la société. On a aussi besoin que les chiffres soient actualisés tout le temps, parce que les gens sont très fous à croire que tout a changé maintenant quand on leur évoque des faits qui t'aident les deux ans. Je ne lis pas beaucoup de livres de ce genre pour des raisons évidentes. On lit ce type de livre une fois, peut-être deux, puis on est convaincu, et on s'intéresse à des livres qui plongent un peu plus profond dans la réflexion, et on passe les 30 années suivantes à en offrir ou à en écrire. Ceci dit, j'ai le sentiment que ce livre doit être le premier du genre, et c'est agréable d'avoir l'impression de remonter à l'origine comme ça. Ce livre contient tout ce que je vous ai résumé, mais aussi d'autres idées intéressantes. Il répond à une critique qu'on entend moins aujourd'hui, ou alors plutôt dans les cercles philosophiques. L'idée que les animaux n'ont pas d'âme, ou au minimum pas de but moraux. Selon lui, c'est faux. Mais quand bien même ce serait vrai, alors ça ne justifierait rien du tout. Si la vie des animaux est tout ce qu'ils ont sur cette terre, alors les faire souffrir n'est acceptable d'aucune façon, puisqu'ils ne sont pas concernés par le paradis et les récompenses divines promises par la chrétienté pour ceux qui souffrent dans cette vie matérielle. N'ayant pas d'âme, ils ne gagnent rien à souffrir. Il critique donc la religion, et l'institution religieuse qui a participé à créer un fossé irréconciliable entre l'humain et les animaux, un fossé qui est idéologique et non biologique. D'ailleurs, il utilise l'expression lower animals les animaux plus bas, pour exprimer que les humains sont les animaux. Ça sonne un peu étrange à l'oreille, 130 ans plus tard, mais l'intention est là. Il s'agit de remettre les humains et les animaux sur le même continuum. Il parle aussi des travaux récents qui prouvent, enfin, maintenant, que les animaux sont intelligents. Ça aussi, c'est dans chaque livre que j'ai lu. C'est un éternel recommencement, comme si on venait toujours de prouver la semaine dernière l'intelligence animale. La vérité, c'est que c'est impossible de prouver à une personne décidée à torturer que tu mérites de la considération. La considération morale nécessite de la bonne foi de la personne en position de force. Et c'est la chose la plus dure à obtenir. Enfin, en terme historique, c'est intéressant. Il y a 130 ans, certaines personnes avaient assez de preuves pour croire en l'intelligence animale. On n'a jamais manqué de preuves. On manque toujours de bonne foi. Et c'est compliqué d'envisager les droits d'un animal que t'as prévu de manger. L'auteur nous parle depuis une autre époque, une époque où l'élevage intensif n'existait pas, et ne détruisait pas non plus la planète en extirpant toutes les ressources. C'est intéressant parce que ça le conduit à formuler des pensées qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Une pensée antispéciste dont les humains ne sont pas les victimes par récocher, et qui est donc particulièrement altruiste. A ce stade de développement du capitalisme, l'auteur ne peut pas dire aux humains Vous voyez, exploiter les animaux nous fait du mal aussi, ça détruit notre monde Non, parce qu'il ne sait pas encore ce que le capitalisme va devenir. Il s'en méfie, il voit bien le problème de l'exploitation humaine. Mais c'était impossible pour lui d'imaginer les proportions que ça allait prendre. Il est donc obligé de se concentrer exclusivement sur ce que l'exploitation animale fait de mal aux animaux. Et contrairement à ce que les défenseurs du spécisme aiment nous faire croire, c'était pas beaucoup mieux avant. L'exploitation des animaux d'élevage a toujours été cruelle et régentée par les intérêts économiques. Dès le début de l'élevage, la question s'est posée. Comment obtenir plus de ressources de chaque animal en lui donnant moins de ressources Moins de temps, moins de place, moins de nourriture, moins de soins. C'est pas la même échelle. Mais... Dans les fermes traditionnelles, les animaux étaient déjà mal nourris, mal soignés, gardés dans les enclos les plus petits possibles. C'est pas juste une supposition de ma part, des auteurs dénoncent déjà ça. Sans technique moderne, l'exploitation animale avait ses propres limites. Évidemment, il n'y avait pas de ferme à métal au XIXe siècle. Mais la cruauté et la négligence n'ont pas besoin de modernité. La négligence est une conséquence obligatoire d'une obligation de rendement qui est liée depuis toujours à l'élevage, et la cruauté est une conséquence possible et fréquente d'une absence de droit et du statut de propriété. L'auteur constate que le cercle de la considération a tendance à s'élargir toujours de la même façon. Les personnes éprouvent de l'empathie en premier pour leur famille, puis pour leur classe, puis pour leur nation, puis pour leur, je cite, coalition de nations qu'on pourrait rapprocher de la manière moderne qu'on a découpé le monde entre Orient et Occident ou entre pays du Nord et pays du Sud, puis pour l'humanité entière, et enfin pour lui, pour l'animalité dans son ensemble. Il faut remarquer que tous les gens qui ont de l'empathie au-delà du cercle de la famille estiment qu'ils sont à cause de ça des meilleures personnes que ceux dont le cercle de considération est moins élevé. Ça devrait suffire à tous de nous faire désirer d'augmenter au maximum notre cercle, c'est-à-dire, pour Henri Assault, jusqu'à l'animalité. J'ai rien à redire à cette argumentation, je la trouve très raisonnable, par contre ça fait instantanément questionner sur la prochaine étape. Est-ce que l'animalité est la dernière étape de l'empathie Il y a des arguments pour et des arguments contre. Dans les arguments pour, la sentience. Je vous disais au tout début, la plupart des auteurs parlent de la sentience comme caractéristique significative qui ouvre le droit à la considération morale. Le raisonnement est le suivant. La sentience étant la capacité à avoir des sensations subjectives, c'est-à-dire qui sont à nous, positives ou négatives, c'est la condition pour être une personne à qui ce qu'il arrive importe. En effet, si on ne peut pas ressentir quoi que ce soit, ni positif ni négatif, alors on ne peut littéralement pas nous faire du mal, même en nous détruisant. En fait, il n'y a pas de jeu, d'individu à qui le mal peut être fait. Avec ce raisonnement, on peut détruire entièrement et sans raison un arbre et ne rien faire de mal. L'arbre n'a pas de jeu à qui on peut faire du mal, il ne pense pas, il ne ressent pas, il ne veut pas. L'exemple de l'arbre est choisi avec soin. En effet, les arbres font partie des choses non sentientes envers qui nous avons une intuition de sentience. La plupart des gens n'aiment pas couper les arbres sans raison. Je suis tombée sur une vidéo qui montrait le processus de fabrication des planches de bois, et sur l'une de ces vidéos, on voit un arbre être accorché par une machine mécanique. J'ai montré cette vidéo à tous mes amis véganes en leur disant que c'était la preuve de la sentience des arbres. Ils l'ont tous regardé et m'ont dit que cette vidéo ne prouve pas que les arbres sont sentiers. Non, cette vidéo ne le prouve pas. Mais le malaise que nous avons tous eu, lui, prouve que nous ne sommes pas entièrement convaincus non plus que les arbres ne ressentent rien. Mais parlons deux secondes de science, la sentience, c'est pas un fluide métaphysique qui flotte dans l'air, c'est une fonction biologique qui est rendue possible par un ensemble de neurotransmetteurs, et qui trouve son utilité évolutive dans la capacité de l'individu à agir en fonction des informations qu'il reçoit. Pour lire simplement, si ça ne peut pas bouger, ce n'est pas sentient. Parce qu'une fonction qui nous ferait ressentir la douleur sans pouvoir l'éviter aurait disparu rapidement au cours de l'évolution. Du coup, les arbres ne sont pas sentients. Et à ce stade, c'est une certitude. Pourtant, l'intuition que nous avons, c'est qu'il ne faut pas leur faire du mal, entre gosses guillemets. Je ne sais pas honnêtement ce que ça signifie comme intuition, mais ce n'est pas que moi, ce n'est pas que vous, c'est une intuition très largement partagée par la plupart des êtres humains. On peut argumenter que c'est un faux positif dû à notre évolution comme animaux sociaux, mais honnêtement, la phrase il ne souffre pas, il a juste l'air de souffrir vous avez vraiment l'impression que c'est historiquement une phrase de bon camarade Voilà mon argumentation. Elle mène à rien, elle n'est pas rationnelle, et autant je revendique le droit de faire tenir mon éthique sur autre chose que la rationalité, autant qu'elle ne mène à aucune conclusion pour le moment, c'est clairement un problème qu'il faut résoudre. Parce que je ne suis vraiment pas disposée à devenir frugivorethique à cause d'une simple intuition. Mais pour être... plus modérée, partir du principe que le monde végétal, voire minéral, a aussi droit à une forme de considération, a des implications concrètes en termes d'écologie et de développement de l'industrie. De fait, certaines personnes argumentent en faveur d'une empathie pour tout le vivant, et la première conclusion concrète à laquelle ça mène, en plus d'être végane évidemment, c'est de devenir fortement anticapitaliste. Il y a un passage intéressant sur le fait que le droit, c'est le garde-fou au sentimentalisme. Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par sentimentalisme, enfin plutôt je ne sais pas quel sens ça prenait exactement à l'époque. Mais je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est une sensibilité et une empathie à géométrie variables qui accordent beaucoup à certains et peu à d'autres sans raison valable. Il donne l'exemple des animaux domestiques, aimés et parfois couvés jusqu'à l'étouffement si les maîtres n'ont pas de bonne notion des besoins réels de leurs animaux. Mais qui ne redeviennent rien du tout dès que leur maître disparaît ou dès que le maître s'en est lassé. Il a cette formule. C'est un crime capital que d'être une bête qui n'appartient à personne. Par capital, il veut dire que c'est un crime puni la peine de mort. Cette formule parle aussi des animaux sauvages, très peu protégés à l'époque comme aujourd'hui, et montre les limites du statut de propriété des animaux. Il réfléchit à la stratégie militante. Les mêmes questions se posent depuis longtemps. Réforme ou révolution Il argumente en faveur de la réforme pour toutes les raisons habituelles. Plus facile à mettre en place, l'opinion publique change lentement, et c'est bien normal, émotionnellement, de vouloir mettre fin aux pratiques les plus cruelles en priorité. Sans compter que plus une pratique est cruelle, plus la base militante pour lutter contre sera forte. On trouve beaucoup plus de gens motivés contre le foie grêle à chasse à courre que contre l'exploitation laitière. Mais il met aussi en garde contre la rhétorique du moins pire. Il ne faut pas laisser nos adversaires politiques, c'est-à-dire ceux qui mettent en place et font vivre le spécisme. Imposer leur vision du monde en créant artificiellement une frontière entre l'exploitation cruelle et l'exploitation acceptable. La plupart des industries font ça. Même les plus cruelles trouvent toujours une industrie pire, un abattoir plus sale, une législation plus permissive, un ouvrier inhabituellement cruel à montrer du doigt. On peut toujours trouver pire, et quand on ne trouve pas, on peut l'imaginer. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe avant est acceptable. Et parfois, la réforme tombe dans cet écueil. Typiquement, la campagne œuf de l'an 214 est une campagne réformiste. Il s'agit de faire pression sur les grandes marques pour qu'ils ne vendent ou n'utilisent plus d'eau en batterie. C'est une bonne campagne, elle fonctionne un peu sur le temps long. Mais quand je vois une association abolitionniste féliciter publiquement une marque de gâteau pour utiliser des oeufs bio, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise. Parce que c'est pas notre job de dire Wow, cette cage est grande et confortable, les poules devaient être trop bien ici Enfin, il fait remarquer que pour l'opinion publique, en l'occurrence il parle de l'homme de la rue, puissent se pencher sur les droits des animaux, ils ne doivent pas être eux aussi soumis à la tyrannie d'exploitation. C'est quasi impossible de se préoccuper ou d'avoir le pouvoir d'obtenir pour d'autres des droits auxquels on n'aurait pas accès nous-mêmes. Soins, sécurité, liberté. Les humains en ont besoin comme les animaux, et disons-le tout net, c'est vraiment pas une garantie pour tous. Selon lui, les progrès en droit doivent se faire de manière harmonieuse dans toutes les directions de la société. Et il conclut en reprenant son titre que c'est en relation avec le progrès social que les droits des animaux sont le mieux compris. C'est la fin de cet épisode des classiques de l'antispécisme dans le désordre. La prochaine fois, je vais me faire plaisir avec un livre plus récent, ainsi l'animal et nous, de la sociologue Kauthar Archi.