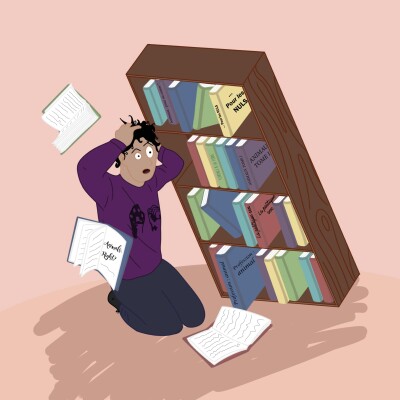Speaker #0Aujourd'hui je vais vous présenter l'ouvrage de Florence Burgard, Être le bien d'un autre. C'est un ouvrage assez court de philosophie du droit qui traite de cette question. Que signifie juridiquement pour un individu d'être approprié comme une chose par un autre individu ? Ce livre traite évidemment de la question des animaux et les évolutions de la législation à travers l'histoire, mais fait aussi une rétrospective de la législation concernant les esclaves. La rétrospective commence à partir du moment où les sources de droits sont suffisamment importantes, c'est-à-dire à partir de l'Empire romain. Je dois préciser que ce livre a été écrit après l'évolution de la loi française de 2016, qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Il est donc à jour. Cet article, le nouvel article 515-14, je vais vous le lire, il faudra bien le garder en tête par la suite parce qu'il y fait souvent référence. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Florence Burga explique que le droit tel qu'on l'utilise aujourd'hui n'a que deux catégories, les biens et les personnes. C'est d'ailleurs son premier argument en faveur de reconnaître les animaux comme personnes. Pourquoi bousculer une classification qui fonctionne juste pour maintenir les animaux à l'écart juridiquement de l'humanité ? Les animaux sont des personnes, il suffit de les classer dans la bonne catégorie. D'autres philosophes peuvent souhaiter l'ajout d'une catégorie intermédiaire, mais c'est une revendication assez rare. Ce qu'on constate avec le nouvel article 515-14, c'est que les animaux, auparavant des biens traités comme des biens, sont maintenant des êtres sensibles traités comme des biens. Pas des personnes au sens juridique du terme. En droit, les mots ont un sens strict, et les personnes ont des droits particuliers qui n'ont pas été accordés aux animaux aujourd'hui. En fait, le nouvel article 515-14 n'apporte aucun changement sur les conditions matérielles des animaux. Il apporte juste un outil légal supplémentaire qui pourrait être utilisé par les protecteurs des animaux pour plus tard. L'auteur évoque la fiction juridique et la force du comme si Effectivement, en droit, on simplifie la réalité pour pouvoir légiférer dessus. D'où le les animaux sont soumis au régime des biens Il y a là deux choses à comprendre. Les animaux ne sont pas des biens, mais on va continuer à faire comme si. Actuellement, peu d'animaux dans le monde ont pu bénéficier de la protection due aux personnes. Quelques actions en justice ont eu lieu dans d'autres pays pour des animaux enfermés dans des zoos. où parfois les associations ont pu se porter partie civile pour un animal, réclamer la fin de son enfermement arbitraire et aboutir à une obligation de libération. Mais il est plus courant que ces requêtes échouent, et il est même déjà arrivé que les requêtes aboutissent, mais ne soient suivies d'aucun effet. Déclarer légalement qu'un individu animal est une personne sensible n'est pas forcément contraignant juridiquement, mais la stratégie des associations est bien de créer de plus en plus de précédents jusqu'à devenir la norme. C'est dans le cadre de cette stratégie que s'inscrit la mobilisation pour faire ajouter ces simples mots l'animal est un être sensible dans le code civil. Qu'est-ce qu'un bien ? Qu'est-ce qu'une personne ? Un bien, c'est une chose qui peut être possédée. Elle utilise le mot mancipable sur lequel on peut mettre la main pour la prendre. Je dis peut parce qu'une chose n'a pas besoin d'être effectivement possédée pour être une chose. Elle donne l'exemple des animaux sauvages qui n'appartiennent à personne, mais qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Ils sont appropriables par n'importe qui, à quelques rares exceptions. Le mot mancipable a d'ailleurs donné le mot émanciper qu'on voit beaucoup plus souvent. Il s'agissait donc légalement de sortir un esclave de son statut de chose appropriable pour lui donner le statut de personne qui s'appartient par elle-même. Actuellement, nous n'avons pas la possibilité juridique d'émanciper les animaux. ils ne peuvent donc en aucun cas s'appartenir eux-mêmes. Depuis l'Empire Romain, on constate une incroyable similarité dans la législation qui réjante le statut des esclaves et celui des animaux. Pendant longtemps, il n'y avait pas de distinction. La loi précisait que les esclaves et les animaux étaient des biens et devaient être considérés comme tels, et au début de l'Empire Romain, ni l'un ni l'autre ne bénéficiaient d'aucune protection. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est bien parce que ça n'a rien d'évident que la loi doit le préciser. Exactement comme les lois qui servent à contrôler le corps des femmes qui existent justement parce que les femmes n'obéissent pas d'elles-mêmes et qu'il faut la force d'un appareil juridique pour les contraindre. De la même manière, personne ne se donne la peine de préciser que les objets sont des choses, puisque ce sont effectivement des choses et que personne ne le contredira. Une atteinte à l'animal ou à un esclave de la part d'une personne qui n'est pas son propriétaire donnait droit à un dédommagement financier pour le maître, mais d'aucune façon il était considéré comme un meurtre ou une agression. Par la suite, on constate, en parallèle, donc dans des lois séparées, que les statuts suivent le même chemin. Des lois régulent en premier lieu la cruauté visible. Il devient interdit de commettre en public des actes qui peuvent choquer les personnes sensibles. C'est la première étape. Elle n'arrive pas d'elle-même, mais parce qu'un certain nombre de gens ont commencé à se révolter du traitement des esclaves et des animaux. Les esclaves en particulier non seulement peuvent parler pour eux-mêmes, mais ayant la possibilité d'être affranchis et d'évoluer dans le même monde social que les possédants, ils ont un pouvoir d'action sur la politique et le droit que les animaux n'auront jamais. Néanmoins, on constate que la loi évolue à peu près de la même façon. De plus en plus de lois protectrices s'ajoutent, des lois contre la cruauté, des lois contre les mauvais traitements, et enfin pour les esclaves romains, une loi contre l'homicide volontaire, même de la part d'un maître. Il faut noter que ces lois, qu'on peut clairement qualifier de welfaristes, j'expliquerai après, ne remettent pas en cause l'esclavage. L'esclavage a aussi été aboli par voie légale, mais non pas grâce à une accumulation de lois protectrices, mais par une loi plus forte, qui change totalement le statut des anciens esclaves. En fait, ces lois protectrices doivent plus être vues comme un symptôme d'un changement qui est possible, mais pas inévitable. Aucun changement social n'est inévitable, mais possible, comme son amorçage. La comparaison s'arrête là. Je ne vous apprendrai pas qu'en France, l'esclavage est aboli, et que les animaux sont encore traités comme des choses. Il y a quand même un fait intéressant, c'est que le Code Noir, le texte qui régissait le traitement des esclaves sous Napoléon, c'est tellement inspiré du droit romain qu'on dirait une copie exacte à peine traduite. Tout comme le code noir a aussi connu des évolutions, on retrouve la même évolution welfariste qu'on a pu voir dans le code romain, et une abolition qui s'est passée de la même façon, au moins sur le plan juridique. A ce stade, je dois expliquer le mot welfariste, qui vient du mot bien-être en anglais, qui est souvent opposé avec le mot abolitionniste. C'est très... Il s'agit de savoir si nous souhaitons un arrêt d'exploitation et son inégalité, ou une amélioration des conditions de vie. La question à laquelle il faut répondre c'est, existe-t-il un cadre où posséder quelqu'un est acceptable ? Pour moi la réponse est non. Mais il existe beaucoup de gens engagés dans la protection animale, comme Elisabeth de Fontenay, qui pensent que si. Donc il ne s'agit que de protéger correctement les animaux qu'on exploite. Je dois préciser que cette distinction fonctionne de deux façons, ce qu'on voudrait dans un monde idéal et ce pour quoi on milite. On peut estimer que dans un monde idéal, l'exploitation des animaux serait abolie. Mais qu'en l'état actuel des choses, nous ne pouvons obtenir que des améliorations de leur traitement. C'est un débat permanent au sein des mouvements antispécistes, et nous n'avons globalement aucune réponse ferme à y apporter puisqu'une libération animale n'a jamais été organisée avant. Enfin, de manière annexe, l'auteur s'interroge sur la question du devoir légaux des animaux, sans doute pour répondre à cette objection philosophique selon laquelle le droit est un contrat social et que sa protection ne s'applique qu'à ceux qui peuvent le respecter aussi. Elle veut nuancer l'idée courante que les animaux sont seulement des personnes à protéger. L'auteur pense que les animaux sont aussi des sujets de droit, et elle fait appel pour ça au concept de droit naturel, rendu célèbre par Rousseau. Le droit naturel Droit dans le ensemble de règles, c'est l'idée que les êtres humains vivant en société ont mis en place des règles pour éviter les conflits. Des résolutions similaires pour des conflits similaires et qui sont acceptées par ceux à qui elles s'appliquent justement parce que comme étant similaires d'une fois sur l'autre, elles sont considérées comme justes, qu'on peut s'y attendre et prévoir les conséquences de nos actions. Avec ce concept du droit naturel, ces règles n'ont pas besoin d'être écrites ou même formalisées. Et c'est de cette façon-là qu'on peut y inclure les animaux. Les animaux sociaux ont forcément des règles pour vivre en société, des règles qui ressemblent aux nôtres. En ce sens qu'elle résolve les conflits futurs de la même manière qu'ont été résolus les conflits passés. L'auteur propose deux règles universelles chez tous les animaux sociaux qui sont le droit à l'autopréservation et la pitié. L'autopréservation s'explique d'elle-même, c'est le fait de chercher à faire ce qu'il faut pour survivre et se protéger. Dans la mesure où tous les animaux, humains ou non, font ça sans avoir de justification à y apporter, on peut la considérer comme un droit. Quant à la pitié, c'est le sentiment de répulsion qui nous pousse à ne pas laisser quelqu'un souffrir sur notre vue. J'ai tendance à considérer les animaux comme des patients sur le plan légal et moral, c'est-à-dire que je ne leur trouve pas de devoir particulier vis-à-vis d'autrui. Mais force est de constater qu'ils ont des comportements moraux, avec les animaux de leurs espèces ou avec d'autres espèces. Donc l'argumentation de Florence Burka et de Rousseau d'une certaine façon m'a convaincue. A quelques exceptions près, j'ai tendance à penser que la plupart des humains impliquent spontanément ces deux règles, et que le comportement et les pensées discriminatoires, spécistes ou autres, nécessitent un apprentissage et un encouragement par la société, alors que la répulsion envers la souffrance d'autrui est innée. A ce sujet, si vous avez 5 minutes, je vous conseille l'article La première des discriminations de Lorraine Plume, il est disponible sur internet. On comprend que pour l'auteur, l'impulsion spontanée de la plupart des gens est de ne pas laisser souffrir ni un humain ni un animal, tant que ça ne vient pas en contradiction avec la première règle. Autant dire qu'avec ces deux règles simples, on résoudrait la plupart des problèmes sociaux du monde d'un clin d'œil humain comme animaux.