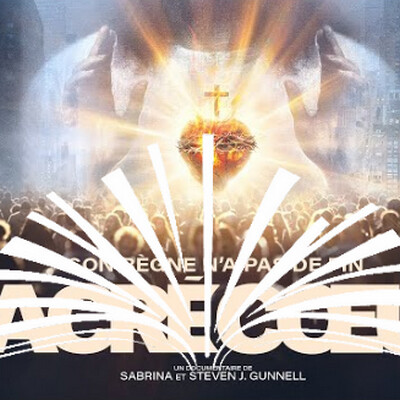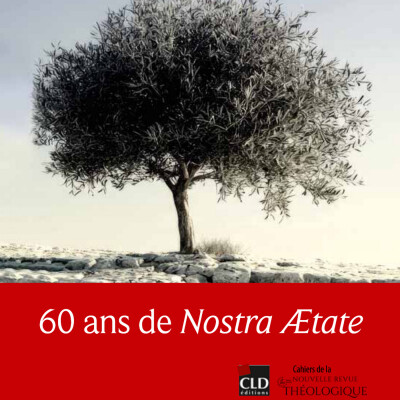- Speaker #0
Bienvenue dans les dialogues théologiques de la NRT, le podcast où la théologie s'écoute autant qu'elle se lit. Alors je vous souhaite une bonne lecture, ou plutôt bonne écoute.
- Speaker #1
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes.
- Speaker #2
C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, mais elle voit des anges...
- Speaker #3
Nous assistons actuellement à un phénomène assez remarquable, le succès populaire presque inattendu du film documentaire Sacré-Cœur. Alors ce succès, évidemment, il ravive l'intérêt pour une dévotion ancienne, mais il soulève aussi, je crois, des interrogations légitimes sur sa véritable portée théologique.
- Speaker #4
C'est une bonne chose, je pense. Au-delà de l'émotion, de l'attrait populaire, qui sont réels, il est essentiel de se demander ce que signifie théologiquement cette focalisation sur le cœur du Christ. Est-ce que c'est une simple expression de piété parmi d'autres ou est-ce qu'on touche là au cœur même de la foi ? C'est précisément ce que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui.
- Speaker #3
Et pour cela, on va s'appuyer sur différentes sources. notamment des réflexions qui viennent des archives de la nouvelle revue théologique, la NRT, qui a souvent abordé ce thème, mais aussi, et c'est important, sur la dernière grande encyclique du pape François, d'Ilexitnos, Il nous a aimés, qui propose une synthèse théologique assez renouvelée.
- Speaker #4
Alors j'ai une confidence à vous faire, je n'ai pas encore vu le film documentaire Sacré-Cœur, et je vous promets, j'irai le voir, ne serait-ce que pour respecter l'engouement de tant de personnes qui ont été touchées par ce film. Et puis une autre confidence, avant toute chose, j'ai été touché par ce que m'a dit une amie il n'y a pas très longtemps. « Mais Père Alban, toi tu ne m'as jamais parlé du Sacré-Cœur. » J'avoue que ça m'a un petit peu surpris parce que je suis jésuite ! et c'est vrai que le mot Sacré-Cœur n'est pas sur mes lèvres à chaque prédication. Mais je crois que le message du Sacré-Cœur fait partie de l'ADN des jésuites dès lors qu'ils parlent de reconstruction du monde, de réparation non pas avec ce mot, mais par la miséricorde, par l'accompagnement des personnes là où elles sont. Je crois qu'il ne faut pas trop vite dire que les jésuites ont abandonné le Sacré-Cœur. Et la question qui va structurer notre discussion aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment appréhender théologiquement le Sacré-Cœur ? Est-il une sorte de condensé de la révélation de l'amour divin ? Ou bien, comme certains le craignent, est-ce qu'il s'agit simplement de le comprendre comme une forme de dévotion particulière, avec bien sûr une richesse propre, mais aussi des limites intrinsèques ? C'est une interrogation... qui à mon avis est fondamentale pour situer correctement ce symbole dans le vaste paysage de la spiritualité chrétienne.
- Speaker #5
Une prière de John Henry Newman au Sacré-Cœur, tirée de ses méditations sur la doctrine chrétienne, citée dans l'encyclique Dilexit Nos du pape François. Ô très sacré, très aimant, cœur de Jésus, Tu es caché dans la Sainte Eucharistie et tu bats toujours pour nous. Je t'adore donc avec amour et crainte, avec une affection fervente et une volonté soumise et résolue. Ô mon Dieu, quand tu condescends à me permettre de te recevoir, de te manger et de te boire, et à faire de moi pour un moment ta demeure, oh, fais battre mon cœur à l'unisson du tien. Purifie-le de tout ce qui est terrestre, fier et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel. de toute atonie, de tout désordre, de toute perversité. Remplis-le de ta présence, afin que ni les événements de la journée, ni les circonstances du temps présent, n'aient le pouvoir de le troubler, mais que, dans ton amour et dans ta crainte, il puisse trouver la paix !
- Speaker #3
Bien, les perspectives sont posées. Je voudrais d'abord insister sur une distinction qui me paraît cruciale. que j'emprunte au théologien Louis Bouyer, appliqué ici au Sacré-Cœur. Il faut vraiment différencier une théologie sur le Sacré-Cœur, qui serait une réflexion extérieure, peut-être spéculative ou purement historique, d'une théologie du Sacré-Cœur, qui, elle, plonge ses racines dans la révélation elle-même. Et cette théologie du cœur, je la vois s'enraciner d'abord dans l'Écriture, l'épisode du côté transpercé du Christ en croix, rapporté par Jean au chapitre 19, c'est fondamental. Pleura, le côté qui laisse voir l'intérieur comme le noté Bouyer. Mais on peut penser aussi à l'invitation de Jésus lui-même en Matthieu 11, 29. "Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur." Et puis la tradition des pères de l'Église a beaucoup médité sur ce côté ouvert, y voyant la naissance de l'Église comme une nouvelle Ève née du nouvel Adam endormi sur la croix. Et le passage plus tardif, c'est vrai, du côté au cœur qui a été favorisé par le développement de la dévotion, ce n'est pas, à mon sens, une déviation. C'est plutôt un progrès indéniable. Pourquoi ? Parce que le symbole du cœur, il exprime de manière plus directe, je crois, plus personnelle, l'amour rédempteur du Christ. Cet amour, ce n'est pas une idée abstraite, c'est la source vive, actuelle de la vie de l'Église. Un amour qui, pour nous atteindre, a choisi de passer par le don total, par l'immolation. Et ce cœur devient alors le lieu par excellence de la rencontre personnelle avec Dieu. C'est ce que Newman résumait par sa devise « Cor ad cor loquitur » « Le cœur parle au cœur » , une formule d'ailleurs que François reprend dans « Dilexit nos » . C'est dans ce cœur en fait que s'unissent les gestes et les paroles du Christ, faisant de lui, comme le dit l'encyclique, une synthèse de l'évangile. Le point de jonction où l'amour divin assume et guérit l'amour humain. Et Dilexit nos, justement, appelle à une théologie "cordiale", une théologie qui intègre notre affectivité, notre corps, et qui refuse une foi désincarnée.
- Speaker #5
Un extrait de Dilexit nos du pape François. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons s'arrêter pour parler avec la Samaritaine au puits. où elle va prendre de l'eau. Nous le voyons, au milieu de la nuit, rencontrer Nicodème qui a peur d'être vu avec lui. Nous l'admirons se laisser laver les pieds, sans honte, par une prostituée. Dire à la femme adultère les yeux dans les yeux. Je ne te condamne pas. Affronter l'indifférence de ses disciples lorsqu'il dit à l'aveugle sur la route avec tendresse. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Le Christ montre que Dieu est proximité, compassion, et tendresse.
- Speaker #4
Je reconnais sans aucune peine l'importance capitale du terme cœur dans toute la Bible. "Lev" en hébreu, voir Deutéronome 6,5 : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ou "cardia" en grec, comme on le trouve si souvent dans l'évangile de Jean. Des auteurs de la revue comme Vladimir Zielensky en 1997, qui explore la tradition orientale, ou même Soeur Marie-David Weill, cette année 2025, analysant les sources bibliques et patristiques, ces auteurs montrent très bien que le cœur, c'est le centre vital de l'être humain. C'est le lieu de l'intelligence profonde, de la volonté, de la mémoire, de la relation intime. avec Dieu. Ma réserve, elle porte plutôt sur l'identification peut-être un peu rapide entre ce symbole biblique universel et la dévotion spécifique au Sacré-Cœur. C'est en effet quand même un phénomène historiquement plus tardif et géographiquement plus localisé, principalement en Occident. J'y vois alors un risque de focalisation excessive. La formule du cœur s'est ajoutée à celle du côté, qui est plus ancienne à propos de la crucifixion, et plus directement scripturaire. "Dilexit nos" elle-même reconnaît que cette dévotion a pu historiquement servir de succédané, de supplément d'âme, si on veut, face à une théologie devenue parfois trop abstraite, trop desséchée. Non, en réalité, bon, c'est légitime historiquement, mais il y a un risque quand même. Le risque que je vois, c'est justement de basculer dans une théologie "sur" le cœur, pour reprendre votre distinction issue de Louis Bouyer, qui deviendrait soit une spéculation un peu détachée de la vie, soit une forme de sentimentalisme religieux. un peu coupé de l'expérience fondamentale de la foi comme rencontre vivante et transformation de tout l'être.
- Speaker #3
Mais n'est-ce pas précisément ce que la théologie cordiale que j'évoquais tout à l'heure cherche à éviter ? Intégrer justement l'affectivité sans tomber dans le sentimentalisme ?
- Speaker #4
Oui, c'est l'intention, sans doute. Mais je pense qu'il faut aussi écouter ce que disent d'autres traditions. La spiritualité orientale, par exemple, telle que l'expose Zielensky offre une perspective complémentaire, peut-être même plus fondamentale encore. Pour elle, le cœur, c'est d'abord le lieu de la metanoïa, vous savez, ce repentir profond, ce retournement intérieur. Et puis le cœur, c'est le lieu de la prière incessante, la fameuse prière de Jésus qu'on appelle à juste titre "la prière du cœur", qui consiste à invoquer sans cesse le nom divin.
- Speaker #5
Un extrait de la Philocalie : La prière faite avec attention et sobriété, sans aucune autre pensée ou imagination, avec les paroles « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu », livre notre esprit à notre Seigneur Jésus-Christ et par les paroles « Aie pitié de moi » , elle le rend à lui-même car il ne peut prier qu'à partir de lui. Mais quand il arrive à l'amour parfait, alors, ayant reçu son salut, Il se donne entièrement au Seigneur seul.
- Speaker #4
Dans cette perspective orientale, le cœur est vu comme la demeure de l'Esprit-Saint et comme l'arène du combat spirituel contre les passions, les mouvements désordonnés de l'âme. Et pour ma part, j'estime que c'est une approche que je qualifierais de plus ontologique, c'est-à-dire centrée sur l'être profond, sa transformation par la grâce, ce que la dévotion au Sacré-Cœur occidental ne donne pas forcément de manière immédiate. Elle est moins dépendante, me semble-t-il, d'une image visuelle du cœur ou d'une affectivité particulière. qui est celle de la réparation. Alors je me demande si une assistance trop exclusive sur la dévotion au Sacré-Cœur ne risque pas de faire oublier que la révélation est fondamentalement un dialogue. Dieu, comme le dit si bien le Concile Vatican II dans Dei Verbum, s'adresse aux hommes comme à des amis. Et le lieu premier de cette rencontre, c'est le cœur. qui écoute la parole dans le silence. C'est ce que souligne toute la tradition monastique, occidentale mais orientale aussi, ce qu'on appelle l'ésikhaste, qu'a exploré Zielensky dans ce bel article de la NRT. Ce n'est donc pas forcément d'abord un cœur physique, fut-il symbolique, quand on contemple de l'extérieur. Et puis, je me pose la question. Est-ce que cette dévotion au Sacré-Cœur intègre toujours suffisamment la dimension trinitaire ? Est-ce que la dévotion au Sacré-Cœur respecte aussi la dimension apophatique de la spiritualité, c'est-à-dire le respect du mystère insondable de Dieu, au-delà de toute image qui est symbolisée par le nom divin ? Alors, "je suis celui qui suis". Où est le... cœur dans cette affirmation ? Voilà, ce sont quelques questions qui me viennent. Vous avez compris, je me fais l'avocat du diable. Mais je crois que ce sont des questions importantes.
- Speaker #3
Effectivement. Reprenons peut-être le premier point de tension. Symbolisme spécifique versus richesse du symbole universel du cœur. Je persiste à penser que le passage du côté au cœur n'est pas une réduction, mais un... approfondissement symbolique nécessaire. Le symbole du cœur, justement, parce qu'il est si humainement parlant, il exprime mieux l'amour personnel, actuel du Christ rédempteur. Ce n'est pas une abstraction. Le cœur blessé est un symbole réel. Ce n'est pas une simple métaphore. Il rend tangible, presque visible, cet amour infini qui a choisi l'incarnation et la mort pour nous rejoindre. C'est la logique même de la révélation chrétienne qui passe par des signes concrets, sacramentels. Le cœur de chair de Jésus, transpercé et glorieux, C'est le signe par excellence de cet amour divin fait homme.
- Speaker #4
Un symbole, un signe, oui, c'est tout à fait vrai. C'est concret. Cependant, le fait qu'il se soit développé historiquement dans l'Occident risque, à mon avis, d'éclipser une richesse sémantique beaucoup plus vaste, celle du cœur biblique et qui a été reprise dans la patristique. Si on parle de symbole réel, Le cœur biblique, c'est aussi, comme on a dit, le lieu de la Memoria Dei, le souvenir de Dieu, de la conscience, de l'intelligence spirituelle, le lieu du combat intérieur, le lieu de l'invocation du nom. Ainsi, n'y a-t-il pas un risque que la focalisation sur l'image du cœur physique, même compris symboliquement, je le comprends, devienne une forme de piété, mais parmi d'autres, qu'elle soit potentiellement déconnectée de la transformation intérieure radicale, la metanoïa, qui est au centre de l'évangile et de la tradition que j'évoquais, notamment orientale ? Le symbole est essentiel, bien sûr, mais il ne doit pas voiler la réalité ontologique qu'il signifie, c'est-à-dire, dans le cadre du cœur, la rencontre transformante avec Dieu au plus intime de soi.
- Speaker #3
Mais c'est précisément là, me semble-t-il, qu'intervient la pertinence de la distinction entre théologie du cœur et théologie sur le cœur. Une authentique théologie du cœur n'est ni une spéculation extérieure, ni une sentimentalité superficielle. Elle est intrinsèquement cordiale, justement. Elle naît de cette rencontre cœur à cœur dont parlait Newman. Le pape François cite Bonaventure à ce sujet. « Savoir que le Christ est mort pour nous, ça ne doit pas rester une simple connaissance intellectuelle, mais devenir sentiment, amour. » Vu comme ça, cette théologie n'est pas une dévotion particulière, mais c'est bien une synthèse de l'Évangile qui unifie doctrine et vie, contemplation. et engagement.
- Speaker #4
Le racinement dans la révélation est absolument crucial. Vous avez raison, je crois qu'on peut avancer en contemplant la scène de la crucifixion.
- Speaker #5
Un texte du père Yves Raguin, cité par Marie-David Weill dans son article sur la théologie du Sacré-Cœur : Les hommes cherchaient à connaître Dieu par tous les moyens possibles est imaginable, mais la plupart de ses efforts ont tourné court. Pour connaître Dieu en profondeur, il fallait pouvoir le transpercer. Ce n'était possible que si Dieu lui-même s'offrait à nous, pour qu'il fût par nous transpercé. Or, c'est ce qu'il fait en s'incarnant. Le cri « Nous avons tué Dieu » est une illusion. Nous n'avons pas tué Dieu, nous l'avons transpercé. Jusqu'au fond, en face de nous, Dieu n'offre plus de résistance, car il est amour. En le transperçant, nous avons percé son mystère, et nous avons compris qu'il était l'amour. Le Christ aurait pu faire encore beaucoup plus de miracles, cela n'aurait pas convaincu finalement les hommes de l'infini de l'amour divin. Seul le cœur ouvert pouvait nous éveiller à la notion d'un amour divin si total.
- Speaker #4
Justement, n'est-ce pas ce cœur ouvert sur la croix qui constitue le sommet de la Révélation, le point où tout converge ? Je pense à l'affirmation assez audacieuse de Thomas d'Aquin, reprise dans le Catéchisme de l'Église catholique, selon laquelle le cœur transpercé du Christ est la clé d'interprétation de toute l'Écriture. que se révèle l'amour trinitaire. Louis Bouyer disait que c'est "voir l'intérieur de Dieu". Marie-David Weill, dans son article dans la NRT, va même jusqu'à parler du cœur du Christ comme du "nexus mysteriorum", le nœud où se rejoignent tous les grands mystères, la Trinité, l'incarnation, la Pâque, la naissance de l'Église. C'est de ce cœur ouvert que jaillit l'Église. Alors, oui, reconnaissons-le, le cœur transpercé est un moment absolument clé. Nous sommes d'accord. Et il faut le considérer, ce cœur, à la fois transpercé et glorieux. On pense à Thomas, invité à toucher les plaies du ressuscité. N'est-il pas précisément ce qui rend l'amour divin universellement accessible, concret ? On évoquait tout à l'heure la tension entre universalité et spiritualité particulière culturelle. Le cœur du Christ, je crois qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, est un symbole de cet amour divin qui s'incarne, qui prend notre cœur, qui partage notre condition jusqu'à la mort par amour. Est-ce que ça ne parle pas un langage universel ? Ce langage de l'amour, c'est en tout cas ce que dit le pape François dans Dilexit Nos. Loin d'être un particularisme occidental, le réalisme du Sacré-Cœur, c'est justement ce qui ancre l'amour divin dans notre humanité commune, partagé par tous, au-delà de toutes les cultures particulières.
- Speaker #3
Pour moi, il reste un symbole central. Contempler ce cœur, je crois, c'est être constamment ramené à l'essentiel et appelé à une réponse d'amour qui engage toute notre existence, personnellement et en Église.
- Speaker #4
Notre conversation a effectivement mis en lumière la pluralité des approches, la richesse des significations associées au mot cœur dans la tradition chrétienne, et spécialement à propos du symbole de l'amour du Christ manifesté au sommet sur la croix. La longue tradition théologique et spirituelle de l'Église, elle ne peut qu'affiner notre intelligence du mystère insondable. de l'amour divin révélé dans le cœur du Christ et à cet égard la spiritualité du cœur de Jésus nous y aide. Qu'elle soit abordée sous l'angle de la dévotion occidentale, de la prière orientale, la contemplation du cœur de Jésus demeure une invitation permanente à approfondir notre relation vivante avec lui, à laisser son amour façonner et transformer nos propres cœurs. Les textes, les traditions que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui offrent une matière abondante pour poursuivre la réflexion et le dialogue. Merci à vous qui nous avez suivis, à bientôt.
- Speaker #0
Pour continuer à suivre la réflexion, pourquoi ne pas vous abonner à la NRT ? En ce moment, jusqu'au 31 décembre 2025... Abonnement découverte à 40% de réduction sur le prix normal sur les formules numériques et bimédias. Avec le code 2026-40. Soit 33 euros l'abonnement numérique au lieu de 55 euros. Bonne lecture !