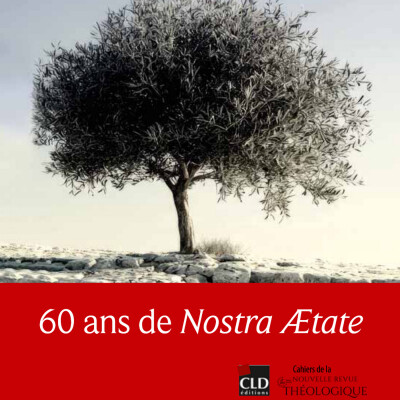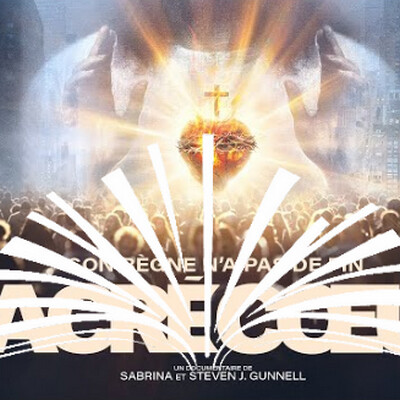- Speaker #0
Bienvenue dans les dialogues théologiques de la NRT, le podcast où la théologie s'écoute autant qu'elle se lit. Ici, pas de chair de marbre ni de bibliothèque poussiéreuse, on cause, on réfléchit, on interroge et on essaie surtout de penser la foi sans trop froncer les sourcils. Si vous avez déjà feuilleté la nouvelle revue théologique, vous savez qu'on aimait les rigueurs et ouvertures, tradition et actualité. Alors je vous souhaite une bonne lecture, ou plutôt bonne écoute.
- Speaker #1
Bienvenue à toutes et à tous, et bonjour Père Alban Massy.
- Speaker #2
Bonjour Elsa.
- Speaker #1
Bienvenue à vous. Vous êtes le directeur de la nouvelle revue théologique, et nous sommes ensemble pour aborder un sujet à la fois profond et très actuel, la relation entre l'Église catholique et le peuple juif.
- Speaker #2
Oui, l'occasion est particulière puisqu'on approche du 60e anniversaire de Nostra Aetate.
- Speaker #1
Alors Nostra Aetate, c'est un texte du Concile Vatican II, publié par Paul VI le 28 octobre 1965, et souvent qualifié de révolutionnaire.
- Speaker #2
Alors c'est un mot fort, mais je crois qu'il est juste. Ce texte, en effet, a poussé l'Église à se regarder dans son propre mystère, pour y reconnaître le peuple juif.
- Speaker #1
Et pour explorer tout cela, on va s'appuyer sur un nouveau cahier de la Nouvelle Revue Théologique, dirigé par vous, Alban Massy. Et ce cahier s'intitule « Israël et l'Église dans le dessein de Dieu » , avec un sous-titre ou une sorte d'exergue « Pour que les deux marchent ensemble » .
- Speaker #2
Oui, c'est une citation du prophète Amos. Il soupire en donnant ce proverbe « Deux hommes marchent-ils ensemble ? » Sans s'être mis d'accord, la marche d'Amos avec Dieu est fondée sur un accord préalable. Amos dit, moi je suis prophète, mais parce que Dieu m'a envoyé et moi je suis d'accord. C'est une mission reçue. Moi j'y vois l'image d'une marche commune entre Israël et l'Église. Une marche fondée sur un accord spirituel voulu par Dieu.
- Speaker #1
Alors ce cahier rassemble des contributions majeures. des textes fondateurs et aussi des analyses nouvelles. Et du coup, on a un vrai panorama de 60 ans de dialogue. Notre mission aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de déplier ces avancées, de repérer les défis qui demeurent aujourd'hui.
- Speaker #2
Exactement. Cette conversation entre juifs et chrétiens, commencée au Concile il y a 60 ans, elle est loin d'être terminée. Il faudrait qu'elle devienne une véritable marche ensemble.
- Speaker #1
Alors je glisse une petite info pratique, le cahier est en librairie le 23 octobre 2025, mais il peut d'ores et déjà être commandé sur le site www.nrt.be. Je vous propose qu'on commence par le commencement. Pourquoi la déclaration Nostra Aetate est-elle considérée comme révolutionnaire ?
- Speaker #2
Alors je dirais que ce texte... plutôt que révolutionnaire, même si j'accepte ce mot, il est en tout cas radical, au sens qu'il nous conduit à la racine. Et c'est vrai pour l'ensemble de la déclaration sur la relation de l'Église avec les religions non chrétiennes en général, mais surtout à propos du judaïsme. Il marque la naissance d'une nouvelle théologie catholique du judaïsme. L'Église sortait d'une logique d'opposition. voire de substitution. L'idée qu'elle remplaçait Israël pour reconnaître un lien spirituel indissoluble.
- Speaker #1
Et le contexte compte, puisque nous sommes en 1965, soit 20 ans après la Shoah.
- Speaker #2
Vous avez raison de le souligner. Même si le mot Shoah n'apparaît pas dans le texte du Concile, son ombre plane sur tout le débat conciliaire. Nostra Aetate 4 rejette l'accusation de déicide contre le peuple juif et condamne clairement l'antisémitisme.
- Speaker #1
Alors dans ce cahier de la NRT, Thérèse Martine Andrevon le rappelle bien. La Shoah est présente en creux dans cette relecture. Mais cela ouvre aussi un immense défi théologique, non ?
- Speaker #2
Absolument. Comment affirmer que Jésus est le Christ sans que cela sonne comme une condamnation du chemin juif ? Et inversement, comment entendre le refus juif de Jésus autrement que comme un rejet ?
- Speaker #1
Oui, Thérèse Martine Andrevon estime qu'il faut trouver un cadre où le « oui » de l'un n'écrase pas l'autre.
- Speaker #2
Et c'est exactement ce que Nostra Aetate rend possible. Le travail, lui, théologique, ne faisait que commencer.
- Speaker #1
Dans une deuxième étape de ce cahier, on s'intéresse aux documents rédigés par la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme après Vatican II, et ces documents vont aller plus loin, notamment sur la figure de Jésus.
- Speaker #2
Oui, alors je vous cite les titres de ces deux documents de 1974 et de 1985, qui sont un peu longs, mais suggestifs. « Orientation et suggestion pour l'application de la déclaration Nostra Aetate » . On sentait qu'il fallait appliquer, qu'il fallait mettre en œuvre ce que le concile avait donné comme orientation. Et puis, en 1985, les notes pour une correcte présentation des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Thérèse Martine Andrevon parle alors d'une « Christologie de la racine » . ... On ne peut pas comprendre Jésus si on le coupe de son peuple. Né de Marie, il est, selon la chair, fils d'Israël.
- Speaker #1
Et les notes de 1985 ajoutent, je cite, Jésus est juif et il est resté toujours.
- Speaker #2
C'est une phrase simple, mais elle est révolutionnaire là pour le coup. Sa judéité n'est pas un costume terrestre, elle fait partie de son être, même ressuscité. Cela combat le docétisme et redonne tout son sens au titre de messie.
- Speaker #1
D'ailleurs, le cardinal Lustiger, dans un autre texte de ce cahier, parle à ce sujet de, je cite, « personnalité corporative » .
- Speaker #2
Oui, dans la Bible, un individu peut porter en lui tout le destin d'une communauté. Ici, tout le peuple assumé par le messie. Pour le cardinal Lustiger, Jésus le juif assume l'histoire, la vocation et l'espérance d'Israël. Son destin reste lié à celui de son peuple.
- Speaker #1
Et cela conduit à relire la foi chrétienne tout entière à partir de cette racine juive. Ça oblige aussi à redonner toute sa force au titre de Messie, Christos en grec.
- Speaker #2
Oui, le Christ, ça veut dire le Messie. Ce titre, il est tellement juif dans son origine. On l'avait peut-être oublié derrière le mot « Seigneur » dans la piété chrétienne. Alors ça fait écho d'ailleurs à des recherches historiques, comme celle de Daniel Boyarin que mentionne Thérèse Andrevon. Daniel Boyarin, professeur à Tel Aviv, montre que l'idée d'un Messie à la fois humain et divin n'était pas si impensable dans certains courants juifs de l'époque de Jésus.
- Speaker #1
Alors si je comprends bien... Ça nuance l'idée d'une rupture nette et immédiate entre juifs et chrétiens.
- Speaker #2
Oh oui, la séparation a été progressive et complexe. Reconnaître que Jésus reste juif, c'est aussi reconnaître la racine juive de la foi chrétienne elle-même. Et si Jésus reste lié à Israël, ça a des conséquences énormes sur la façon de voir l'alliance de Dieu avec le peuple.
- Speaker #1
Alors justement, c'est un autre point clé. de ce cahier. Mgr Pierre Dornelas met en garde contre la vieille idée de la substitution.
- Speaker #2
Oui, cette théorie n'a jamais été une doctrine officielle, mais elle est encore souvent dans la conscience, dans la mémoire chrétienne. C'est l'idée selon laquelle la nouvelle alliance dans le Christ effacerait celle du Sinaï. Or, les textes récents du magistère rappellent que l'alliance de Dieu avec Israël n'a jamais été révoquée.
- Speaker #1
Oui, saint Paul le dit dans le 11e chapitre de l'Épître aux Romains, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance.
- Speaker #2
Tout à fait. Monseigneur d'Ornellas s'appuie sur un concept juif, le "hiddoush". La nouveauté qui ne détruit pas l'ancien, mais qui l'accomplit. Comme un arbre qui sort de la graine. La nouvelle alliance ne supprime pas la première, elle la confirme. Elle l'universalise sans la couper de ses racines. Et Mgr d'Ornellas applique cela à la nouvelle alliance promise par Jérémie 31. La nouveauté radicale, c'est que cette alliance, non pas qu'elle soit différente, mais elle est parfaite, indéfectible. Dieu l'écrit dans les cœurs, elle ne pourra plus être brisée.
- Speaker #1
Passionnant. Passons maintenant à un troisième point de ce cahier, où le jésuite Albert Chapelle, qui était d'ailleurs très proche du cardinal Lustiger, dans un article que ce cahier de la NRT reprend, Albert Chappel donc insiste sur la nécessité de nommer Israël dans la liturgie.
- Speaker #2
Oui, c'est la conséquence du point qu'on vient de voir sur le Messie et sur l'accomplissement de l'Alliance. Pour Albert Chapelle, nommer Israël dans la liturgie, ce n'est pas un rappel simplement historique, mais c'est une manière d'affirmer notre filiation spirituelle, de dire on est de la même famille en quelque sorte. La promesse faite à Abraham continue jusqu'au chrétien, fils d'Abraham, greffé sur la racine même par Jésus, le Messie d'Israël. Cette idée de lien organique peut conduire à dire qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu au fond, avec Israël comme racine et l'Église comme élargissement aux nations.
- Speaker #1
Et ça nous conduit à une figure biblique fascinante, celle du serviteur souffrant qu'on rencontre en Isaïe 53. Le cahier publie sur ce thème un texte important de Michel Remaud de
- Speaker #2
1981. C'est un texte... à mon avis, écrit par un grand artisan du dialogue entre juifs et chrétiens. La tradition chrétienne voit dans le chant du serviteur le Christ souffrant. La tradition juive, elle, voit dans le chant du serviteur le peuple d'Israël.
- Speaker #1
Oui, il est souffrant au milieu des nations.
- Speaker #2
Et Rameau suggère que les deux lectures peuvent coexister. Jésus et Israël partagent une vocation de souffrance rédemptrice.
- Speaker #1
Oui, comme ça, en même temps. C'est une idée vertigineuse.
- Speaker #2
Oui, alors surtout quand il évoque, avec Jacques Maritain, une correspondance entre la passion du Christ et les souffrances d'Israël dans l'histoire, notamment la Shoah.
- Speaker #1
Et au plan théologique, il s'appuie sur quoi ?
- Speaker #2
Eh bien, surtout sur Romains 11, vous l'avez cité tout à l'heure, où Paul... parle aussi de la mise à l'écart temporaire d'une partie d'Israël. Michel Remaud dit cela non pas comme une punition, mais comme un élément d'un mystère plus grand qui est la réconciliation du monde.
- Speaker #1
Oui, alors si je comprends bien, Israël empêche l'Église en quelque sorte de se croire arrivée.
- Speaker #2
Tout à fait, pas de triomphalisme. Le royaume n'est pas encore là en plénitude. Le refus d'Israël aujourd'hui, c'est le rappel constant du « pas encore ». Israël maintient l'Église ouverte à l'avenir de Dieu.
- Speaker #1
Oui, du coup, c'est une vision vraiment très profonde du rôle d'Israël. Peut-être pouvons-nous aborder maintenant le côté pratique de ce cahier et les conséquences pastorales. de ces développements doctrinaux.
- Speaker #2
Oui, Antoine Guggenheim insiste sur la purification de la mémoire, cette repentance pour les fautes passées, les silences, l'antisémitisme chrétien. Ça doit se traduire dans l'enseignement, la catéchèse.
- Speaker #1
On peut dire qu'il lutte contre la tentation marcioniste ?
- Speaker #2
Oui, il faut être attentif à cette vieille tentation. de séparer Jésus de ses racines juives, cette tentation de dévaloriser l'Ancien Testament, de voir le judaïsme comme dépassé, il faut apprendre à lire la Bible avec des lunettes juives, reconnaître la richesse de la tradition rabbinique, prendre le judaïsme au sérieux, comme un partenaire vivant. C'est ce que disait aussi le cardinal Lustiger, dont la voix est si particulière sur ce sujet.
- Speaker #1
Oui, Aron Jean-Marie Lustiger, plaident vraiment pour une fraternité qui respecte l'altérité.
- Speaker #2
Il refuse toute confusion, mais il invite à une rencontre vraie. La conférence de 2002 qu'il avait donnée, qui est reprise dans le cahier, est très lucide. Il souligne aussi la complexité de l'identité juive, qui n'est pas simplement religieuse, mais qui est aussi culturelle, historique. nationale.
- Speaker #1
Oui, alors de son côté, Alexis Leproux va réfléchir à la résistance d'Israël.
- Speaker #2
Oui, la non-reconnaissance de Jésus par des Juifs aurait peut-être une signification pour l'Église elle-même, en l'empêchant de se refermer sur elle-même.
- Speaker #1
Du coup, la présence juive serait comme un aiguillon un peu salutaire, en quelque sorte. C'est un peu ça ?
- Speaker #2
Oui, on voit bien le lien ici entre théologie, spiritualité, pastoral.
- Speaker #1
Mais tout ça se passe dans le monde réel, le monde réel qu'on connaît avec ses conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que le cahier aborde aussi les questions brûlantes d'aujourd'hui. Vous-même, Père Alban Massy, vous y signez un article sur Gaza et la voix de l'Église.
- Speaker #2
Oui, l'enjeu est de tenir ensemble la fidélité au peuple juif et la compassion. pour toutes les victimes. Le pape François parlait de proximité, et je le cite, intrafamiliale, non pas intrafamiliaire. Il parle d'intrafamilialité. Cette proximité, ça veut dire qu'elle n'excuse rien, mais elle oblige.
- Speaker #1
Oui, donc si je comprends bien, le lien spécial entre l'Église et Israël, ne peut jamais être une excuse pour l'injustice.
- Speaker #2
Vous comprenez bien. Principalement, il y a d'un côté la fidélité à ce lien unique avec le peuple juif, le frère aîné. Et puis de l'autre, il y a l'appel de l'évangile à la compassion pour toutes les victimes, à la dénonciation de l'injustice, d'où qu'elle vienne.
- Speaker #1
Vous rappelez d'ailleurs aussi l'impératif moral né de la Shoah. Ce que Fackenheim appelait le 614e commandement, à savoir ne pas permettre à Hitler d'avoir raison, c'est-à-dire ne pas recommencer la Shoah en agissant comme bourreau des autres.
- Speaker #2
Oui, et les garde-fous éthiques existent dans la tradition juive elle-même. Je pense à la loi du talion, qui est plutôt une compensation et non pas une vengeance.
- Speaker #1
Oui, alors au fond, survivre en tant que juif... C'est peut-être aussi défendre la dignité humaine partout.
- Speaker #2
Oui, c'est un repère éthique universel. Dans cette perspective d'intrafamilialité, une parole d'Église est possible pour tenir ensemble la proximité avec Israël et la proximité avec les souffrances palestiniennes, en refusant les instrumentalisations et en appelant toujours à la justice et à la paix.
- Speaker #1
Merci Père Alban Massie. Pour conclure... Est-ce que vous pourriez nous donner, selon vous, le message global de ce cahier ?
- Speaker #2
Alors, je dirais qu'il est double. D'un côté, ce cahier montre le chemin extraordinaire qui a été parcouru depuis Vatican II. La reconnaissance des racines juives, le rejet de la substitution, la permanence de l'Alliance. Et de l'autre, ce cahier rappelle que le dialogue n'est pas achevé. Il est au cœur même de l'identité chrétienne.
- Speaker #1
Oui, vous pointez une exigence. Et pas une option.
- Speaker #2
Il faut sans cesse relire, dialoguer, confronter l'histoire et le présent, tenir ensemble fidélité et justice.
- Speaker #1
Comme le dit la conclusion du cahier, c'est un cheminement qui continue. L'histoire n'est pas achevée et le rendez-vous est pris.
- Speaker #2
Et la question demeure, comment chacun participons-nous à ce rendez-vous ? entre Israël et l'Église pour que nous puissions marcher ensemble ?
- Speaker #1
Voilà une belle question pour terminer. Je vous rappelle que le cahier Israël et l'Église dans le dessein de Dieu pour que les deux marchent ensemble paraît le 23 octobre 2025 et est à commander sur le site www.nrt.be. Merci à tous de votre écoute. À bientôt.