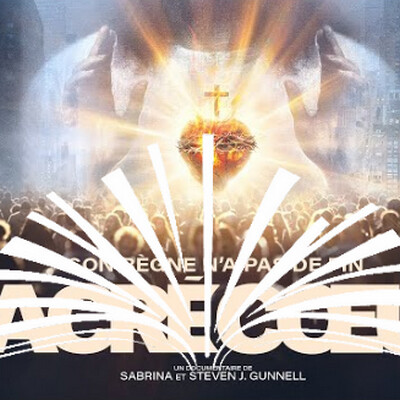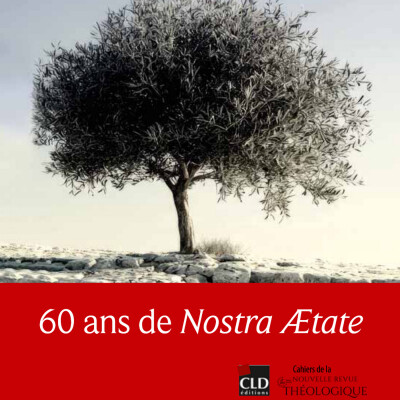- Speaker #0
Bonjour à
- Speaker #1
tous ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'occasion de la fête de la Toussaint et nous interrogeons le cœur battant de la vie chrétienne, la sainteté. Est-elle un sommet pour quelques ans ? Ou bien l'horizon de tous les baptisés est-elle un état mystique ou une dynamique ecclésiale ? Pour répondre, nous vous proposons un parcours à travers les archives de la Nouvelle Revue Théologique depuis les années 30 jusqu'en 2018. Bonjour Père Alban Massie.
- Speaker #2
Bonjour Elsa Brot. Oui, j'ai sélectionné des articles de la revue qui sont comme six moments pour entrer dans une théologie vivante de la sainteté. Citant pour comprendre comment la sainteté peut être perçue autrefois comme mystique ou élitiste, est aujourd'hui à reconnaître comme vocation universelle, comme engagement communautaire, comme tension eschatologique, comme voie contemporaine de transformation du monde. Toutes les dimensions de la théologie, vous voyez. Vous trouverez les liens vers ces articles en lecture gratuite dans la description et le premier commentaire de cette émission.
- Speaker #1
Alors, ce qui est frappant, c'est que... Pendant longtemps, la sainteté a été perçue comme réservée à une élite, les moines, les martyrs, les vierges, les missionnaires, les fondateurs. Et puis, un basculement s'est opéré, spécialement au XXe siècle.
- Speaker #2
Un article publié en 1985 à l'occasion du 20e anniversaire de Vatican II attire l'attention sur ce que le concile a appelé l'appel universel à la sainteté. Ce texte insiste sur le fait que la sainteté n'est pas une option, encore moins un privilège, elle est une vocation pour tous. Et ce n'est pas une simple évolution pastorale, c'est une reprise théologique de fond. Dans cette perspective, la sainteté devient la structure même de la vie chrétienne. Ce que ce texte de 1985 souligne, c'est que cette vocation ne concerne pas uniquement les religieux, mais tout l'organisme ecclésial dans la diversité des charismes.
- Speaker #1
Mais alors, Père Alban, Si tous sont appelés à être saints, que devient l'idée de l'exception ? Voyez, du témoignage héroïque, de la distance inspirante.
- Speaker #2
Alors, c'est une vraie question. On ne supprime pas l'exemplarité, l'exceptionnel, mais on le relativise. On le fait, on le met en lien avec l'appel universel, avec toute l'humanité. Le témoignage du saint n'est plus d'abord ce qui va le distinguer, mais ce qui va engager les autres.
- Speaker #1
et C'est ce que dit très bien ce texte, c'est que cette universalité n'annule pas l'intensité. Je vous propose d'écouter plutôt ce passage que nous lisons ici dans sa version intégrale.
- Speaker #0
Le Seigneur Jésus a enseigné à tous et à chacun de ses disciples, quelles que soient leurs conditions, cette sainteté de vie dont il est à la fois l'initiateur et le consommateur. Vous donc ? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Appelés par Dieu non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont devenus dans le baptême fils de Dieu, participants à la nature divine et donc réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit en leur état ou leur rang dans la société terrestre.
- Speaker #1
Voilà, c'est clair. Pas de deuxième catégorie de chrétiens. Tous sont appelés à la perfection de la charité. Au fond, c'est une théologie sans échappatoire. Et on pense à l'appel du pape François dans une exhortation en 2018 sur l'appel à la sainteté. Il faut regarder non pas seulement les cases exceptionnelles, mais aussi, et je cite le pape, « les saints de la porte d'à côté » . Alors on pense à cette personne âgée, isolée, qui retrouve le sourire pour accueillir sa petite fille qui passe une fois par an à Noël, ou ce jeune porteur de handicap qui ne sait ni lire ni écrire et qui témoigne d'une profonde intelligence du cœur. ou encore à ce prisonnier qui intercède pour ceux qui l'ont trahi, ou à ce pécheur qui pardonne à ceux qui l'ont abandonné, ou enfin à ce mourant qui, en expirant, remet tout son être à Dieu. Ce sont ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ou, pour employer une autre expression du pape François, la classe moyenne de la sainteté.
- Speaker #2
C'est une expression qui vient d'un auteur français que le pape François aimait beaucoup, Joseph Malègue, dans le roman "Augustin où le maître est là".
- Speaker #1
Oui, je crois que ce roman a fait l'objet d'un article dans la NRT, n'est-ce pas ?
- Speaker #2
Oui. en 2015, et il faut que je le rajoute alors à la liste des six articles, cela fera sept le nombre biblique de la perfection. C'est un roman sur la crise existentielle d'un intellectuel dans les années 30, et c'est un roman sur la conversion, sur fond de crise moderniste, où on réfléchit à l'articulation entre la foi et la raison. La classe moyenne de la sainteté Merci. C'est la catégorie de ces saints de la vie quotidienne qui mettent de l'amour dans leurs gestes, qui savent être au service des autres, sans douter que cela soit une manière de rendre le monde meilleur.
- Speaker #1
Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie de cet entretien. Si tous sont appelés à la sainteté, encore faut-il comprendre ce qu'est cette sainteté. Et là, un article fondamental de 1931 nous dit que la sainteté, ce n'est pas seulement une affaire de perfection morale, c'est une question d'appartenance au corps. Son auteur est le jésuite Émile Mersch, un nom peu connu aujourd'hui en dehors des cercles théologiques.
- Speaker #2
Et pourtant, c'est une figure majeure de l'ecclésiologie catholique du XXe siècle. C'est un jésuite belge, professeur à Louvain. Son intuition centrale, que l'on retrouve dans toutes ses œuvres, c'est que la vie chrétienne ne se comprend qu'à partir du mystère. mystère de l'union au Christ, non de façon abstraite, mais comme vie dans le corps mystique. Et c'est précisément ce qu'il déploie dans un article magnifique intitulé « Sainteté de chrétiens, sainteté de membres » .
- Speaker #1
Oui, on est avant Vatican II qui a déployé cette notion de corps pour en faire une image importante de l'Église.
- Speaker #2
Tout à fait. Et quand on parle de corps, on pense quelquefois seulement à la tête, mais il faut... prendre au sérieux les membres. Pour Émile Mersch, il ne s'agit pas d'une image ou d'un concept symbolique, il parle d'une réalité de l'être même de l'Église. Être chrétien, c'est être greffé au Christ comme un membre au corps. Et donc, toute sainteté ne peut être que partielle, incomplète, si on ne l'a pas rattachée à la sainteté du corps tout entier qui est l'Église.
- Speaker #1
Du coup, c'est une correction implicite à une certaine spiritualité individualiste, c'est ça ?
- Speaker #2
Absolument. C'est cela qui est d'une grande actualité, je crois. La sainteté chrétienne n'est pas une réussite personnelle, c'est une participation. Elle est toujours en relation.
- Speaker #1
Et c'est ce que ce jésuite exprime dans un passage admirable que je vous propose que nous lisions maintenant.
- Speaker #0
La sainteté chrétienne, puisqu'elle consiste à agir en membre du Christ, consiste à agir dans un double rattachement. Rattachement au Christ d'abord, toutes nos vertus ne peuvent être qu'un écoulement, un influx venant du chef. Rattachement au membre ensuite, toutes nos vertus ne peuvent être qu'un élément, une partie, un membre en quelque sorte, dans la seule sainteté qui soit totale, la sainteté de tout le corps mystique. Inachèvement, disons-nous. Non pas que la sainteté chrétienne ne transforme qu'un morceau de notre être, mais parce qu'elle ne se comprend que dans la communion, tout doit devenir saint, non à la manière d'un tout, mais à la manière d'une partie dans un tout.
- Speaker #1
Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est qu'il parle d'un inachèvement constitutif. Du coup, ce n'est pas une limite honteuse, mais c'est le signe que la sainteté ne peut être vécue que dans l'unité de l'Église. une vision profondément ecclésiale, voire sacramentelle, de la sainteté.
- Speaker #2
Je suis d'accord et cela permet aussi de comprendre pourquoi la sainteté n'est jamais un jugement porté sur l'autre. On ne sait pas quelle part du corps il soutient. Émile Mersch écrit même « Les efforts que l'un fait en silence peuvent porter la sainteté de l'autre à l'éclat » . Ce n'est pas de la poésie, c'est une théologie rigoureuse de la... communion des saints.
- Speaker #1
Et cela nous oblige à penser la sainteté non seulement comme exigence personnelle, mais comme solidarité spirituelle.
- Speaker #2
Tout à fait, cette communion déborde la mort. Alors cette orientation que Émile Mersch suggère, d'autres vont la déployer, et c'est justement le thème de la prochaine étape de notre émission, la sainteté comme attente active, comme tension eschatologique. Nous allons entendre une voix du monachisme médiéval relue dans la NRT, celle de Saint Bernard de Clairvaux.
- Speaker #1
Alors je rappelle que vous écoutez les dialogues théologiques de la NRT, édition spéciale Toussaint. Après avoir vu que la sainteté est une vocation commune vécue dans le corps du Christ, nous explorons maintenant une autre facette, souvent oubliée, celle de l'attente. Car les saints eux-mêmes, même après leur mort, attendent encore.
- Speaker #2
Et c'est ici qu'intervient un article remarquable, publié en 1948, qui relit la... pensée de Saint Bernard de Clairvaux. L'auteur, un jésuite encore, le père Bernard de Vrégille, explore une théologie de l'état intermédiaire. Que deviennent les saints entre la mort et la résurrection finale ? Et il regarde ce qu'en dit Saint Bernard.
- Speaker #1
Oui, parce qu'on a parfois tendance à penser qu'une fois mort, les saints sont, entre guillemets, arrivés. C'est la vision béatifique. Et pourtant, Bernard montre qu'ils sont certes déjà dans la joie, mais pas encore dans la plénitude.
- Speaker #2
Exact. Bernard distingue trois états, trois lieux de vie, si on veut. La tente, en deux mots, le parvis et la maison. Les tentes, c'est la vie présente. Le parvis, c'est l'état des âmes après la mort. En paix, mais pas encore. arrivé encore dans l'attente, en un seul mot. Et puis, finalement, la maison, c'est la gloire définitive. Et alors, ici, il parle non pas de ceux qui sont au purgatoire, mais il parle bien des saints.
- Speaker #1
Oui, on est loin d'une vision simpliste du ciel. Ce n'est pas un arrêt immédiat et définitif dans la lumière, mais bien une tension continuée vers l'union complète. Voici ce que Bernard dit. dans un passage dense que l'article reprend intégralement.
- Speaker #0
Il y a trois séjours, les tentes, les parvis, la maison. Dans les tentes se trouvent tous les justes qui dans leur chair vivent et peinent, car les tentes sont l'abri du labeur et de la milice. Une tente possède un toit, mais pas de fondation. Elle est mobile. Ainsi, les justes ne sont pas fondés dans le présent, mais cherchent la cité qui tient d'en haut ses fondations, puisque leur foi, sur quoi ils se fondent, n'est pas dans le terrestre mais dans le Seigneur. Ils possèdent un toit, à savoir l'abri et la protection de la grâce. Les parvis, ils avoisinent la maison. Ils sont vastes. Là sont les âmes saintes, dépouillées de leur corps. Elles sont au large, libérées de l'étroitesse de la chair. Les parvis possèdent des fondations mais pas de toit. En effet, les âmes établies dans l'amour de Dieu ne chancellent pas du lieu où nos pas s'étaient fixés. Psaume 121, 2 Mais elles n'ont point de toit, car elles attendent encore un accroissement, qui ne sera que dans la résurrection de leur corps. Après cette résurrection, assurément, elles seront avec les anges, dans la maison qui a fondation et toit. La fondation, c'est la stabilité de la béatitude éternelle. Le toit, la consommation et la perfection de cette même béatitude.
- Speaker #2
Ce qui me touche dans ce texte, c'est qu'il donne une vision profondément biblique de la vie. On retrouve ici le vocabulaire des psaumes, comme aussi celui de l'Apocalypse. Ça nous dit que le saint n'est pas hors du temps, il habite l'attente de Dieu. Et cette attente elle-même est communion. Ce passage condense avec une grande puissance la vision médiévale de l'eschatologie. Pour saint Bernard, la vie spirituelle est comme un pèlerinage en étapes, depuis l'instabilité du monde jusqu'à la demeure stable de Dieu.
- Speaker #1
Moi aussi je suis très touchée par ce texte. Il me semble qu'il y a une humilité profonde dans cette théologie. Les saints, au fond, ne se possèdent pas eux-mêmes. Ils désirent encore, ils espèrent encore. Et ce qu'ils attendent, ce n'est pas tant leur récompense personnelle que la plénitude du corps, la résurrection de tous.
- Speaker #2
Et cela éclaire, je crois, la fête de la Toussaint d'un jour nouveau. Elle n'est pas la fête de ceux qui ont fini, qui sont arrivés, mais la fête de ceux qui intercèdent en espérant, qui nous devancent sans nous oublier.
- Speaker #1
Oui, la sainteté n'est donc jamais achevée tant que l'Église entière n'est pas rassemblée dans la gloire. C'est un horizon commun. Et cela nous entraîne à regarder cet entre-deux de la vie sous la tente. et dans la maison pour reprendre le vocabulaire de Saint Bernard. Je veux parler du purgatoire. C'est un mot tombé un peu en silence, presque en désuétude. Et pourtant, n'a-t-il pas quelque chose à nous dire aujourd'hui encore ? Père Alban, du coup, une première question. Le purgatoire a-t-il encore un sens dans la théologie contemporaine ?
- Speaker #2
Je dirais un sens essentiel, à condition de bien le comprendre. Le purgatoire. Selon l'enseignement de l'Église, ce n'est pas un petit enfer provisoire, mais une purification dans l'amour. J'ai sous les yeux le texte du catéchisme de l'Église catholique rappelé dans l'encyclique Spécial Vie de Benoît XVI. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, souffrent après la mort une purification. purification n'est pas une punition, elle est désir de Dieu. Elle est souffrance d'amour comme le montre magnifiquement la tradition mystique de Catherine de Gênes à Thérèse de Lisieux, et c'est l'objet d'un article du père Pierre Gervais, jésuite canadien qui a été un de mes prédécesseurs à la Nouvelle Revue Théologique.
- Speaker #1
Oui, alors vous parlez de purification et pas de châtiment, mais il me semble que ce n'est pas ce que beaucoup de catholiques ont entendu. durant des siècles.
- Speaker #2
Justement, il faut rappeler ici le travail historique fondamental de Guillaume Cuchet, notamment dans son livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un effondrement » . Il montre que l'effondrement de la prédication sur les fins dernières, mort, jugement, enfer, paradis, a contribué à l'éloignement progressif des fidèles de la pratique chrétienne. Mais il rappelle aussi que la manière dont on parlait du purgatoire centrée sur la peur a été contre-productive.
- Speaker #1
Je vais vous provoquer un peu. Est-ce que vous diriez que la prédication a été quelque part toxique ?
- Speaker #2
En disant qu'on a trop souvent présenté le purgatoire comme une menace et puis on l'a représenté avec les flammes. Et ça fait peur. C'est comme si c'était un prolongement ou judiciaire de l'enfer. Un petit enfer, bon. L'enfer c'est éternel, le purgatoire c'est un enfer qui ne va pas durer. Non, la mystique chrétienne a toujours résisté à cette vision pénale. Écoutez ce qu'écrit Catherine de Gênes au XVe siècle, et c'est repris dans cet article. L'âme aime Dieu intensément. Catherine a une vision du purgatoire. Elle voit les âmes et elle décrit ce que fait cette âme. au purgatoire. L'âme aime Dieu intensément et le Dieu aimant l'attire tout à lui avec une douce violence. Il la réjouit sans lui ôter la douleur qu'elle ressent d'être encore imparfaite. Et notre chère petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, elle dira plus tard à propos du purgatoire, si jamais on lui dit qu'elle doit aller au purgatoire, « Oh, c'est pas parce que je suis prête que je vais aller au paradis, je sens que je ne le serai jamais si le Seigneur... » ne me transforme lui-même. Il peut le faire en un instant. Donc pour elle, le purgatoire, c'est une seconde de découverte de l'amour de Dieu.
- Speaker #1
Oui, donc si je comprends bien, c'est plutôt une espérance et pas un effroi.
- Speaker #2
Exactement. Le purgatoire, ce n'est pas l'enfer en plus doux ou en moins terrible, c'est l'amour qui consomme toute trace de péché. L'image de Thérèse est très forte. Elle compare sa possible entrée au purgatoire à celle des trois enfants dans la fournaise du livre de Daniel. Ils sont dans le feu, mais ils chantent la louange de Dieu.
- Speaker #1
Et quel rapport avec la synodalité dont on parle tant aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut faire un lien ?
- Speaker #2
Un lien profond en fait. Le purgatoire, c'est le lieu de la communion, le creuset invisible du lien entre vivant et mort. L'Église n'est pas... composée seulement des fidèles sur terre, mais aussi des saints, des âmes, en chemin vers la lumière. C'est cette solidarité invisible, cette circulation d'amour qui fait l'unité du corps du Christ. Le purgatoire, dans une théologie de la synodalité, c'est le rappel que nous ne marchons jamais seuls, ni avant, ni après la mort.
- Speaker #1
Et est-ce qu'on pourrait dire quelque chose du lien avec les pauvres que le pape François, étant de pape avant lui, met en avant, comme Léon le Grand ou tout récemment Léon XIV avec Dilexité ?
- Speaker #2
Saint Léon le Grand disait « Dans le pauvre, c'est le Christ lui-même » que tu nourris. » Léon XIV a repris cette phrase dans sa récente exhortation apostolique d'Ilexité. Je crois que le purgatoire dans cette ligne nous apprend à reconnaître le visage blessé du Christ, non seulement dans les vivants, mais aussi dans ceux qui souffrent au seuil de la lumière. C'est une école de compassion et de mémoire pour nous. Notre prière pour les défunts. est un acte d'amour actif. C'est une manière d'accompagner les pauvres de l'au-delà comme on accompagne les pauvres de l'ici-bas.
- Speaker #1
Écoutons maintenant cet extrait de l'article de Pierre Gervais.
- Speaker #0
Tel est le motif pour lequel l'Église prie pour les fidèles défunts. En priant pour eux, elles cherchent à alléger leur souffrance par ses prières, attend le jour où ils seront dans la pleine vision de Dieu, vision qui leur est déjà donnée en partage. Si l'âme ne mérite pas pour elle-même en purgatoire, cela ne l'empêche pas de pouvoir mériter pour les autres, dans son union, au mérite du Christ en sa passion. C'est ainsi qu'en purgatoire, comme l'évoque Thérèse de Lisieux, au milieu des flammes, Elle peut intercéder pour les vivants, prenant à cœur leur salut. Le dogme du purgatoire établit ainsi un rapport de proximité, d'échange, d'entraide, sinon de connivence entre l'ici-bas et l'au-delà. Il met en contact les vivants et les morts, donnant à ces derniers un visage à taille humaine par-delà le voile de la mort, les uns et les autres se reconnaissant mutuellement et compatissant.
- Speaker #1
Donc le purgatoire, loin de la peur, c'est finalement un appel à aimer.
- Speaker #2
Un appel à aimer jusqu'à ceux qui nous ont quittés, à espérer pour eux. Il nous dit que nul n'est perdu quand il aime, même imparfaitement. Il nous invite à regarder l'horizon sans avoir peur. Et ça, c'est profondément contemporain.
- Speaker #1
Oui, cet horizon nous attire et nous fait bouger ici et maintenant. Car si les saints attendent, c'est à nous d'agir. Et ce sera justement l'objet de la cinquième partie de notre émission, la sainteté non plus comme séparation du monde, mais comme transformation du monde.
- Speaker #0
Pour continuer à suivre la réflexion, pourquoi ne pas vous abonner à la revue ? En ce moment, jusqu'au 31 décembre 2025, abonnement découvert à 40% de réduction sur le prix normal sur les formules numériques et bimédia. Avec le code 2026-40
- Speaker #1
Vous écoutez les dialogues théologiques de la NRT, édition spéciale Toussaint. Nous avons vu que la sainteté est une vocation pour tous, vécue dans la communion, tendue vers un accomplissement encore à venir. Mais comment se vit-elle ici-bas ? Faut-il fuir le monde pour devenir saint ? Où est-il mieux de s'y plonger ?
- Speaker #2
C'est un paradoxe que soulève un article publié en 1953 sous le titre « Eschatologie et engagement chrétien » .
- Speaker #1
Oui, l'auteur, le père Didier, il propose une lecture théologique profonde d'un malaise ancien. Peut-on attendre le royaume sans se désengager des urgences terrestres ? Il évoque une anecdote saisissante tirée d'une pièce d'Albert Camus. Un saint russe, saint Dimitri, se rend au rendez-vous avec Dieu, mais s'arrête pour aider un paysan embourbé. Et à son arrivée, Dieu n'est plus là.
- Speaker #2
Alors c'est toute la tension, faut-il choisir entre Dieu et les hommes ? Camus pose la question à sa manière. C'est l'homme qui engage la responsabilité de l'homme. La théologie répond aussi depuis longtemps. Je pense à la phrase de saint Vincent de Paul, ce n'est pas quitter Dieu que de quitter Dieu pour Dieu. Et l'article du père Didier le rappelle. Aider l'homme, c'est aller à Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre engagement et... et sainteté, à condition que cette action soit charitée.
- Speaker #1
Oui, mais certains courants chrétiens, rappelle l'article, ont longtemps redouté que l'action dans le monde compromette l'attente spirituelle. Karl Barthes, notamment, est cité dans cette perspective avec son refus de toute contribution humaine à l'avènement du royaume.
- Speaker #2
Alors oui, Karl Barth pousse le pouvoir de la grâce au maximum. Et là, l'auteur prend position. Il refuse ce qu'il appelle le désengagement eschatologique. Il affirme au contraire que tout acte de charité a une portée éternelle, qu'il construit déjà le corps du Christ. Écoutons ce passage puissant.
- Speaker #0
Le souci de faire reculer la faim, la guerre, la souffrance. la mort, c'est-à-dire concrètement aujourd'hui l'exploitation du monde, sa planification, son organisation pacifique, la recherche médicale, les tâches économiques, sociales, politiques, scientifiques. Ce souci doit-il apparaître comme étranger à l'épanouissement de la charité ? Un regard sur le Christ suffit à donner une réponse. Le promoteur du royaume de Dieu a lutté contre les maux physiques. Ces miracles ont rassasié les foules, ont guéri les souffrants, consolé les endeuillés « À tous, il est demandé de subvenir aux besoins du pauvre, de soulager toute forme de détresse. »
- Speaker #1
Ah oui, cet article n'est pas vraiment un plaidoyer simplement humanitaire. J'y entends même une affirmation christologique. Agir pour soulager, c'est prolonger l'œuvre du Christ.
- Speaker #2
Absolument, c'est là que la théologie de la sainteté touche au concret. Elle n'est pas... évasion mais engendrement. Chaque acte de justice, d'accueil, de soin porte la marque du royaume. Non pas comme une œuvre parfaite, mais comme une anticipation de ce qui doit venir.
- Speaker #1
Et dans ce contexte, il faut redire que la sainteté n'est pas une abstraction morale, mais une configuration au Christ dans ses gestes les plus simples. Guérir, enseigner, nourrir.
- Speaker #2
Cela rejoint profondément ce que dit la liturgie de la Toussaint. Elle célèbre des vies tracées dans la poussière du monde, mais illuminées par la charité. Et c'est pourquoi on entend l'évangile des béatitudes. C'est comme une mémoire des gestes concrets et non pas des songes mystiques.
- Speaker #1
Ce lien entre le monde et la sainteté, c'est aussi ce qui justifie la reconnaissance canonique des saints. C'est ce qui nous conduit à notre sixième et dernière partie. Après avoir exploré la vocation universelle, la communion, l'attente, l'engagement, nous posons une dernière question. Où sont les saints aujourd'hui ? Et peut-on parler, comme le suggère un article publié en 1995, d'un nouveau siècle des saints ? Il faut reconnaître que c'est une belle formule, mais à vrai dire, elle surprend. Car l'image que nous avons du XXe siècle, puis du début du XXIe siècle, est plutôt marquée par la violence, la sécularisation, la perte des repères religieux.
- Speaker #2
Et c'est justement cela qui donne du poids à cette hypothèse. La sainteté au XXe siècle et au XXIe siècle ne disparaît pas, elle change de visage. Ce que montre cet article. C'est que les figures reconnues saintes depuis Vatican II, pensons à Charles de Foucault, à Mère Thérésa, à Oscar Romero, ce ne sont pas des mystiques retirés du monde, mais des hommes et des femmes plongés dans les fractures du siècle.
- Speaker #1
Oui, et ce texte insiste sur une autre évolution importante, la réforme des procédures de canonisation entreprises sous Jean-Paul II, qui a mis en valeur des figures plus variées. plus, entre guillemets, ordinaires, parfois même presque anonymes.
- Speaker #2
Exactement. L'auteur, un Belge, l'abbé Eugène Collard, fut un homme de médias en son temps et il voit dans ces changements de procédure et dans cette évolution un retour à la sainteté du peuple, celle des bienheureux, de la porte d'à côté, comme on a dit tout à l'heure avec les mots du pape François.
- Speaker #0
J'ai noté cet article car il est assez technique. Il s'intéresse à la fabrique des saints, si vous voulez. Il plaide pour que le processus ne soit plus aussi centralisé qu'il l'était, que tout ne se passe pas à Rome. C'est un texte de 1995 et on peut dire qu'il a été exaucé. Il y a moins de célébrations de canonisation au Vatican.
- Speaker #1
On va laisser les plus curieux lire cet article. je crois que l'essentiel est de voir que devant la nécessité de donner à l'humanité Des modèles de vie réussis, ce n'est pas la dictature des sentiments, de l'émotion qui va donner les critères de la sainteté, mais bien l'évangile. Écoutons le chanoine Collard.
- Speaker #2
Il est aujourd'hui manifeste que les canonisations se sont multipliées. Certains y voient une inflation suspecte, d'autres une pastorale intelligente. Mais au-delà de cette controverse, un fait demeure. L'Église a besoin de pasteurs et de témoins qui brillons par leur sainteté, car ce sont les saints qui font avancer l'Église. Leur vie éclaire l'Évangile, leurs engagements traduisent la charité en gestes, et leur humilité devient une école pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais l'effet d'exemplarité. Les seins sont les signes visibles de l'invisible.
- Speaker #1
Si nous voulions résumer, peut-être que nous pourrions dire que le sein n'est pas un super-héros, mais bien un miroir évangélique. Et le besoin de figure inspirante n'a jamais été aussi fort.
- Speaker #0
Oui, c'est aussi un appel à notre responsabilité. Si tant de saints ont été reconnus dans les dernières décennies, c'est peut-être pour nous rappeler que notre génération n'est pas orpheline de la sainteté.
- Speaker #1
Alors oui, le XXIe siècle peut être un siècle de saints, non parce que les temps sont difficiles, mais parce que le changement d'époque que nous vivons exige une charité inventive, une foi enracinée, une espérance indéracinable.
- Speaker #0
On peut conclure en disant que ce parcours dans les archives de la Nouvelle Revue Théologique nous a montré que la sainteté est à regarder comme une voie commune, solidaire, dans l'espérance, en tension, active, visible.
- Speaker #1
Oui, on pourrait ajouter que c'est la respiration du corps du Christ et l'empreinte de l'esprit dans l'histoire.
- Speaker #0
Belle formule Elsa. Si nous ne sommes pas tous appelés à être... canonisés, nous sommes tous appelés à vivre de cette sainteté partagée dans le quotidien. À notre place, dans l'unité du corps, qui est le corps du Christ.
- Speaker #1
C'est ce que rappelle Émile Mersch, je le cite. "Dans l'unité, tout est commun et chacun, n'ayant fait que sa part, a cependant fait le tout". Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous.
- Speaker #0
À bientôt et abonnez-vous à ce podcast. cast poursuivent les prochaines émissions. Ce sera sur John Henry Newman et le sens de son doctorat, la déclaration qu'il est docteur de l'Église.
- Speaker #1
À bientôt, Père Alban.
- Speaker #0
Au revoir, Elsa.
- Speaker #2
Pour continuer à suivre la réflexion, pourquoi ne pas vous abonner à la revue ? En ce moment, jusqu'au 301 décembre 2025, Abonnement découverte à 40% de réduction sur le prix normal sur les formules numériques et bimédias. Avec le code 2026-40.