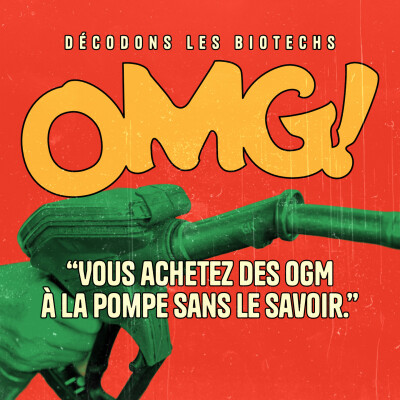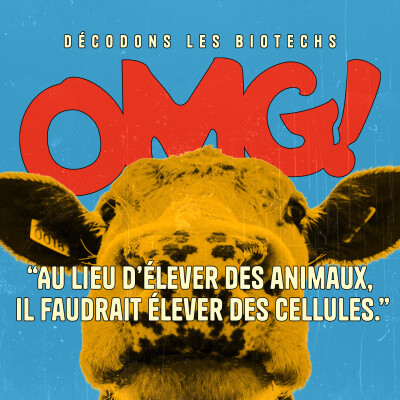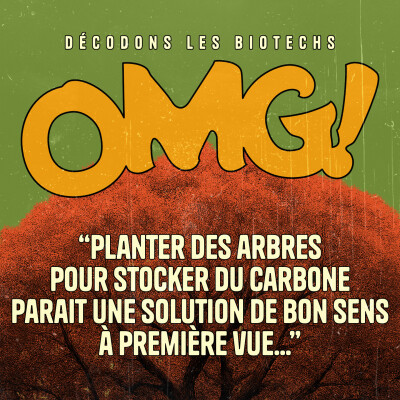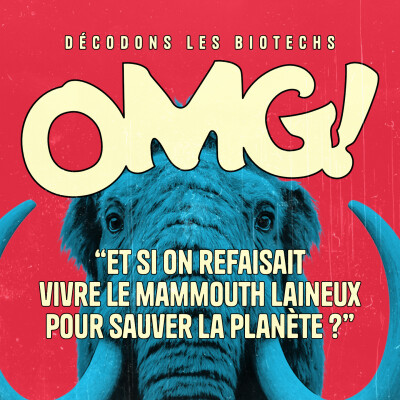- Sur le front, France 5
À l'intérieur de cet immense bateau, il n'y a qu'un seul produit, un seul, des graines de colza, naturellement riches en acides gras, qui seront transformées en huile, puis en biodiesel.
C'est un bateau qui vient d'Australie. Donc il a traversé la planète pour nous amener du colza australien.
Tout à fait, il pourrait être transgénique.
Ça veut dire qu'on importe légalement de l'autre bout du monde du colza transgénique ?
Oui, l'Union Européenne interdit la culture du colza transgénique, mais autorise l'importation du colza transgénique. Il y a un discours un peu schizophrénique.
On le voit bien sur ces images. Les graines, elles s'envolent, ce n'est pas du tout sécurisé. Et donc, le colza, il va se retrouver sur le bord des routes, autour des ports. C'est extrêmement volatile.
- Inf'OGM
Vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode de « OMG ! Décodons les biotech », nous allons nous intéresser aux différents agrocarburants, aussi appelés biocarburants. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de l'émission « Sur le Front », diffusée sur France 5 en 2022. Christophe Noisette, journaliste d'InfoGM, était à Rouen et a pu constater que du colza transgénique australien était débarqué dans l'usine SAIPOL. L'usine SAIPOL produit des agrocarburants à partir de colza. Il s'agit d'une des nombreuses filiales de la multinationale Avril, dirigée par Arnaud Rousseau, également président de la FNSEA. Avril est présente dans nos cuisines avec les huiles Lessieur et Puget, ou les œufs matines, par exemple.
Lors du tournage, notre journaliste aperçoit du colza qui pousse au bord de la route, près du port de Rouen. Il cueille quelques plans, les fait analyser et, sans surprise, apprend qu'il s'agit de colza transgénique, génétiquement modifié pour tolérer un herbicide. Ce colza pousse donc en France de façon certes involontaire, mais illégale. Inf'OGM alerte le ministère de l'Agriculture.
L'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, est saisie. Elle affirme que l'ANSES exige des mesures drastiques pour éviter cette pollution génétique. Notre découverte n'est pas un cas isolé. Les analyses réalisées par le ministère de l'Agriculture en avril 2022 confirment la présence de colza transgénique. Plus inquiétant encore, InfoGM a retrouvé des nouveaux plants transgéniques en mai 2023 à Rouen et à Sète, près d'une autre usine Saipol. Pourtant, le ministère nous avait affirmé en avril 2022 que, je cite, « un suivi des repousses sera mis en place sur plusieurs années ». Actuellement, ce sont les agrocarburants dits de premières générations qui sont largement utilisés dans le monde. Ils sont produits à partir de cultures alimentaires. Il existe deux grandes familles d'agrocarburants :
- L'éthanol, de l'alcool issu de la fermentation d'une plante, betterave, blé, maïs, canne à sucre, qu'on incorpore à l'essence.
- Et le biodiesel, une huile issue d'oléagineux, soja, palme, colza, incorporables au diesel. Ce sont eux qu'on trouve dans les fameux sans-plomb 95E10, super-éthanol E85, biodiesel B10 ou encore diester. La deuxième génération est issue de la transformation de la cellulose. Dans les deux cas, nous verrons qu'ils sont produits à partir ou grâce à des organismes génétiquement modifiés. Comme ces OGM ne sont pas destinés à l'alimentation, l'origine OGM de ces produits n'est pas indiquée. Vous achetez des OGM à la pompe sans le savoir. Des OGM pour fabriquer des carburants non fossiles pour lutter contre le changement climatique, voilà l'objectif officiel. Ces agrocarburants sont-ils un bon outil pour une transition écologique et énergétique ? Quels sont leurs impacts actuels ? Quelles seraient les conséquences de leur généralisation ? Pour comprendre la réalité des agrocarburants aujourd'hui en France, commençons par donner la parole à Philippe Pointerau, agronome qui a travaillé pour Solagro, une association professionnelle engagée pour une agriculture plus résiliente.
- Philippe POINTEREAU
Aujourd'hui, la quasi-totalité du diester vient du colza, qui est soit produit en France, soit importé. Ça représente une surface d'environ 1,9 million d'hectares, dont 1,2 million d'hectares importés et 700 000 hectares produits en France. Et en 2023 Les importations de diéster ont représenté 2,2 milliards d'euros.
- Inf'OGM
Les agrocarburants sont présents dans nos stations-service. Presque tout le monde en consomme. Et ce n'est pas le fait du hasard ou d'une demande citoyenne. C'est dû à des politiques publiques qui manient la carotte et le bâton.
- Philippe POINTEREAU
Aujourd'hui, il faut comprendre qu'en France, on incorpore 8,5% d'agrocarburant dans les carburants, soit de l'éthanol, soit du diéster. L'éthanol dans l'essence, le diéster dans le gasoil. Pourquoi on a autant d'agrocarburants en France ? Il y a une obligation européenne qui oblige les pétroliers, les vendeurs de carburant, à l'utiliser. Sinon, il y a une taxe très dissuasive qui est de 1,4 euro par litre. C'est-à-dire que s'ils n'incorporent pas les 8,5% dans leurs carburants, ils sont taxés de 1,4 euros le litre. Donc en fait, cette taxe qui s'appelle la taxe incitative relative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports est très dissuasive.
- Inf'OGM
Plus largement, une quarantaine de pays dans le monde, dont les Etats-Unis ou l'Indonésie, appliquent les mêmes politiques d'incorporation obligatoire. Et cette politique a été poussée par certaines grandes entreprises. Selon une étude menée par Oxfam, l'industrie des agrocarburants producteurs de matières premières, négociants en matières premières, transformateurs et fournisseurs de technologies, ont dépensé entre 14,5 et 19,5 millions d'euros et engagé 399 lobbyistes pour influencer les politiques de l'UE en 2015.
Le bâton, mais aussi la carotte, disons-nous.
- Philippe POINTEREAU
Ils bénéficient d'une défiscalisation des agrocarburants et ils ont une détaxation de 80 centimes sur l'éthanol et de 51 centimes sur le diesel. Ce qui représente un soutien d'environ 2,7 milliards d'euros par an. Et donc aujourd'hui, au final, de toute façon, c'est le consommateur qui paye le coût des agrocarburants qui est quand même plus cher aujourd'hui que le pétrole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans soutien, il n'y aurait pas d'agrocarburant en France.
- Inf'OGM
Or, ce colza importé, que ce soit d'Australie, du Canada ou d'Ukraine, est transgénique. Aux États-Unis, les agrocarburants sont plutôt issus du maïs qui, dans ce pays, est à 98% génétiquement modifié. La betterave sucrière, également utilisée pour produire de l'éthanol, est elle aussi largement transgénique aux Etats-Unis ou au Canada. Nous venons de voir que les agrocarburants sont souvent produits avec des plantes OGM. Ces dernières ont été génétiquement modifiées pour tolérer un herbicide ou pour... produire un insecticide. Dans les deux cas, ce qu'on constate depuis plus de 20 ans, c'est que les cultures de ces OGM s'accompagnent d'une augmentation des épandages de pesticides. Outre leurs effets sur la santé, les pesticides ont un impact sur le changement climatique tout au long de leur cycle de vie, lors de leur fabrication, leur transport et leur élimination. Ces monocultures intensives ont aussi besoin d'engrais en quantité. D'après un article de Nature publié en 2022, les engrais à base d'azote représentent environ 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sans même compter les émissions liées à la transformation ou la distribution. Philippe Pointerau, citant le rapport de la Cour des comptes de 2016, nous dit encore.
- Philippe POINTEREAU
Donc un hectare de colza permet de produire l'équivalent de 2,1 tonnes d'équivalent pétrole, et il faut la moitié de cette énergie produite pour la produire, c'est-à-dire qu'on a un rendement de 50%. Pour l'éthanol, on a un bilan qui est en général un peu moins bon pour le diéster parce qu'on a une étape qui est la distillation qui coûte très cher en énergie puisque l'éthanol au départ, c'est dilué, c'est comme le vin, on a 10% d'alcool et il faut en avoir 100%. Donc là, on est en général à un bilan qui est de moins 50%. Ce ne sont pas des solutions hyper performantes.
- Inf'OGM
Faible rendement à la production, mais aussi lors de la consommation. Là encore, les chiffres sont tout à fait parlants. On fait moins de kilomètres avec 1 litre d'agrocarburant qu'avec 1 litre de pétrole. En effet, toujours selon la Cour des comptes, l'intensité énergétique est inférieure de 34% pour le bioéthanol par rapport à l'essence et inférieure de 8% pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, concrètement, on peut faire 909 km avec un plein d'essence contenant 5% d'éthanol, 880 km si elle contient 10% d'éthanol et seulement 653 km si elle contient 85% d'éthanol. L'impact sur le climat ne se limite pas à la façon dont les agrocarburants sont produits. Une autre dimension très importante par rapport à la question du carbone est le... changement d'affectation des sols, à savoir passer d'une forêt ou d'une prairie à une culture de soja, colza ou autre. Pour comprendre ce phénomène, nous avons interrogé Benoît Gabriel, professeur à AgroParisTech, une école qui forme des ingénieurs et scientifiques dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation.
- Benoît GABRIEL
Si on fait le bilan des émissions de gaz à effet de serre d'un biocarburant, on va prendre les émissions pour la production de la matière première agricole, puis le transport et la transformation. Donc ça, c'est tout un paquet qu'on va appeler émissions cycle de vie. Dans le cas de changement d'affectation des sols, on va regarder les émissions liées aux pertes de carbone des écosystèmes qui auront été impactées. Donc ces émissions qui peuvent être dues au fait qu'on va retourner une prairie ou déforester, c'est le carbone qui est contenu dans les sols, dans les arbres ou dans la prairie, et donc c'est des émissions qui arrivent en plus. Les chiffres sont très très variables, et c'est pour ça que nous avons fait une méta-analyse avec l'étude commandée par l'ADEME. Mais bon, on peut facilement doubler les émissions de gaz à effet de serre, le cycle de vie. Si on dit que le fossile, ça émet 100, pour faire 1 kilomètre par exemple, donc le biocarburant, on espère, va émettre moins, typiquement de l'ordre de 50. Mais si on inclut les changements d'affectation des sols, on peut tomber de nouveau à 100 ou 150 ou 200.
- Inf'OGM
En gros, ce qu'il nous dit, c'est que si on détruit une forêt qui stocke du carbone pour produire des plantes destinées aux agrocarburants, le bilan carbone d'une unité d'énergie pourrait être même supérieur à du bon vieux pétrole.
- Benoît GABRIEL
Ça, c'est une première donnée concrète, c'est-à-dire que l'agrocarburant ne permettait pas d'économiser des émissions de gaz à effet de serre dans les cas où on allait vers la conversion de forêts naturelles ou de prairies.
- Inf'OGM
La déforestation pour produire des agrocarburants est une réalité dans les pays du Sud. Ainsi au Brésil, le soja ou la canne à sucre remplacent des forêts. Et en Indonésie, c'est l'huile de palme qui est produite sur d'anciennes forêts. Selon un rapport de la Rainforest Foundation de 2020, au rythme actuel, ces changements d'affectation des sols se traduiraient par la destruction de 7 millions d'hectares de forêts, dont 3,6 millions sur des sols tourbeux très riches en carbone. Les émissions de gaz à effet de serre associées à cette déforestation seraient de l'ordre de 11,5 milliards de tonnes équivalent CO2, soit davantage que les émissions annuelles de la Chine. Et en France, on ne déforeste pas ? On n'a pas de changement d'affectation des sols ?
- Benoît GABRIEL
Si on revient en France et en Europe, on n'a a priori pas de déforestation pour produire des cultures énergétiques. En revanche, on a des effets sur la prairie puisqu'on sait qu'on a perdu pas mal de prairies dans les 20 dernières années. Il y a eu des conversions de surface toujours en herbe, donc prairie permanente, vers des cultures agricoles et notamment pour permettre de produire plus de colza. Comme on économise très peu de gaz à effet de serre, de CO2, il faut cultiver la parcelle qui a été retournée pendant très très longtemps pour rentrer dans nos frais, entre guillemets.
- Inf'OGM
Benoît Gabriel précise également que ces changements d'affectation des sols ont aussi un impact sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau, même s'il reconnaît que moins de données sont disponibles. En effet, transformer une prairie permanente en champ de colza engendre notamment l'utilisation, ou une forte augmentation, d'engrais et de pesticides. Et une prairie est beaucoup plus riche en biodiversité qu'une monoculture intensive. On vient de comprendre, grâce aux précisions de Philippe Pointerau et de Benoît Gabriel, que les agrocarburants, dits de première génération, ne sont pas très efficients en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, surtout lorsque le colza pousse sur une ancienne prairie ou une forêt. Par ailleurs, les cultures énergétiques concurrencent les cultures nourricières. Philippe Pointerau donne une idée de cela. Si on relocalisait toute la production d'agrocarburants sur le territoire français, il nous dit
- Philippe POINTEREAU
Donc on voit bien que si on arrondit à 2 millions d'hectares, pour faire simple dans le calcul, et qu'ils produisent environ 10% de nos carburants, on voit clairement que si on voulait produire avec des agrocarburants 100% des carburants, il faudrait 20 millions d'hectares alors qu'on a une surface agricole de 28 millions d'hectares. Donc ça veut dire que l'essentiel de notre surface agricole serait utilisé pour la production d'énergie.
- Inf'OGM
Et cette concurrence alimentation-agrocarburant impacte le prix de l'alimentation ? Pour éclairer cette question, nous avons interrogé Franck Galtier, chercheur en économie politique au CIRAD. Il nous fait part d'un bouleversement assez surprenant dans l'histoire des agrocarburants.
- Franck GALTIER
À la fois du fait que les produits de l'agriculture étaient utilisés pratiquement que pour l'alimentation et qu'en plus, on a utilisé massivement des intrants chimiques pour favoriser cette production agricole, on en est arrivé à une situation de surproduction. Et du coup, les agrocarburants sont une réponse à cette situation. De la même manière qu'aux États-Unis, on a stimulé la consommation de viande pour arriver à éponger les excédents de céréales. De la même manière, on a promu les agrocarburants. Mais maintenant, on peut se demander ce qui se passe si on change de situation et qu'on ne se retrouve plus dans une situation d'abondance, mais dans une situation de rareté ou de pénurie.
- Inf'OGM
Et Franck Galtier estime clairement que nous sommes en train de passer à une situation de retour de la pénurie. Il nous explique.
- Franck GALTIER
Pourquoi ? À cause de la croissance démographique, à cause de l'augmentation du pouvoir d'achat qui induit une augmentation de la demande, notamment de produits animaux, qui induit une pression plus importante sur les terres. On estime à peu près que pour produire une calorie animale, il faut cette calorie végétale. Donc plus on consomme des produits animaux, plus il y a besoin de terre, d'une certaine manière. Et du coup, dans ce contexte-là, c'est quand même assez questionnable le fait d'utiliser des quantités de terre assez importantes pour produire de l'énergie, alors qu'on a aussi besoin de ces terres pour produire de l'alimentation pour les humains et les autres espèces animales.
- Inf'OGM
Mais Franck Galtier évoque une deuxième dimension qui rend les agrocarburants problématiques. C'est le fait des crises politiques, comme la guerre en Ukraine, ou environnementales, comme les conséquences possibles du changement climatique, sécheresse, inondations. Dans ces cas-là, le prix des matières premières agricoles bondit, du fait de leur rareté, et la faim dans le monde progresse.
- Franck GALTIER
Alors pourquoi est-ce qu'ils font problème ? Pour une raison très simple, c'est que les agrocarburants sont en fait... soutenus par des politiques publiques. Et ces politiques publiques passent en grande partie par ce qu'on appelle les mandats d'incorporation, qui impliquent qu'il est obligatoire d'incorporer une certaine quantité ou un certain pourcentage d'agrocarburants dans les carburants qui sont vendus à la pompe. Ces mandats d'incorporation, en fait, ce sont des mandats qui sont stables. Ils ne se modifient pas au cours du temps. Et donc, même quand il y a une crise alimentaire qui se produit, ces mandats se maintiennent. Et du coup, ça conduit, ce qui est un peu choquant, à nourrir les voitures avant de nourrir les humains et les animaux. Et ce sont des quantités qui ne sont pas du tout négligeables. C'est à peu près 15% du maïs produit et consommé dans le monde qui est utilisé pour faire du carburant. Et si on prend aussi l'ensemble des huiles végétales, c'est aussi 15% à peu près qui est utilisé pour faire des agrocarburants.
- Inf'OGM
Une des premières crises alimentaires liées aux agrocarburants est celle de 2008 quand les États-Unis adoptent le Biofuel Act, une loi qui impose de garder du maïs pour les productions nationales d'agrocarburants. Cela se traduit par une explosion du prix des céréales et par ricochet par des émeutes dans plusieurs pays. Franck Galtier nous donne un ordre d'idées de cette augmentation des prix de l'alimentation liée à la politique en faveur des agrocarburants. Il évoque notamment la crise récente, celle de 2021-2022.
- Franck GALTIER
Le prix des céréales et des huiles a plus que doublé. Selon les indicateurs qu'on prend, ça peut être un doublement, un triplement des prix sur les marchés internationaux. L'enjeu, c'est surtout la flexibilisation des politiques. On est un certain nombre d'économistes à défendre l'idée que quand une crise se produit sur les marchés internationaux, c'est-à-dire quand le prix du maïs ou le prix des huiles dépasse un certain niveau, qu'il faudrait interdire ou plafonner l'utilisation de ces produits pour faire du carburant.
- Inf'OGM
Nuançons un peu les propos de Franck Galtier. Il y a une certaine flexibilité. En 2015, par exemple, l'Union européenne a décidé de réduire son pourcentage obligatoire d'incorporation de 10% à 7%.
Nos deux interlocuteurs, critiques sur cette première génération d'agrocarburants, estiment qu'une nouvelle génération pourrait être plus pertinente, plus intéressante. Il s'agit d'utiliser d'autres matières premières végétales qui n'entreraient pas en compétition avec la production nourricière comme source de biomasse pour les agrocarburants. Cette nouvelle génération fait souvent appel à des modifications génétiques. Nous allons nous attacher à comprendre cette nouvelle génération d'agrocarburants et voir si cet espoir est confirmé. Comme nous le disions au début de cet épisode, il faut bien avoir en mémoire qu'actuellement, 99% d'agrocarburants utilisés dans le monde sont de première génération. Trois stratégies qui utilisent des modifications génétiques sont actuellement en cours de développement. Premièrement, produire de la biomasse par des plantations d'arbres OGM à croissance rapide, comme les eucalyptus ou peupliers, ou d'herbes dédiées comme le miscanthus. Cette stratégie pose des problèmes assez similaires à celles des cultures alimentaires évoquées en début d'épisode. Ces monocultures remplaceront des forêts naturelles, des prairies, des friches, autrement dit des espaces riches en biodiversité. La seconde stratégie est la mise en culture d'algues génétiquement modifiées pour tirer parti de leur capacité à absorber du CO2 et produire, par photosynthèse, des huiles pouvant être transformées en biodiesels. Selon un article publié en 2024 dans la revue Frontiers in Genome Editing, la majorité des projets de modification génétique de micro-algues concernent les agrocarburants. La troisième stratégie que nous allons détailler consiste à utiliser en théorie des déchets, des résidus de culture alimentaire ou agricole, et de les transformer en agrocarburants grâce à des micro-organismes génétiquement modifiés. Cela devrait donc permettre de réduire les impacts évoqués dans la première partie de l'épisode. Benoît Gabriel, professeur à AgroParisTech que nous avons écouté précédemment, nous dit :
- Benoît GABRIEL
Les avantages des carburants deuxième génération, c'est qu'on les fabrique à partir d'une biomasse très générique, en gros des feuilles, des tiges, des branches d'arbres, donc pas forcément de la matière première alimentaire. On n'a pas besoin de farine de blé, on n'a pas besoin d'huile de colza pour faire ces biocarburants, donc on n'a pas besoin de surface en plus. Le deuxième avantage, c'est qu'on produit cette biomasse avec très peu d'intrants, très peu de produits comme des engrais, etc. Donc on a des bilans en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont bien plus intéressants.
- Inf'OGM
Comment peut-on faire du carburant avec des pailles, des branches, des feuilles ? En utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés. De nombreuses entreprises se sont lancées sur ce créneau. Amyris, Carbios, Metex, mais aussi les multinationales pétrolières comme ExxonMobil, TotalEnergie, BP. Un grand projet de recherche, Futurol, a mis au point un procédé qui mobilise des micro-organismes OGM pour dégrader la cellulose et produire des agrocarburants. Ce procédé est actuellement développé par l'entreprise Accens, une filiale de l'Institut français du pétrole énergie nouvelle (IFPEN). Futurol regroupe des acteurs publics, comme l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), et des entreprises privées comme Lessaffre, Tereos, Total Energie, Unigrain. L'INRAE précise que les forces mobilisées par l'INRAE pour mener à bien le projet Futuroll représenteront en moyenne 16 personnes par an pendant 8 ans, chercheurs, ingénieurs et thésards. Ce n'est pas anodin et impossible de savoir quelle part reviendra au service public une fois le procédé commercialisé. Jean-Guy Berrin, Directeur de recherche à INRAE au laboratoire Biodiversité et Biotechnologie Fongique, étudie dans son laboratoire à Marseille les enzymes des champignons qui sont impliqués dans la dégradation de la cellulose, c'est-à-dire la paroi des plantes. Ce chercheur, qui a participé au programme Futurol, nous décrit ce procédé.
- Jean-Guy BERRIN
Les micro-organismes impliqués sont principalement des champignons et des levures. Les champignons sont utilisés pour déconstruire la biomasse. Donc la découper en petits morceaux et les levures sont impliquées dans le processus pour fermenter les sucres en éthanol, notamment éthanol carburant, en alcool.
- Inf'OGM
Arrêtons-nous déjà sur un point : les champignons dégradent naturellement le bois. C'est ce qui se passe dans une forêt. Mais il s'agit dans ce programme de recherche appliqué d'optimiser ce processus.
- Jean-Guy BERRIN
Aujourd'hui, l'objectif notamment des industriels, c'est d'améliorer ce champignon trichoderma reesi. Et pour l'améliorer, en effet, on utilise des outils génétiques, des modifications. Alors au départ, il a été modifié de manière aléatoire, avec de la mutagénèse aléatoire, en utilisant par exemple des ultraviolets ou des molécules chimiques. Puis on est arrivé à un plateau où on n'arrivait plus à améliorer ce champignon et ses performances. Donc là, les dernières améliorations qui ont lieu, c'est des améliorations beaucoup plus ciblées. où on va améliorer le champignon en lui rajoutant des enzymes qu'on est allé piocher dans la biodiversité naturelle, donc des enzymes d'autres champignons, pour l'équiper un peu mieux et qu'il soit plus performant dans le procédé.
- Inf'OGM
Oui, plus ciblé. Cela ne veut pas dire que la maîtrise est totale. Il y a toujours des effets non intentionnels, dont certains inconnus, dans toute manipulation génétique, peu importe les techniques utilisées. En tout cas les chercheurs ont mis au point un super champignon capable de dégrader plus facilement la biomasse. Faudrait pas qu'ils se retrouvent dans la nature et qu'ils grignotent nos forêts, nos taillis et nos charpentes.
- Jean-Guy BERRIN
Ce qui s'est passé ces 10-20 dernières années, c'est de développer un processus où on va aller extraire les sucres de la biomasse lignocellulosique et notamment de la cellulose. Et là, les sucres se retrouvent emprisonnés dans le polymère. Donc c'est des polymères assez récalcitrants à la dégradation. Donc c'est comme ça que les plantes se défendent dans la nature, et c'est comme ça que les plantes survivent et ne sont pas dégradées si facilement que ça par les micro-organismes. Mais en fait, les micro-organismes comme les champignons ont évolué dans la nature pour arriver à déconstruire notamment la cellulose et à la couper en petits morceaux. Et lorsqu'on coupe en petits morceaux la cellulose, on obtient du glucose. Donc le glucose, c'est une molécule très simple, et c'est la molécule qui est fermentée ensuite en alcool.
- Inf'OGM
Ajoutons que dans la nature, la dégradation des molécules organiques complexes est très longue. Elle se déroule sur des dizaines d'années et parfois plus dans les forêts naturelles. Donc à cette étape du processus, en utilisant un champignon génétiquement modifié, on a transformé en sucre, en glucose, de la biomasse cellulosique, ou en français courant, du bois de la paille. La deuxième étape consiste à fermenter ce sucre pour le transformer en éthanol. qu'intervient une levure génétiquement modifiée ?
- Jean-Guy BERRIN
La levure qui est utilisée dans ces procédés agrocarburants, ce n'est pas exactement la même levure que celle qu'on utilise pour faire de la pâtisserie ou des procédés empiriques. C'est une levure qui arrive à tolérer notamment l'éthanol, puisque quand elle va transformer le glucose en éthanol, on va obtenir des titres d'éthanol ou des concentrations d'éthanol assez importantes. Donc il faut que cette levure soit optimisée pour tolérer l'éthanol. Et ensuite, ce sont des levures qui sont capables de fermenter plusieurs types de sucres, comme le glucose, le xylose, la rabinose, le galactose, le manose, plusieurs monomères.
- Inf'OGM
Quand Jean-Guy Berrin dit "optimisé", il faut comprendre, génétiquement modifié. Ces levures OGM seront utilisées dans un milieu confiné. Cependant, l'étanchéité parfaite des fermenteurs est un leurre. Ainsi, une dissémination de ces levures et champignons OGM de Futurol est possible. La dissémination de ces transgènes peut aussi se faire via les résidus de fermentation utilisés dans l'alimentation animale ou comme engrais comme cela est proposé. Les promoteurs affirment que ces résidus sont exempts de levures ou de champignons vivants. Des exemples nombreux de restes de micro-organismes dans le produit de fermentation existent cependant, car les procédés industriels de purification laissent parfois à désirer. Ont-ils fait une analyse biochimique pour savoir s'il y a des transgènes dans ces résidus ? Comment vont-ils évoluer, se disséminer ? Et donc, grâce à ces nouveaux micro-organismes, l'idée de départ est de faire autrement, d'éviter d'empiéter sur les cultures alimentaires, en utilisant des pailles de céréales, des résidus d'agroforesterie. Certains évoquent même l'idée d'utiliser les vieux meubles des déchetteries comme ressources. Cette idée semble pertinente et permettrait d'éviter les impacts que nous avons évoqués précédemment. Mais existent-ils des limites à l'utilisation de ces déchets ?
- Jean-Guy BERRIN
L'idée n'est pas de raser des forêts ou d'utiliser toutes les biomasses lignocéllulosiques disponibles sur le territoire pour en faire des agrocarburants. Ce n'est pas du tout l'idée.
- Inf'OGM
Jean-Guy Bérin, en effet, nous explique qu'il faut un retour au sol, car tous ces résidus ont un rôle de fertilisant naturel, indispensable à la vie des sols. Ceci limite de facto la biomasse disponible.
- Jean-Guy BERRIN
Il y a cette conscience collective qu'il faut retourner au sol une partie de la biomasse végétale et prélever qu'un certain pourcentage pour ces procédés-là. Donc en fait, les études ont montré qu'en calcul, notamment les gaz à effet de serre, par exemple l'avantage que peuvent présenter les agrocarburants par rapport à des carburants classiques, fossiles. Les études ont montré qu'il fallait prendre en compte d'où vient la biomasse et les pratiques agricoles quand il s'agit de coproduits agricoles.
- Inf'OGM
Benoît Gabriel, d'AgroParisTech, insiste sur cette idée de ne pas tout prélever.
- Benoît GABRIEL
Pour donner une règle très simple, on ne peut pas exporter les pailles plus d'une fois tous les trois ans. Donc en fait, on va laisser au sol deux tiers de la biomasse des pailles pour qu'elles entretenissent la matière organique, la fertilité, la qualité des sols, ses propriétés physiques, etc. Mais on sait qu'on ne peut pas prélever non plus tous les résidus de la forêt.
- Inf'OGM
Franck Galtier du CIRAD va plus loin et nous met aussi en garde sur la notion de déchets valorisables.
- Franck GALTIER
Le fait d'avoir une filière qui transforme des produits considérés comme des déchets, induit forcément une tendance à favoriser la production de ces déchets et aussi à qualifier comme déchets des produits qui en fait ne sont pas des vrais déchets puisqu'ils sont utilisés autrement. Et donc ça c'est un peu les effets pervers, on va dire, auxquels on peut s'attendre du développement des agrocarburants de deuxième et troisième génération, mais plus généralement de toutes les politiques ou stratégies d'économie circulaire ou de recyclage qui visent à utiliser des produits considérés comme des déchets ou des terres considérées comme des friches. Du coup, ça risque de favoriser la production de déchets et l'invisibilisation des usages qui étaient faits auparavant de ces produits.
- Inf'OGM
Et cette prudence, préconisée par les chercheurs, de ne prélever que partiellement ces coproduits, est-elle suivie par les industriels ? Il semblerait que non.
Jean-Guy Berrin nous signale que le procédé mis au point par le programme de recherche Futurol et commercialisé par Axens a été vendu et sera expérimentée dans deux usines, l'une en Croatie, l'autre en France. L'usine croate, située à Sisak, appartient au groupe pétrolier INA. Elle entend produire 55 000 tonnes d'éthanol annuellement en utilisant, je cite, des matières premières lignocellulosiques, telles que les résidus agricoles, et des cultures énergétiques comme le Miscanthus gigantus. Donc, on a déjà dans l'idée de cultiver une plante, pour fournir la matière de ces agrocarburants nouvelle génération. Certes, ce sont des plantes qui semblent peu gourmandes en intrant, mais on a déjà quitté le projet idéal de n'utiliser que des déchets. On nous dit aussi que cette culture serait faite sur des terres abandonnées par l'agriculture nourricière. Cela pose notamment des questions de biodiversité. La faune et la flore sauvage aiment beaucoup ces rares zones abandonnées par l'être humain. À l'heure de la sixième extinction des espèces, d'origine anthropique cette fois-ci, il semble nécessaire de ne pas coloniser l'ensemble de la planète.
Et quand ces terres seront toutes exploitées ? Si la demande en carburant ne diminue pas, quelles terres seront converties pour y implanter ces cultures énergétiques ? Cette crainte que les déchets ou les friches ne suffisent pas à alimenter tous nos moteurs est réelle. Si on doit garder une partie des pailles et des branchages pour permettre au sol de se renouveler, si on veut continuer à rouler, voler, aller dans l'espace, et si le pétrole disparaît, quels écosystèmes seront mis à l'épreuve ?
Le Brésil est un pays qui a énormément misé sur les agrocarburants. Parmi les entreprises impliquées dans cette industrie, on retrouve l'entreprise française Tereos, qui possède notamment la marque de sucre Béghin Say. Le Brésil a autorisé plusieurs levures transgéniques pour transformer officiellement la bagasse en éthanol. La bagasse, c'est le résidu fibreux de la canne à sucre une fois qu'on l'a pressée pour en extraire le sucre. La bagasse est considérée comme un déchet. Donc en théorie, il n'y a pas de concurrence avec les cultures vivrières.
Mais une étude de la Fondation Getulio Vargas, réalisée en 2024, remet malheureusement en cause cette image idyllique. Marcello Santana, chercheur à l'École brésilienne d'économie et de finances, qui dépend de cette fondation, explique qu'il existe deux façons d'augmenter la production de canne à sucre : replanter plus souvent ou étendre cette culture à de nouvelles superficies.
Citons directement la conclusion : « notre étude a révélé que lorsque la production d'éthanol augmente au Brésil, seulement 8% du nouvel éthanol provient de la canne à sucre qui a été plantée de manière plus intensive. Les 92% restants proviennent de nouvelles zones ». Et de poursuivre : « dans cette recherche, nous avons identifié que 20% de ces nouvelles zones étaient à l'origine des forêts, ce qui implique la déforestation pour produire les plantes nécessaires pour produire ce biocarburant. 70% des nouvelles zones étaient soit des pâturages, soit elles cultivaient d'autres cultures, tels que le blé et le maïs ».
Pour le dire autrement, les carburants produits à partir de cannes à sucre et de levure transgénique ont participé à la déforestation au Brésil. Cette publicité d'un biocarburant produit uniquement par fermentation d'un déchet ne tient donc pas la route.
Mais cette publicité est largement diffusée en France, notamment autour du projet d'une énorme usine de biocarburant de seconde génération à Lacq, près de Pau. Ainsi, son directeur affirmait sur France Bleu « Élyse Énergie s'engage à ce que deux tiers de cette biomasse proviennent de résidus, de déchets et les 10% restants de production forestière. »
Écoutons Emmanuel Macron.
- Emmanuel MACRON
On va réinventer un avenir énergétique et industriel à Lacq avec BioTJet qui grâce justement à un jeune acteur français qu'on va accompagner, va créer 700 emplois directs et va nous permettre de créer ce e-biocarburant que vous allez utiliser.
- Inf'OGM
Nous avons interrogé Jacques Descargues, ancien secrétaire général de l'Office national des forêts (ONF), entre 1986 et 2005, et actuellement membre du collectif Forêts vivantes des Pyrénées, qui s'oppose à cette usine. Avec un investissement prévisionnel de 2 milliards d'euros, elle sera dédiée à la production de carburant pour l'aviation et le transport maritime en transformant de la biomasse liquéfiée avec des micro-organismes génétiquement modifiés. La start-up Élise, qui est aux manettes, évoque un objectif de 75 000 tonnes de kérosène d'origine naturelle en 2028, soit 1,3% des besoins de l'aviation civile en France. Jacques Descargues nous donne quelques chiffres pour montrer ce que cela implique en termes de ressources.
- Jacques DESCARGUES
Pour produire 75 000 tonnes de biocarburant pour l'aviation, il faudrait à peu près 500 000 tonnes de biomasse essentiellement forestière. Mais on mobiliserait aussi de la biomasse agricole, des noyaux, de l'agroalimentaire, etc. Et on utiliserait aussi des récupérations des déchets agricoles et des déchets forestiers. Mais là, il y a un grand flou sur la répartition de cette biomasse qui est nécessaire pour fabriquer effectivement le biocarburent. À moyen terme, c'est quasiment impossible d'alimenter l'usine uniquement avec des déchets du secteur agricole, des haies et de la paille. C'est tout à fait irréaliste. Il faudra qu'ils utilisent de la biomasse forestière. directement ou indirectement. Pour avoir 500 000 m3 de bois, il faut environ 20 000 hectares de forêt. En moins de 10 ans, ça veut dire qu'il faudrait couper l'équivalent de la forêt de Fontainebleau ou du massif d'Iraty. Les études qui ont été faites tant au niveau national qu'au niveau local montrent qu'il n'y a plus de disponibilité. Dans la mesure où la forêt est impactée par le réchauffement climatique, la productivité de la forêt a baissé de 53% en moins de 10 ans. Et d'ailleurs, ils ne se cachent pas pour dire que de toute façon, eux, c'est pour l'aviation, donc ils auront les moyens de surpayer ces produits, ce qui veut dire qu'ils sont prêts à déclencher une concurrence commerciale forte sur tout le secteur de la filière bois. Ce qui est le paradoxe le plus important, c'est que ce projet serait conforme à peu près à la réglementation européenne en termes de bilan carbone, parce que l'Europe et la France, l'État français, considèrent que la forêt est renouvelable. Donc couper de la forêt serait neutre sur le point carbone. Mais quand on fait des calculs concrets, on voit que pendant les 20 premières années au minimum, ce nouveau carburant émettra plus de CO2 que si on consommait du kérosène issu de ressources fossiles.
- Inf'OGM
Jean-Guy Berrin expliquait qu'il fallait de l'eau pour transformer cette biomasse en agrocarburant.
- Jean-Guy BERRIN
Dans le procédé, l'eau est bien entendu importante, ne serait-ce que pour traiter la biomasse au départ et obtenir la biomasse sous forme liquide après le broyage et pour produire les enzymes de champignons puisqu'en fait on force les champignons à produire les enzymes d'intérêt dans des grands bioréacteurs.
- Inf'OGM
Jacques Descargues explique qu'il faut beaucoup, beaucoup d'eau pour faire fonctionner ces fermenteurs où les micro-organismes produisent ces carburants.
- Jacques DESCARGUES
Pour l'eau, il y aurait un prélèvement d'à peu près 8 millions de mètres cubes. Là, actuellement, ils essaient de baisser ce besoin, mais ça représente une augmentation très significative, d'autant que la région Aquitaine est une région qui est la plus sensible sur la crise hydrique. Et donc, on a effectivement une très grosse inquiétude au niveau de la gestion de l'eau.
- Inf'OGM
Mais plus fondamentalement, Jacques Descargues considère que ce projet est voué à l'échec et que l'argent public investi est gaspillé.
- Jacques DESCARGUES
Ce projet de Lacq est inquiétant dans la mesure où tous les projets qui ont été lancés au niveau international pour faire du kérosène à partir de la biomasse ont tous échoué. Donc sur le plan technique, aujourd'hui, on n'a aucune garantie ni précision sur la fiabilité du processus technologique qui va être mis en œuvre. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le PDG Total, en audition au Sénat, a dit très clairement que ça marchait à peu près en laboratoire, mais ça ne marchait pas sur le plan industriel. Pour produire du kérosène, il faut du bois de très grande qualité. Dès qu'on a du bois de qualité inférieure et à fortiori des déchets, le système ne fonctionne pas. Là, ils nous disent qu'ils ont trouvé la solution. Et il y a eu effectivement un pilote au niveau de la recherche qui a été fait à Dunkerque. Mais ce pilote, on sait qu'il a produit de très petites quantités de production. Ce pilote a été financé par l'État. Et malgré cela, on n'a aucune information sur les conclusions de ce pilote. Aucune. On nous dit « circulez, secret industriel , il n'y a rien à voir ».
- Inf'OGM
Nos interlocuteurs semblent unanimes. On ne pourra pas remplacer le pétrole par de la biomasse à consommation égale. D'autant que, comme nous le rappelle Jean-Guy Berrin, la biomasse est vouée à être utilisée pour de nombreux autres usages. La pression sur la biomasse va s'amplifier. Écoutons-le encore.
- Jean-Guy BERRIN
Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas que de produire de l'éthanol carburant à partir de biomasse inocéliosique, c'est de remplacer toute la filière du pétrole et toute la chimie qui est issue du pétrole.
- Inf'OGM
Le rêve de la bioéconomie est plein de promesses, mais notre enquête soulève de nombreuses inquiétudes et difficultés. L'historien Jean-Baptiste Fressos nous informe qu'il n'y a jamais eu de transition technologique qui nous a permis de consommer moins de matière. Elles se sont ajoutées. Il dit : « Il faut retenir une chose de l'industrialisation On a consommé une plus grande variété de matière et chacune a été consommée en quantité supérieure ». Car pour extraire le charbon des mines, on a utilisé toujours plus de bois. Pour développer le pétrole et les voitures, on a utilisé toujours plus de charbon. Et on pourrait faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. On développe les agrocarburants, mais on continue d'investir massivement dans le pétrole. L'ONG Reclaim Finance dit que les banques ont accordé 2700 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris. avec un volume de financement en hausse chaque année depuis 2016. Nous laisserons la conclusion à Jacques Descargues.
- Jacques DESCARGUES
Donc on est effectivement dans cette fuite en avant, où les humains n'arrivent pas à accepter l'idée qu'il va falloir avoir des politiques de sobriété si on veut continuer à exister. Mes collègues forestiers me disent : « Jacques, il ne faut pas t'inquiéter, les forêts existeront demain, l'espèce humaine, on en est pas sûr ».
- Inf'OGM
Vous venez d'entendre « OMG ! Décodons les biotech », le podcast du média indépendant Inf'OGM.
Ce podcast a été réalisé par Charlotte Coquard et Christophe Noisette, avec le soutien technique de Plink! et en particulier Pierre-Henri Samion et Rémi Sanaka. La musique originale a été réalisée par Julien Fauconnier de Studio Time. Merci à toute l'équipe d'Inf'OGM et en particulier à Hélène Tordjman, Antoine Vépierre et Sylvain Willig.
Nous tenons à remercier les bailleurs qui nous ont permis de réaliser ce podcast : les fondations Ecotone, Olga et Nature et Découvertes et le ministère de la Culture. Pour en savoir plus sur les OGM et les biotechnologies, retrouvez toutes nos infos sur infogm.org.