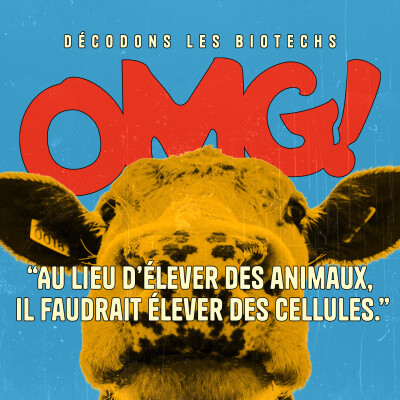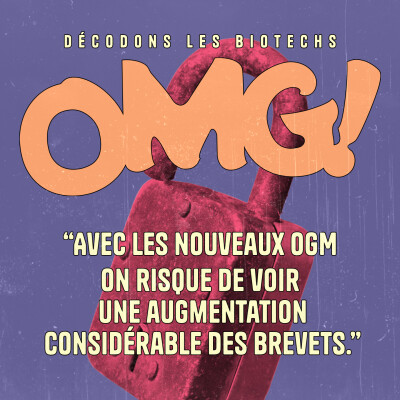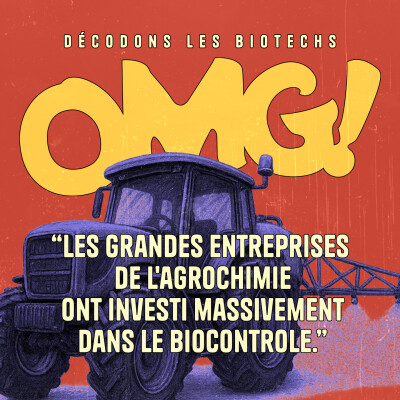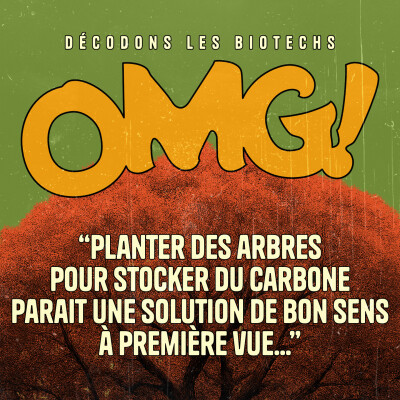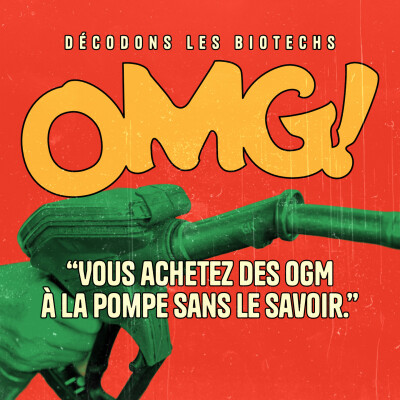- Inf'OGM
La volonté de produire plus de viande, de lait, de laine a toujours été un des objectifs de la sélection animale depuis que l'humain s'est sédentarisé.
Mais au milieu du XXe siècle, une rupture s'est produite. Alors qu'une vache produisait en moyenne 2000 litres de lait par an dans les années 60, on arrive aujourd'hui à 10 000 litres pour certaines vaches de la race Prim Holstein, 10 fois son poids.
Dans cette lignée, l'industrie modifie génétiquement des animaux pour qu'ils grossissent toujours plus vite. Ce serait soi-disant une réponse à l'impact environnemental de l'élevage. Et face aux voix qui s'élèvent pour dénoncer tant l'impact sur le climat que les maltraitances animales, l'industrie développe également de la viande de synthèse. En quoi les modifications génétiques ou la viande in vitro permettent de répondre aux critiques de l'élevage ?
Pour comprendre cela, nous avons dans ce quatrième épisode de "OMG Décodons les biotech" interrogé plusieurs chercheurs, une éleveuse et une association qui défend l'alimentation végétale.
La question de l'élevage n'est pas qu'une affaire d'économie et de calories. Il y a une dimension émotionnelle importante. Beaucoup d'animaux, êtres sensibles, ont co-évolué avec l'être humain. Et parler de l'élevage est souvent un sujet qui divise.
Sélectionner les animaux d'élevage pour qu'ils produisent plus de viande par tête, c'est une vieille idée. Désormais, l'industrie veut créer des animaux sortent d'usines à viande ou à lait en les modifiant génétiquement. Elle argumente que la population mondiale augmente, qu'il faut la nourrir et donc améliorer considérablement selon leurs mots l'efficacité des animaux. Comme dans mes précédentes enquêtes, je retrouve les mêmes arguments de l'industrie pour justifier ces innovations. Ensemble, essayons de comprendre ce qu'il en est réellement.
Je découvre que pour booster génétiquement la productivité des animaux, il existe deux stratégies, expérimentées dès les années 90.
La première stratégie consiste à modifier génétiquement des animaux pour qu'ils produisent plus d'hormones de croissance. Elle a surtout été testée sur des poissons.
En 1989, une entreprise, Aquabounty, insère dans le génome de saumon atlantique deux transgènes, issus du saumon chinouk et de la loquette d'Amérique. L'ensemble doit permettre une production d'hormones de croissance en permanence, stimulant l'appétit du saumon qui est alors censé grandir environ 2 à 4 fois plus vite que le saumon d'élevage conventionnel. Plus de 30 ans après, l'entreprise annonce un arrêt de cette production. Elle n'aura produit que quelques tonnes de ce saumon. Quelques autres poissons OGM ont été autorisés à la commercialisation, mais jamais dans des quantités importantes. J'ai d'abord discuté avec Marc Vandeputte, chercheur à l'Institut National de Recherche sur l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, sur les questions piscicoles pour comprendre l'échec de ce saumon transgénique.
- Marc Vandeputte - Inrae
Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que c'est économique, sociétal ou technique ? Alors, il y a déjà un aspect économique qui est lié aux performances de ces animaux. Pour le saumon Aquadvantage, je ne pense pas qu'il grandissait plus vite. que les saumons sélectionnés par des méthodes classiques sur la croissance. Peut-être qu'ils le faisaient en 1989, mais pas aujourd'hui. Il y a à l'évidence aussi un problème sociétal. Nulle part, le public ne demande à consommer ce genre de produit-là. Il y a peut-être des endroits où ils s'en moquent, mais nulle part ils le demandent.
- Inf'OGM
Quant aux autres projets, comme le tilapia génétiquement modifié, il nous dit également
Le Center for Aquaculture Technologies et son tilapia au Brésil. Il dit qu'il est plus efficace, mais on a juste à écouter ce qu'il nous dit. On n'a pas de données, il n'y a pas de publication, il n'y a rien. Pourquoi ce poisson OGM ne grossit pas plus vite qu'un poisson sélectionné traditionnellement ? La première explication, ce sont les difficultés à modifier un animal et les effets indésirables que cela génère.
- Marc Vandeputte - Inrae
On a l'idée de penser que ces modifications génétiques, ça donne tout de suite. un impact important sur la production. Alors, c'est vrai qu'on peut obtenir des modifications assez spectaculaires, mais en fait, il faut du temps pour obtenir une lignée utilisable. Avec les techniques classiques de transgénèse, il fallait au minimum trois générations. Et on a pensé qu'avec les technologies de type CRISPR, qui étaient beaucoup plus efficaces, on allait aller beaucoup plus vite. Et en fait, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a toujours ce qu'on appelle des problèmes de mosaïcisme, c'est-à-dire que quand on fait la transformation génétique, toutes les cellules de l'animal ne sont pas impactées et en fait il faut une, deux, trois générations pour obtenir des lignées qu'on appelle stables et homozygotes qui vont pouvoir se reproduire à l'identique et être utilisées en production.
- Inf'OGM
D'autre part, plusieurs études ont montré que la modification du taux d'hormones de croissance dans le corps des animaux ... peut entraîner de nombreux autres effets. Cette hormone agit sur d'autres caractères. Un rapport de la Société royale du Canada de 2001 nous dit que ces effets non intentionnels sont la règle et non l'exception chez le poisson génétiquement modifié. Le rapport donne des exemples. Modification de l'activité enzymatique, de l'anatomie générale, du comportement et selon toute vraisemblance de l'activité hormonale. D'autres études documentent des anomalies morphologiques chez des saumons transgéniques, mais aussi des atteintes au bien-être, des changements de comportement et, au final, un risque pour les capacités de survie des poissons. Marc Vandeputte me précise également un autre problème lié aux conditions d'élevage.
- Marc Vandeputte - Inrae
Aujourd'hui, on n'a pas un seul poisson transgénique, que ce soit Aquadvantage ou les deux poissons au Japon, qui soit élevé dans des conditions normales. On est dans des circuits fermés à terre. pour être sûr qu'ils ne s'échappent pas. Et ça, ce n'est pas les conditions de meilleure rentabilité. Aujourd'hui, un poisson de mer, la meilleure rentabilité, elle est dans des cages en mer. Sauf que là, ce n'est pas possible. Même les pays qui autorisent la commercialisation n'autorisent pas aujourd'hui ce type d'élevage. C'est sûr que si on met des poissons dans des cages en mer, ils vont s'échapper. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà, il y aura des accidents. Il y en a qui vont se retrouver dans le milieu naturel.
- Inf'OGM
Ah, mais quels sont les risques pour les poissons sauvages s'ils se croisent avec des poissons OGM ?
- Marc Vandeputte - Inrae
Donc, si les poissons transgéniques se trouvent plus doués pour copuler avec leurs congénères sauvages, mais que leurs descendants sont moins performants, alors ils risquent d'entraîner la population dans une spirale d'extinction. Ou alors, s'ils sont vraiment beaucoup plus performants, effectivement, ils risquent d'envahir la population et de la remplacer. Quand ils l'ont fait sur les saumons modifiés pour l'hormone de croissance, ce qu'on a vu, c'est que ces poissons... Dans le milieu pseudo-naturel, ils ne grandissaient pas plus vite que les autres parce qu'il fallait qu'ils trouvent leur nourriture. Et contrairement à un milieu d'élevage où il n'y a qu'à ouvrir la bouche pour que la nourriture vous tombe dedans, là, il faut aller la chercher. Et la deuxième chose qu'ils ont montré, ces animaux, avec leur hormone de croissance, ils avaient tout le temps faim. Donc, ils étaient tout le temps dehors à essayer de trouver de la nourriture et beaucoup moins prudents par rapport aux prédateurs. Et ils se faisaient manger en priorité. et très probablement, si on les relâchait dans le milieu naturel, ils seraient éliminés rapidement par la sélection naturelle.
- Inf'OGM
Précisons que ce milieu naturel simulé n'est pas un modèle mathématique. Il s'agit de se rapprocher au plus près des conditions naturelles. Marc Vandeputte est donc plutôt confiant quant aux risques liés aux poissons hormonés. Mais le développement probable de poissons issus des nouvelles techniques génétiques pourrait apporter des avantages sélectifs pour les poissons modifiés. Dans ce cas, le chercheur rappelle que l'industrie cherche à stériliser ses poissons.
- Marc Vandeputte - Inrae
Je pense que si on travaille sur la stérilité, c'est justement pour limiter les risques. Parce qu'effectivement, s'il se met à y avoir des poissons édités, produits un peu partout dans le monde, et peut-être dans des pays à la réglementation moins stricte que l'Europe, ça serait quand même pas mal qu'on puisse contrôler qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature.
- Inf'OGM
Mais bon, la stérilité ne sera jamais absolue, c'est un leurre. C'est en tout cas ce qu'a conclu l'agence norvégienne en charge d'évaluer les risques d'un élevage de saumons génétiquement modifiés dans des cages en pleine mer. Donc, première stratégie, je disais, booster les hormones par la génétique. Ça n'a pas l'air de bien marcher. La deuxième stratégie... consistent à modifier génétiquement un animal pour bloquer le gène responsable de la myostatine. La myostatine est une protéine qui limite la croissance musculaire. Cela a été testé sur de nombreuses espèces, cochons, moutons, chevals, bovins, etc. Aucun de ces animaux n'a été commercialisé. Par croisement conventionnel, certains bovins, notamment ceux de la race blanc-bleu-belge, ont déjà une masse musculaire hypertrophiée. L'intérêt de la modification génétique est d'étendre cette innovation à toutes les races bovines et à toutes les espèces domestiques. Mais ces projets se heurtent à de nombreux problèmes. Jean-François Hocquette, également chercheur à l'INRAE et président de l'association française de zootechnie, en évoque certains.
- Marc Vadeputte - Inrae
Effectivement, les animaux culards sont tellement gros qu'il y a des difficultés à la naissance et qu'il faut pratiquer de façon systématique une césarienne, ce qui n'est pas forcément bon en termes de bien-être animal.
- Inf'OGM
Et qui dit césarienne dit intervention vétérinaire, donc coût et limite à l'autonomie paysanne. Et Jean-François Hocquette souligne également que
- Marc Vadeputte - Inrae
L'hypertrophie musculaire en général a des répercussions globales sur le bien-être de l'animal, que ce soit en termes cardiaques, que ce soit en termes de fatigue musculaire. Et effectivement, quand il y a une masse musculaire trop importante, ça pose tout un tas de problèmes annexes.
- Inf'OGM
Donc, les deux stratégies pour rendre les animaux plus gros fonctionnent mal, avec surtout des atteintes importantes à la santé et au bien-être animal. Finalement, les chercheurs interrogés pensent que la sélection classique, sans modification génétique, est plus efficace. Ainsi, Marc Vandeputte souligne
- Marc Vadeputte - Inrae
Pour ce qui est de la sélection classique, on va choisir les meilleurs animaux à l'intérieur d'une population, mais quand on va modifier un gène, Pour augmenter d'un seul coup la vitesse de croissance, on n'est pas du tout sûr qu'on ait ces bénéfices de meilleure robustesse, de meilleure adaptabilité des poissons.
- Inf'OGM
Pierrick Haffray, qui travaille au Sysaaf, un syndicat professionnel regroupant des entreprises de sélection avicole et piscicole, fait le même constat.
- Pierrick Haffray - Sysaaf
Aujourd'hui, les travaux qu'on a conduits avec les entreprises françaises de sélection sur la truite ou sur le bar, montrent qu'après 20 ans de sélection, les animaux sont 20% plus efficaces. Ça veut dire qu'ils ont consommé moins d'aliments pour reproduire autant.
- Inf'OGM
Évidemment, il y a une logique économique. Jean-François Hocquette reconnaît que le modèle économique est basé sur la taille et il le dénonce.
- Marc Vadeputte - Inrae
Évidemment, le modèle économique de la filière viande est basé sur des critères assez simples pour rémunérer les éleveurs, c'est-à-dire le type d'animal... le poids des animaux, la conformation des carcasses et l'engraissement des carcasses. Certainement qu'il faudrait faire évoluer ce modèle économique.
- Inf'OGM
Mais il y a un autre débat derrière cela. Le raisonnement qui sous-tend cette logique du toujours plus gros est le suivant. Si les animaux grandissent plus vite, ils consomment moins de calories pour en produire autant ou plus. Donc on peut nourrir plus de personnes avec moins de matières premières, d'énergie, de pollution. C'est tout bénef. L'élevage intensif aurait alors moins d'impact environnemental. Jean-François Hocquette aborde cette question de façon assez subtile.
- Jean-François Hocquette -
Quand un animal produit beaucoup de viande ou beaucoup de lait, on prend sa production de gaz à effet de serre, c'est le numérateur, qu'on divise par une quantité de lait ou par une quantité de protéines importantes ou de viande importante, et de ce fait, comme le dénominateur c'est un grand nombre, On a une production de gaz à effet de serre par kilo de viande produit qui est faible comparativement à l'élevage extensif ou à l'animal peu producteur. Mais inversement, dans un élevage extensif où l'animal produit moins, il dépense plus d'énergie à se promener pour trouver l'herbe par exemple, on est dans un cas de figure où l'animal, c'est essentiellement un ruminant, va... à convertir de l'herbe que nous, êtres humains, on ne peut pas manger, en viande et en lait. Donc tout dépend comment on calcule l'efficacité et la production de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on considère uniquement les protéines consommables par l'Homme ? Et dans le cas de l'élevage extensif, on convertit des protéines non consommables par l'homme en protéines consommables par l'homme. Donc avec ce raisonnement. l'animal est extrêmement efficient cis-à-vis de l'Homme.
- Inf'OGM
Pour compléter, j'ai interrogé quelqu'un qui a une vision à l'autre bout du spectre, Anissa Putois, responsable de la communication à PETA France, association qui se bat pour établir et protéger les droits des animaux. Elle dénonce le syllogisme de départ.
- Anissa Putois
Alors oui, certes, l'animal grandit plus vite, donc dans son cycle polluera moins. Mais si on met ça dans le contexte plus grand de la production générale de l'élevage, on n'a pas de moment où l'élevage va être vide parce que l'éleveur perdrait de l'argent. On a par rapport à cela plus d'animaux et donc plus de pollution. Parallèlement à la quantité d'animaux qui vont être produits, qui sera plus importante vu que les animaux seront tués plus rapidement. On aura une pollution qui sera toujours croissante.
- Inf'OGM
Face à ces problèmes biologiques et éthiques, il n'est pas sûr qu'un animal génétiquement modifié pour grossir beaucoup plus vite voit le jour bientôt. Mais d'autres projets de modification génétique des animaux sont en cours. Le nouveau credo est de les adapter aux changements climatiques et d'améliorer, cette fois, le bien-être animal. Ce sont les arguments publicitaires mis en avant. Mais qu'en est-il ? Concernant les poissons, Pierrick Haffray et Marc Vandeputte nous disent qu'il existe aujourd'hui des investissements importants en Norvège et au Canada, justifiés par le bien-être animal. Ils prennent l'exemple du pouls de mer chez le saumon.
- Marc Vandeputte - Inrae
Plus le poisson va rester longtemps dans la mer, plus il va être exposé et plus il va falloir le traiter pour éliminer les pouls de mer. Donc aujourd'hui, il y a certes... Certains sélectionneurs norvégiens pensent que la méthode la plus efficace pour sélectionner des animaux qui craignent moins le pouls de mer, c'est d'avoir des animaux à croissance plus rapide qui vont rester moins longtemps dans le milieu exposé.
- Inf'OGM
Cependant, certains articles scientifiques affirment que ce sont les conditions d'élevage qui créent le problème avec les pouls de mer. Il a même été montré que les élevages sont devenus une source de parasites pour le saumon sauvage juvénile se rendant en pleine mer. Une autre promesse, c'est d'adapter les animaux aux changements climatiques. Par exemple, des chercheurs néo-zélandais ont annoncé avoir réussi à rendre les tâches noires des vaches Holstein plus claires par manipulation génétique pour que les vaches aient moins chaud. En utilisant l'outil moléculaire CRISPR, ils ont supprimé un des gènes impliqués dans la production de la mélanine, une protéine responsable de la couleur foncée. Seuls deux veaux sont nés et aucun n'a survécu au-delà de 4 semaines, pour des raisons officiellement liées au clonage. Quand on sait que l'élevage nécessite de déforester pour produire du soja, largement OGM, que les animaux produisent un important gaz à effet de serre, le méthane, n'est-il pas un peu curieux de modifier les vaches pour qu'elles résistent mieux à la chaleur ? Mais le changement climatique est une préoccupation réelle pour les éleveurs. Marc Vandeputte le confirme, mais il se dit sceptique quant à la capacité à le faire en modifiant génétiquement les animaux.
- Marc Vandeputte - Inrae
Pour ce qui est des caractères sélectionnés chez les poissons, on pense souvent que le pisciculteur veut juste sélectionner des animaux qui grandissent plus vite. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres caractères qui sont beaucoup plus importants, comme l'aptitude à la transformation, la résistance aux maladies et maintenant aussi l'adaptation au changement climatique. Et par rapport au changement climatique, là, effectivement, on est aussi vraisemblablement sur des caractères complexes, c'est-à-dire où le fait que les animaux s'adaptent, ça va être lié à tout un tas de caractères d'aptitude des animaux et où probablement, ça sera difficile d'agir en modifiant un seul gène. Mais c'est compliqué quand même parce qu'il faut arriver à mesurer le caractère qui va vraiment nous intéresser. dans la tolérance au changement climatique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un poisson qui est capable de survivre à un pic de chaleur de 35 degrés ? Ou est-ce que c'est un poisson qui est capable de vivre sans tomber malade pendant 15 jours à 32 degrés ? Ou est-ce que c'est un poisson qui va continuer à manger même si la température est un peu excessive ? C'est compliqué. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu là-dedans.
- Inf'OGM
Mais Pierrick Haffray et Marc Vandeputte me parle d'un autre projet mené en Chine qui utilise les nouveaux outils de modification génétique.
- Marc Vandeputte - Inrae
Les carpes sans arêtes intermusculaires, ces petites arêtes qui restent dans les filets, c'est impossible à faire par sélection. Il y a une variabilité, mais entre une carpe qui a beaucoup d'arêtes et une carpe qui n'a pas beaucoup d'arêtes, on va en avoir 93 au lieu d'en avoir 97. Donc il faudrait 10 000 ans pour sélectionner des carpes sans arêtes. Et là, ils ont réussi en quelques années à faire ça. avec un bénéfice potentiel pour le consommateur.
- Inf'OGM
Des carpes génétiquement modifiées sans arrêt pour faciliter le travail de l'agroalimentaire. La question du bien-être animal est bien loin. Je commence à comprendre que l'objectif premier est d'adapter les animaux aux conditions d'élevage industriel, avec ses histoires de poux, et aux besoins de l'industrie agroalimentaire. Et Pierrick Haffray le dit explicitement.
- Pierrick Haffray - Sysaaf
C'est quand même un des enjeux majeurs de l'amélioration génétique, l'amélioration de la robustesse, de l'adaptation à l'élevage.
- Inf'OGM
Dans la série « Adaptons les animaux à l'élevage » , La question des vaches sans cornes mérite d'être discutée. Ces vaches sans cornes sont vendues comme une avancée éthique, réduisant les nuisances dans les élevages intensifs. Et il est évident que l'écornage facilite l'élevage des vaches dans des stabilisations exigues et limite le risque de blessures entre vaches et envers les humains. L'écornage est donc pratiqué largement. Et Agnet Spengler, qui travaille pour l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique en Suisse, nous dit qu'il s'agit d'une réelle source de douleur.
- Agnet Spengler
Si on écorne les petits veaux, ça c'est vraiment un grand problème parce que ça fait tellement mal et les veaux ont des douleurs, quelquefois pendant des mois.
- Inf'OGM
Elle nous explique en quoi ces fameuses cornes sont en réalité très importantes pour les bovins.
- Agnet Spengler
Les cornes ont aussi une fonction thermorégulatrice et ça c'est surtout important dans les pays. chaud, ou bien aussi chez nous, maintenant s'il fait toujours plus chaud, et on voit que dans les pays où il fait très chaud, on a toujours des animaux avec des très grandes cornes.
- Inf'OGM
On peut par exemple citer la race Ancolé-Watoussi, originaire d'Afrique, dont les cornes peuvent atteindre 1,80 m de long.
- Agnet Spengler
L'autre, bien sûr, c'est soigner le corps. Elles peuvent se crater avec les cornes. Peut-être ce qui est le plus important, c'est que les cornes sont aussi des armes. Et bien sûr, dans nos détentions à la maison, sur les fermes, ils n'ont pas vraiment besoin des cornes comme armes. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de loups sur les Alpes et si les animaux pâturent dans les montagnes, les cornes peuvent vraiment leur aider.
- Inf'OGM
Et donc ? au nom du bien-être animal, des entreprises ont cherché à obtenir des races sans cornes par sélection naturelle ou modification génétique. Recombinetics, une entreprise étatsunienne, a obtenu une autorisation de mise sur le marché d'une vache génétiquement modifiée sans cornes, au Brésil. Suite à une étude publiée dans le journal Nature Biotechnology en 2020, cette autorisation a été suspendue. Agnet Spengler nous explique pourquoi.
- Agnet Spengler
Si on veut sélectionner des vaches sans corne avec la modification génétique, on croit que ça va beaucoup plus vite, plus vite que la sélection normale. Mais peut-être vous savez qu'on est déjà en train d'essayer ça depuis dix ans. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de succès. Et le problème, c'était qu'on avait presque un succès. on avait un vous-même qui avait vraiment cette caractéristique avec cette modification génétique. Mais après, on a trouvé qu'il avait aussi hérité des bactéries résistantes contre les antibiotiques. Et on voyait qu'on ne peut pas utiliser ce taureau parce qu'il va transmettre cette caractéristique aux autres animaux. Si on fait la modification génétique, on a toujours le risque Merci. de transmettre des caractéristiques qu'on ne veut pas et qu'on ne sait pas.
- Inf'OGM
Ce que me dit Agnet Spengler, Jean-François Hoquette me l'a aussi évoqué. Il s'agit de conséquences liées à la modification génétique en tant que telle, peu importe sa finalité. Jean-François souligne que cela est lié à la vitesse des manipulations qui iront avec le temps de la co-évolution.
- Jean-François Hocquette -
Quand on sélectionne des animaux, ou quand on fait une manipulation génétique pour introduire une mutation spécifique, effectivement, il y a toujours des effets collatéraux qu'on ne connaît pas forcément à l'avance. Et donc, effectivement, quand les troupeaux évoluent plus lentement, il y a forcément une adaptation progressive du génome où les interactions entre les GN évoluent plus lentement et potentiellement, on a moins de surprises. Quand on fait une évolution génétique rapide par des techniques, j'allais dire un peu plus radicales, On atteint plus facilement son objectif, mais en même temps, on maîtrise moins les effets collatéraux.
- Inf'OGM
Tiens, cette idée de lenteur me fait penser au cochon de Noémie Calais. Elle élève dans le Gers une douzaine de truies, environ 200 porcelets à l'année. Et ces animaux sont intégrés dans un projet plus large, dans une ferme gérée collectivement en polyculture élevage. Cette éleveuse travaille avec une race rustique, le porc gascon. Elle aussi prône la lenteur. garantent de la robustesse et de l'adaptation.
- Noémie Calais
Je vis sur une zone de coteaux où il fait chaud. Donc clairement, j'ai tout intérêt à travailler avec le porc gascon, qui est une race rustique locale qui a évolué tout doucement pendant des centaines d'années sur ces reliefs-ci. Et je n'ai aucun intérêt à aller choisir un gros porc rose qui fasse plein de viande, qui soit lourd, qui soit rose. pas résistant du tout à la chaleur, avec des oreilles dressées, alors que moi, les cochons, ils ont besoin de se protéger du soleil. Il faut accepter, en fait, cette lenteur, et que nous, on s'adapte à cet animal-là, et qu'on n'essaye pas de le pousser. Si on essaye de le pousser, de toute façon, ça va être catastrophique. Si on essaye de lui faire faire plus de portée, plus de petits, moins de gras, des carcasses plus grosses, ça va très mal se passer. Cet animal n'est pas fait pour ça. C'est à nous de réapprendre à travailler avec le vivant. et pas aux vivants de s'adapter à nos besoins démesurés de toujours plus. C'est faux, en fait. On n'a pas besoin de manger de la viande à profusion. On a besoin de réduire notre consommation de viande, c'est minimum 50% si on veut que ça tienne sur cette planète.
- Inf'OGM
Mais revenons-en à nos problèmes techniques. J'ai aussi découvert que pour utiliser une modification génétique obtenue chez un animal, il fallait utiliser une technique connexe le clonage, et que cette technologie était, elle aussi, assez peu maîtrisée. C'est Agnet Spengler qui m'en parle.
- Agnet Spengler
Alors, ce n'est pas possible de seulement faire une modification génétique avec un animal. On va faire des clonages pour avoir environ 20 ou 30 organismes pour faire cette modification en même temps. Et le clonage, c'est vraiment un grand stress. pour les organismes et la plupart ne survivent pas. Alors, par exemple, pour cet expériment avec ce taureau qui n'avait pas de corne, je crois qu'on avait environ 27 animaux clonés. À la fin, on avait un. Alors, vous voyez que c'est un tellement grand stress.
- Inf'OGM
On le comprend, Agnet Spengler n'est pas convaincue par les modifications génétiques et elle aussi préfère la sélection naturelle.
- Agnet Spengler
La sélection classique, elle est tellement intéressante et on peut travailler avec les animaux. On peut les observer et choisir les meilleurs, ceux qui sont vraiment sains, ceux qui sont vraiment productifs. Et c'est vraiment joli de travailler avec les animaux entiers. Et ce n'est pas nécessaire de travailler avec les gènes parce que là, on ne voit pas ce qu'on a.
- Inf'OGM -
Anissa Putois de l'association PETA est beaucoup plus radicale dans sa critique des modifications génétiques.
- Anissa Putois
Les modifications, donc, elles sont là pour faire perdurer un système. On pense à ces histoires de cornes, bien entendu, c'est pour que les animaux ne puissent pas s'encorner, mais on sait également que c'est dans des environnements où les animaux sont trop nombreux et ils sont parqués dans des petits environnements, alors que si on leur laissait plus d'espace, on aurait moins ces histoires de... d'attaques ou de blessures entre eux.
- Inf'OGM -
Les chiffres montrent clairement que les régimes sans viande sont en hausse en Europe. Selon une étude de France Agrimaire de 2018, environ 5% de la population en France et en Allemagne se déclarent végétariens ou véganes. Ils sont même 8% au Royaume-Uni. Les grandes entreprises ont bien compris cette tendance. Dès 2015, les grandes enseignes de la distribution, en France, lançaient leur gamme vegan. Carrefour avec Carrefour Veggie, Auchan avec Envie de Veggie, Intermarché avec Veggie Marché. Il existe plusieurs façons de produire des substituts de produits laitiers ou carnés. Historiquement, le soja dominait ce marché avec l'emblématique steak de soja que les Allemands et les Néerlandais consomment depuis au moins trois décennies. Depuis, les recettes se sont complexifiées et deux orientations radicalement différentes ont été empruntées. Des produits bio sans modification génétique et des produits avec des OGM. Du côté biotech, mentionnons quelques projets. Le plus connu est celui de l'entreprise Impossible Food et son Impossible Burger, un steak de soja auquel a été ajouté de l'hème, un composant de l'hémoglobine obtenu industriellement grâce à la culture d'une levure transgénique. Il a été commercialisé aux Etats-Unis en 2018. Citons rapidement la société israélienne Polopo, qui entend produire des protéines d'œufs par des pommes de terre OGM. La société Pigmentum, elle aussi israélienne, qui vise à faire produire des protéines de lait par des laitues OGM. Ou encore l'entreprise Moulek, qui commercialise depuis 2024 son Piggy Soy, un soja OGM au goût de porc grâce à un gène de cochon. Jean-François Hoquette de l'INRAE nous parle d'un projet encore plus ambitieux, recréer carrément de la viande à partir de cellules.
- Jean-François Hocquette -
Au lieu d'élever des animaux, il faudrait élever des cellules. Donc ça consiste à mettre des cellules musculaires dans un grand incubateur qu'on appelle bioréacteur. Ces cellules sont plongées dans un milieu de culture qui apporte les nutriments, les sources d'énergie en termes de glucides, de lipides. les acides aminés pour fabriquer des protéines, etc. Donc ce milieu de culture joue quelque part le rôle du sang chez les animaux. Et donc les cellules peuvent se multiplier beaucoup plus que dans un animal, et à la fin, on obtient une masse musculaire extrêmement importante, à partir de très peu de cellules. Et selon ce courant de pensée, le produit qu'on obtient serait de la viande. Et donc on pourrait potentiellement produire une très grande quantité de viande, en se passant d'animaux.
- Inf'OGM -
Alors, comment cela fonctionne ? Il existe deux grandes familles de techniques.
- Jean-François Hocquette -
Il y a une première famille de techniques qui repose sur des prélèvements musculaires sur un animal. On appelle ça une biopsie musculaire. Donc, on fait un prélèvement de muscles sur une vache, sur un cochon, sur un poulet, sur un poisson. Ça peut être sur votre chat de compagnie. On met ces cellules dans un bioincubateur. L'animal évidemment n'est pas abattu et les cellules se multiplient. Et on obtient à la fin quelque chose qui ressemble à des fibres musculaires.
- Inf'OGM -
Et pour le moment, c'est cette famille qui est utilisée. Marie-Pierre Ellies, professeure en sciences animales et qualité des viandes à Bordeaux Sciences Agro, nous explique.
- Marie-Pierre Ellies
Tous les produits qui sont actuellement commercialisés à Singapour et les produits qui ont été développés dans différentes entreprises. à l'état de prototype. Ce sont des produits qui sont issus d'un prélèvement sur biopsie au niveau des animaux et qui ensuite sont mis en culture un très très grand nombre de fois pour arriver à faire en fait comme des feuilles de fibres musculaires. Donc ces feuilles sont récoltées, ensuite c'est la disposition de différentes feuilles les unes sur les autres qui arrive à constituer un total de... d'une structure qui ressemblerait à des feuilles de muscles.
- Inf'OGM -
Très bien, mais comment ces cellules font pour se reproduire ? Il faut du sérum fétal de veau. Jean-François Hoquette m'explique.
- Jean-François Hocquette -
Pour obtenir du sérum de veau fétal, on abat une vache gestante. Évidemment, on tue son fœtus au passage. On récupère le sang du fœtus, on l'extrait et on a une potion magique qui apporte toutes les hormones et les facteurs de croissance. nécessaires à la multiplication cellulaire. Et l'entreprise qui commercialise à Singapour de la viande de culture utilise du sérum de veau fétal. Alors non seulement ce n'est pas éthique, mais en plus c'est très coûteux. Donc elles sont en train de mettre au point un milieu de culture synthétique sans sérum de veau fétal, mais c'est des recherches qui prennent du temps.
- Inf'OGM -
L'eurodéputé Thielemetz estime que 600 000 à 800 000 litres de sérum de veau fétal sont produits chaque année dans le monde. ce qui équivaut à un nombre de fœtus situé entre 1 et 2 millions. Il y a une deuxième famille de techniques. On utilise cette fois des modifications génétiques. Plus besoin de prélèvements sur l'animal. Précisons tout d'abord qu'actuellement, les cellules génétiquement modifiées utilisées pour la viande cultivée sont aussi mises en culture dans des milieux contenant du sérum fœtal. Même si les entreprises annoncent qu'à terme, elles vont réussir à s'en passer complètement.
- Jean-François Hocquette -
Il y a une deuxième famille de techniques qui repose sur des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules qui ont été rendues immortelles par modifications génétiques. Et dans ce cas-là, les cellules peuvent se multiplier à l'infini et on n'a plus besoin d'animaux. Quand on prend des cellules et qu'on fait des modifications génétiques qui leur permettent de se reproduire quasiment à l'infini, quelque part, pour celui qui veut faire de la viande de culture, ça devient plus facile parce qu'il stocke ses cellules. à moins 80, en les protégeant avec ce qu'on appelle des cryoprotectants, et puis il ressort un tube de cellules, il le met dans son bion réacteur, et ça produit de la viande de culture, quand il veut et comme il veut.
- Inf'OGM -
Mais Marie-Pierre Ellies nous explique que cette technique est risquée.
- Marie-Pierre Ellies
Néanmoins, il y a un certain nombre de blocages parce qu'on ne sait pas dans le temps, en fait, s'il n'y a pas de risque de développement de quelque chose qui ressemblera à un cancer, parce qu'une multiplication trop nombreuse de cellules, ça peut avoir des effets délétères.
- Inf'OGM -
Mais est-ce que cette viande de synthèse est un projet réaliste à court terme ou une pure fiction ?
- Jean-François Hocquette -
Il y a quatre entreprises qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Eat Just pour Singapour, Upside Food et Good Meat pour les États-Unis et Alice Farms en Israël.
- Marie-Pierre Ellies
Il y a aussi l'entreprise Gourmet en France qui a déposé un dossier pour faire du... Fois gras de culture, donc sans animaux et sans abattage, sans gavage, etc.
- Inf'OGM -
Mais Marie-Pierre Ellies ne pense pas que ces produits de viande de synthèse vont se développer à court terme. Première raison, le prix.
- Marie-Pierre Ellies
Alors, il a été annoncé des prix qui seraient à peu près équivalents par rapport à la viande d'ici 2026. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais d'autant moins que ça n'a pas été développé à grande échelle.
- Inf'OGM -
Ensuite,
- Marie-Pierre Ellies
des problèmes techniques et production à grande échelle. Ça veut dire qu'il faut arriver à faire des bioréacteurs qui permettent la production de ce type de viande de culture. En termes de conception de ces infrastructures, ce sont des choses énormes à faire. Et derrière, il faut avoir des levées de fonds qui sont importantes. Enfin, la réglementation. Et puis il y a des blocages par rapport à la commercialisation du produit en tant que tel. Pour le commercialiser en Europe, ce type de produit, il faut que ce soit accepté comme un nouveau produit. Et pour être accepté comme un nouveau produit, il faut que les entreprises fassent la preuve que c'est un produit qui n'induit aucun risque, ni pour l'homme, ni pour l'environnement.
- Inf'OGM -
Donc à court terme, on peut manger de la viande cellulaire à Singapour et peut-être bientôt aux Etats-Unis, en Israël ou dans certains pays d'Amérique du Sud, mais probablement pas de sitôt en Europe. Mais si cela arrivait, est-ce que ce serait une bonne nouvelle ? Tout d'abord, est-ce que ce serait un bon aliment en termes de goût, de santé, d'environnement ? Permettrait-il de résoudre les problèmes que pose l'élevage ? Par rapport au goût, Marie-Pierre Ellies nous dit que la viande cellulaire n'est pas vraiment de la viande. La viande n'est pas qu'un agrégat de cellules.
- Marie-Pierre Ellies
La viande de culture qui a été réalisée, au départ, c'était que des fibres musculaires. C'est-à-dire que ce qui était consommé ou consommable éventuellement, c'était un amas de fibres musculaires, sous une forme très proche ou la plus proche possible d'un morceau de viande, mais c'était que des fibres. Petit à petit, les industriels ont commencé à rajouter d'autres types de tissus, et donc en l'occurrence des tissus adipeux pour s'approcher davantage de la structure du muscle. Sauf que dans la cellule normale qu'on fait, il y a des interactions entre ces différents types de tissus, entre le gras, entre le tissu conjonctif, le tissu adipeux. Il y a toute la partie croissance de l'animal qui va faire des liens entre ces différents types de tissus. Et il y a aussi toute la partie maturation derrière qui fait qu'on abat un animal et on ne le consomme pas directement parce qu'il y a une action des enzymes endogènes notamment qui va interagir sur la partie tissu musculaire. Et tout ça, ça ne se fait pas dans la viande de culture.
- Inf'OGM -
Donc cela n'a pas tout à fait le goût de la viande, mais est-ce que ça apporte les mêmes nutriments ? Jean-François Oquette nous dit.
- Jean-François Hocquette -
Mais les études sur la composition sont extrêmement rares. Elle suggère que la teneur en protéines, que la composition en acides aminés, que la teneur en lipides sera à peu près la même. La composition en acides gras, la teneur en fer et la teneur en vitamines seront probablement différentes, mais on n'en est pas très sûr. Il y a encore quelque chose qui n'a pas été testé, c'est la digestibilité des protéines, c'est-à-dire l'aptitude du corps humain à... digérer et absorber les nutriments, non seulement les protéines, mais aussi les lipides, les acides aminés et puis les micronutriments de cette viande de culture.
- Inf'OGM -
Ok, mais au-delà de savoir si ce produit est de la viande, est-ce qu'on est sûr que c'est sans risque pour la santé ?
- Jean-François Hocquette -
Sur le plan sanitaire, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, la composition du milieu de culture. Est-ce qu'il va y avoir des résidus du milieu de culture dans ce produit ?
- Inf'OGM -
Autre problème que Jean-François Hoquette évoque, la dérive génétique.
- Jean-François Hocquette -
Quand les cellules se multiplient un très grand nombre de fois, il y a toujours des erreurs génétiques. Ce qui fait que, finalement, le matériel génétique des cellules à la fin ne sera pas le même. que le matériel génétique des cellules au début. On appelle ça une dérive génétique. Est-ce que ça pose problème du point de vue sanitaire ? On n'a pas la réponse à toutes ces questions.
- Inf'OGM -
Et la culture de cellules in vitro est mutagène en soi, même en l'absence d'agents mutagènes ajoutés. Donc globalement, ce que je comprends, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur les impacts sanitaires et les différences nutritionnelles. Mais qu'en est-il de l'impact de cette viande de synthèse sur l'environnement ? Jean-François Hoquette estime que les études ne sont pas aussi unanimes.
- Jean-François Hocquette -
En ce qui concerne la viande de culture, pour estimer la consommation d'énergie et la production de gaz à effet de serre, les chercheurs n'ont qu'un seul outil qui est la modélisation. Et quand on fait des modèles, on fait des hypothèses. Et les modèles sont extrêmement dépendants des hypothèses que l'on fait au départ. En 2011, il y a eu un modèle, un premier modèle. qui a tourné à l'initiative de l'Université d'Oxford et qui ont conclu qu'il y aurait un bénéfice très important à faire de la viande de culture en termes d'utilisation d'énergie et de production de gaz à effet de serre par rapport à l'élevage. Mais il y a d'autres modèles après, faits par des équipes américaines par exemple, qui ont plutôt dit l'inverse. Il y a aussi une problématique qui tourne autour du méthane et du CO2, c'est-à-dire que l'élevage produit pour faire court essentiellement du méthane. qui est un gaz à fort pouvoir échauffant, mais qui disparaît très vite de l'atmosphère. Au contraire, quand on utilise des énergies fossiles, par exemple pour chauffer les bioréacteurs pour produire de la viande de culture, on produit essentiellement du CO2, qui a un pouvoir échauffant beaucoup plus faible, mais qui persiste très longtemps dans l'atmosphère. Et donc, l'avantage relatif de la viande de culture par rapport à l'élevage dépend du pas de temps.
- Inf'OGM -
Ce bilan dépendra de ce qu'on compare à l'élevage extensif peu consommateur d'énergie ou à l'élevage intensif avec des fermes-usines chauffées, éclairées, avec des animaux nourris au soja issus de la déforestation de l'Amazonie. Le raisonnement de Jean-François Hoquette n'est donc valable que dans le cas où les vaches passent la quasi-totalité de leur vie dans les prés. Pour l'impact environnemental, on reste dans le flou, et ce notamment à cause d'un grave manque de transparence.
- Jean-François Hocquette -
C'est extrêmement difficile de connaître la stratégie des entreprises qui veulent faire de la viande de culture. Elles ne sont pas transparentes parce qu'elles sont en concurrence entre elles. Elles veulent protéger par des brevets leurs process. Donc, elles communiquent le minimum et ça pose des problèmes pour la recherche académique. Mais moi, quand je demande de visiter un laboratoire de viande de culture, ça m'est refusé.
- Inf'OGM -
Avec ce bilan environnemental mitigé, je suis retournée voir Anissa Putois de l'Association de protection des animaux PETA pour lui poser une question. Ne craint-elle pas que la viande cellulaire vienne juste s'ajouter à la viande d'animaux ?
- Anissa Putois -
Oui, il y a bien sûr une crainte que cette viande de synthèse vienne s'ajouter à la viande animale plutôt que la remplacer, mais c'est là où les politiques, mais aussi les marques... Et les consommateurs, chaque personne a vraiment le pouvoir de voter avec son porte-monnaie et de choisir les alternatives à la viande traditionnelle, on va dire, qui provient de conditions industrielles intensives qui sont indéniablement cruelles et mauvaises pour la planète.
- Inf'OGM -
Mais malgré tout, si ce n'est pas l'idéal, pour elle, c'est largement mieux que l'élevage, même extensif.
- Anissa Putois -
La viande de synthèse n'entre pas dans une alimentation végétale et nous on prône vraiment une alimentation végétale, végane. Alors la viande de synthèse, c'est un moyen effectivement de remplacer pour les gens qui vraiment ne vont pas faire autrement, ou par exemple les animaux de compagnie. Mais oui, la pollution et les ressources utilisées restent quand même bien au-dessus d'une alimentation végétale. Cela dit, ces innovations, selon nous, si elles permettent de remplacer... L'élevage à grande échelle d'animaux dans des conditions atroces, avec énormément de souffrances, de maladies, de blessures qui ne sont pas traitées. Aussi la possibilité de faire naître des pandémies, on le voit avec la grippe aviaire, la grippe porcine, toutes les autres zoonoses qui proviennent des élevages parce que les animaux sont en trop grande quantité parqués les uns sur les autres. Bien entendu, ce serait quelque chose qu'on soutiendrait parce qu'on a quelque chose qui est une production qui est meilleure. pour la planète également parce qu'on utilise moins de ressources, moins polluantes et on n'utilise pas d'individus, on ne fait pas souffrir des individus. On sait que ce sont des êtres sensibles qui tiennent à leur vie, qui ont des émotions comme nous.
- Inf'OGM -
Pour Noémie Calais, la question n'est pas là. Elle défend, elle, un élevage paysan et une réduction drastique de la consommation de viande. Et elle craint autant la viande de synthèse que l'élevage intensif.
- Noémie Calais
J'ai très peur que la viande in vitro, ce soit une industrie qui en remplace une autre. Que cette industrie du labo, des grandes cuves en inox, du tout vide et du tout stérile dans lequel sont brassées ces cellules. Ça apporte les mêmes dérèglements que ces grands bâtiments, tout vide, tout stérile, tout désinfecté, j'avais lisé, dans lesquels on a entassé des animaux pour qu'ils produisent, produisent, produisent de la protéine, et avec tous les problèmes qu'on connaît, de maladies, d'antibio, d'antibiorésistance derrière, etc. Pour moi, on passe vraiment d'un extrême à un autre, et au milieu, on oublie qu'il y a en fait un élevage paysan qui nous permet de... de manger des choses saines, qui ont du goût, qui ont du sens, et qui en plus sont robustes pour continuer à produire demain. Moi j'ai hyper peur dans la viande in vitro, qu'il y ait un jour une bactérie pathogène dans le process, et alors là, laisse tomber, la nature n'aimant pas le vide, quand on travaille dans des environnements tout stériles, tout fermés, tout désinfectés, là c'est une bombe à retardement, absolue.
- Inf'OGM -
Derrière ce débat élevage versus viande de synthèse, je pense que c'est clair, se cache un débat beaucoup plus vif, tendu et polarisé. Faut-il continuer à faire de l'élevage ? Pour PETA et sa chargée de com' Anissa Putois, c'est non. Même avec un élevage paysan de taille modeste.
- Anissa Putois -
Nous, la solution qu'on prône, c'est de devenir vegan, de passer à une alimentation végétale qui n'exploite plus d'animaux. Même si on a des petites productions, l'animal est tué en fin de compte. Donc on ne sera jamais dans le respect de l'animal. Si on veut comparer production industrielle à petit élevage, on aura moins de dérives dans les petits élevages. Mais d'une part, l'animal souffrira tout de même, parce qu'il sera tout de même envoyé à l'abattoir au final. Et puis de toute façon, il est exploité comme un bien. Et puis d'autre part, on ne peut pas nourrir... toute une population qui s'obstine à manger un régime carné avec ce genre d'élevage.
- Inf'OGM -
Mais pour les deux chercheurs, l'élevage extensif apporte des services écosystémiques. Écoutons d'abord Marie-Pierre Ellies.
- Marie-Pierre Ellies
Il y a des services rendus par l'élevage qui, si jamais on développait à grande échelle la viande de culture, ne seraient plus rendus. Finalement, on aurait beaucoup plus de broussailles, on aurait moins d'entretiens. Parce que vous enlevez l'élevage, il y a des zones où il n'y aura plus rien, parce que ces zones-là tiennent par une population rurale qui est encore présente et qui fait qu'on maintient encore la boulangerie, on maintient encore une petite école.
- Inf'OGM -
Mais ces services ne le sont que dans une certaine idée qu'on se fait du monde, à savoir qu'il faut des prairies, des espaces ouverts avec des villages dynamiques. Mais ce n'est qu'une façon de voir le paysage et la société. Ce n'est que... qu'un modèle civilisationnel parmi d'autres possibles. Jean-François Hoquette pose la question en termes de surface agricole.
- Jean-François Hocquette -
Si on supprime tous les animaux d'élevage, on se reposera uniquement sur la production végétale. Et là, il faudra d'immenses surfaces de terre arable, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ça va poser d'autres problèmes. On a la chance d'avoir des animaux qui mangent de l'herbe, y compris sur des territoires sur lesquels on ne peut pas faire de culture.
- Inf'OGM -
L'élevage qu'évoque Jean-François Hoquette, c'est un élevage paysan, de plein air, où effectivement les animaux se nourrissent d'herbes qui ne seraient utilisées pour personne. Mais dans les pays industrialisés, la grande majorité des élevages sont intensifs. Dans ce cadre-là, il faut plusieurs calories végétales pour produire une calorie animale. Le ratio est de 1 à 10 pour le bœuf, par exemple. Il est important de garder cela en tête et de ne pas oublier cette dichotomie. Donc, l'élevage extensif et paysan, c'est celui que pratique Noémie Calais. Elle me parle d'une synergie dans un tel système, celui du petit lait, qui est très acide et qu'on ne peut pas relâcher dans l'environnement. C'est un exemple parmi d'autres, mais il est assez parlant, je trouve.
- Noémie Calais
Historiquement, le porc, c'était un recycleur de toutes ces matières que nous, les humains, on ne peut pas manger. Sur une ferme collective, ça a du sens parce qu'il y a aussi une bergerie, chèvrerie, fromagerie. Donc il y a du petit lait, du lactosérum, qui est un coproduit de l'activité fromagère, que nous humains on ne peut pas manger, ou alors il faut le faire recuire, ça fait de la ricotta en très faible quantité, il y a beaucoup d'énergie qui passe là-dedans, et de toute façon après il reste quand même du petit lait. Donc le petit lait, c'est le déchet, et le déchet... soit on l'exporte vers des industries qui le traitent, qui en font de la poudre, qui le mettent dans des poudres pour sportifs et compagnie, soit en fait, on le fait à la paysanne à l'ancienne, on l'utilise comme une matière pour nourrir d'autres animaux qui s'en régalent.
- Inf'OGM -
L'autre gros argument que développe Jean-François Hoquette, c'est la fertilisation des sols.
- Jean-François Hocquette -
Réduire l'impact environnemental de l'élevage à quelques critères, comme par exemple l'utilisation d'énergie, la production de gaz à effet de serre, Et la consommation d'eau, c'est une vision un peu limitée, un peu réductionniste. Pourquoi ? Parce que l'élevage traditionnel produit de la matière organique, donc les excréments des animaux, qui enrichissent le sol, qui fertilisent le sol, qui favorisent la prolifération des micro-organismes dans le sol, et ainsi les sols ont moins besoin d'engrais chimiques et peuvent produire soit des... des céréales par exemple pour nourrir l'humanité, soit de l'herbe et des fourrages pour nourrir les animaux. Donc ce cercle vertueux de la matière organique qu'on recycle entre les plantes, les animaux et leurs excréments, et puis la matière organique dans le sol, est très important. Et pour se passer d'engrais chimiques, il faut maintenir ce cercle vertueux.
- Inf'OGM -
Là encore, Jean-François Hoquette parle d'un élevage de plein air extensif. Car les excréments de l'élevage intensif sont plutôt un problème environnemental. Pensons aux algues vertes. Anissa Putois de l'association PETA répond à cet argument.
- Anissa Putois -
Je répondrai à la question des gens qui s'inquiètent de ne plus avoir d'engrais lorsqu'on passera à une alimentation sans animaux. que, d'une part, ça ne se fera pas du jour au lendemain, on aura vraiment une transition assez lente, parce que c'est comme ça qu'évolue notre société, et on aura le temps. D'ailleurs, il existe déjà des engrais végétaux.
- Inf'OGM -
En effet, il est possible d'utiliser des cultures qui permettent d'apporter nutriments et matières organiques, comme les engrais verts, ou d'épandre des composts de déchets végétaux. Que répond Néomy Calais à cela ?
- Noémie Calais
Dans le Gers, on est sur des coteaux qui sont très érodés. À l'échelle de l'Union européenne, il y a déjà 70% des terres qui sont érodées. Et ça, l'érosion, c'est vraiment le problème majeur. C'est la terre arable, c'est notre potentiel nourrifié pour demain. Donc en fait, si on continue à faire des céréales de façon intensive, conventionnelle, c'est tout notre capital qui s'érode, qui part dans les fossés, qui part dans les cours d'eau. Un sol, il faut des vingtaines, des vingtaines voire centaines d'années pour le refaire, pour refaire cette toute petite couche de quelques centimètres. Donc en fait, le moyen pour régénérer un sol, c'est de lui remettre de la matière organique. Ça ne marche pas avec des engrais de synthèse. Il y a de la matière organique végétale qu'on peut mettre, mais il y a aussi et surtout les fumiers, qui ont un très bon équilibre, une très bonne minéralisation. Les fumiers animaux aident à refaire tout un starter, tout un cycle de bactéries, de vies bactériennes, bactériologiques, mycorhiziennes, de champignons, levures, etc. C'est absolument indispensable si on veut retrouver des sols pour nous nourrir et continuer à faire du végétal demain. Et en fait, sur des sols qui sont très pentus, très zéro dé, ce n'est pas très malin de passer avec des tracteurs qui sont nécessairement pour faire des céréales gros et lourds.
- Inf'OGM -
Noémie Calais soutient que, dans le système actuel, l'élevage paysan est nécessaire à la production végétale.
- Noémie Calais
J'aimerais bien savoir si les véganes seraient prêts juste à accepter qu'on existe avec ce système qu'on a en ce moment pour continuer à soutenir une agriculture paysanne. pour les productions végétales, bio, qui nécessitent des fumiers que nous, on apporte. Mais que, en fait, pour le moment, on a besoin d'avoir un revenu de la vente de lait, de la vente de viande, pour continuer à faire cette agriculture paysanne qu'on promeut tous. Parce qu'en fait, si nous, les éleveurs paysans, on s'effondre, les productions paysannes végétales, elles s'effondrent aussi parce que les deux vont ensemble. Et les seuls qui restent debout dans tout ça, c'est les industriels et leur cortège de destruction du vivant.
- Inf'OGM -
Mais elle soutient aussi que l'élevage paysan ne peut pas suffire à consommation de viande égale. Donc, que ce soit pour défendre un régime végane ou un élevage paysan, dans les deux cas, il faut changer de paradigme et arrêter la course-poursuite au toujours plus, au toujours plus gros. Vous venez d'entendre OMG, Décodons les biotech, le podcast du média indépendant Inf'OGM. Ce podcast a été réalisé par Charlotte Coquard et Christophe Noisette, avec le soutien technique de Plink, et en particulier Pierre-Henri Samion et Rémi Sanaka. La musique originale a été réalisée par Julien Fauconnier de Studio Time. Merci à toute l'équipe d'Inf'OGM, et en particulier à Hélène Tordjman, Antoine Vépierre et Sylvain Willig. Nous tenons à remercier les bailleurs qui nous ont permis de réaliser ce podcast, les fondations Ecotone, Olga et Nature & Découverte, et le ministère de la Culture. Pour un savoir plus sur les OGM et les biotechnologies, retrouvez toutes nos infos sur infogm.org