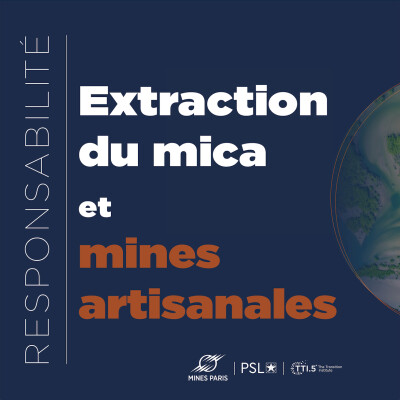- Nadia Maïzi
Planète en transition, le podcast de l'Institut TTI.5. L'anthanide, ytrinium et scandium, regroupés sous le nom de terres rares, antimoine, gallium, germanium et autres métaux, et pour les plus célèbres, cuivre, cobalt, lithium ou encore nickel, sont autant d'éléments chimiques qu'ils constituent un enjeu majeur pour nos sociétés modernes. Utilisées en petite quantité dans l'industrie dite de haute technologie, il est difficile de leur substituer d'autres éléments. Leurs réserves propres sont inégalement réparties sur la planète. Leur rôle est central dans les technologies dites de décarbonation, c'est-à-dire celles qui sont promues pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, ces matériaux dont la demande ne cesse de croître sont devenus rapidement stratégiques pour les enjeux énergétiques et climatiques qui nous préoccupent. Mais leur rôle ira-t-il jusqu'à modifier les jeux d'alliances géopolitiques fondés sur l'économie des ressources fossiles ? C'est l'analyse de l'émergence d'un nouveau type de gouvernance, une gouvernance métallique, que nous vous proposons de décrypter dans ce podcast Planète en Transition, aujourd'hui avec...
- Marie Codet
Marie Codet, doctorante au Centre de mathématiques appliquées de l'École des mines de Paris. Mon sujet de thèse s'intitule « Économie circulaire et transition, une analyse prospective à long terme des défis technologiques et politiques » . relative au marché des matériaux et à l'eau.
- Nadia Maïzi
Bonjour Marie, tu évoques dans le titre très large finalement des enjeux que tu souhaites traiter dans ton travail de thèse, la question des défis technologiques. Et dans le cadre de cette transition énergétique dont on entend beaucoup parler, ces matériaux qui sont utilisés pour les technologies sont souvent qualifiés de critique. Est-ce que tu peux nous commenter cette question de criticité des matériaux ?
- Marie Codet
Bonjour Nadia. Alors effectivement, la criticité, c'est une notion particulière qui est relative au risque qui entoure un matériau. Et donc, comment on évalue cette criticité ? Il y a trois variables. Le risque d'approvisionnement, et notamment la vulnérabilité d'un matériau à ce risque. Donc, le risque d'approvisionnement, les conséquences d'une rupture d'approvisionnement, et aujourd'hui, également, les conséquences environnementales de la production et de l'exploitation de ces métaux. C'est ces trois dimensions-là qui entrent un peu dans l'évaluation de la criticité.
- Nadia Maïzi
Mais ces matériaux, en fait, à quoi correspondent-ils ? On confond, je crois, parfois minéraux, métaux... Est-ce que tu peux nous... Décortiquer un peu la notion de matériau dans le contexte de cette transition.
- Marie Codet
Un matériau, la définition en particulier, c'est juste une matière qui entre dans la construction d'un objet. Alors qu'un minéral, ça va désigner tous les corps inorganiques qui composent l'écorce terrestre.
- Nadia Maïzi
Par exemple ?
- Marie Codet
Par exemple, le feldspat, l'aboxyte ou encore le graphite sont des minéraux. Et en fait, un mot qui ressemble mais qui n'est pas pareil et dont la définition est différente, c'est minerai. Un minerai, c'est un minéral qu'on extrait du sol et qui contient des substances chimiques, notamment métalliques, en quantité suffisante pour que l'extraction industrielle soit possible. Donc c'est ça la définition d'un minerai. Et en fait, un métal, c'est une catégorie d'éléments chimiques qui est caractérisée par une variété de propriétés. et notamment la conductivité. Donc du coup, les métaux sont extraits d'un minerai.
- Nadia Maïzi
Donc un métal vient d'un minerai qui vient d'un minéral.
- Marie Codet
Exactement.
- Nadia Maïzi
Et donc par rapport à cet enjeu de criticité, comment un métal devient critique ?
- Marie Codet
Alors, il faut savoir que la criticité peut varier en fonction du pays, en fonction de l'institution qui va l'étudier. Parce que, comme je le disais, c'est une notion qui ne repose pas seulement sur la seule présence géologique du métal. Au-delà de la géologie, on prend en compte l'économie, donc la concentration du marché. On prend en compte l'importance stratégique de ce minerai pour telle ou telle industrie. On prend en compte les dégâts environnementaux. que produisent l'exploitation de ce minerai. Et donc, finalement, la liste des éléments critiques peut varier d'une région à l'autre. Pour l'Union européenne, par exemple, la liste de criticité, en 2023, contient 34 éléments. Et avant cela, elle en contenait un peu moins. Donc ça évolue en fonction du temps, ça évolue en fonction des besoins.
- Nadia Maïzi
Et tu peux nous donner des exemples de métaux qui sont critiques ?
- Marie Codet
J'aimerais préciser, avant, que la rareté... et la criticité sont deux choses différentes. La rareté, c'est une notion purement géologique qui désigne la concentration dans la croûte terrestre. Par exemple, l'or, c'est un métal qui est rare, mais qui n'est pas critique. Le cuivre, c'est un métal qui n'est pas rare, mais qui est critique. Et le platine, ça va être un métal qui est considéré à la fois comme rare et critique, du moins pour l'Union européenne.
- Nadia Maïzi
Donc en fait, la criticité, c'est vraiment lié à ce risque d'approvisionnement très élevé.
- Marie Codet
Tout à fait.
- Nadia Maïzi
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les étapes de production de ce métal assez grossièrement ?
- Marie Codet
Oui. Alors pour être très schématique, après les phases d'exploration, on a les phases d'exploitation. Donc on va chercher le métal dans la terre et en gros, on le concasse pour faire un produit semi-fini qui est ensuite envoyé en séparation. Et raffinage, et après cette étape de séparation raffinage, on se retrouve avec du métal. Donc on part d'un minéral qu'on a extrait pour se retrouver après le raffinage avec un métal.
- Nadia Maïzi
Et donc si je reprends ce que tu nous disais, l'aspect critique du matériau va dépendre de la localisation de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement.
- Marie Codet
Exactement, pour préciser on a un indice qui s'appelle l'indice de Erfindal-Hirschmann qui mesure la concentration de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement et c'est là où on a un problème. de criticité pour certains maillons, pour certains métaux. Je pense au lithium, au cobalt ou aux terres rares. Quand on regarde le HHI de la production de ces métaux, il est beaucoup plus fort que celui du pétrole. Donc ça veut dire que la production de ces métaux est concentrée dans beaucoup moins de pays producteurs que le pétrole.
- Nadia Maïzi
Donc il y a un caractère qui est assez diffus ? Oui. par rapport à l'exploitation des ressources fossiles ?
- Marie Codet
Alors, diffus, parce qu'on va avoir une multiplicité des chaînes d'approvisionnement, parce qu'on a besoin d'une grande diversité de métaux différents. En revanche, on va avoir des pôles concentrés. Par exemple, pour le cobalt, le premier producteur... qui est la République démocratique du Congo, représente 68% des parts de marché. Le lithium, on a l'Australie qui représente 47% des parts de marché. Et enfin pour les terres rares, on a la Chine qui produit 70% des terres rares à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est les chiffres pour 2022.
- Nadia Maïzi
Et pour les compagnies qui sont impliquées dans cette chaîne, est-ce qu'on retrouve aussi la même concentration ?
- Marie Codet
On a une forte concentration des majors. Par exemple, pour le cobalt et le lithium, il y a 5 entreprises seulement qui représentent la moitié de la production, et ça représente même 61% de la production pour le lithium.
- Nadia Maïzi
Donc si on se concentre sur les pays producteurs, est-ce qu'ils intègrent donc l'ensemble de cette chaîne ?
- Marie Codet
Pas tous. Pour reprendre l'exemple du Congo, donc qui produit 68% du cobalt à l'échelle mondiale, en fait, il ne le raffine pas. La plupart de ce cobalt est envoyé en Chine, la Chine qui représente plus de 60% du raffinage du cobalt à l'échelle mondiale. Et là aussi, on a une problématique dans ce maillon du raffinage autour de la concentration, justement parce que la Chine... et très prépondérante, elle représente outre le cobalt plus de 60% du raffinage du lithium et des terres rares.
- Nadia Maïzi
Si on revient sur les pays producteurs, est-ce qu'on peut faire encore une fois ce parallèle avec la question des hydrocarbures et cette idée de malédiction des ressources dont on a beaucoup entendu parler ?
- Marie Codet
Oui, la malédiction des ressources, c'est la tendance des pays riches en ressources naturelles, dont la part des exportations de ressources dans le PIB est élevée, à connaître des taux de croissance plus faibles que les pays moins riches en ressources. ainsi que de l'instabilité politique et des conflits armés. Je parlais tout à l'heure du Congo, qui est le premier producteur de cobalt. C'est particulièrement vrai dans ce pays qui a connu une guerre civile il y a peu. Et en fait, le problème du cobalt, c'est un métal qui est particulier parce qu'il peut être miné de manière artisanale. Et en fait, si les mines artisanales ne sont pas un problème en soi, ce qui en découle, c'est un manque de transparence, un manque d'observation des droits de l'homme et des pratiques qui entrent en jeu. Et donc, c'est plus facile finalement de commettre des exactions quand on est une armée étrangère ou quand on est un groupuscule terroriste et d'aller miner de manière illégale du cobalt dans des mines artisanales.
- Nadia Maïzi
Donc finalement, cette malédiction des ressources, elle va se traduire... par la présence d'autres types d'acteurs dans cette filière économique. Si tu nous fais un peu le panorama, au-delà des producteurs et des consommateurs, qui sont ces acteurs qui interfèrent avec la chaîne ?
- Marie Codet
Alors, je parlais justement des groupuscules terroristes. Eux, ils font partie d'un type d'acteurs qui s'appelle les ONG illégales, donc des organisations non gouvernementales illégales, donc qui regroupent les mafias, les groupuscules terroristes. On a aussi des ONG forcément légales, qui elles vont se concentrer plus sur les problématiques de transparence, les problématiques de droit de l'homme et de défense des populations locales. On a les entreprises, je parlais des majors tout à l'heure. On a des entreprises qui elles sont des entreprises étatiques. Je pense notamment Ausha Rare Earth Group, qui est un géant des terres rares chinois. Mais il y a des majors comme Glencore par exemple, qui est une major anglo-suisse. Et donc ces entreprises minières qui peuvent représenter plusieurs maillons de la chaîne, donc à la fois la production et le raffinage, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes. Il y a aussi des entreprises dédiées à un seul gisement ou à un seul minerai. Ou bien il y a aussi des entreprises qui se spécialisent dans un processus de raffinage en particulier. Donc il y a des grosses entreprises, des plus petites entreprises qui se sont plus spécialisées. On a également les places de marché. Comme tous les marchés de commodité, ce sont des marchés qui sont très volatiles, mais ce point est exacerbé pour les métaux, parce que ce sont des petits marchés avec peu de liquidités, ce qui fait qu'ils sont plus enclins à la manipulation. Et enfin, un dernier acteur qui est quand même assez essentiel, ce sont les populations locales, notamment les populations natives sur des espaces... Comme par exemple, je pense en Australie, on a des populations natives, au Canada aussi. Ces populations natives et les populations paysannes également, leur droit à la consultation et leur droit au consentement dans le cadre des projets miniers, il est garanti en fait dans les déclarations des Nations Unies.
- Nadia Maïzi
Dans les ONG, est-ce qu'il y a des initiatives plutôt positives également ?
- Marie Codet
Oui, tout à fait. Alors, des initiatives comme une organisation qui s'appelle EITI, qui vise à plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement, qui va réunir à la fois des acteurs du monde privé et des émanations des gouvernements. Et donc on voit un travail collaboratif pour plus de transparence et moins de corruption dans l'industrie minière.
- Nadia Maïzi
Le panorama que tu nous dresses est quand même un peu chaotique.
- Marie Codet
Oui.
- Nadia Maïzi
On se demande finalement si l'exploitation de ces minerais bénéficie aux zones qui les exploitent et s'il y a des effets qui peuvent être positifs.
- Marie Codet
Alors effectivement, tout n'est pas non plus tout noir. Quand on parle des projets miniers à grande échelle, il faut savoir que ça peut avoir des externalités positives aussi, même pour les populations locales. Donc ils vont pouvoir bénéficier d'infrastructures. Par exemple, au Chili, la population locale a pu bénéficier d'infrastructures de désalination de l'eau qui avaient été construites d'abord pour les industries minières. Et même dans les petites mines artisanales, finalement, il y a entre guillemets un bon côté, c'est que parfois dans ces régions-là, il n'y a pas d'autres opportunités professionnelles finalement pour la population locale. Et donc c'est un moyen de subsistance.
- Nadia Maïzi
Donc au-delà de cette partie offre, si on passe à la partie demande, est-ce que tu peux nous clarifier la position des consommateurs ? En fait, est-ce que ça recoupe les producteurs ? Est-ce qu'ils sont complètement indépendants ? Est-ce qu'ils sont positionnés régionalement ?
- Marie Codet
Alors techniquement, tout pays qui a une industrie peut être consommateur de métal. Après dans les faits... les plus gros consommateurs de métaux, ça reste les pays fortement industrialisés comme la Chine, les Etats-Unis ou certains pays d'Europe. Et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que ces pays ils cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement pour ne pas vivre de rupture comme ça a pu être le cas pour le Japon en 2010-2011 lors de ce qu'on a appelé la crise des terres rares.
- Nadia Maïzi
Tu peux nous rappeler le contexte ?
- Marie Codet
Alors la crise des terres rares s'est produite entre la Chine et le Japon quand le Japon a arraisonné un bateau de pêche chinois qu'il soupçonnait d'espionnage et donc fait emprisonner l'équipage du bateau. Ce à quoi la Chine a répliqué en baissant de manière non officielle ses exportations de terres rares vers le Japon alors même que la Chine représentait plus de 80% des importations japonaises de terres rares.
- Nadia Maïzi
Pour quel usage ?
- Marie Codet
Majoritairement dans les technologies de pointe qui utilisent des aimants permanents. Dans le cadre de la transition énergétique, ça va être par exemple les éoliennes ou encore les véhicules électriques.
- Nadia Maïzi
Donc ?
- Marie Codet
En quelques semaines, on a vu un doublement du prix par exemple du néodyme, qui a eu des répercussions sur les prix de production de ces technologies. Après, il faut quand même nuancer, les prix sont quand même globalement revenus à la normale assez vite après cet épisode. Et en fait, cet incident diplomatique, il a représenté un sursaut, un réveil dans les stratégies des pays consommateurs qui, à partir de ce moment-là, ont décidé de diversifier leur chaîne d'approvisionnements. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais la Chine, à l'époque, représentait une partie considérable de la production des terres rares. Donc en 2010, la Chine, c'était... 90% de la production des terres rares et en 2022, finalement, ça a baissé à 70%. Donc ça reste quand même considérable. Mais pour le raffinage, finalement, on n'a pas trop évolué sur la question dans la mesure où en 2019, la Chine s'est restée quand même 90% des activités de séparation et de raffinage des terres rares à l'échelle mondiale.
- Nadia Maïzi
Donc finalement, quelles sont les stratégies potentielles pour les consommateurs ?
- Marie Codet
Alors on a les études de criticité qui visent à indiquer quels métaux sont les plus à risque de rupture d'approvisionnement, mais on a aussi la recherche de l'autonomie stratégique. Qu'est-ce que c'est l'autonomie stratégique ? C'est le fait de compter sur soi avant tout, et aussi sur des pays entre guillemets alliés, dont on sait a priori qu'ils ne devraient pas nous couper les importations d'un jour à l'autre.
- Nadia Maïzi
Dans l'autonomie stratégique, est-ce qu'on peut observer des réouvertures de mines, par exemple ?
- Marie Codet
Oui, on a l'exemple de la mine de Mountain Pass, qui est une mine de terre rare aux États-Unis. Ou encore en France, il y a à Treguenec, en Bretagne, l'étude de l'ouverture d'une mine de lithium. Le souci, c'est que dans les pays comme les nôtres, qui n'ont plus d'industrie minière, On observe aujourd'hui une forte opposition sociale à ces projets.
- Nadia Maïzi
Est-ce qu'il y a également des plans au niveau, justement, de l'Europe, très consommatrices, qui essayent un peu de structurer cet approvisionnement ?
- Marie Codet
Oui, en 2023, l'Union européenne a publié le Critical Raw Material Act, qui, en plus d'établir la nouvelle liste de criticité, vise à... encourager la réouverture des mines sur le sol européen, encourager également le raffinage sur le sol européen et favoriser l'industrie du recyclage.
- Nadia Maïzi
Et pour la Chine, finalement, comment la situation va-t-elle évoluer ? C'est un producteur, mais c'est un très grand consommateur aussi.
- Marie Codet
Alors la Chine s'est intéressée un peu plus tôt que les Occidentaux à la fin de ses réserves et à la potentielle pénurie en métaux. justement parce que son industrie en dépend tellement. Et dès les années 2000, on a vu des plans comme le Go Global, où le gouvernement chinois poussait ses entreprises à aller investir dans des pays à l'étranger, des pays miniers, pour sécuriser les approvisionnements. Il y a aussi, alors c'est pas vraiment un plan... établi officiellement, mais ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie ou en anglais Belt and Road Initiative, qui vise également à nouer des partenariats et des alliances avec des pays, entre autres, fortement dotés en métaux critiques qui permettent de sécuriser des approvisionnements en métaux vers la Chine contre des infrastructures, contre des prêts, contre d'autres types de projets.
- Nadia Maïzi
En fait, là, tu nous racontes une histoire où on se retrouve avec une multiplicité d'acteurs qui cherchent à utiliser des matériaux dans un cadre qui est quand même celui de la lutte contre le changement climatique, puisqu'on est en liaison avec les actions de décarbonation, avec des technologies de décarbonation. Et pourtant, on sent que finalement, chacun des acteurs réfléchit de manière assez... indépendante par rapport à cet enjeu de criticité dont tu nous as parlé. Ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est comment tu vois finalement le modèle d'alliance potentiel entre ces différentes régions, ces différents intérêts ? Est-ce qu'ils s'éloignent ? Est-ce qu'ils s'inspirent de celui de l'OPEP ? Ou est-ce que ce sont de nouvelles formes qui sont en train d'émerger et qui s'éloignent visiblement de notre préoccupation climatique ?
- Marie Codet
Alors, Au niveau de la cartélisation, donc l'OPEP est un cartel de producteurs, il y a plusieurs initiatives qui ont pu être lancées ou annoncées. Je vais donner l'exemple de l'Indonésie qui a proposé un cartel de producteurs de métaux des batteries. L'Indonésie qui est le premier producteur de nickel à l'échelle mondiale. C'est une initiative qui n'a pas pris du tout. Et en fait c'est ce qu'on voit à l'échelle de la plupart des initiatives de cartélisation, et ce depuis des dizaines d'années. C'est que la plupart n'aboutissent pas, justement parce qu'il y a un manque de convergence d'intérêts des différents producteurs.
- Nadia Maïzi
Mais hormis ces projets de cartel, est-ce qu'il existe d'autres types d'alliances ?
- Marie Codet
On a l'exemple effectivement du récent partenariat pour la sécurité des ressources minérales qui va réunir l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, la Finlande, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède. et l'Union Européenne, donc des pays développés. Officiellement, leur but, c'est de diversifier les chaînes d'approvisionnement, promouvoir des standards écologiques, sociétaux et de gouvernance très élevés et favoriser l'industrie du recyclage. En réalité, il y a de nombreux auteurs qui ont pointé du doigt le fait que c'était plutôt une alliance qui visait à sécuriser les approvisionnements en métaux face aux puissances rivales.
- Nadia Maïzi
Quelles puissances rivales ?
- Marie Codet
Les puissances rivales sont représentées par le bloc des BRICS plus 6. Les BRICS, à l'origine, c'est juste le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels se sont aujourd'hui ajoutés 6 pays, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont un peu le bloc rival de l'Occident, notamment dans la sécurisation des approvisionnements en métaux. et qu'il y a un bloc géopolitique qui viserait à contrebalancer le pouvoir économique et politique de l'Occident. Toutefois, il faut quand même nuancer tout ça dans la mesure où, encore une fois, les intérêts des uns et des autres, même au sein d'un même bloc, peuvent être très divergents. Je vais donner l'exemple de l'Inde, qui est dans les BRICS, qui se pose comme un pouvoir rival, mais aussi qui se présente comme un partenaire potentiel des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, qui regroupe des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays développés. Et on a pu voir l'Inde participer à un sommet spécifiquement sur les matériaux critiques en se présentant comme futur producteur allié. des pays de l'Agence internationale de l'énergie. Donc voilà, des intérêts qui divergent, même au sein d'une même alliance.
- Nadia Maïzi
Et finalement, des associations par opportunisme par rapport à la position proposée par les différentes associations qui existent.
- Marie Codet
Oui, et en fait, c'est quand même particulièrement détrimentaire parce que, comme tu le disais, le but de sécuriser ces métaux, c'est entre autres de produire des technologies pour faire la transition énergétique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, C'est qu'au lieu d'avoir une coopération internationale pour arriver à ce but commun qui est de limiter la température, on voit qu'il y a une désorganisation totale et un manque d'harmonisation dans les initiatives et un manque d'harmonisation dans les stratégies à la fois des consommateurs et des producteurs.
- Nadia Maïzi
Dans ce constat un petit peu négatif, est-ce que tu vois des perspectives que les choses évoluent d'une façon plus favorable ?
- Marie Codet
Aujourd'hui, il y a plusieurs voix dans la littérature qui sont élevées pour souligner le fait qu'il faudrait plus de gouvernance à l'échelle mondiale pour gérer ce commerce et ces échanges de métaux dans le cadre de la transition. Et je pense que la création d'une organisation internationale qui harmoniserait toutes ces initiatives et tous ces échanges pourrait permettre d'aller vers un avenir géopolitique un peu moins incertain que ce vers quoi on se dirige actuellement.
- Nadia Maïzi
Je te remercie beaucoup Marie et j'espère que tes propositions ou ta vision sera celle qui émergera dans le futur.
- Marie Codet
Merci Nadia. Actuellement, je suis en train de rédiger justement une revue de la littérature autour de la géopolitique des matériaux critiques et de travailler aussi à la modélisation de ces matériaux dans le modèle de prospective du Centre de mathématiques appliquées. Ces travaux de prospective, je l'espère. serviront à élaborer des politiques allant dans le sens d'une meilleure gouvernance métallique et de plus de coopération internationale. C'était Planète en transition,
- Nadia Maïzi
un podcast de l'Institut TTI.5.