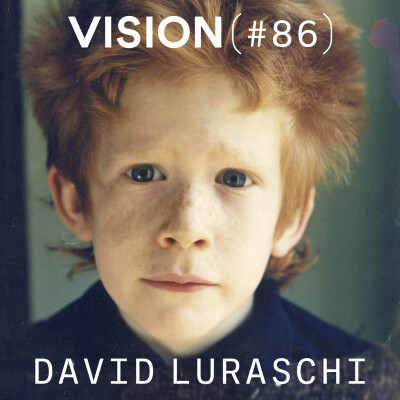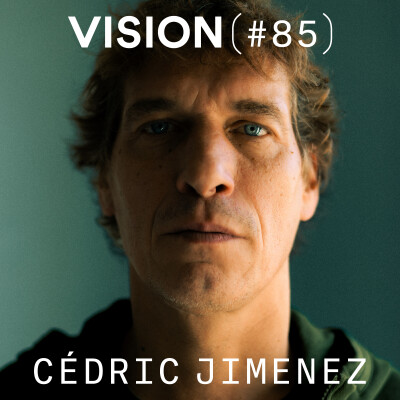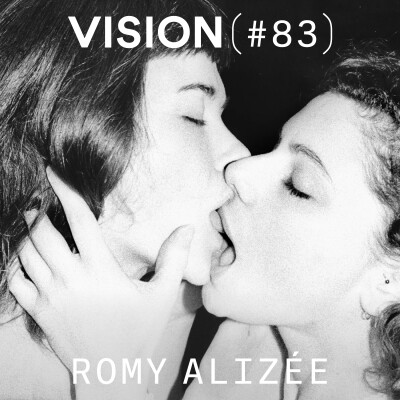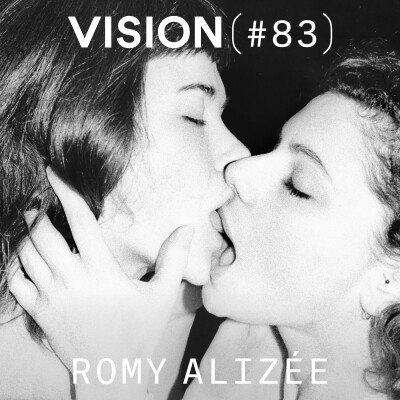Speaker #0Je pense qu'il y a un motif, en tout cas, qui revient sans arrêt dans mes films, ou un élément, enfin un élément, oui, c'est vraiment le mot, c'est l'eau. Et c'est souvent le fait d'immerger ou de mettre mes personnages en contact avec l'eau. Donc j'ai envie de dire qu'une image qui, je ne sais pas si elle résume mes films, mais en tout cas, elle évoque mes films et elle se répète dans plusieurs films. C'est par exemple une jeune fille ou une petite fille sous l'eau, ou dans l'eau. qui joue avec l'eau, peut-être qui joue avec l'eau, ce serait le bon mot, parce qu'il y a un côté plaisir de ça. Donc je pense à la fin d'Innocence, la fillette qui découvre la fontaine dans la ville et qui va jouer avec l'eau, se mettre dedans littéralement. Et puis dans le dernier film, La Tour de Glace, c'est peut-être pas un spoiler que de dire à la fin, il y a une jeune fille qui joue avec l'eau. Et en l'occurrence, c'est une cascade, une cascade de montagne. Alors on ne sait jamais toujours très bien pourquoi on est attiré par certaines choses, mais en tout cas je trouve que l'eau est tout simplement un élément très cinématographique, c'est à la fois très concret et puis aussi abstrait d'une certaine façon. C'est un peu des fois comme une manière de traverser quelque chose, ça aurait pu être du feu, le feu aussi après c'est un peu plus compliqué à filmer, à mettre en scène peut-être, et ça peut avoir plein de formes, donc c'est la fontaine, la cascade, la pluie, la glace, la neige, la mer évidemment, donc ça permet de jouer avec ça, je trouve que ça permet des choses ludiques en fait, et ça permet aussi à la fois d'avoir ça comme élément unique dans l'image, presque abstrait si on veut, comme des choses presque abstraites, et puis aussi que les personnages se confrontent à ça, donc on peut avoir on peut leur faire jouer des choses avec l'eau et c'est ça qui me plaît. Après, au-delà de ça, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a souvent un rapport avec la nature dans mes films. Et bien sûr, l'eau, c'est un des éléments. D'ailleurs, j'avais fait un tout petit court-métrage qui s'appelle « Des Natura » , et où l'idée, c'était les quatre éléments. C'était deux petites filles qui se promènent dans la forêt, et puis il y a l'idée de l'eau. Là aussi, effectivement, il y a une rivière. Je n'y pensais plus, mais voilà, c'est une obsession, on dirait. L'eau, l'air, la terre, le feu. Mais là, pour l'instant, ce n'est encore que l'eau, essentiellement. Je ne sais pas si ça vient de films. Peut-être qu'il y a un film, j'ai envie de dire, ce serait La nuit du chasseur, avec cette barque qui dérive au fil de la rivière. Et cette rivière, c'est comme la route, c'est une route. C'est un chemin, c'est aussi effectivement à la fois physique et un peu mental ou onirique, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ce film-là vraiment, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Je m'appelle Lucille Ladzi-Alejewicz, je suis réalisatrice de films de fiction, je n'ai jamais fait de documentaire. Donc j'ai fait quatre longs-métrages, Innocence, Évolution, Irwig, et le film qui va sortir le 17 septembre, La Tour de Glace. Et j'ai fait aussi un moyen-métrage au tout début, à la fin des années 90, mon premier film, quand j'ai commencé à faire des films, qui s'appelle La Bouche de Jean-Pierre. J'ai fait une école de cinéma qui s'appelait l'IDEC, qui est devenue par la suite la FEMIS. Dans cette école, j'ai eu la chance, c'était un peu ça le système de l'école, c'était de faire des courts-métrages chaque année. On n'avait pas, je dirais, pas beaucoup d'enseignements. Ce n'est pas comme la FEMIS, ce n'était pas du tout structuré comme ça par département. Mais il y a quand même un aspect du cinéma qu'on a un peu plus travaillé là-bas, en tout cas. Voilà, moi, c'était un peu cette branche-là que j'avais choisie, c'est le montage. Et je trouve que ça m'a vraiment énormément plu. C'était un peu une révélation, le montage. Et je ne suis pas devenue pour autant monteuse, mais j'ai monté, quand je suis sortie de l'école, en fait, avec Gaspard Noé, on a monté une petite structure de production, les cinémas de la zone, pour pouvoir produire ce qui était à l'époque nos courts-métrages, en fait, et sur ces films-là. Donc, en l'occurrence, Karn et finalement Seul contre tous, qui s'est révélé être un long métrage, mais on l'a fait un peu comme un court métrage. On a fait un peu, on faisait un peu tous les deux, un peu tout dessus, si on veut. Et en particulier, j'ai travaillé au montage sur ces films-là. Ensuite, le moyen métrage que j'ai fait moi-même, je l'ai monté moi aussi. et simplement après ça... C'était un peu difficile pour moi de vraiment continuer à fond le montage et en même temps vouloir faire des films. Donc j'ai un peu continué à beaucoup m'intéresser au montage. Et sur mes films suivants, j'ai aussi quand même désiré travailler avec un monteur parce que je trouvais que c'était plus enrichissant. Mais c'est vraiment un aspect du cinéma qui me plaît, qui m'intéresse énormément. Donc je suis tout le temps là au montage. Et je demande au monteur de bien vouloir accepter cette situation et essayer des choses éventuellement que je peux proposer. Donc j'ai monté un tout petit peu des autres choses au début, puis finalement c'est un peu une chose que j'ai laissée de côté, en tout cas de monter des films des autres. Ce que je fais parfois aussi, c'est de collaborer sur des projets des autres au niveau du scénario. J'ai travaillé sur Enter the Void, au scénario, surtout sur la partie qui adapte le livre des morts des Tibétains. C'est la partie sur laquelle j'ai la structure, en fait, et puis les éléments qu'on a repris de ce texte dans son film, Gaspard. Sinon, si je remonte avant l'IDEC, avant cette école de cinéma, en fait, moi j'habitais au Maroc, à Casablanca, jusqu'à la fin des années 70, où j'ai passé mon bac là-bas, puis c'est seulement après que je suis venue à Paris pour faire des études, et donc j'ai commencé à aller au cinéma. toute seule, quand j'avais, je ne sais pas, 13 ans, par là. Ce qui était très, très intéressant à ce moment-là à Casa, c'est qu'il y avait beaucoup de salles de cinéma, et des très belles salles d'ailleurs, qui étaient peut-être des fois un peu décaties, mais il y avait aussi un côté, la beauté de ces bâtiments-là aussi. Je pense que ce n'était pas pour rien, dans le plaisir qu'on prenait à y aller. Et j'ai vu, c'était surtout des films contemporains, mais il y avait beaucoup de choses quand même. Il y avait du cinéma européen, du cinéma... Par exemple, il y avait du cinéma italien, le cinéma des années 70, c'était très riche. Moi, ce que j'aimais le plus, c'était les diallos. Donc, j'ai découvert les premiers films de Dario Argento, mais pas que les siens, d'autres de ce genre-là, qui me plaisaient énormément, que je trouvais très excitants, très effrayants, mais très beaux aussi, visuellement. Il y avait une atmosphère, quelque chose, l'histoire, je m'en moquais un peu. D'ailleurs, c'est pas ça qui était le plus intéressant. c'était vraiment le... les décors, les personnages, les ambiances et tout ça. Et c'était un peu comme un espèce de cinéma d'adulte, à la fois un peu inquiétant, évidemment, mais aussi très attirant. Il y avait ça, mais il y avait aussi, bien sûr, pas mal de films américains. Je me souviens d'avoir vu Duel de Spielberg, qui était aussi quelque chose, un peu une révélation. Je ne sais plus à quel âge je l'ai vu par là, mais c'était du cinéma. Et aussi, un fameux film qui est sorti à cette époque-là, c'est L'Exorciste. Donc oui, j'étais attirée par le cinéma fantastique, un peu d'horreur, mais L'Exorciste, ça m'a vraiment traumatisée. Et voilà, j'étais moins... Les comédies, tout ça, c'était moins ma tasse de thé, on va dire. Et puis ensuite, quand je suis venue à Paris, là, j'ai pu voir une plus grande variété de films. Évidemment, je suis allée à la cinémathèque, etc. Donc, ma cinéphilie est devenue un peu moins, je ne sais pas, un peu plus riche, un peu plus sophistiquée, peut-être, je ne sais rien. Alors, je ne sais pas dans quel sens tout à fait prendre la question, si c'est le premier rapport au cinéma. Comme plein d'enfants de ma génération, on a été emmenés voir des films pour enfants, des films d'animation entre autres, et en particulier des films de Walt Disney. Donc si c'était le premier rapport, je dirais que c'est peut-être le premier film que je me souviens avoir vu. Et en fait, c'est Merlin l'Enchanteur qui m'avait beaucoup impressionnée, je ne sais pas, je devais avoir 5 ou 6 ans, avec toutes les métamorphoses et justement quelque chose avec les éléments, maintenant que j'y pense. J'ai pas revu le film depuis très très longtemps, mais je crois qu'il passe par le feu, l'eau, l'air et tout ça. Et puis sinon, après, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à, c'était pas encore vraiment de la cinéphilie très élaborée, mais j'ai commencé à aller au cinéma toute seule et à trouver que c'était extrêmement fort émotionnellement et vraiment inspirant et tout ça. il y avait donc à la fois les films que j'ai pu voir à ce moment là de moi-même, mes choix, et puis aussi peut-être de commencer à jouer avec des images. Je n'avais pas accès, c'est dans les années 70, j'habitais au Maroc, je n'avais pas accès à beaucoup de matériel lié au cinéma, on va dire. Il y avait quelques revues de cinéma, et notamment il y avait une encyclopédie du cinéma qui paraissait toutes les semaines, je crois, et qui était essentiellement des photos, avec un peu de texte, et les photos me faisaient rêver. Donc ces images-là, c'était donc des images fixes, des photogrammes en fait de films, et ça me faisait... terriblement rêver à ces films que je ne pouvais pas voir et qui existaient. Après le lycée, oui, j'avais envie de peut-être faire une école de cinéma, mais je ne savais pas très bien comment ça se passait, ni je ne pouvais pas y accéder tout de suite. Donc, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et je pense que ça aussi, ce n'était pas tout à fait par hasard. C'était aussi, bon, voilà, ça rassurait mes parents que je fasse la fac et je ne sais pas, ça avait l'air très sérieux, histoire de l'art. Et donc, j'ai eu vraiment la chance de tomber sur des profs qui nous apprenaient à lire les images, les tableaux, les peintures, en l'occurrence. Et par exemple, le fameux Daniel Arras, qui a beaucoup écrit sur comment regarder une image, comment regarder un tableau. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup marquée, en fait. À la fois, il nous faisait voir le côté... La forme, c'est-à-dire comment par la forme on raconte quelque chose, comment par la couleur, comment les couleurs racontent quelque chose, comment la mise en scène de l'espace raconte comment les personnages placés à tel endroit, les lignes, on va dire. Et en plus, ce qui était peut-être intéressant pour moi, par rapport au cinéma, c'est qu'en fait, on travaillait sur des périodes de peinture qui étaient avec de la représentation. Ce n'était pas de la peinture abstraite. C'était par exemple le XVIe siècle ou le XVe siècle. Et du coup, vraiment, les tableaux racontaient des histoires. Et ils nous montraient aussi comment les gestes des personnages et les regards. On faisait beaucoup travailler sur le regard et l'importance du regard des personnages dans le tableau et qu'est-ce que ça signifiait. Et par exemple, même le regard caméra, en fait, les personnages qui regardent vers le spectateur. Donc tout ça, en fait, c'était des choses narratives. C'était comment on raconte une histoire à travers des gestes. à travers des regards, à travers des couleurs, à travers des... même évidemment la construction de l'espace. Donc ça peut amener au cinéma. Peut-être dans mon cinéma, où j'ai très tendance à faire des plans fixes, il y a effectivement une mise en scène à partir du cadre qu'on fait, et donc... Ce n'est pas forcément très compliqué, ce n'est pas forcément très long non plus à mettre en scène, mais disons que souvent les actions, les faits, on les met en scène à partir du cadre, beaucoup plus que... Faire jouer la scène aux acteurs et ensuite découper. C'est un peu ça aussi, forcément. Mais disons qu'il y a beaucoup cette idée de faire des plans fixes et de la mise en scène à partir du cadre. Ce qui me plaît dans les cadres fixes, c'est sans doute aussi que ça oblige à laisser des choses hors champ. Et bien sûr, le hors champ est très important. Mais c'est aussi, je ne sais pas, ça donne un... Oui, ça donne pas seulement un style, ça donne un sens. Et ça donne une force. aux choses qui se passent dans l'image. C'est comme ça que je le vois. Le fait que parfois, il faut que les acteurs sortent du cadre, ou quelque chose sort du cadre, quand il est fixe, c'est ça qui me... Je trouve ça très excitant, très intéressant. Après, c'est du cinéma de fiction qu'on doit un peu préparer. Je ne fais pas énormément d'improvisation, il y en a, mais ce n'est pas non plus comme on pose un cadre et on attend d'attraper quelque chose dedans. Un petit peu quand même. Par exemple, Innocence, qui est un film avec beaucoup de petites filles. Parfois, on en avait cinq, six, sept à l'image, cinq peut-être. Et on faisait des cadres fixes. C'était vraiment comme un enclos dans lequel on mettait nos oiseaux, je ne sais pas, nos petits poulets, si on veut. Et voilà, il y avait quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y avait de la narration qui arrivait par le cadre, par le fait qu'il y ait des limites. Je me donne des règles, j'impose des règles à l'équipe qui sont... notamment à l'image, qui sont effectivement, si on a décidé de faire des plans fixes ou si des mouvements, c'est vraiment précisément un type de mouvement à un moment, souvent plutôt des mouvements d'accompagnement. Mais c'est le plan fixe, c'est le scope, le format scope, le format cinémascope. C'est le fait de ne pas utiliser, ou le moins possible, des projecteurs et d'utiliser le plus possible la lumière naturelle. Et après, c'est... Voilà. Donc ça, ça fait une boussole, en fait. Ça m'aide à... Merci. Ça m'aide pendant le tournage, qui c'est souvent des chaos, et il faut prendre plein de décisions, et vite, et tout ça, d'avoir des règles, parfois on les transgresse, évidemment, mais parfois seulement, quand il faut vraiment, quand on ne peut pas faire autrement. Et ça m'aide à suivre le cap, sinon aussi par exemple de se dire, on fait ça avec une seule focale, on ne change pas de focale, ou vraiment dans des cas particuliers, parce que ça se sent, les perspectives derrière changent et tout ça, ça donne une unité au film. Et voilà, et ça, ça m'aide, c'est comme des outils pour m'aider à avancer dans la jungle ou dans la brume, je ne sais pas. Ça vient aussi d'un, je ne me sens pas capable de bouger la caméra dans tous les sens, on va dire, et donc peut-être ça, ça me fait peur, donc j'ai tendance à simplifier au point... d'avoir effectivement des plans fixes. Après, il y a, par exemple, dans le premier, on va dire, vrai film que j'ai fait qui s'appelle La bouche de Jean-Pierre, qui est un film de 50 minutes. En plus, on tournait dans un appartement. Et donc, c'était assez logique de poser la caméra, de ne pas la bouger. Après, c'était aussi des histoires de temps, de matériel qu'on n'avait pas. Il y a un moment où on fait des espèces de travelling en étant sur un chariot. Ça, ce n'était d'ailleurs pas dans l'appartement où on fait tourner la caméra sur son axe, mais c'est des petits moments. Et effectivement, ça vient un peu de conditions économiques et de ce que je me sens ou pas capable de faire. En plus, à l'époque de la bouche de Jean-Pierre, on avait justement des projecteurs. Et les projecteurs, une fois la lumière était en place, voire même presque accrochés à la caméra, c'était... c'était plutôt les drapeaux qui étaient accrochés à la caméra. On ne pouvait pas beaucoup bouger. Parce que voilà, ça, ça m'a conduit à faire un cinéma assez, on va dire, statique. À l'arrivée, je me suis dit, bon, jouons avec ça. Et je pense que dans La Bouche de Jean-Pierre, ça marche d'autant bien que ça donne une espèce de, je ne sais pas, de pesanteur à ce lieu. Et puis, de toute façon, oui, il n'y avait pas tellement la possibilité, par ailleurs, de faire tellement de mouvements. Après, Innocence, ça bougeait un peu plus parce que les petites filles bougeaient, se déplaçaient, marchaient dans le parc. En plus, c'est des filles qui font de la danse, donc il y avait une tendance quand même à les accompagner. Mais plutôt, c'était du mouvement d'accompagnement, on va dire. Ce n'était pas vraiment comme, je ne sais pas, la caméra dans certains films qui bouge pour aller se promener, pour aller chercher telle ou telle chose. Et après, par exemple, Evolution, on avait très, très peu d'argent. On a tourné sur une île espagnole. où en fait, ça nous aurait coûté cher même d'avoir un Stedicammer, par exemple. Et du coup, je me suis dit, bon, faisons avec ces contraintes un principe artistique. Donc là aussi, je suis retournée à quelque chose de très fixe. Et en fait, ça m'a plu, quoi. Comme ça, peut-être un style ou un goût pour quelque chose s'est développé. Et je me dis, ça peut marcher, ça me plaît. Donc, voilà, c'est venu comme ça. Après, c'est venu aussi d'un cinéma que j'ai pu aimer, que ce soit... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mouvement chez lui, mais je pense à Bresson ou aux Zous. C'est sûr que ça bouge pas beaucoup chez aux Zous. Voilà que j'aime, et je trouve qu'il y a une force là-dedans, voilà, donc ça s'est défini comme ça. Après l'expérience de la bouche de Jean-Pierre, où justement ce n'était pas le cas, on n'avait pas cette liberté-là en partie aussi à cause de l'éclairage, sur Innocence, où c'était... Avec tous ces enfants, déjà, il fallait qu'on puisse mettre en place très vite les plans, parce que ça allait être très difficile avec elles. Et aussi, effectivement, avoir une certaine liberté, même si, en effet, je dis, on fait la mise en scène à partir du cadre, ça a évidemment des limites. Il faut quand même voir où est-ce qu'elles peuvent se déplacer. Et aussi, même, en plus, avec des enfants, il faut quand même leur laisser un peu de latitude. Après, c'était un peu, dans ce film, comme épingler des papillons. C'est-à-dire que c'était un cadre fixe dans lequel on plaçait les enfants. placée aussi un peu en fonction de comment elle pouvait arriver un peu à vivre. Là-dedans, c'est sûr que c'est très précieux de pouvoir placer la caméra dans tous les axes, en fait, et tout d'un coup de se dire, mais si on se retourne, en fait, c'est beaucoup mieux, parce que soit c'est mieux pour les gens qu'on filme, soit c'est mieux pour le décor, tout simplement. Donc, effectivement, cette liberté-là, elle est très, très précieuse, et la rapidité qu'on gagne aussi avec cette liberté, c'est génial. Et peut-être une autre chose de la lumière, de ce principe de lumière naturelle, en tout cas avec des directions de lumière naturelle, c'est-à-dire que ce soit la lumière du jour ou les lampes qui sont vraiment dans le décor, c'est que ça, pour moi, ça donne une espèce d'ancrage dans la réalité. Et comme les films, c'est toujours plus ou moins des choses qui se passent dans l'imaginaire ou en partie dans l'imaginaire, que la lumière soit réelle, ça me... Je trouve ça très important. De même que les lieux, les décors. Le dernier film, on a tourné en studio, mais on a tourné en studio parce que c'est l'histoire d'un tournage en studio. En fait, moi, ça me plaît beaucoup les décors réels, les lieux vrais, parce que je trouve que si c'est pareil, ça donne un ancrage à ces histoires qui sont des contes plus ou moins fantastiques. Par exemple, si un personnage doit délirer sur une tâche sur le mur, C'est bien si le mur il existe pour de vrai, que cette tâche on l'a trouvée. Je pense que ça vient pour moi des choses que je cherche à exprimer. Je ne me dis pas, tiens je vais faire un film dans un genre, ou de ce genre, ça vient un peu intuitivement. Ça vient plutôt des... Peut-être pas des histoires, mais des situations, des personnages, des motifs. Je pars d'images, je pars d'ambiances, je pars beaucoup des lieux. Même si je ne les ai pas forcément quand j'écris, j'imagine des lieux, j'imagine des ambiances, j'imagine des images. Et des personnes là-dedans, et des émotions. Je pars de ça. Je ne pars pas d'histoires et je ne pars pas d'un personnage au sens très psychologique. Ce n'est pas du tout la psychologie qui m'intéresse. Et comme c'est souvent, c'est même toujours des contes, c'est presque malgré moi, c'est effectivement l'idée d'un trajet, d'un personnage ou de quelques personnages dans des lieux qui représentent une forme de dramaturgie. Les lieux, la topographie, c'est un peu la dramaturgie. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et c'est donc des images, des ambiances. et j'essaie de... Faire un voyage émotionnel à mes personnages, ou un voyage qui est souvent une forme de voyage de découverte. Donc ils passent par des endroits, ils découvrent des lieux, ils découvrent éventuellement des événements. Voilà, c'est un peu comme ça. Et ça ne part pas d'une histoire, ça part d'images et d'émotions et de sensations. En fait, c'est vraiment... Comme dans les contes, c'est où le personnage va devoir traverser des épreuves, traverser une forêt, et il doit se mettre en route. C'est des quêtes, c'est un peu ce qu'on appelle classiquement la quête du héros. Je ne sais pas, quelque chose va déclencher cette quête, et puis il va traverser, dans mon cas, il explore un territoire. Dans une sens, la petite fille qui arrive, elle va explorer cette forêt, cette épreuve. On va lui apprendre, il y a telle chose là, telle autre chose. Et dans chaque endroit, ça raconte quelque chose. C'est une progression. Oui, c'est des épreuves, c'est des coming of age, c'est des processus de maturation, de grandir. C'est pour ça aussi que souvent, c'est des films dont les personnages sont des enfants ou des jeunes ou des adolescents. Dans La Tour de Glace, ça commence à grandir. Elle a peut-être 16 ans. Et du coup, c'est ça, ils se découvrent, ils grandissent éventuellement. Après, il y a un cas de figure, il y en a un qui ne grandit pas. Oui, c'est déjà un adulte, mais lui, il est un peu foutu. Il tourne en boucle. Je suis comme ça tout le temps, malgré moi, attirée par des histoires avec des enfants ou des jeunes. C'était plutôt des enfants jusqu'à présent. Maintenant, c'est effectivement une adolescente. Mais parce que, bien sûr, c'est des moments où tu es un peu nouveau. Donc, on va découvrir des choses vraiment qu'on ne connaît pas. Et aussi, ce qui me plaît avec les enfants, c'est que justement, comme ils sont encore un peu innocents, mais innocents dans le sens de ne pas savoir. Ils peuvent interpréter, donc ils peuvent projeter plus facilement. J'ai l'impression que le rapport à l'imaginaire avec les enfants, ça marche bien ensemble. C'est un peu réducteur, ce que je dis, évidemment. Mais je dois aussi avoir un truc sur passer à l'âge adulte, être un gros, gros nœud chez moi, dont je ne suis pas entièrement consciente, mais qui ressort dans les films chaque fois. C'est ce rapport au monde adulte qui est souvent mystérieux, qui est des fois absurde, qui est fantasmagorique. Les personnages d'adultes sont souvent un peu fantasmés et on ne les connaît pas très bien parce que les films sont vus du point de vue des jeunes protagonistes. Et c'est toujours vrai quand même avec la tour de glace, même si on s'approche un tout petit peu plus de la vraie personne. En fait, elle découvre d'abord par le prisme du conte, c'est-à-dire par le prisme de la Reine des Neiges, qui est un conte que cette jeune fille, qui s'appelle Jeanne dans le film, aime beaucoup. Et quand elle va se retrouver dans ce studio de cinéma, c'est sans doute pas totalement par hasard que c'est ce conte-là qu'il filme. Donc, elle va d'abord rencontrer la Reine des Neiges avant de rencontrer l'actrice. Donc, c'est vraiment la partie la plus fantasmée. Et après, elle va rencontrer l'actrice, qui en plus est une star dans l'histoire, donc avec un statut comme ça, à la fois un peu de pouvoir, un peu effrayant, parce qu'en plus elle est compliquée cette femme, et elle règne un peu en reine également. Enfin voilà, presque cette actrice, elle se confond avec son propre personnage, elle est comme mangée un peu par son personnage de reine, il y a quelque chose de l'emprise. qui n'est pas que sur la jeune fille, qui est aussi sur l'actrice. La Reine des Neiges a une emprise aussi sur l'actrice, en fin de compte, quelque part. Et donc, elle va découvrir l'actrice et peut-être à un moment s'approcher, découvrir un peu plus la femme derrière cette diva. Ça aurait été difficile de trouver quelqu'un d'autre comme Marion Cotillard en France pour jouer ce rôle, parce qu'elle est vraiment, d'une part, dans ce statut de star, oui, vraiment, et donc à la fois elle est très familière et à la fois elle ne l'est pas du tout, on ne sait pas qui c'est en fait Marion en vrai. Moi-même, je ne sais pas plus que ça non plus. Et voilà, et en même temps, j'ai l'impression de la connaître et tout le monde la connaît. Donc, il y a à la fois cette présence, cette distance, c'est déjà ça. Après, Marion, je la trouvais, enfin, je trouve qu'elle est capable de jouer des choses très différentes et qu'elle a plusieurs, vraiment, elle a plein de facettes. Elle a ce côté, elle est comme ça, de beauté, de sensualité, de charme, d'attraction. Et puis, je sais ou je devinais qu'elle pouvait être froide et distante. Et voire dure, et voire plus que ça. Et du coup, voilà, Marion, elle peut faire ça aussi. Et ce n'est pas tout le monde, peut-être, qui peut faire ça. Et le jouer comme ça, et elle est très... Je trouve qu'elle le fait avec subtilité, et avec peu de choses, et ça, c'était super. J'avais fait un film avec elle il y a 20 ans, donc ce n'était pas la même Marion, ce n'était pas la même moi non plus. C'était avant la môme, donc avant qu'elle devienne... Quelque part, il y avait un peu un prolongement finalement, parce que je me disais, c'est drôle, ce personnage que je lui ai fait jouer dans Innocence, où elle est cette professeure de danse, à la fois c'est un peu une figure idéale féminine, et pour les petites filles comme ça qui la regardent, c'est comme un modèle un peu, on va dire. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et elle est malheureuse, et elle a comme une blessure, une faille, voilà. Et à un moment aussi, elle se montre dure. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je n'ai pas réalisé tout de suite, mais en fait, je me suis dit, c'est un peu le même type de personnage dans une autre situation, plus tard, dans un autre environnement. Donc, je ne sais pas. Et voilà. Et en tout cas, Marion aussi, elle a ce côté très... Elle a cette beauté un peu classique, on va dire. Et comme il y avait cette référence vraiment aux stars des années 30, 40, je trouvais que ça marchait avec elle vraiment. Et en même temps, elle est moderne dans son jeu. Enfin, elle a ces deux aspects, quoi. Donc, elle est... Oui, il n'y en a pas... Il n'y en a pas deux comme elle. Ce qui est excitant avec les enfants, c'est qu'ils sont surprenants en réalité. Ce n'est pas que les acteurs ne le sont pas, mais ils le sont de manière différente. Parce qu'ils ont vraiment leur perception à eux de ce qu'on est en train de tourner. Ils sont vraiment dans le moment présent. Par exemple... Les histoires que ça raconte, ce n'est pas tellement ça qui les intéresse. C'est vraiment, d'une part, l'expérience du tournage, et d'autre part, les petites choses qu'ils ont à faire sur le moment, etc. Après, ce qui est différent, je pense que c'est les histoires d'âge aussi, et peut-être aussi quand même entre les filles et les garçons. Innocence, j'ai fait ce film avec que des petites filles qui ont entre 6 et 11 ans, et parfois on en avait 35, puisque c'est comme toute une école, etc. Et c'était très intense émotionnellement, notamment avec les petites, évidemment, parce qu'elles étaient très jeunes, parce qu'elles avaient ce rapport avec nous, comme si on était... C'est aussi comme si elles étaient dans une école ou comme si elles étaient dans, je ne sais pas, une colonie de vacances. Et elles avaient un rapport aussi très immédiat et très fort les unes avec les autres. Enfin, ça faisait vraiment... Et effectivement, et avec nous. et je crois que Même si parfois c'était difficile avec elles, quand elles ne voulaient pas, elles ne voulaient pas. Puis c'était à nous de nous plier et de trouver éventuellement des ruses pour leur faire faire certaines choses. Enfin, en tout cas pour garder leur intérêt, parce que c'était que ça le truc. Il fallait que ça, la concentration et que ça les intéresse, parce que parfois ça ne les intéressait pas. Et les grandes, même les plus grandes qui avaient 11 ans, elles trouvaient ça des fois nul, ce qu'on leur demandait de faire, de devoir, je ne sais pas, marcher en tenant la main d'une petite. Les costumes étaient nuls. Et après, les garçons, sur Évolution, il y en avait moins à la fois, heureusement. Il y en avait quatre ou cinq, éventuellement. C'était des garçons de 10, 11 ans, 12 ans. D'ailleurs, Max, qui joue le principal, il avait en réalité 13 ans. Donc, c'est quand même autre chose déjà. C'était des pré-ados. Alors, eux, ils étaient moins dans... Enfin, c'est pareil. Ce qui les amusait, c'était la réalité du tournage. certaines scènes et plus c'était bizarre, plus ça les adorait d'être dans l'aquarium, de faire semblant d'être mort, de faire semblant qu'on leur ouvre le ventre, je sais pas ça c'était... Voilà après, eux comme les filles, je pense qu'ils s'en fichaient du film en soi et par exemple c'était un peu frustrant pour moi mais quand ils ont vu le film, ben ils le voyaient comme un film je pense de valeur Les vacances, tu vois, pas comme une histoire, donc ça leur passait un peu au-dessus, quoi. Et donc, c'est « Ah oui, tiens, on avait fait ça, tu as vu, c'est rigolo, tu te rappelles. » Voilà, bon, c'est bien aussi, en fait. Et les filles, pour Innocence, c'est un peu pareil. Je pense qu'elles se remémoraient l'expérience du tournage, qui en soi était déjà un monde entier, avec les costumes, avec les petits micros qu'on leur posait sur elles, avec, bon, plein de choses, avec les décors, etc. Voilà, et après j'ai eu effectivement deux fois un film où c'est une petite fille de 9-10 ans, toute seule, parce que dans les autres films c'est des enfants entre eux, ce qui est plus facile d'une certaine manière, parce qu'ils y prennent plus de plaisir, mais d'un autre côté pour nous des fois c'est moins facile, parce qu'ils sont beaucoup plus dissipés quand ils sont ensemble évidemment. Et sur La bouche de Jean-Pierre, la petite fille Sandra Sanmartino, et sur Irwig où elle a aussi, c'est une petite fille de 9 ans. où il n'y a pas d'autres enfants avec elle qui jouent, c'était très facile. Après, c'est vraiment d'essayer de sentir ça au casting, leur concentration possible, leur sorte d'implication. Mais dans tous les cas, l'histoire elle-même, je pense que souvent ils s'en fichent et c'est amusant, c'est intéressant d'ailleurs. Parce que ce n'est pas ça en fait, qu'ils voient. Ils voient des choses très concrètes et c'est intéressant. Au tout début, par exemple, quand j'ai fait La bouche de Jean-Pierre, qui est un film qui est le moins, on va dire, dans l'imaginaire de tous mes films, qui est dans la réalité, enfin en tout cas une espèce de réalité, je ne me rendais pas compte si j'étais hors du paysage français ou à quel endroit j'étais. Effectivement, c'est un film dans un milieu plutôt réaliste, comme ça, un peu populaire. Alors ça se passe dans des HLM, c'était un peu les... Je ne sais pas, ça me semblait plus universel et abstrait, par exemple, de filmer des gens dans des HLM que de les filmer dans des appartements bourgeois haussmanniens. C'est un peu pour ça. Et après, le film, il est en fait très stylisé, il ne repose pas sur vraiment des dialogues. Enfin, il y en a, etc. Mais je me suis rendue compte, après l'avoir fait, que les gens le voyaient comme quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait. Mais je n'en avais pas eu conscience en le faisant. Je pense que, et surtout La Bouche de Jean-Pierre, peut-être même c'est celui qui se rapproche du cinéma de Gaspard du début, parce qu'on l'a fait ensemble, ces films, Carnes, Seul contre tous, La Bouche de Jean-Pierre, on les a fait ensemble. Le fait qu'on soit deux, ça nous donnait l'impression qu'on n'était pas seuls, qu'on était beaucoup à faire un peu ce cinéma-là. C'était aussi une époque, donc ça c'est vers la fin des années 90, où il y avait quand même, par exemple, il y avait Yann Cunen, il y avait même les tout débuts de Dupontel. où on pouvait se dire, bon, eux aussi, ils essayent de faire un cinéma visuel, stylisé, mais qui est quand même dans la réalité encore, enfin, plus ou moins, peut-être plus du pontel que Yann, je ne sais plus. Voilà, donc il y a eu ce moment-là, fin des années 90, où il y avait comme, peut-être même aussi, Mathieu Kassovitz, en fait, avec La Haine. Ça nous semblait être un peu de la même famille. Après, quand j'ai fait Innocence... J'ai l'impression que je me suis plus écartée de ça, parce que je suis allée effectivement vers des choses plus d'imaginaire. Et vraiment, je ne saurais pas si on me dit c'est quoi le genre, c'est quel genre Innocence. Je ne me suis pas du tout posé la question. De même, rétrospectivement, je ne sais pas dire. Alors oui, ça se passe dans un monde imaginaire, mais ce n'est pas un film de genre, surtout comme on sent ce qu'on dirait aujourd'hui. Donc oui, ça a été... J'ai bien vu, avec Innocence, plus qu'avec La Bouche de Jean-Pierre, qui avait eu quand même un petit succès, que tout d'un coup, là, les gens se disaient « mais c'est quoi ça ? » et ne savaient pas comment réagir par rapport au film. Et ça a été assez difficile en France sur le moment. Et la sortie, après, sur la durée, le film s'est mis à exister vraiment, etc. Et puis dans les autres pays et tout ça. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse que des jeunes. ou relativement jeune, découvre mon film, ce film-là. Mais oui, j'étais vraiment... C'est ça, c'était pas du cinéma de genre au sens un peu plus commercial. Donc c'était pas un film de cette sorte-là. Et c'était un film, on va dire, d'auteur, quoi. Mais pas d'auteur comme le cinéma français était, et même est encore. Voilà, donc oui, je me suis sentie là très isolée, on va dire. Et quand j'ai fait, j'ai mis vraiment très, très longtemps à réussir à faire un autre film. Et je pense que ça a à voir avec ça. C'est comme si ce truc-là, Innocence, qu'est-ce que les gens ne savaient pas. En tout cas, les financiers, les producteurs, ça n'avait pas trop quoi en faire. Les journalistes, sur le moment, même s'ils avaient l'air d'aimer, ils étaient perplexes. Donc, tout ça faisait, c'est quoi ça ? Voilà. Et après, Évolution, c'était un film un peu plus dans le genre, justement, puisque c'est de la science-fiction, mais ce n'est pas une science-fiction, comment dire, c'est plutôt un film encore intimiste, en fait. qui exprime les peurs d'un enfant, et c'est dans un contexte qui pourrait être de la science-fiction, enfin très low-tech, quoi, mais... Voilà, donc... Est-ce que ça a été mieux perçu ? C'est pareil, pour un film de genre, ça semblait pas au bon endroit. Et pour un film d'auteur, non plus. Donc voilà, ça a mis vraiment du temps. Après, c'est étrange, parce que j'ai fait un troisième film, Eerie, qui, là, je me suis dit, mais c'est aussi... parce que les circonstances s'y prêtaient. C'est un film qu'on a financé avec les Anglais parce que, effectivement, d'une part, parce que, voilà, j'avais rencontré des gens en Angleterre qui aimaient mon cinéma et qui étaient ouverts éventuellement à participer à un projet et aussi parce que, si j'ai voulu adapter un roman d'un Anglais et je travaillais avec un scénariste anglais, donc tout d'un coup, il y a des choses qui s'alignaient un peu, mais surtout, je me suis dit, ce film-là, Airwix, c'est pareil, c'est quoi son genre ? C'est pas un... Il y a du fantastique, il y a des éléments éventuellement un peu d'horreur dedans. C'est un film, c'est une espèce de film néo-gothique, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ce n'est pas la grammaire ou les codes exactement du cinéma de genre, au sens où on l'entend de plus en plus. C'est aussi un film d'auteur, mais voilà. Et pour les Anglais, je pense que c'est quelque chose qu'ils comprenaient mieux, parce qu'ils sont plus habitués peut-être à ces... à jouer avec des choses de l'imaginaire, justement le code des genres, mais un peu comme ça, de manière en le distordant, ou un peu de manière périphérique, voilà. Et après, oui, même si la sortie française n'était pas extraordinaire du tout, j'ai eu l'impression que... Alors je pense que la cinéphilie des gens changeait, les producteurs ne sont plus les mêmes, ils n'ont pas été élevés avec la même cinéphilie. Les gens qui ont 60 ans, voire... plus aujourd'hui, leur cinéphilie c'était vraiment dans les salles de cinéma et c'était sans doute un certain cinéma notamment français voilà, le cinéma d'auteurs français et après peut-être les générations d'après, ils ont été plus nourris par la vidéo et donc avaient accès à des films plus éclectiques etc. Donc je pense que ça ça a aidé et voilà. Et maintenant je ne sais pas à quel endroit je suis mais je ne sais pas si j'ai des cousins, ils sont Par exemple, eux, ils vivent en Belgique, mais disons, ils sont français, c'est du cinéma francophone. Ça, c'est Bruno Fortanier et Hélène Cathet. Il y a eux. Après, je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être quelqu'un comme Julia Kowalski. C'est autre chose, mais il y a quelque chose qui se rapproche un peu. On a un endroit de... Il y a même un film comme le film de Maty Diop, Atlantique, qui est un film à la fois réel, réaliste et poétique, et avec une dimension... fantastique. Voilà, ça, par exemple, c'est un film que j'aurais adoré faire. J'ai l'impression de me reconnaître dedans. Peut-être c'est à cause du Maroc. Bon, ce n'est pas au Maroc, son film à elle, mais disons qu'il y a quelque chose, peut-être, sur le rapport du fantastique dans la réalité. Après, peut-être l'autre chose, c'est que mon cinéma, ce n'est pas un cinéma du spectaculaire ou de l'efficacité au sens narratif. C'est encore autre chose. Après, je pense que c'est plutôt que la cinéphilie des gens est devenue plus éclectique, plus ouverte et que des formes qui étaient plus marginales sont devenues plus mainstream. Je trouve que, étrangement, le cinéma de Julia Ducournau... Peut-être un peu moins le dernier, mais c'est comme si elle rend plus mainstream des choses qui étaient, des éléments qui étaient peut-être plus dans les marges avant. Mais je pense que c'est un mouvement général de recycler toutes ces choses qui maintenant commencent à être connues.