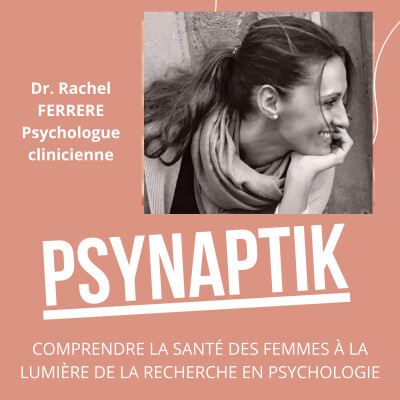Speaker #0Bonjour et bienvenue sur le podcast de PsyNaptique. Je m'appelle Rachel Ferrer, je suis chercheuse en psychologie et psychologue clinicienne. À travers ce podcast, j'ai envie de créer un pont entre le monde de la recherche scientifique et notre quotidien. La psychologie et les neurosciences regorgent de découvertes passionnantes, mais souvent elles restent coincées dans des articles un peu arides réservés aux chercheurs. Ici. Je vais vous aider à les décoder, les vulgariser et surtout les relier à des thèmes concrets autour de la santé. La douleur, le stress, nos émotions, nos comportements. Et comme comprendre son cerveau peut être sérieux mais pas forcément ennuyeux, je vous promets un ton clair, accessible, parfois avec une petite touche d'humour, pour que la science parle à tout le monde. Alors. Installez-vous confortablement, on part ensemble explorer ce qui se joue dans nos têtes et dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui semble purement médical a priori, mais qui en réalité est profondément psychologique. Le dépistage du cancer du sein. Chaque automne, Octobre Rose remet ce sujet sur le devant de la scène. Et pourtant... Les chiffres restent stables. A peine 44% des femmes participent au dépistage organisé contre les 70% attendus en Europe. Alors pourquoi ? Pourquoi tant de femmes repoussent, évitent ou renoncent ? Pas par négligence, mais souvent par peur, par fatigue, par manque de confiance. Aujourd'hui ? Nous allons parler de ces freins invisibles, la peur, l'anxiété, les croyances, le poids du passé et le rôle essentiel des proches et des équipes. Commençons par lire la lettre de Sonia, 52 ans. Bonjour Rachel, l'année dernière j'ai reçu le courrier pour le dépistage. J'ai mis trois semaines avant d'ouvrir l'enveloppe. Ma mère est morte d'un cancer du sein quand j'avais 15 ans. Depuis, chaque fois que je vois le mot mammographie, j'ai mal au ventre. Quand la radiologue m'a dit qu'il fallait refaire une image, j'ai cru que tout recommençait. Finalement, c'était un faux positif, mais je n'ai plus jamais dormi tranquille. J'ai compris que ce n'était pas la peur du cancer, mais la peur de revivre ce sentiment d'impuissance. J'y retournerai cette année, mais j'aimerais qu'on parle aussi de ça, de la peur. et du souvenir. J'ai moi-même reçu la fameuse invitation à ce dépistage avec le petit livret explicatif qui est censé m'apporter des informations susceptibles de me rassurer. Le problème, c'est que j'y lis que le cancer du sein est à la fois le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Étonnant. Je croyais que c'était celui qui se traitait le mieux. J'y lis aussi qu'il représente plus de 12 100 décès par an et que mes seins vont être comprimés dans deux plaques. Bref, une invitation au voyage en enfer. Alors, quel est le rôle de cette peur ? Eh bien, la peur n'est pas forcément négative. Les recherches d'Ivanova et de Valmen montrent qu'elle agit comme un moteur à double effet. Si on se sent capable d'agir, la peur devient un signal d'alerte utile qui pousse à passer à l'action. Mais si on se sent impuissante, elle devient paralysante. C'est ce qu'on appelle un évitement défensif. La peur devient si forte que le cerveau préfère ne pas affronter la situation. Concrètement, ça donne « je n'ai pas le temps » , « ce n'est pas urgent » ou « je ne veux pas savoir » . Ces phrases sont souvent des façons de se protéger, mais ce mécanisme d'évitement empêche aussi la prévention. La peur va donc devenir un moteur lorsque la patiente a un sentiment de contrôle. Expliquer aux patientes la qualité des prises en charge pluridisciplinaires dans le cas d'un diagnostic de cancer, parler du nombre de patientes diagnostiquées qui aujourd'hui vont bien, sont des leviers plus favorables que l'affichage du nombre de décès par année. Bref, il y a encore du boulot. Le cas de Sonia ? illustre la situation des femmes ayant été confrontées au cancer, que ce soit à travers leur propre maladie ou celle d'un proche. Ces femmes vivent souvent le dépistage non comme une simple démarche préventive, mais comme une expérience émotionnelle chargée. Pour elles, l'examen ne symbolise pas la prévention, mais la possibilité d'un retour du drame. Le geste médical réactive des souvenirs, des sensations. parfois des images ancrées dans la mémoire du corps et de l'esprit. Cette réactivation peut être intense, même lorsque le dépistage se conclut par un résultat normal. Mais un simple faux positif, c'est-à-dire un examen qui suggère une anomalie avant d'être infirmé, suffit à provoquer un stress psychologique durable, parfois assimilable à un traumatisme mineur. Dans le cas de Sonia, le dépistage agit comme un stimulus associé à la peur initiale. Les sons de la machine, l'attente de résultats, l'odeur du cabinet, ou même le courrier de convocation, peuvent raviver des souvenirs émotionnels liés à la maladie. Sur le plan neuropsychologique, cela s'explique par le rôle de l'amidale et de l'hippocampe dans la mémoire émotionnelle. Ces structures encodent les expériences menaçantes de manière durable, parfois indépendamment du contexte actuel. Ainsi, même si la situation est aujourd'hui sans danger réel, le corps et le cerveau réagissent comme si le danger revenait. J'aimerais revenir à présent sur la question des faux positifs, autrement appelés résultats faussement alarmants. Ces faux positifs créent une détresse aiguë, suivie d'une anxiété résiduelle. Les travaux de l'équipe de Gilbert montrent que les femmes ayant vécu un faux positif rapporté plusieurs mois plus tard des symptômes d'hypervigilance, de troubles du sommeil et de ruminations anxieuses comparables à ceux observés dans les réactions de stress post-traumatique. Ce phénomène n'est pas lié à la fragilité des patientes, mais à la violence psychique du suspense diagnostic. Le moment où tout semble suspendu, où l'on se projette déjà dans la maladie, avant d'être rassuré. La certitude rationnelle, tout va bien, ne suffit pas à effacer la trace émotionnelle, j'ai cru que c'était grave. Alors quels sont les autres freins silencieux à la démarche de dépistage ? L'équipe de recherche d'Odonel a montré que la dépression et l'anxiété réduisent la participation au dépistage. Ce n'est pas un refus, c'est une perte de motivation et de ressources cognitives. Quand on est en détresse, tout paraît plus lourd. Appeler, s'organiser, affronter l'incertitude. L'entretien motivationnel, hélas trop peu pratiqué, aide à reconnecter la personne à ses propres raisons d'agir, en fixant notamment des micro-objectifs, à réduire le projet de dépistage aux petites actions à mener. Par exemple, je vais juste appeler pour prendre rendez-vous, plutôt que je vais faire le dépistage. Ces petits pas restaurent le sentiment d'efficacité personnelle. Et parfois, il faut du lien humain. Une amie, une sœur, une collègue, un professionnel qui accompagne. Le dépistage est plus facile quand il n'est pas vécu seul. Certaines études ont montré que les femmes ayant un niveau d'études inférieure au secondaire participent beaucoup moins au dépistage. Elles expriment un sentiment d'incompétence face au langage médical et une méfiance accrue vis-à-vis du système de santé vécu comme distant ou bien paternaliste. Ce n'est pas un refus de soins, mais une forme de distance apprise. Je ne comprends pas bien, donc je préfère ne pas y aller. Cette problématique interroge ce que l'on appelle le niveau de littératie en santé. La littératie en santé désigne la capacité ... à trouver, comprendre, évaluer et utiliser les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée en matière de santé. Elle ne se limite pas à la lecture. Elle implique la compréhension du vocabulaire médical, la capacité à poser des questions, à évaluer la fiabilité d'une source et à appliquer l'information à sa propre situation. Quand cette littératie est faible, les messages de prévention, souvent techniques et abstraits, deviennent inaccessibles. Et lorsque je vois le nombre de statistiques sur le fameux petit livret associé à ma convocation pour le dépistage, je me dis que sans bagage universitaire, je pourrais être tentée d'en avoir très très peur. Maintenant, parlons des croyances fatalistes. Un exemple, si le cancer doit venir, il viendra. Ah les croyances, si différentes d'une culture à l'autre. Et pour rappel, le territoire français abrite en son sein des millions de femmes de cultures très différentes. Les croyances fatalistes reposent sur l'idée que la santé et la maladie dépendent du destin, de la volonté divine ou de la chance, plus que de comportements individuels. Elles traduisent une faible perception de contrôle personnel sur la santé. L'équipe de passe-mort a montré que ces croyances réduisent l'intention de dépistage, même lorsque l'information médicale est claire. Le fatalisme agit ici comme un mécanisme de protection émotionnelle. Si tout est déjà écrit, je n'ai pas affronté la peur de découvrir quelque chose. Et cette logique bloque l'action préventive. Un autre facteur important est l'isolement social, qui diminue fortement la participation au dépistage. L'isolement social prive les femmes des ressources affectives et pratiques qui soutiennent la prévention. Échange d'informations, accompagnement, normalisation des émotions. Les femmes seules ou isolées socialement ont moins accès à l'information, moins de modèles de comportement préventif et moins de soutien émotionnel pour faire face à leur peur. Les travaux de l'équipe de McQueen ... ont montré que la probabilité de se faire dépister augmente lorsque le sujet circule dans le réseau social. C'est-à-dire lorsque j'ai une amie, une sœur, une collègue avec qui en parler ou avec qui aller faire ce dépisteur. Et si nous parlions maintenant des minorités culturelles et sexuelles ? Les femmes issues des minorités rapportent fréquemment le sentiment d'être jugées, mal comprises, ou invisibilisées dans les consultations. Les études montrent que pour les femmes LGBTQ+, les examens gynécologiques et les campagnes de dépistage sont souvent conçues dans un cadre hétérocentré. Elles cumulent des micro-expériences difficiles qui créent ce que la psychologie sociale appelle une menace identitaire, la peur d'être jugée sur ce qu'on est avant même d'être écoutée comme patiente. Cette anticipation de jugement, souvent fondée sur des expériences réelles, peut suffire à dissuader de consulter. Le cabinet médical devient alors un lieu d'inconfort émotionnel, voire d'évitement. Tout cela entraîne une insécurité relationnelle qui est un facteur de désengagement vis-à-vis du dépistage. La sécurité relationnelle désigne le sentiment d'être accueilli, compris et respecté dans son identité, sans crainte d'humiliation ni de rejet. Quand elle est absente, chaque interaction médicale devient une épreuve émotionnelle importante, parfois plus douloureuse que l'examen lui-même. Pour ces femmes, le dépistage n'est pas un simple acte préventif, c'est un test de confiance envers l'institution médicale. Et lorsque cette confiance est fragilisée, la peur d'être maltraitée, incomprise ou jugée, prend le pas sur la peur de la maladie. Le phénomène est observé non seulement chez les femmes LGBTQ+, mais aussi chez les femmes migrantes, afro-descendantes, aux issues de culture où la pudeur, la honte corporelle ou la hiérarchie médecin-patient sont particulièrement marquées. Enfin, il faut noter que l'absence de représentation inclusive dans les campagnes de prévention renforce cette distance. Lorsqu'aucune femme qui leur ressemble n'apparaît dans les affiches ou les spots de sensibilisation, certaines patientes concluent implicitement que ce message n'est pas pour elles. Mais tiens ! Voyons à quoi ressemblent les personnages des illustrations du fameux petit livret que j'ai reçu. Oui, disons que les patientes sont plutôt de type caucasien avec cheveux longs. Bon, tant mieux pour moi, tant pis pour les autres. Alors quels seraient les conseils pratiques à donner aux femmes pour les aider à aller vers ce dépistage ? Tout d'abord, s'informer et s'informer à son rythme. Lire, poser des questions. Demandez à avoir des explications, mais cela auprès de médecins ou bien auprès de sites référencés. Je pense que les forums ne sont pas du tout des bonnes idées. Ensuite, prévoir le rendez-vous à un moment serein. Éviter des jours surchargés ou émotionnellement lourds. Et puis peut-être ne pas forcément attendre d'être complètement prête. À un moment donné, c'est juste se dire je vais prendre un rendez-vous et puis ça va me laisser le temps peut-être de me préparer, mais il y aura déjà un engagement dans l'action. Et ça, à l'air de rien, ça peut déjà faire baisser l'anxiété. Vous pouvez aussi décider d'y aller accompagné, parce que le soutien réduit l'anxiété, et puis de préparer un rituel positif après, peut-être prévoir un café, un repas avec une copine, parce qu'associer le dépistage à... à quelque chose de positif, va vous donner le sentiment d'une expérience globale positive. Et puis demandez de l'aide si la peur est trop forte. N'hésitez pas à demander l'aide d'un psychologue ou bien à aller rencontrer les associations de patientes qui pourront vous aider aussi à démystifier tout cela. Pour les équipes, les petits conseils à donner, ce serait effectivement de prendre le temps d'explorer la peur et le vécu des patientes. Et de demander quel a été le vécu précédent du dépistage dernier. Ça me semble être très important. Il s'agira aussi de normaliser la peur. C'est important de renvoyer aux femmes que beaucoup de femmes ressentent cette appréhension. Et que c'est normal d'avoir peur et qu'en même temps, elles sont en train de faire un geste extrêmement important pour leur santé et les féliciter de cela. Il sera aussi important de donner des repères temporels. Voici comment se passe l'examen, voilà combien de temps il dure. Et puis prévoir un suivi psychologique après info positive, surtout chez les patientes déjà fragilisées. C'est rarement proposé. Pour conclure, je vous dirais que le dépistage n'est pas un réflexe, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre le corps, la mémoire et la peur. C'est aussi le résultat d'une rencontre entre le médecin traitant, le gynécologue, le radiologue et une femme en bonne santé qui a peur de ne plus l'être et qui a peur de voir sa vie basculer. Chaque femme avance à son rythme, avec ses histoires, ses blessures, ses forces aussi. La psychologie ne remplace pas la médecine, mais elle permet de comprendre pourquoi certaines femmes agissent et d'autres se figent. Parler de ces émotions, c'est déjà faire un pas vers la prévention. Et parfois, le dépistage commence tout simplement par une conversation entre deux femmes. Alors parlez-en autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode.