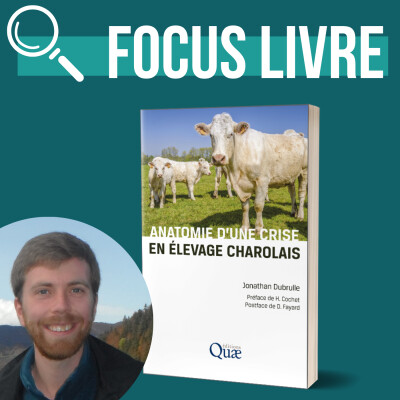Speaker #0Dans cette série d'épisodes, les éditions Quae et le groupe Sciences en Questions vous proposent de découvrir la conférence "Les promesses de One Health, s'ouvrir à d'autres savoirs", animée par Nicolas Lainé. Ce premier épisode définit la notion de One Health et explique de quoi l'approche One Health et l'héritière. One Health, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, en particulier depuis la pandémie, on va y revenir, donc il a été largement plébiscité. également sur le plan politique et évidemment sur le plan scientifique, et ça induit parfois sous la forme d'une injonction à travailler en interdisciplinarité, voire à se tourner vers la transdisciplinarité, justement en train de prendre ces trois composantes en compte, que sont la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Évidemment, si le One Health est apparu au grand jour, en tout cas l'approche One Health au grand jour assez récemment, finalement l'idée même de réunir dans une même perspective, intégrer santé des hommes, des animaux dans leur environnement, n'est pas nouvelle pour autant. Et on pourrait, ce ne sera pas l'objet de mon propos aujourd'hui, mais dans l'histoire des sciences et même au-delà, retrouver, établir une liste assez longue de personnalités scientifiques et d'institutions. qui au fil des époques ont justement tenté de promouvoir cette indépendance en matière de santé. Juste pour citer un exemple, concernant le rapprochement santé humaine et animale, on fait souvent référence à l'épidémiologiste américain et vétérinaire également Calvin Schwab, dans sa proposition du One Medicine, une seule santé, qui proposait justement cette approche intégrée entre santé vétérinaire et santé humaine. Mais pour notre période contemporaine, l'approche one-health, c'est un peu comme si on avait un système de santé humaine, telle qu'elle est mise en avant aujourd'hui et telle qu'elle s'inscrit à l'échelle internationale, elle s'inscrit, on peut dire, dans le prolongement d'une proposition qui émane d'une conférence organisée en 2004 par la World Conservation Society, une organisation non-gouvernementale internationale qui agit pour la protection de la biodiversité et qui avait pour ambition d'associer la conservation de la nature à des objectifs de santé publique. en faisant le lien entre, justement, émergence de maladies infectieuses issues de la faune sauvage et dégradation des écosystèmes. Alors, cette conférence, elle a donné lieu à la publication des 12 principes de Manhattan, mais surtout, elle a mis au jour l'expression « one world, one health » , donc un seul monde, une seule santé. Et à partir de cette expression, elle fut reprise en 2008, donc sous le terme « one health » , une seule santé, et elle a été portée par l'organisation. des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Organisation Mondiale de la Santé, et l'OMSA, anciennement OIE, Organisation Mondiale de la Santé Animale. Et cette approche, si on veut la définir rapidement, elle insiste sur le fait qu'on ne peut pas s'occuper de la santé humaine si l'on ne s'intéresse pas en même temps de la santé animale et environnementale. On sait que de nombreuses maladies infectieuses affectant les humains sont en grande partie d'origine animale, on estime à près de deux tiers d'entre elles, et où on a des liens en tout cas avec les maladies animales qui elles-mêmes dépendent de l'environnement dans lequel les animaux vivent. Et donc finalement ce One Health apparu au début des années 2000 constitue une nouvelle manière de penser la santé, notamment, on aurait pu prendre d'autres exemples ou d'autres marqueurs, mais de ce qu'on a nommé la grande accélération qui a conduit à une augmentation sans précédent des échanges à l'échelle mondiale, mais aussi à la pression démographique et aux conséquences sur les écosystèmes et donc au risque d'émergence de maladies. Sur le plan international aussi, juste pour donner un cadrage, on peut considérer que le One Health s'inscrit comme un mouvement qui se développe en parallèle à ce que l'on a nommé la santé globale, qui témoigne aussi de ce qu'on appelle la globalisation, au sein de laquelle elle ouvre un champ. souhaitant rapprocher les questions de santé à celles d'écologie et donc faire le lien entre enjeux sanitaires et les crises écologiques que l'on connaît aujourd'hui. Alors jusqu'à la pandémie justement de Covid, je l'ai dit, le One Health c'était une initiative qui était finalement, alors c'était une approche mise en avant mais qui était surtout mal définie. qui peinaient aussi à se mettre en œuvre, et ce qui a d'ailleurs valu différentes critiques. Certains ont qualifié le One Health de concept fourre-tout, au contour donc mal défini et flou, et qui avaient donc des difficultés à proposer une définition qui soit capable justement de satisfaire quelque part les nombreuses disciplines et sciences impliquées, mais aussi les institutions, à l'échelle internationale. Sur ce point, il a par exemple été montré que finalement, ce flou, dans sa définition et dans la mise en œuvre du One Health, il se justifiait de lui-même, puisque quelque part, il permettait à chacun de se revendiquer de cette approche, et pour les instances internationales en particulier, finalement, à ne pas souffrir de concurrence et de légitimité d'action entre elles. C'est par exemple ce qu'avait très bien montré un sociologue chinois, a propos de la gestion de la grippe H5N1 en Asie, lorsqu'elle a émergé. où effectivement pour limiter sa contamination, c'est l'abattage de volailles par millions qui avait été préconisé. Mais cet abattage est apparu aussi comme un point finalement de tension entre différentes institutions, en particulier l'OMS qui voyait effectivement l'abattage massif comme la solution en matière publique. Mais ça ne pouvait pas satisfaire ni l'AFAE ni l'OIE, puisqu'elles avaient plutôt en tête leurs conséquences de ces mesures sur les animaux et les éleveurs. Et finalement... En prenant une approche commune, conjointe, One Health, il n'y avait finalement plus à choisir entre, d'une part, protection de la santé humaine et préservation de la santé animale, qui constituent des objectifs bien distincts de chacune de ces instances internationales. J'ai parlé de ces critiques, en particulier depuis la conférence de Manhattan. One Health est apparue comme une approche qui privilégiait essentiellement... les zoonoses et les maladies liées à la faune sauvage et qui étaient surtout mobilisées, d'abord par la science vétérinaire, mais aussi l'épidémiologie, la médecine de santé publique et l'écologie. Et bien que d'emblée interdisciplinaires, des enjeux disciplinaires sont apparus. Il a été par exemple montré sur des études bibliométriques qu'en quelque sorte la science vétérinaire avait l'apanage du one-edge puisqu'elle représentait la majorité des... des publications, en particulier une étude a montré que près de 61% des travaux qui sont revendiqués du One Health étaient publiés dans des revues vétérinaires. Ces enjeux disciplinaires, on sait bien qu'ils sont aussi importants pour parfois accéder à des financements sans lesquels la recherche ne peut pas se faire. Alors comme je viens de le dire, le One Health met également l'accent sur les maladies infectieuses sans finalement prendre pleinement en compte l'environnement ni la biodiversité. Et c'était aussi une approche tournée scientifique exclusivement, qui ne tenait pas finalement compte des préoccupations et des conséquences locales des mesures qui sont prises, notamment en matière de biosécurité, on peut parler de l'abattage ou de biosurveillance, et en particulier de l'assimilation ou de l'acceptation de ces mesures par les sociétés rurales. Par exemple, pour faire référence au mouvement... agricole actuellement en France. Au tout début, la semaine dernière, j'avais été frappé d'entendre un agriculteur qui était interviewé à la radio ou à la télé, un éleveur porcin, qui ne comprenait pas, par exemple, une aberration pourquoi on lui a imposé aujourd'hui des nouvelles normes en matière de prévention de peste porcine africaine. Il était le premier au micro et ça m'a frappé à dire, mais la peste porcine africaine n'est pas en France, je ne vois pas pourquoi je devrais prendre de nouvelles mesures de biosécurité qui vont transformer l'Ox. Il y avait aussi cette question du lien avec la société civile et de l'acceptabilité des mesures qui sont parfois imposées par le haut. J'ai dit toutes ces critiques sur le One Health, sa mise en place et les différents enjeux jusqu'à la pandémie, parce que justement on a constaté que la pandémie a entraîné une sorte de prise de conscience, qui a donc mis en avant le One Health, sur l'importance de cette interdépendance. et a insisté aussi sur la nécessité de le rendre opératoire, notamment par une ouverture et une forme de rééquilibrage de chacune de ses composantes. Depuis la pandémie également, la proche honnête a été davantage reconnue, institutionnalisée. Elle a été rejointe en 2022 par exemple par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais face à la difficulté d'une définition et donc assez critique, cette... coopération internationale donc quadripartite, a constitué et s'est doté d'un groupe d'experts, donc le One Health High Level Expert, un groupe d'experts de haut niveau, composé de 26 experts internationaux. Et donc ce groupe d'experts a été doté de confier plusieurs missions, notamment bien sûr de conseils sur l'élaboration d'une approche stratégique à entreprendre sur le long terme pour réduire les risques de pandémie, mais aussi... des missions d'évaluation scientifique et sur le plan politique de l'émergence et de la gestion de crise sanitaire. Et aussi également de définition des synergies nécessaires pour mieux institutionnaliser et mettre en œuvre cette approche. Très récemment, le One Health Expert, le OLEP comme on l'appelle, a rédigé aussi un plan d'action qui court les quatre prochaines années. Mais face aussi aux critiques et au flou autour du One Health, ce n'est pas surprenant finalement si l'une aussi de ces premières missions qui a été confiée à ce groupe a été de mieux définir ce qu'est l'approche One Health. Et justement, je propose de regarder cette définition qui est assez récente. C'est aussi une définition qui évolue. Alors, celle-ci, elle date de la première proposée en 2021, puis elle a été mise à jour là en 2023. Et c'est quelque part la définition que l'on peut considérer comme officielle. C'est pour ça que je la présente et qui se veut, on va le voir, le plus inclusif possible. Sans tout lire, mais j'ai repris un petit peu, mis en gras les points saillants de cette définition. Donc approche intégrée et unificatrice qui prend donc acte du fait de la santé des humains, des animaux et des domestiques sauvages. Des plantes et de l'environnement sont interdépendants. Et c'est aussi donc une approche qui mobilise de multiples acteurs, disciplines et communautés. On voit aussi qu'il y a cette notion de durabilité aussi, de prise en compte du changement climatique qui est intégrée. au sein même de la définition. Cette définition qu'on peut considérer comme officielle. Cette définition s'appuie également sur cinq piliers pour sa mise en œuvre. L'équité entre les secteurs et les disciplines, la parité socio-politique et multiculturelle, pour ceux qui s'y intéressent aujourd'hui, c'est aussi le point 5, la collaboration. transdisciplinaire et multisectoriel, englobant toutes les disciplines, les formes de connaissances modernes et traditionnelles, ainsi qu'un large point de vue représentatif. Donc en plus de ces cinq piliers, l'effort qui a été fait justement par ce groupe d'experts de haut niveau a été aussi de proposer une nouvelle manière de représenter le One Health. Ce n'est plus finalement le centre du noyau entre la santé des écosystèmes, la santé des humains et la santé des animaux. où le One Health représente son centre, mais cherche également à proposer les moyens d'y parvenir. Et on voit bien que le One Health se passe juste au-dessus, dans ces roues entrelacées. Et ce n'est pas simplement le point de rencontre entre ces trois santé. Donc finalement, cette définition est inclusive, comme je l'ai dit. Elle est aussi très alléchante sur le papier. Et on voit bien à travers ce diagramme-là comment la mise en place du One Health se passe dans ce que j'ai encadré en rouge. Elle évite à réfléchir différemment, à opérer à un décloisonnement disciplinaire et aussi à une ouverture vers des acteurs de la société avec l'idée de produire ou plutôt de coproduire des savoirs originaux en matière de santé. Et donc aujourd'hui, c'est sur la base justement de cette… de cette définition que je vais mener des réflexions à partir de mes travaux pour voir comment on peut rendre cette approche One Health clairement opératoire. Car finalement, l'un des intérêts du One Health aussi, c'est qu'il nous fait réfléchir finalement, en tant que chercheur, à sa mise en œuvre, qui n'est pas aisée, et donc à notre propre pratique. Et je rejoins ici pleinement les propos du sociologue Jérôme Michelon lorsqu'il affirme que Finalement, plus qu'une notion ou une approche, One Health est un mot d'ordre épistémique, c'est-à-dire quelque chose qui fait agir les scientifiques. Je vais articuler la présentation autour de trois parties, pour aussi décliner en trois questions, auxquelles à chaque fois je vais répondre à partir d'exemples principalement basés sur des travaux empiriques, des enquêtes ethnographiques, soit issus de mes propres recherches, soit d'autres travaux. Sur le premier point, comme je l'ai mentionné au commencement, l'idée du One Health n'est pas nouvelle. Dans sa forme la plus récente et dans sa gouvernance, elle émane de grandes instances internationales qui ont elles-mêmes des modes d'action et des conceptions de programmes de santé ou d'aide au développement. Dans un premier temps, je reviendrai sur les racines coloniales du One Health. C'est la nécessité de mener une réflexion sur les savoirs en santé. pourquoi O'Hanel s'est-elle l'héritière ? Et nous dirons que... Les grands oubliés parmi les différents régimes de savoirs sont les savoirs locaux ou profanes, qui sont mobilisés quotidiennement par les populations locales, avec leurs animaux et sur l'environnement. Et pourtant, ils sont les premiers, je le rappelle, à pouvoir détecter des signes de maladie chez leurs animaux. Les humains et l'environnement pourraient donc agir bien avant toute intervention d'experts ou de spécialistes pour éviter une diffusion. Ensuite, dans un deuxième temps, avant de réfléchir à la manière d'intégrer ces savoirs et ces connaissances, je m'intéresserai à la nature de ces savoirs issus des populations en procédant à une forme d'épistémologie de ces savoirs locaux ou profanes pour montrer de quoi ils sont constitués. Je mettrai en avant leur caractère dynamique de ces savoirs, montrer qu'ils sont eux-mêmes intimement liés et co-construits avec d'autres formes de connaissances extra-humaines et notamment... en interaction avec les animaux. Et puis je réfléchirai finalement à la manière d'intégrer cette expérience pratique et ce mode de vie des populations quotidiennement engagées avec les animaux et leur environnement pour mieux les mobiliser dans le cadre de gestion et de prévention de crimes sanitaires. Donc je passe à mon premier point, ce que j'ai nommé décoloniser le One Health. Alors d'abord pour revenir effectivement aux sources du One Health, Je propose de m'arrêter sur la période coloniale. Alors j'aurais pu, comme je l'ai dit, bien sûr, remonter plus loin dans le temps, en pointant par exemple à un moment de l'avènement des sciences modernes, qui au cours de son histoire a opéré une séparation entre traitement de la santé humaine et animale. J'aurais pu également sortir de l'Occident pour considérer d'autres manières ou d'autres traditions de considérer ensemble santé humaine, animale et environnementale. On peut penser par exemple à l'approche holistique de la médecine ayurvédique en Inde. Mais finalement, en ce qui concerne le One Health, en tout cas tel qu'il a été mis à jour il y a une vingtaine d'années, remonter à la période coloniale semble particulièrement pertinent. Alors d'abord parce que cette période, elle préfigure en quelque sorte le monde d'aujourd'hui. Aussi, on va le voir, j'ai déjà mentionné, le One Health a hérité en partie d'une série de représentations, de visions du développement et des rapports nord-sud, comme on les qualifie, qui plongent finalement leurs racines dans des interventions datées des années 30 et dans le... contexte des empires coloniaux. À ce moment, s'est développée la médecine tropicale, humaine-animale, qui accordait une importance aux dimensions environnementales des maladies et qui avait pour objectif de traiter de la santé des populations nommées indigènes pour favoriser leur développement agricole, mais aussi, surtout, on va le voir, pour garantir la santé des administrateurs en contrôlant celle des populations locales et de leurs animaux pour servir une entreprise. d'exploitation des ressources. Je vais prendre deux exemples. Je vais développer trois exemples dans cette partie, deux avec des visées et des conséquences assez similaires en ce qui concerne justement le traitement accordé aux populations locales en Afrique et un troisième, plus récent, donc issu de mes recherches au Laos, qui met en avant des tensions ou des frictions entre différents régimes de savoir sur les animaux. Donc le premier exemple, Par exemple, de la population Maasai, dont je parlerai aussi dans chacune des parties de cet exposé, en particulier dans le territoire Maasai qui couvre la Tanzanie et le Kenya, où l'historien Richard Waller a montré que précisément, à partir de la période coloniale, deux formes d'élevage coexistaient, l'une au détriment de l'autre. On a d'un côté le système d'élevage du colon blanc, le White Shetler, et de l'autre le système native des indigènes. Chacun de ces systèmes avait sa propre vision et gestion des maladies animales. En ce qui concerne le système d'élevage Massa, il s'appuyait essentiellement sur l'expérience pratique de ces populations, ancrées dans leur croyance locale, témoignant d'un rapport spécifique à l'environnement, ce qui constitue plus tard une partie de l'essence de ce que sont les savants locaux. Et dans ce système local, précise Waller, la maladie était finalement considérée comme faisant partie de l'environnement et du paysage, en tout cas du pastoralisme, et d'ailleurs des mesures préventives ou curatives étaient mises en place. Par exemple, les tiques étaient combattues en brûlant des herbes, tandis qu'on laissait volontairement circuler certaines maladies, comme la fièvre de la côte est ou la peste bovine, afin de chercher à renforcer l'immunité des animaux et réduire l'impact des épisodies. En ce qui concerne l'autre système d'élevage, celui des colons et de leurs troupeaux, il dépendait entièrement de l'État pour leur protection et c'était aussi un système qui était clairement orienté vers le marché. Ce système s'appuyait sur une approche scientifique de la production, soutenue par les vétérinaires qui avaient pour objectif de protéger les terres, le bétail et les moyens de subsistance des colons européens, des risques de propagation de maladies avec le bétail des indigènes. Ce mode de gestion a imposé sur l'ensemble du territoire des mesures de contrôle, comme la séparation, l'isolement d'animaux malades du reste du cheptel et la mise en place de barrières également pour les troupeaux qui étaient considérés à risque. en particulier ceux des indigènes. Alors en conséquence, les éleveurs Massai n'ont plus le droit de traverser certains espaces, ils se sont retrouvés certains isolés avec leurs animaux dans des zones clairement délimitées, et leur mouvement restreint devait en fait empêcher toute interaction en dehors de ces zones. Et les analyses de Weller vont même au-delà, dans une approche ethno-historique, de la simple lutte contre les maladies du bétail pour les opéras. pour les Européens, parce que plus généralement, il montre comment elle servait aussi d'une justification du contrôle des populations qui était, il faut le dire, considérée du point de vue des administrateurs coloniaux comme des populations irrationnelles, indisciplinées, féroces, avec toutes les images qu'il y a derrière. Et dans cette enquête, l'auteur montre en effet que finalement, l'existence de ces deux systèmes et la forte dichotomie qui l'a présidée n'a fait finalement que de renforcer l'image d'une distinction raciale entre colons. et que finalement, si la gestion des maladies pouvait être effectivement une menace réelle, elle était également pensée comme une métaphore qui soulignait le contraste entre d'un côté colonisation et sauvagerie, on dit le progrès ou la stagnation. Alors finalement, l'établissement de frontières entre bétail des colons et celui des Maasai, finalement, n'a pas cessé après l'indépendance, ce que montre la recherche, où... Les Massaïs, les autres éleveurs de la région, les politiques en place mises en œuvre par le nouvel État indépendant, ont fait que de prolonger et de renforcer ce processus de séparation en place, en cherchant à contrôler et à limiter la mobilité des cheptels locaux. C'est pourtant un aspect essentiel chez les pasteurs Massaïs, qui a donc eu un impact direct sur leur mode de vie et mode d'existence. L'ethnographie Massaïs qui a été menée nous apprend que, par exemple, concernant ce qu'on pourrait nommer une épistémologie locale, Il n'y a pas de démarcation, je l'ai dit tout à l'heure, pour la maladie, mais également entre l'homme et l'animal, également entre vie animale et milieu environnant. Et d'ailleurs, l'ethnographie souligne également que les Maasai, évidemment, ne tirent pas seulement leurs moyens de subsistance du bétail, mais que c'est aussi incarné dans leur système de croyance, leur histoire, leur champ. Ils ont aussi intégré leur connaissance et leur interaction avec les animaux. Aujourd'hui, dans la Tanzanie contemporaine, les politiques en matière d'élevage, d'utilisation des terres et de médecine vétérinaire perpétuent, comme je l'ai dit, ces conceptions coloniales guidées par, mettant en avance les aspects seulement négatifs du pastoralisme, que ce soit pour le paysage, pour la santé des populations ou le contrôle des maladies. La politique nationale mise en place au début des années 2000 à l'échelle nationale soutient une forte modernisation et industrialisation du secteur, notamment par le biais de privatisation. Et elle recommande aujourd'hui également le développement de partenariats avec le secteur du privé et également la privatisation en ce qui concerne les services de santé et la lutte contre les maladies, alors même qu'en lisant bien entre les lignes, on s'aperçoit qu'elle reconnaît pourtant que la sphère privée n'est pas en mesure, on n'a pas les moyens, souvent faibles voire inadéquates, pour répondre aux réels besoins des éleveurs. Mais finalement... L'ensemble de ces politiques en matière d'élevage opèrent une rationalisation de l'usage des terres, limitant de plus en plus les espaces disponibles pour la mobilité animale. Et en même temps, l'augmentation de la privatisation des terres signifie que les pâturages ouverts diminuent en taille et doivent donc se confronter à de nouvelles restrictions auxquelles font face les pasteurs massifs sous peine de conflits ou alors même d'amendes qui sont imposées par le gouvernement. Et tout ceci, finalement, participe à une forme de... de dénigrement et une stigmatisation des formes de connaissances et d'expertise locales. Je prends un autre exemple un petit peu plus court, mais qui est tout aussi éclairant, celui de la Rhodesie du Sud, qui est un des futurs... Zimbabwe. La suite d'épisodiques ont eu lieu au tournant du XIXe et du XXe siècle. Les dispositifs de surveillance des animaux et des hommes, on va le voir, ont contribué à une organisation et à la sécurité territoriale de l'État colonial pour servir au développement économique. Je m'appuie ici sur les travaux de la sociologue Muriel Fidier et de ses collègues au CIRAD, où, comme ce fut le cas pour le Maasai, dans un... soucis finalement de prévention animale mais aussi de productivité des mesures de distance et de démarcation été mis en place par ces politiques coloniales entre donc d'un côté le troupeau des populations locales et de l'autre ceux des administrateurs avec l'objectif était d'éviter tout contact entre eux les autorités locales en coloniale pardon ont également instauré des ce qu'ils ont nommé des réserves indigènes qui rassemblaient les populations locales et leurs troupeaux dans des zones fermées, en les interdisant de sortir de ces zones. Aux yeux des administrateurs, d'ailleurs, ces populations locales avaient un cheptel qui était beaucoup trop important et qui n'était pas assez rentable à leurs yeux. Et donc, une idée derrière aussi cela, c'était de les faire réduire, en fait, leurs cheptels et d'avoir des individus plus productifs. Alors, cela revient parfaitement à nier le rôle de prestige social que jouent les troupeaux pour ces populations. Monsieur Hans-Marie, peut-il vous en dire ? enfermés et donc et d'ailleurs on n'hésitait pas à battre il ya des écrits on trouve très bien abattre les individus qui sortaient de ces de ces de ces espaces donc cette gestion pour du territoire en fait elle avait aussi un autre objectif il s'agissait surtout de libérer des espaces pour les troupeaux commerciaux et des colons blonds et pour cela il fallait absolument donc limiter la transhumance qui exploitent de grands espaces et en complément sur le versant on va dire de la faune sauvage En plus de la création de réserves indigènes, c'est accompagné également de la création de réserves naturelles pour les animaux sauvages. Parmi ces mesures de contrôle et de limitation, il y avait une limitation géographique, il y avait également une limitation de jeunes, l'installation de barrières, mais aussi une surveillance, le marquage des animaux, l'enregistrement des habitants. C'était vraiment une politique très... C'était bien, oui. sécuritaire. L'ensemble des pratiques, finalement, justifiaient une forme de ségrégation spatiale, fondée sur des critères en ratio, et sur la base de coupes de catégorisation entre les massas, les colons indigènes, hommes animaux, mais aussi domestiques sauvages, ou artsins, malsains, qui servaient à marquer la présence de l'autorité de la puissance coloniale en l'imprégnant sur le territoire. Et au-delà du contrôle des maladies animales, l'objectif était bien de garantir la sécurité des colons, la prospérité économique des territoires colonisés, et de favoriser le développement auquel ces populations étaient exclues. Alors là encore, comme c'est le cas chez les Maasai, avec l'indépendance du pays, finalement ces dispositifs se sont poursuivis. Et ils ont servi finalement de base au contrôle des maladies, telles que la fièvre afteuse, selon les normes internationales. ayant permis de développer l'élevage pour l'exportation. Aujourd'hui, la sécurité est assurée par le contrôle des frontières et par des processus de clôture et d'enfermement. On souligne là encore une fois l'importance de ces politiques coloniales, de la figure vétérinaire et de la mise en place de ces politiques de gestion. On notera également, comme chez les Massas, cette continuité des mesures, notamment à travers la mise en place de... de dispositifs. Alors je viens à un troisième exemple aussi issu de mes propres recherches en Asie qui soulignent plus récent là, une mise à l'écart de certains savoirs au détriment d'autres, pour le dire plus directement, des savoirs issus des sciences vétérinaires, des savoirs locaux qui ne sont rarement pris en compte et pour lesquels il n'y a finalement aucune réelle tentative de les relier à des préoccupations globales, soit en matière de santé ou de conservation de la La diversité, c'est ce que j'ai pu observer au Laos dans le cadre d'un projet comparatif qui portait sur la perception locale des maladies animales et où j'ai enquêté sur la tuberculose des éléphants domestiques. Sans trop détailler ici, la tuberculose chez les éléphants, c'est une zoneuse qu'on a qualifiée d'inversée, qui a donné lieu à plusieurs alertes au niveau mondial au début des années 2000, jusqu'en France d'ailleurs, puisque dans le parc zoologique de la... Tête d'or à Lyon, il y avait deux cas suspicieux de tuberculose d'éléphant. Et au Laos, comme à l'instar d'autres pays d'Asie, du Sud et du Sud-Est, ces alertes ont donné lieu à la mise en place d'une surveillance chez ces animaux. On a payé un dispositif coordonné par le département of Fisheries and Livestock, du ministère de l'Agriculture laotien. Elle s'est également exercée dans le cadre d'un programme national de gestion des éléphants. initié à l'origine par une ONG occidentale. L'objectif était la mise en surveillance de ces éléphants afin de détecter chez eux la présence de la maladie ou du bacille, d'éclairer les facteurs de transmission et d'identifier les risques afin de se préparer à ces conséquences sur les plans sanitaires et environnementaux. Dans mes enquêtes, j'ai centré mes interrogations sur le rôle des cornacs, les personnes qui vivent et travaillent avec les... et à la place de ce savoir dans leur dispositif particulier, donc il s'agissait de savoir en quoi l'émergence de cette maladie influençait-elle leur perception des risques et même leur relation quotidienne avec leurs animaux, s'ils considèrent les éléphants comme des potentiels réservoirs de maladies. Plus généralement, j'ai également cherché à décrire les transformations induites par la mise en surveillance dans le système de gestion des pages chidernes. qui inclut donc cornac, vétérinaire, mais aussi membre d'ONG, comme je l'ai dit, et la reconfiguration et la place de chacun qu'elle impose. Donc finalement, comment ces cornacs et propriétaires d'animaux perçoivent-ils cette nouvelle présence de scientifiques sur le terrain ? Et mon enquête, elle a mis à jour un certain nombre de difficultés pour effectuer efficacement ce travail de surveillance. Alors d'abord, cette surveillance dans le pays, elle se base sur des observations et la collaboration des cornacs. pour informer les vétérinaires de la présence de signes cliniques sur l'animal. Et au sein du dispositif, ces cornacs sont d'ailleurs présentés comme des acteurs clés pour alerter des signes de la maladie. Or, en discutant avec eux, en menant mon enquête, je me suis rapidement aperçu qu'ils étaient très mal préparés à jouer ce rôle, parce que localement, c'est une surveillance de type passive. C'est-à-dire que les vétérinaires, lors de leur visite dans les villages, ils questionnaient les cornacs. mais ils se sont sortis finalement à la difficulté de leur faire accepter un risque zoonotique. Pour ces derniers, le franchissement de la barrière inter-espèce concernant les maladies, la tuberculose en particulier, quelque chose de difficilement pensable, ils ne considèrent pas leurs animaux comme des réservoirs potentiels, et ne les imaginent même pas susceptibles d'amplifier sa diffusion parmi les hommes, la faune sauvage et le cheptel domestique. Par ailleurs... Pour les cornacs et propriétaires d'éléphants, la tuberculose chez ces animaux apparaît comme quelque chose d'assez récent, qui est fortement associé à l'implantation de la biomedicine dans le pays. L'apparition du pathogène chez les éléphants le renvoie à la période coloniale, où le Laos était sous protectorat français, période au cours de laquelle d'importantes campagnes de vaccination ont eu lieu chez les populations humaines. Ce qui fait que finalement, localement, la tuberculose, telle qu'on la nomme, ou analogue, est uniquement associé au volet humain et qu'il est impensable à quel concerne les animaux domestiques. Sur le déroulé de cette surveillance, comme je l'ai dit, elle s'appuie essentiellement sur des signes cliniques, typiques de la tuberculose, l'écoulement nasal ou l'amaigrissement par exemple, présents sur ces animaux. Or, la pertinence de ces signes extérieurs et visibles sur le corps des animaux n'est pas évidente. Pour les cornacs, ils s'appuient sur tout un ensemble de signes à la fois visibles et invisibles pour évaluer au quotidien l'état de santé des animaux. Les cornacs, par exemple, ont l'habitude de voir leur éléphant fatigué ou amaigri sans que ses symptômes ne soient reliés à quelconque maladie. C'est le cas, par exemple, après 4 ou 5 jours de travaux de débordage de bois dans les forêts, ils voient leur éléphant s'amaigrir. Et donc, si la pertinence des signes cliniques... Le partage des maladies entre hommes et éléphants est un impensé d'un point de vue local. En s'intéressant plus précisément au système de soins et au traitement local des maladies d'affection touchant les éléphants, on s'aperçoit que hommes et animaux, s'ils ne sont pas vulnérables aux mêmes maladies, ils sont par contre vulnérables à des entités invisibles, telles que les esprits, qui sont omniprésents dans l'anthologie animiste des cornaques, donc les esprits qui soient bons ou mauvais. Au Laos, le quotidien des relations homme-éléphant est fortement ritualisé. Il existe d'ailleurs plusieurs spécialistes qui aident à réguler justement ces relations, les mophiles qui pratiquent la médecine des rituels ou les moyas qui soignent par les plantes. Et par exemple, on voit sur la photo, le soir, avant de laisser son éléphant aller librement dans la forêt, on va devoir informer les esprits du sol ou du lieu afin de leur demander de protéger l'animal. Et donc dans mon enquête... puisque je l'ai dit, le partage de maladies ne fait pas sens localement, pour comprendre ce qui peut circuler entre les espèces et les représentations associées, j'ai décentré mon regard depuis la maladie vers les esprits pour lesquels justement hommes et éléphants sont aux prises aux mêmes vulnérabilités. Il s'agit là en tout cas d'un élément, ce décentrement, qui n'est absolument pas pris en compte dans le dispositif de surveillance et qui souligne... Également la complexité de la représentation locale de la maladie, de son interprétation, qui ne serait due pas à des données ou à des interprétations purement biomédicales. Alors finalement, mon enquête a souligné également les motivations extrasanitaires de cette mise en surveillance, qui mêlait à la fois enjeux sanitaires et de conservation, puisque l'éléphant d'Asie, l'Ephos Maximus, est une espèce menacée, et aussi des enjeux liés à la gestion et au savoir sur les animaux. Et d'ailleurs, si les cornacs et propriétaires, comme je l'ai dit, sont présentés comme étant des acteurs clés pour les vétérinaires, ils sont... finalement, ils sont également dans cette surveillance, eux-mêmes l'objet de ces derniers, c'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes dépistés à la tuberculose en passant soit des radios, soit par des prélèvements sérologiques. Donc, en étant impliqués, ils sont quelque part néanmoins mis à distance et à l'écart du dispositif, puisque finalement, enfin, in fine, ce sont seulement les médecins ou les vétérinaires qui sont seuls capables de dire qui est malade ou pas, humain ou animaux. Et en se positionnant comme ça, ça... un petit peu au-dessus de la mêlée, cela confère aussi une position au-dessus, en tout cas une légitimité par rapport aux savoirs locaux. En fait, dans ce dispositif de surveillance, aucun effort, je l'ai dit, n'a été véritablement opéré pour prendre en compte, mais aussi intégrer au cœur des connaissances et des savoirs locaux les questions liées à la prévention des risques sanitaires et environnementaux. Et pourtant, il ne faut pas douter que l'efficacité d'un tel dispositif soit positive. réside précisément dans une articulation ou un dialogue, une intercompréhension des différentes conceptions de la maladie et que la surveillance, pour le coup, gagnerait en efficacité si on pouvait concilier ces différentes conceptions. Et finalement, cette dispositif de surveillance a donné lieu à une forme de négation du savoir des cornaques. C'est un point qui s'est également illustré lorsque j'étais sur le terrain. puisque durant mon séjour au Laos, il y avait une caravane d'éléphants domestiques qui travaillait le pays de village en village pour alerter sur la situation critique de l'animal et chercher à raviver son attachement aux populations s'il ne fallait le faire. Et le point culminant finalement de cette caravane était son arrivée dans la ville de Luang Prabang, l'ancienne capitale du royaume du pays du million d'habitants qu'on appelle le Laos. Et comme on peut voir sur les photos, les Kornaks étaient eux-mêmes invités à parader. dans des tenues assez passéistes, ils étaient folklorisés, on les renvoie quelque part à un temps passé, idéalisé, et alors que ça aurait pu être là, pour le coup, une occasion d'intégrer clairement ce savoir aux préoccupations globales actuelles, en traduisant les risques, même ne serait-ce que dans la langue et dans les termes, la surveillance aurait sans doute plus de sens pour les cornets, qui seraient sans doute plus enclins à participer activement aux dispositifs. Je m'arrête là pour cet exemple et l'ensemble, les trois que je viens de donner, j'aurais pu en prendre d'autres sur le poids justement de l'héritage des politiques et d'une vision colonialiste du rapport aux populations sur les savoirs et les pratiques en santé, qui peut d'ailleurs parfois dévier de ses objectifs premiers pour en servir d'autres. Et on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, si on veut faire du One Health de manière inclusive et répondre à cette visée inclusive, qui constitue, je vous l'ai montré dans la définition, l'un des piliers de cette définition, implique donc à mon sens d'opérer des réflexions, ce que j'ai nommé la décolonisation des savoirs en santé. Cette nécessité, justement, s'est parfaitement illustrée dans le contexte pandémique, où on a vu combien la crise Covid a aussi chamboulé beaucoup de choses et à toutes les échelles. En s'étendant d'un bout à l'autre de la planète, la lutte contre le virus a imposé finalement un nouveau mode d'action. plus horizontale que verticale, comme on avait l'habitude en matière de santé, avec des interventions ciblées du nord vers le sud pour répondre à différents enjeux, la malnutrition, la mortalité infantile. Avec la lutte contre la pandémie, on est passé à des mesures globales aussi identiques, gestes barrières, les masques, confinement, prise de manière quasi simultanée d'un bout à l'autre de la planète. Mise en place de mesures, on a d'ailleurs vu que, finalement, certains pays, en particulier en Asie, étaient mieux préparés que nous, que l'Occident, pour certaines de ces mesures. Je cite ici la politique de santé communautaire mise en place en Thaïlande, notamment avec la présence de volontaires qu'on nomme les House of Morts, qui sont plus d'un million sur un pays qui en compte... 70 et qui sont présents partout sur l'ensemble du territoire dans chaque village. Ils constituent donc un réseau de surveillance très efficace qui a été reconnu par l'OMS et d'ailleurs toujours sur cette santé communautaire en Thaïlande le pays s'apprête à instaurer des volontaires formés et dédiés à cette approche. Mais donc pour revenir finalement sur mon propos et cette réflexion des savoirs en santé donc doit aboutir à une forme de de mise en commun de l'ensemble des connaissances et des modes d'abstention de maladies, sans a priori opérer de hiérarchisation entre différentes formes de savoir, et sinon d'abord un effort d'ouverture vers d'autres formes de connaissances. Et parmi ces connaissances, je pense bien sûr en particulier à celles qui sont détenues, mobilisées par les populations locales, qui comme j'ai dit en introduction sont d'ailleurs placées en première ligne face au risque, et qui sont généralement mises à l'écart au moment de l'arrivée d'experts. Un dernier exemple aussi, c'est celui de la lutte contre Ebola en Afrique récemment, où les experts ne portaient aucune attention finalement aux pratiques funéraires locales qui favorisaient la propagation du virus, tandis que ces mêmes experts ne comprenaient pas pourquoi, malgré les mesures d'isolement drastiques, ils ne parvenaient pas à endiguer la diffusion du virus. Vous venez d'écouter un extrait de la conférence de Nicolas Lainé sur le thème « Les promesses de One Health » . Retrouvez-la en vidéo dans son intégralité sur le site de Sciences en questions et au format livre sous le titre « Une seule santé » aux éditions Quae.