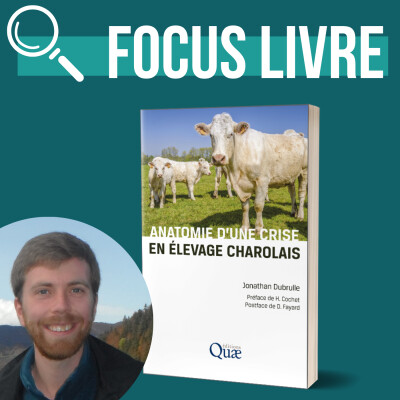Speaker #0Dans cette série d'épisodes, les éditions Quae et le groupe Sciences en Questions vous proposent de découvrir la conférence « Les promesses de One Health, s'ouvrir à d'autres savoirs » animée par Nicolas Lainé. Ce deuxième épisode explique de quoi sont constitués les savoirs locaux. Répondre à l'un des objectifs énoncés par l'approche Schoenels à travers sa définition implique en quelque sorte de sortir d'une forme d'ethnocentrisme en faveur de la science moderne et donc l'ouvrir à un savoir plus pratique. Et il faut ensuite également bien sûr se demander comment mieux penser et articuler les relations entre ces différents régimes de savoir profanes ou scientifiques. Et justement avant de formuler des propositions qui vont dans ce sens, je vais d'abord commencer par... examiner ce que sont finalement ces savoirs issus des populations parce que aujourd'hui on fait beaucoup appel justement et on cherche vraiment à s'appuyer sur ces populations, notamment en matière de prévention, comme tu as cité tout à l'heure le programme Présod, justement, qui s'appuie sur la prévention et le rôle des communautés, mais parfois on ne sait pas forcément de quoi on parle et donc je propose de commencer par examiner ce que sont ces savoirs issus des populations, de quoi ils sont constitués. en montrant toute leur dynamique et complexité. Et j'en viens donc à mon deuxième point. Alors d'abord, je l'ai déjà un petit peu évoqué avec l'exemple Massaï, c'est savoir qu'ils ne se résument pas à une simple rationalité économique, mais ils incluent tout un ensemble d'éléments, sociaux, culturels, voire religieux, et à d'autres formes de rationalité, donc président localement en matière de relations à l'environnement ou aux animaux. La sociologue Jocelyne Porchet, dont tu as cité également, elle parle, elle, par exemple, de rationalité relationnelle et de sens qui prime dans l'élevage paysan au détriment d'un rapport purement utilitariste qu'on trouve dans l'élevage industriel, qui n'est d'ailleurs pas de l'élevage à son sens, mais plus des productions animales. Et toujours pour revenir sur l'exemple Massaï, ils ont récemment été qualifiés d'ailleurs d'écological doctors. puisqu'il a été montré que le pastoralisme extensif tel que pratiqué dans le parc d'Amboseli au Kenya était finalement essentiel à la résilience socio-écologique. Pour cette raison, les Maasai collaborent désormais avec les gardes forestiers pour trouver des solutions concernant notamment l'importante perte de bétail qui est liée aux attaques de grands carnivores comme les lions. Pour impliquer les Maasai, le travail... Des gardes à l'appui d'OANJ a été de recenser l'ensemble de leurs connaissances et de leurs pratiques en matière d'élevage, en insistant sur leurs intérêts en matière de prévention et des conflits avec la faune sauvage. Ce qui ressort, c'est que ces pratiques sont inséparables de celles concernant la gestion des pâturages et la productivité du bétail, qu'elles sont également intimement liées à la culture maçaye. Cette étude a mis en avant les liens entre, d'un côté, pratique d'élevage, durabilité des plantes et des pâturages, et gestion et conservation des espèces, ou plus généralement, les liens entre écosystème et culture humaine. J'ai justement fait un point de côté pour traiter les questions de conservation, au sein desquelles d'ailleurs le savoir des populations est reconnu depuis plusieurs décennies au sein d'instances internationales, je pense en particulier à l'article 8G de la Convention de la diversité biologique. signé à Rio en 1992, qui met justement l'accent sur la préservation des connaissances et des savoir-faire locaux. Dans le prolongement de la CBD, donc le protocole signé à Rio, le protocole de Nagoya qui lui régit aujourd'hui l'accès aux ressources génétiques, génomes, animaux, humains et microbiens, depuis son entrée en vigueur en 2014, met aussi l'accent sur la nécessité d'impliquer les populations locales dans la recherche. afin qu'elles aient accès aux connaissances scientifiques, qu'elles participent à la construction et qu'elles en partagent évidemment les bénéfices. Plus généralement, un rapport de la Banque mondiale vient appuyer ce lien entre savoirs locaux et biodiversité en montrant que si finalement les territoires occupés par les populations locales ne couvrent que 22% de la surface terrestre, ils abritent 80% de la biodiversité mondiale. On sait très bien aussi que l'érosion de cette biodiversité entraîne aussi une perte de savoir sur celles-ci. On pourrait d'ailleurs même dire que ces savoirs locaux sont en partie constitutifs d'éléments de l'environnement et qu'ils sont coproduits en interaction avec eux. J'en viens à un autre exemple d'une recherche que j'ai menée toujours au Laos, c'est ce qui ressort de cette enquête où... à la suite de ce premier projet sur l'étude de la perception locale des maladies. Finalement, j'ai pu voir que Cornac et propriétaires d'éléphants partagent également des connaissances sur les plantes médicinales avec les animaux. Puisque lors de ce premier terrain, lors de ce premier projet, les informateurs ont insisté sur le fait que les éléphants de village ont une riche connaissance de la forêt qu'ils expriment eux-mêmes en cherchant des spécimens et des parties spécifiques de plantes, écorces, feuilles, racines. En d'autres termes, les cornacs eux-mêmes, ils ont conscience que s'ils fournissent du soin et des plantes à leurs animaux, pour contribuer à une alimentation saine, les animaux peuvent également compléter cette alimentation. En particulier lorsqu'ils se déplacent, notamment en forêt pour le travail ou le soir, parce qu'ils sont laissés également vaquer dans les forêts environnantes, les éléphants puissent donc dans l'abondance et la diversité de la végétation qu'ils rencontrent. Donc, également, dans les villages, finalement, et contrairement à la gestion des animaux dans des centres touristiques ou de conservation, finalement, au village, on n'a pas la prétention de vouloir contrôler l'ensemble de tous les aspects de l'alimentation et des soins des animaux. La forêt, comme on l'a dit, est l'équivalent d'une pharmacie en Cagna, où les éléphants peuvent eux-mêmes aller choisir une sélection de médicaments. Lorsqu'un éléphant de village semble malade, on va plutôt préférer d'abord laisser volontairement l'animal seul dans la forêt quelques jours afin de lui laisser l'opportunité de trouver des plantes et d'être en bonne santé, comme on dit en laotien. Ce que m'ont raconté les cornacs m'a poussé à prolonger cette enquête pour m'intéresser précisément au système local de soins. accordé aux éléphants et si l'on veut refléter l'entièreté de ce système de soins de point de vue local il faut inclure donc cet élément essentiel c'est à dire quelque part le respect des connaissances des éléphants eux-mêmes et de leur capacité d'auto médication et donc le champ de ma recherche et de nos vétérinaires à la base que je voulais vraiment documenter les les pratiques locales portées aux animaux a été élargie à l'étude du régime alimentaire des éléphants de village et en parallèle à la recherche de convergence possible entre l'utilisation des plantes par les hommes et les animaux. J'ai continué mon immersion dans les villages laotiens en mobilisant les outils d'enquête ethnographique qui impliquent cette immersion de la population, l'observation des pratiques et leurs variantes, mais aussi la conduite d'entretien ou la collecte de récits de vie. J'ai également mobilisé des outils qui sont propres aussi aux ethnosciences, l'ethnobotanique et l'ethnosologie. Cette enquête, juste pour cadrer, s'est déroulée dans la province de Sayaburi, au nord-ouest du Laos, parmi les communautés Thailao et Thailo. Cette recherche a permis de mettre en évidence des similitudes entre le traitement des humains et celui des éléphants. Alors tant d'un point de vue de la médecine des rituels que celui de la médecine des remèdes. Sur la médecine des rituels, j'ai passé la diapo avec des pratiques et des cérémonies communes qui, d'un point de vue local, permettent d'assurer le bien-être de chacun. Je pense ici à la cérémonie du Bassi qui vise à rassembler l'ensemble des forces vitales réparties dans le corps des éléphants et des autres mammifères comme les buffes, mais aussi les humains. Il s'agit d'une cérémonie de rappel d'âme que l'on rencontre chez d'autres populations en Asie du Sud et du Sud-Est et qui est très courante au Laos. Elle est organisée notamment pour le Nouvel An, lorsque l'on part en voyage ou en ville, ou lorsque l'on entreprend un nouveau travail. On voit que c'est la même cérémonie chez les éléphants, mais également là, par exemple, lors d'un baptême d'un enfant, au moment où on choisit son prénom à l'âge de... On ne choisit pas le prénom à la naissance, mais lorsqu'on choisit le prénom de l'enfant, on fait également cette cérémonie de Bastille. Donc il existe effectivement d'abord une correspondance rituelle et donc une continuité entre le traitement des hommes et des éléphants au Laos. Alors sur la médecine des remèdes… J'ai documenté l'usage et des préparations à base de plantes pour les infections courantes, mais aussi des préparations énergisantes, comme on voit là, des boules d'énergie que l'on prépare pour les éléphants lorsqu'ils partent en forêt plusieurs jours. J'ai également exploré le régime alimentaire des éléphants via l'approche ethno-éthologique proposée par l'anthropologue Florent Brunois, c'est-à-dire que finalement l'accès... aux connaissances et à la compréhension des éléphants et de leur environnement a été obtenu finalement grâce à la médiation et au point de vue des cornacs, en particulier la manière dont ils percevaient le comportement de l'éléphant via ce qu'on pourrait nommer une éthologie locale ou une éthologie vernaculaire. Donc j'ai d'abord interrogé les cornacs sur les plantes consommées par les éléphants et puis je suis également opéré des sorties en forêt pour les accompagner, pour observer quelles plantes... ou quelle partie de plantes, branches, fruits, lianes, écorces, les éléphants consommaient. Donc des sorties qui alternaient le matin ou le soir, en les suivant dans leur activité quotidienne et en réalisant des herbiers in situ. Alors à première vue, il était assez difficile pour les cornacs de répertorier toutes les plantes consommées par les éléphants qui pourraient couvrir plus d'un millier d'espèces selon certains. Je rappelle qu'en tant que grand mammifère herbivore, un éléphant peut consommer jusqu'à 250 kg de végétation par jour et qu'il passe aussi une grande partie de leur journée à manger ou à chercher de la nourriture. Leur régime alimentaire aussi connaît d'importantes variations en fonction de l'environnement, en plaine ou en montagne, et puis bien sûr selon les saisons et la disponibilité des essences. Néanmoins, certains, en particulier que vous voyez en photo, était en mesure de distinguer les plantes consommées strictement selon eux dans le cadre de leur alimentation, nommée Aansang, et celles indiquées dans le cadre d'alimentation médicale, c'est-à-dire les plantes qui soignent. Et sur la base de cette distinction, d'abord est-ce que tu penses qu'ils mangent ces jeux de la nourriture ou est-ce que ça pourrait être un médicament, j'ai ensuite avec les coronas catégorisé les différents types de symptômes, toujours selon eux, la fatigue, problèmes digestifs, blessures, etc. et donc les espèces végétales correspondantes que les éléphants étaient capables de consommer pour se maintenir en bonne santé. Les cornets qui ont accumulé des connaissances sur les habitudes alimentaires des éléphants au fil des générations ont ainsi su être attentifs à l'ingestion de matières inhabituelles, comme le rappellent Sabrina Krièf et EOS, lorsqu'ils présentent justement les conditions de détection de comportements d'automédication chez l'animal. Et cette base de données, elle a ensuite été mise en perspective, comme je l'ai dit, avec d'autres collectifs sur l'endobédecine humaine, pour y chercher donc une correspondance. Alors, au terme de cette enquête, différentes plantes, en fait, sont revenues à maintes reprises, en fait, soit pour se soigner, et deux ont particulièrement retenu mon attention. La première, parce qu'elle fournit effectivement un exemple d'automédication chez les éléphants. C'est en particulier un rôle de vermifuge d'une liane. Certains cornacs s'aperçoivent que bien que la plante soit disponible tout au long de l'année, ils ne la consomment qu'une seule fois dans l'année, toujours à la même période, à l'hiver, en changement de saison, et qu'ils en consomment en petite quantité. En cherchant dans la littérature spécialisée, on s'aperçoit effectivement que cette plante a des propriétés de vermifuge. Et puis une autre... Plantes qui témoignent effectivement également d'un même traitement symptomatique pour les hommes et les éléphants, en particulier pour des problèmes digestifs ou de dysenterie, et qui soulignent un potentiel partage de connaissances médicinales. Alors évidemment, sur l'essence en particulier, les hommes font des infusions de feuilles, tandis que les éléphants eux-mêmes consomment la matière brûle, et en particulier cherchent les racines. En tout cas, les résultats de cette recherche ont permis de mettre en évidence l'existence de ce que j'ai nommé un système multispécifique de médecine et de soins qui concerne les propriétaires d'éléphants et leurs animaux. Et ce point rejoint l'intuition déjà formulée par Hubert Gillet dès 1969 dans son cours d'ethnobotanique au Muséum d'histoire naturelle où à propos de la cohabitation homme-animal et du comportement alimentaire de certains animaux, il écrivait il est possible que l'observation faite par certains indigènes du prélèvement occasionnel de certaines écorces d'arbres de savane africaine ait attiré leur attention sur ces arbres en tant que plantes médicamenteuses. Sur les éléphants d'Asie en particulier, cette notion de... de médecine multiespèce ou multiespécifique m'a permis aussi d'ouvrir une réflexion plus large sur les influences intimes et réciproques des éléphants et des populations locales à travers l'Asie. Et finalement, comme je l'ai dit, considérant leur attachement mutuel sur un temps long, on peut considérer même la communauté hybride homme-éléphant comme une culture multiespèce basée sur... le partage d'un ensemble de pratiques et de connaissances transmises par observation, imitation ou emprunt. Non, ce n'était pas là. Et pour donner un autre exemple très court aussi, puisque j'étais sur mon terrain en Thaïlande jusqu'en décembre dernier, et plus récemment concernant l'emprunt ou l'imitation de connaissances, donc en décembre, dans le cadre d'un projet sur l'élevage que je parlerai tout à l'heure, au cours de mes entretiens sur le régime alimentaire, pareil, selon cette même démarche, des buffles, les éleveurs locaux nous ont confié avoir intégré dans leur alimentation certaines plantes qu'ils voyaient leurs animaux consommer en grande quantité et de manière quotidienne. Juste pour situer, il s'agit d'une population de montagnards, les Lois, qui vivaient dans les montagnes jusque dans les années 70 et qui ont été déplacés par les autorités à la suite de conflits armés dans les années 70 pour vivre dans la plaine. Où est-ce qu'ils se sont donc adaptés à ce nouvel environnement ? Ils ont migré dans la plaine en emmenant leurs buffles et donc ils ont observé la manière dont ces animaux s'adaptaient finalement à la plaine et consommaient des plantes qui n'étaient pas présentes dans les zones de montagne. Et là encore, ils m'ont dit, oui, à force de les voir manger finalement tous les jours cette plante, on s'est dit, on va essayer également. Et donc, ils ont intégré ces plantes et les utilisent désormais dans différents plats de manière quasi quotidienne. Voilà pour ces différents exemples. Je voudrais maintenant insister sur le rôle des sciences humaines et sociales pour accompagner des projets One Health et restituer les savoirs locaux. On le voit avec les exemples que je viens de montrer. Les animaux n'ont pas seulement une histoire, comme il a été montré par des collègues historiens, mais ils possèdent aussi des connaissances sur leur environnement. Cette forme de connaissance non humaine a été dissoute par les sciences modernes qui ne voulaient pas la voir. parfois la considérer comme anecdotique, on a des exemples, mais en tout cas la considérer comme non importante. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec le développement des recherches en zoopharmacognosie, elle nous démontre chaque jour le contraire, avec de nouveaux cas mis au jour, que ce soit les grands singes évidemment comme modèle, mais aussi les chevaux, les éléphants, voire peut-être les buffles. En tout cas, en se penchant du côté des populations locales, on s'aperçoit que ce savoir extra-humain est pris au sérieux et quitte. participent même pleinement à leur connaissance, à leur compréhension du monde, et même que l'expérience et les interactions avec ces éléments participent à la constitution de leur savoir. Sur ce point, elle montre aussi que pour nombre de populations, la santé finalement ne s'envisage pas que d'un point de vue unique et anthropocentrique, mais qu'elle est peut-être pensée aussi comme un ensemble de relations et d'interactions qu'il s'agit de maintenir pour assurer la pérennité d'un équilibre socio-économique. écologiques. Alors, sur ces savoirs locaux également et sur leurs caractéristiques, un de ces composantes est aussi un caractère dynamique, donc interactionnel, je l'ai dit, donc en relation à l'environnement, et on pourrait même dire adaptatif. Pour prendre, pardon, une dernière fois l'exemple des Maasai, les enquêtes les plus récentes en ethnobiologie ont montré que, face aux nombreux changements sociopolitiques, écologiques qu'ils ont vécu et leurs Leur relation avec différents régimes de savoir ont transformé leur connaissance. En particulier en ce qui concerne leur relation au bétail, les Maasai ont créé des connaissances tout à fait originales, qualifiées de pluralistes, dans la mesure où dans leur quotidien, elles intègrent des aspects de biomédecine avec des connaissances vétérinaires locales. Sur les caractéristiques aussi de ces savoirs locaux, encore, bien souvent, il s'agit de savoirs non écrits, transmis de manière informelle, donc c'est vrai que c'est pour les saisir et les appréhender, et qui sont constamment finalement reproduits, voire réinventés lorsqu'ils sont mis en œuvre. Autrement dit, loin d'être figés, ces savoirs locaux sont en quelque sorte en constante recomposition, c'est précisément ce que montre l'anthropologue des techniques, Marie-Claude Maillasse, que tu avais également cité. à propos des savoirs à faire des populations dans le monde indien, qui nous dit qu'ils ne peuvent s'appréhender que dans l'action, que dans la pratique, qu'on peut vraiment comprendre et saisir ces savoirs. Pour saisir cette dynamique qui s'opère à chaque fois, qu'un savoir est mobilisé, l'anthropologie est bien placée pour en rendre compte. Parce qu'à propos de ces savoirs locaux, l'anthropologie ne s'intéresse pas seulement à ce que les gens savent, mais elle s'intéresse aussi à la manière dont ils apprennent et à la manière dont ces connaissances se transmettent. En fait, l'étude de ces savoirs constitue également, pour ainsi dire, le cœur du métier de la discipline, qui mène des enquêtes auprès des populations. On pourrait même dire, à l'instar d'un article tout récemment publié par... anthropologue Tim Ingle, que l'anthropologie n'étudie pas les peuples et les populations en soi, mais qu'elle étudie avec eux, et s'engage de fait dans un dialogue autour de leur manière d'être, de faire, de leur perception et représentation, ceci dans une quête de sens qui est propre à la discipline. Donc finalement, oui, la discipline, à travers ses enquêtes, elle cherche à comprendre, à mettre en exergue la cohérence et la logique interne de ses savoirs, qui forment un système. ayant donc une propre cohérence basée sur un ensemble de signes, appréhendés généralement selon une démarche empérico-déductive. On doit ici faire référence à l'anthropologue français Lévi-Strauss, l'un des pères de la fondateur de l'anthropologie de tradition française, d'avoir montré justement toute cette cohérence et cette logique qui constitue ce qu'il a nommé la science du concret. Et sa démonstration a souligné finalement que la pensée à la fois scientifique et mythique et de la science de l'anthropologie, ne doivent pas être comprises comme l'une précédant l'autre dans un schéma d'évolution, mais bien qu'il s'agit là de deux modes de pensée autonomes, donc plutôt que deux étapes d'évolution des sociétés, et que donc oui, la science du concret, ou la pensée primitive, comme on a pu l'appeler également, ne précède pas ce qu'on appelle aujourd'hui nos sciences modernes. Pour revenir un petit peu à ces savoirs locaux et One Health, on voit bien qu'il y a une appétence aujourd'hui pour ces recherches de terrain, pour participer à la mise en place du One Health. Jusqu'ici, Tantonnet a un rôle de médiateur entre scientifiques et populations locales, notamment pour l'acceptation de mesures sanitaires, de fait de leurs relations particulières. On fait de plus en plus appel aux anthropologues en particulier pour restituer le sort de ces populations. Puisque en matière de santé, les travaux assistent également sur le fait que les maladies sont des phénomènes bioculturels et que les facteurs sociaux jouent un rôle crucial dans leur émergence, dans leur diffusion, mais aussi dans leur gestion. Ils permettent de mettre à jour les facteurs culturels et sociaux qui favorisent l'émergence de maladies. Vous venez d'écouter un extrait de la conférence de Nicolas Lainé sur le thème « Les promesses de One Health » . Retrouvez-la en vidéo dans son intégralité sur le site de Sciences en questions et au format livre sous le titre « Une seule santé » aux éditions Quae.