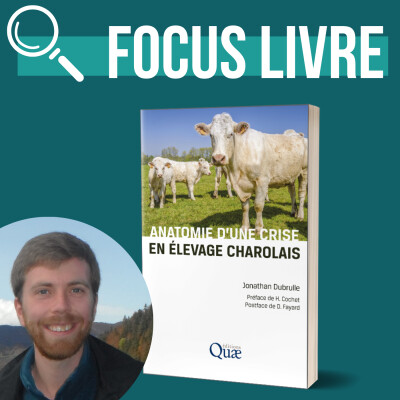Speaker #0[Musique] dans cette série d'épisodes les éditions Quae et le groupe Sciences en questions vous proposent de découvrir la conférence "Les promesses de One Health, s'ouvrir à d'autres savoirs" animé par Nicolas Lainé.
Ce troisième et dernier épisode explique comment intégrer l'expérience pratique des communautés locales dans l'approche One Health.
Je reviens à mon troisième point, alors justement en... en documentant, comme je l'ai dit, en restituant dans leur contexte de l'action et de leur production ces savoirs, ça peut permettre de les considérer comme de véritables ressources pour mener des réflexions sur le statut et l'émergence de maladies. C'est ce que je propose de voir dans mon troisième point, voir comment justement pouvoir intégrer cette expérience dans la recherche One Health. Alors, comme on l'a vu, la définition du One Health demande à dépasser… en fait l'interdisciplinarité pour aller vers de la transdisciplinarité, donc en considérant d'autres savoirs qui ont eux-mêmes leur propre logique épistémologique dans cette ouverture. Et en matière de conservation ou de gestion des ressources, il y a eu beaucoup de tentatives d'hybridation, voire d'imbrication de savoirs locaux avec des savoirs scientifiques. Cependant, cette hybridation ou imbrication entraîne... par nécessité une forme de rationalisation et pour partir un effacement de certains savoirs, sans parler des enjeux de pouvoir qui peuvent résider lorsque différents régimes de savoirs sont engagés. En tout cas, en ce qui concerne les savoirs locaux, ils perdraient toute une partie de leur essence lorsqu'ils sont traduits, transformés ou utilisés hors de leur contexte culturel et social de production. pour finalement chercher à tout prix à faire de l'hybridation de savoirs et pour se prémunir aussi de tout risque d'instrumentalisation, hybridation qui resterait dans tous les cas aussi asymétrique et comme je l'ai dit qui ne rendrait pas justice à la complexité de ces savoirs locaux en les figeant, je prendrais plutôt donc de considérer ces savoirs comme de véritables partenaires de recherche permettant de répondre conjointement à des défis. de manière collaborative et complémentaire, il s'agit en quelque sorte de mettre les savoirs en réseau, puisqu'il y a autant d'épistémologie que de discipline et de vision du monde, et que finalement, ce qui nous concerne, de manière de penser les maladies. C'est ce que suggérait d'ailleurs il y a plus de dix ans l'anthropologue Manuela Carnero d'Ecunha à propos de la conservation de la biodiversité, puisque cette mise en réseau de savoirs, elle permet d'offrir une vision élargie d'une situation. En même temps, elle facilite également un dialogue équitable entre savoirs scientifiques et d'autres formes de savoir, en particulier ceux des populations, où au sein de chaque réseau, ils ne seraient plus réduits à de simples fournisseurs d'informations ou de données, comme on peut le voir aussi dans le cadre, par exemple, de recherches participatives ou sciences citoyennes, qui peut justement grandement faciliter la collecte de données et donc être très utile, mais qui a peut-être le défaut de considérer les populations comme des prestataires, donc qui peut fournir des données. pour qu'il soit utilisé à des fins scientifiques. Au contraire, la mise en réseau des perspectives des connaissances intègre pleinement les populations et leurs savoirs au sein du processus de recherche et de production des connaissances et permet donc d'ouvrir un dialogue. C'est, pour le dire simplement, réfléchir ensemble et travailler avec. Et avant de conclure, je propose justement de terminer en présentant une expérience de recherche qui se veut transdisciplinaire. Pour mettre concrètement le One Health en pratique, il s'agit d'un projet bupharm que je porte et qui vise à explorer des liens complexes entre production animale, biodiversité et santé, à partir d'enquêtes conduites au sein d'élevages extensifs de buffles, en milieu rural, dans trois pays d'Asie. Un projet constitué d'anthropologues, d'écologistes, de biologistes moléculaires, de botanistes. Sa particularité est qu'il prend comme point de départ les connaissances des éleveurs qui sont directement intégrées et qui orientent même le processus de recherche. Buffer me souhaite ainsi dépasser une vision parfois un peu incomplète, voire simpliste de l'élevage, principalement basée sur un système de production intensif et qui ne prend pas en compte les systèmes alternatifs comme l'élevage familial ou le système extensif. Alors qu'il y a plusieurs rapports et même articles qui montrent que, justement, du fait qu'ils soient quelque part fortement vulnérables et dépendants de la dynamique des écosystèmes et de leur aléa, ces modes de systèmes d'élevage sont bien adaptés. faire face à des variabilités comme le changement climatique ou l'émergence de maladies. Et pour ces raisons, certains ont même affirmé que ces systèmes agricoles extensifs englobent quelque part l'approche One Health. Alors, juste sur le projet, parce que je ne suis pas sûr qu'il me reste beaucoup de temps. En Thaïlande, l'approche porte sur la communauté Lua, que j'ai déjà mentionnée, dans le village de Ban Wai Pan, dans la province de Nal. communauté originaire de montagne avec un village assez récent puisque vous le voyez en bleu là donc le long de la rivière nantes qui a été créé en 1972 dans la plaine et c'est un village assez particulier puisque quand je suis arrivé on s'est aperçu que donc sur 52 ménages dont 47 possèdent des buffles et sur 180 habitants il y a 300 buffles au village donc c'est c'était un terrain qui Ce qui semble intéressant en tout cas. Et donc l'élevage extensif de buffles, comme tout élevage extensif, activité saisonnière, où suivant les saisons, on déplace les buffles du village vers leur zone de pâturage, dans la forêt communautaire. Et puis une fois qu'on a récolté le riz après la collecte et en saison sèche, on les fait revenir pour qu'ils restent dans les rizières. Donc ils passent entre 5 et 6 mois dans la forêt communautaire de mai à juin. jusqu'à décembre chaque année. Et c'est donc un mode d'élevage qui implique aussi des interactions avec des populations sauvages lorsqu'ils sont en séjour en forêt. Et ces rencontres interspécifiques présentent des risques zoonotiques, épisotiques. D'ailleurs, à la fin de la saison des pluies, avant de les ramener au village, ils sont bien sûr d'abord inspectés dans un camp situé à l'entrée de la forêt. On va d'abord... contrôler leur état de santé avant de les faire revenir au village pour plusieurs mois. Et donc, embrassant cette perspective One S, l'intention de ce projet était d'abord de considérer, selon nos spécialités, trois aspects de ce système extensif. D'abord, d'étudier les pratiques locales en matière de soins et de santé, de mesurer les impacts environnementaux de ce type d'élevage, et également de mesurer la distribution microbienne au sein de l'écosystème village-forêt. Et donc, pour traiter chacun de ces aspects, Il ne s'agissait pas non pas de considérer les éleveurs comme de simples fournisseurs de données, mais d'accorder à leur connaissance une importance égale au nôtre. Et en intégrant ces perspectives, l'objectif était finalement de mieux comprendre d'abord le contexte local, de ce qui fait sens et de ce qui fait sens localement. Parmi le travail de terrain, donc de documentation des pratiques ethnovétérinaires, on étudiait également le pluralisme médical. Parmi les disciplines engagées, l'anthropologie a joué un rôle moteur, puisque le travail d'enquête a d'abord consisté en la conduite d'une ethnographie qui visait à décrire les pratiques d'élevage et à déclarer plus généralement le rapport que les lois entretiennent avec l'environnement. On a opéré finalement comme une sorte d'ethnographie collective à partir de questions générales qui sont présentées ici, qui nous permettaient finalement de nous immerger. tous au village. Et ce moment, justement, a permis en quelque sorte une forme d'acculturation sur les différentes perspectives et les différents points de vue. C'est un point important parce que j'ai tenu à ce que justement cette enquête collective, cette ethnographie collective, comme je l'ai appelée, j'ai tenu à ce que le biologiste était là, le botaniste également. Ce n'était pas juste l'anthropologue qui va d'abord faire son enquête et après qui restitue. C'était vraiment tous ensemble. Ce qui a permis finalement à chacun aussi de se prêter au jeu et puis en ayant sa perspective en tête, de questionner à leur tour les éleveurs pour pouvoir justement cette ethnographie servir de base pour ensuite guider nos investigations et donc des hypothèses de travail qui ont ensuite été pensées à partir des pratiques des éleveurs. Et plutôt d'agréger nos questions spécifiques, on a... cherchait à prioriser l'émergence d'investigations communes autour d'aspects qui faisaient sens localement. En particulier, cet exercice transdisciplinaire a mis en avant deux aspects. En particulier, le premier sur la question de l'automédication des buffles. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est la même démarche que sur les éléphants et je cours après le temps. Le second, par contre, concerne l'existence de zones minérales, appelées localement pongues, que l'on retrouve dans des endroits spécifiques au cœur du village, dans les rizières ou dans la forêt adjacente. Et sur ces pongues, je vais un petit peu détailler justement comment chaque discipline a traduit cet aspect et comment il est devenu dans ce projet un aspect... commun d'investigation. Au cours de l'enquête, les éleveurs ont attiré notre attention sur ces zones. Ils ont expliqué que c'était des zones qui avaient la réputation d'attirer les animaux, en même temps qu'ils considèrent comme hantées, c'est-à-dire qu'ils évitent d'y amener leurs troupeaux de buffles et ne s'y aventurent pas d'eux-mêmes. Localement, ces zones, les pompes, ont la réputation de provoquer de mauvais présages qui, selon les éleveurs, peuvent inclure une transmission de maladies entre le bétail, les animaux sauvages, mais également de rendre malables les humains. Par conséquent, il est d'usage pour la communauté face annuellement des offrandes pour honorer l'esprit qui habite dans ce pont et qui ne porte pas préjudice au village. Le pont, vous voyez sur les photos, c'est une zone qui est constamment humide et boueuse tout au long de l'année, en saison sèche ou en saison de pluie. Des recherches approfondies ont d'abord montré qu'il s'agissait de zones riches en sels minéraux, que viennent lécher les animaux. Les avions nous ont également informé que de par le passé, ces zones étaient encore plus abondantes et qu'elles étaient d'ailleurs très prisées par les chasseurs positionnés non loin de ces zones de pongues. Et donc dans le projet, ces pongues sont devenues des lieux d'investigation et il s'agissait donc de comprendre leur impact sur les rencontres interspécifiques et la potentielle propagation de maladies. Et chaque membre du projet s'était forcé d'abord à interpréter cette notion et a initialement proposé des interprétations et hypothèses. Les botanistes ont par exemple exagéré la présence de plantes vénéneuses et ont réalisé d'abord un inventaire des plantes et constitué un herbier autour du pont. Les écologues ont exploré la possibilité de présence de polluants comme les métaux lourds ou les bioxines dans la zone. Tu vois donc un test selon lequel la composition géologique des ponts peut contenir des minéraux qui libèrent ces éléments toxiques, en particulier en période de pluie. Et donc, le fait, plutôt que de procéder à… Là, vous voyez encore une zone de pong, vous voyez, où est-ce qu'on est à coup sûr, on peut trouver des buffles toujours dans ces pongs. Et donc, plutôt que d'opérer des échantillonnages de manière un petit peu aléatoire, finalement, en écologie et en biologie, ils ont ciblé ces zones de pong. D'un point de vue local aussi, les ponks sont vénérés comme des lieux de culte, je l'ai dit, et donc une attention particulière a également été portée sur ces ponks d'un point de vue anthropologique. Le rituel consacré à la divinité est considéré comme crucial pour les lois. Il est exécuté lors du Nouvel An qui a lieu au mois de janvier. J'ai opéré une enquête ethnographique détaillée sur les pratiques. Et les croyances associées à ces pongs, l'idée était d'évaluer l'impact écologique et sanitaire de ces pratiques, et en particulier en se concentrant sur les offrandes qui sont faites dans ces pongs, à savoir qui consomme ces offrandes une fois que l'on a déposé du poulet, du riz ou des fruits pour apaiser la divinité, puisque ces offrandes comprennent des fruits, du riz, de l'alcool. et bien sûr selon les lois ces offrandes sont consommées symboliquement par les esprits mais nous avons aussi cherché à étudier leur impact pour attirer ou repousser d'ailleurs certaines espèces et pour cela on a équipé ces pongs de caméras de pièges photographiques et grâce à ces pièges on a pu identifier les espèces qui fréquentent ces sites, qui sont connues par les animaux, leur nombre et déterminer finalement leur ... à quel moment ils venaient. Ces pièges ont permis finalement de montrer, vous voyez sur les photos, qu'en dehors des buffles, les pongs sont visités par des vaches domestiques, des chiens, mais aussi des chauves-souris la nuit, et des buffles sauvages aussi, mais on ne les voit pas là. Donc vous avez le rituel, et puis vous avez justement la caméra qui est située en face du rituel. Voilà, alors je crois vraiment que je cours après le temps, donc je vais conclure. Très rapide. On voit bien que finalement, en matière de One Health, aujourd'hui, des moyens considérables sont déployés pour initier des projets de cette approche. Je recite également l'initiative Présode, initiée en 2021, qui a des appels de fonds importants, qui est aujourd'hui portée par 170 partenaires, donc 15 gouvernements. Et comme j'ai essayé de le montrer d'abord dans le premier point, l'approche One Health a elle-même une histoire. C'est une histoire longue de tentatives de rapprochement, d'approche intégrée en santé, mais elle a aussi surtout une histoire récente qui est empreinte, je l'ai dit, de représentation, de mode d'action et de considération portée à l'égard d'autres savoirs non scientifiques. Et si l'on souhaite aujourd'hui que l'approche OANEL s'incarne concrètement avec des impacts durables et ne reste pas donc à un état de discours ou de déclaration, il s'agit d'opérer, comme je l'ai dit en premier lieu, des réflexions sur les savoirs en santé. pour décoloniser l'OANNEL, c'est donc l'ouvrir à d'autres formes de savoir. Alors mon propos ici n'était pas, bien sûr, de chercher à idéaliser les connaissances des populations, on sait très bien qu'elles n'ont jamais inventé de vaccins ou quoi que ce soit, mais plutôt de reconnaître qu'elles sont parfois oubliées, voire niées sur le terrain, et que ces connaissances devraient occuper leur place qui leur revient dans les processus de recherche, ces productions de connaissances, d'autant, et c'est aussi ça un des apports de l'anthropologie, cette version unifiée et globale de One Health. L'anthropologie s'intéresse au particularisme, aux spécificités. Donc c'est aussi de montrer qu'il ne peut y avoir de solution finalement uniformément adaptable d'un bout à l'autre de la planète, mais qu'il y a quelque part aussi autant de solutions que de contextes et de cas, et que ces solutions se construisent bien au cas par cas et en prenant en compte l'ensemble des perspectives sur un contexte donné avec les populations et puis bien sûr avec les pouvoirs publics. Et plus généralement, eh bien... De fait, en tant que chercheur, et quelle que soit la discipline, le One Health doit nous inviter à interroger notre propre pratique, à réfléchir à la manière de produire des connaissances, et donc à ce qui fait science. Et donc je vois ici One Health comme une opportunité de faire de la science différemment, d'impliquer davantage les chercheurs dans la société, avec les populations, et donc à renverser quelque part les rapports nord-sud pour les rendre de manière plus juste et équitable.
[Musique] Vous venez d'écouter un extrait de la conférence de Nicolas Lainé sur le thème les promesses de One Health. Retrouvez-la en vidéo dans son intégralité sur le site de Sciences en questions et au format livre sous le titre "Une seule santé" aux éditions Quae.
[Musique]