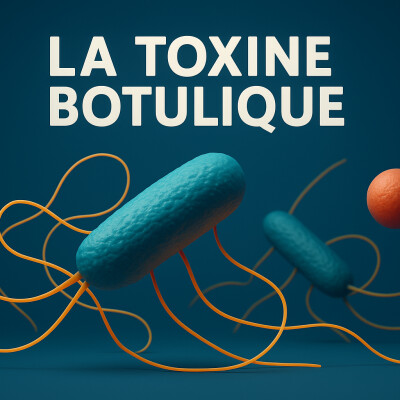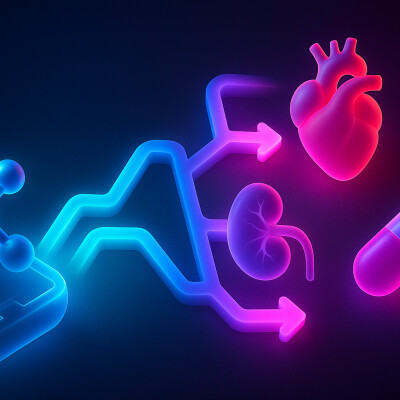Speaker #0science en lumière le podcast de la ctt s sud wad bonjour faisons un focus aujourd'hui sur le pneumocoque comprendre la bactérie la vaccination les traitements et les recommandations bienvenue dans ce nouvel épisode de science en lumière aujourd'hui nous abordons un sujet clé en santé publique le pneumocoque Cette bactérie est responsable d'un large éventail d'infections, allant des pneumonies aux otites et jusqu'aux formes graves, comme les méningites et les septicémies. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des vaccins disponibles pour prévenir certaines de ces infections, mais savez-vous vraiment pourquoi cette prévention est si importante ? Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur le monde du pneumocoque, les types de vaccins existants, les traitements antibiotiques, et pour qui la vaccination est fortement recommandée. Nous verrons de façon plus précise dans une deuxième partie la différence entre vaccins conjugués et polysaccharidiques, et enfin, pour les plus initiés, la particularité de la bactérie et sa phylogénie. Ce podcast est écrit et réalisé par Christophe Blin. Développons l'impact du pneumocoque, qui est une menace silencieuse mais sérieuse pour la santé. Pour bien comprendre le rôle du pneumocoque en santé publique, il faut d'abord connaître son mode d'action. Streptococcus pneumoniae, que l'on appelle plus simplement le pneumocoque, est une bactérie que l'on retrouve souvent dans les voies respiratoires supérieures des individus en bonne santé. Ce portage est souvent asymptomatique. On est porteur sans être malade. Cependant, dans certaines conditions, un affaiblissement du système immunitaire, une maladie chronique ou encore le jeunage, cette bactérie peut devenir pathogène et provoquer des infections potentiellement graves. On estime que dans le monde, des millions de cas d'infections à pneumocoques surviennent chaque année et parmi ceux-ci, des centaines de milliers d'enfants de moins de 5 ans et de personnes âgées décèdent de complications liées aux infections pneumococciques invasives. En termes de pathologie, le pneumocoque est une cause majeure de pneumonie bactérienne, mais il est aussi responsable d'otites moyennes de méninger les populations vulnérables, surtout lorsqu'elles évoluent en septicémie ou en méningite. Heureusement, la vaccination a permis de réduire de manière significative le nombre de cas graves de ces infections. Les programmes de vaccination ciblés en particulier pour les jeunes enfants et les personnes âgées, ont contribué à réduire la circulation de certaines souches de pneumocoques et à protéger les personnes les plus à risque. Voyons les vaccins contre le pneumocoque, les différents types, leurs spécificités et les recommandations de doses. Pour prévenir ces infections graves, deux principaux types de vaccins antipneumocoxiques sont utilisés. Le vaccin conjugué et le vaccin polysaccharidique, chacun ayant des indications et des mécanismes d'action spécifiques. Le Prévenard 13 et le Vaxnevance 15 des vaccins conjugués sont les des vaccins les plus couramment administrés. Ces vaccins ciblent 13 sérotypes de pneumocoque pour le pneumocoque et 15 pour le Vaxnevance. Ces sérotypes ont été choisis parmi ceux qui causent les infections invasives les plus fréquentes et graves. Chez les jeunes enfants, la vaccination commence dès l'âge de 2 mois. avec une série de trois doses, une première dose à deux mois, une deuxième dose à quatre mois, puis un rappel à onze mois. En stimulant une réponse immunitaire de longue durée, le Prévenard 13 et le Vax915 assurent une mémoire immunitaire durable, indispensable pour protéger les enfants contre les infections graves. Ces vaccins sont également recommandés chez certains adultes présentant des facteurs de risque spécifiques. Le pneumovax 23 un vaccin polysaccharidique couvre quant à lui un spectre plus large de sérotypes, avec 23 souches ciblées. Il est généralement recommandé pour les adultes, et en particulier pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les patients atteints de maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, et ceux dont le système immunitaire est affaibli. Contrairement au Prévenard 13, ce vaccin n'induit pas de mémoire immunitaire aussi durable, mais il offre une couverture élargie pour les adultes, souvent avec une dose unique, bien qu'un rappel puisse être envisagé 5 ans après la première injection pour les personnes à très haut risque. En parallèle, un vaccin plus récent, le Vaxnevance, qui cible 15 sérotypes, est désormais disponible. Ce vaccin, en couvrant des sérotypes additionnels par rapport au Prévenard 13, offre une protection renforcée pour les enfants et pour certaines populations adultes et pourrait être utilisé en complément des autres vaccins pour une couverture maximale. Cette nouvelle option vaccinale est particulièrement prometteuse dans un contexte de diversité accrue des sérotypes de pneumocoques circulants et de l'augmentation des résistances bactériennes. Voyons à présent les traitements antibiotiques contre les infections à pneumocoques, leur posologie et les enjeux de résistance. Si la vaccination est un excellent moyen de prévenir les infections pneumocoxiques, que fait-on lorsque l'infection est déjà présente ? Les antibiotiques demeurent le traitement principal contre les infections apneumocoques, bien que la résistance aux antibiotiques représente un défi croissant. En première intention, pour des infections comme la pneumonie ou l'otite, on utilise souvent la moxiciline. Pour les adultes, la posologie habituelle est de 500 mg toutes les 8 heures, tandis que chez les enfants, la dose recommandée se situe généralement autour de 80 à 90 mg par kilo et par jour, répartis en trois prises. Dans le cas d'infections plus graves, telles que les méningites ou les septicémies, un antibiotique plus puissant comme la ceftriaxone est souvent prescrit. Ce traitement est administré par voie intraveineuse, avec une dose de 1 à 2 g par jour pour les adultes, selon la gravité de l'infection. En présence d'une allergie au bétalactamine, des alternatives comme l'azithromycine peuvent être envisagées. Elle est généralement administrée à raison de 500 mg par jour pendant 3 jours. Il est cependant essentiel d'adapter le traitement aux spécificités de l'infection et de faire preuve de prudence, car la résistance du pneumocoque aux antibiotiques, en particulier aux pénicillines, est en hausse. C'est pourquoi la vaccination revêt ici une importance supplémentaire en réduisant le besoin de recours aux antibiotiques et en contribuant à limiter l'évolution des résistances. Reprenons sur les recommandations de vaccination et voyons quelles sont les populations cibles et pourquoi. En France, la vaccination contre le pneumocoque fait partie du calendrier vaccinal recommandé dès le plus jeune âge, avec le Prevenard 13 ou le Vaxnevance 15, administré à 2 mois, 4 mois, puis en rappel à 11 mois. Mais la vaccination ne concerne pas uniquement les enfants. Pour les adultes de plus de 65 ans, Ainsi que pour ceux ayant des maladies chroniques comme le diabète, les maladies respiratoires ou les maladies cardiovasculaires, la vaccination avec le pneumovax 23 ou le vax 915 est fortement recommandée. Chez les personnes immunodéprimées, qu'il s'agisse d'immunosuppression médicamenteuse ou de maladies comme le VIH, la vaccination antipneumocoxique est cruciale pour limiter les risques de complications graves. Ces recommandations de vaccination visent à protéger les populations les plus vulnérables, mais elles jouent également un rôle indirect dans la santé publique en contribuant à réduire la transmission de la bactérie dans la population générale. En d'autres termes, même les personnes non vaccinées bénéficient d'une certaine protection par la réduction du portage bactérien chez les vaccinés, un effet que l'on appelle l'immunité collective. Pour aller plus loin, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un infectiologue. Le spécialiste a mis en évidence les défis actuels dans la lutte contre le pneumocoque, expliquant notamment comment la vaccination contribue à limiter la résistance aux antibiotiques. Selon lui, les nouveaux vaccins comme le Vaxnevance marquent une avancée importante en élargissant la protection contre des sérotypes émergents, mais la recherche continue pour s'adapter à l'évolution de la bactérie et de ses résistances. Voyons la conclusion de cette première partie qui confirme l'importance de la prévention et les bons réflexes à prendre pour nous tous. Pour conclure, le pneumocoque représente une menace silencieuse, mais ces infections peuvent être efficacement prévenues grâce aux vaccins disponibles. En particulier pour les enfants, les personnes âgées et celles vivant avec des pathologies chroniques, la vaccination contre le pneumocoque constitue un rempart essentiel contre les formes graves. de la maladie. Si vous ou vos proches appartenez au groupe ciblé par les recommandations vaccinales, il est toujours bon de consulter un professionnel de santé pour évaluer les bénéfices de la vaccination. Voyons maintenant pour les plus initiés la phylogénie de cette bactérie. La phylogénie de Streptococcus pneumoniae est complexe et a fait l'objet de nombreuses études pour comprendre l'évolution de cette bactérie pathogène, sa diversification, et ses mécanismes de résistance au traitement. Voici un aperçu de sa phylogénie et des techniques utilisées pour la décrire. Voyons l'origine et la diversité génétique de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae appartient au genre Streptococcus. qui inclut de nombreux autres streptococques pathogènes, comme Streptococcus pyogène, responsable de la scarlatine et de certaines angines. Le pneumocoque est particulièrement diversifié, avec de nombreux sérotypes identifiés, plus de 90, qui sont classés en fonction de la capsule polysaccharidique qu'il exprime. Ces différents sérotypes présentent des variations génétiques importantes, influencées par la pression de sélection exercée notamment par les vaccins et les antibiotiques. Voyons quelles sont les méthodes d'analyse phylogénétiques. Les études de la phylogénie de Streptococcus pneumoniae utilisent principalement des outils de génomique, tels que le séquençage de l'ADN complet, la multi-locus sequence typing, MLST, et la comparaison des génomes entiers, WGS. MLST, cette méthode consiste à séquencer plusieurs gènes de ménage pour classifier les souches en différents types de séquences, ST. Rappelons que les gènes de ménage sont des gènes dont l'expression ne subit pas de régulation spécifique au cours de la vie cellulaire, car ils assurent des fonctions indispensables à la cellule. Ce séquençage est utile pour suivre l'évolution des clones pathogènes et résistants aux antibiotiques. Comparaison de génomes complets En analysant les génomes complets, les chercheurs identifient les variations au niveau des gènes de virulence, des gènes de résistance et des éléments mobiles, comme les plasmides et les transposons, qui facilitent le transfert horizontal de gènes. Qu'en est-il de l'évolution et de la pression de sélection ? Comme nous l'avons vu, la vaccination et l'utilisation d'antibiotiques, surtout les vaccins conjugués, comme le Prevenar 13 et nouvellement le Vaxnevans, qui ciblent certains sérotypes, ont exercé une forte pression de sélection. Cela a conduit à une augmentation de la fréquence des sérotypes non vaccinaux, dit de remplacement. et à l'émergence de souches résistantes. Les études phylogénétiques montrent que streptococcus pneumonier évolue rapidement par recombinaison génétique, permettant aux souches de s'adapter aux pressions de l'environnement et de persister même face aux traitements et aux vaccins. Voyons maintenant les lignées et clones majeurs. Plusieurs lignées et clones de streptococcus pneumonier sont particulièrement étudiés en raison de leur importance clinique. Par exemple, les clones résistants aux antibiotiques comme le clone Espagne 23F1, largement répandu dans le monde, et le clone France 9V3 sont des exemples de souches qui ont évolué pour devenir résistantes. La phylogénie permet de cartographier ces lignées résistantes et de suivre leur propagation géographique, ce qui est essentiel pour les stratégies de santé publique. Enfin, voyons les applications et implications en santé publique. Les données phylogénétiques sont essentielles pour adapter les vaccins et surveiller les épidémies de souches résistantes. En intégrant des analyses phylogénétiques dans les études épidémiologiques, les chercheurs et les autorités de santé peuvent anticiper l'émergence de nouveaux sérotypes dominants ou résistants et ajuster les formulations vaccinales en conséquence. De nouvelles approches comme la métagénomique et l'analyse en temps réel des données de séquençage permettent également de mieux comprendre les dynamiques évolutives de streptococcus pneumonier au sein des populations humaines. En somme, la phylogénie de streptococcus pneumonier est un domaine en évolution rapide qui utilise des outils de biologie moléculaire avancée pour tracer l'évolution de cette bactérie, étudier la diversification de ses lignées et améliorer les stratégies de prévention et de traitement des infections pneumococciques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science en lumière. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre l'importance de la vaccination anti-pneumococcique et l'impact de cette bactérie sur notre santé publique. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à rejoindre notre prochaine exploration scientifique. À très bientôt !