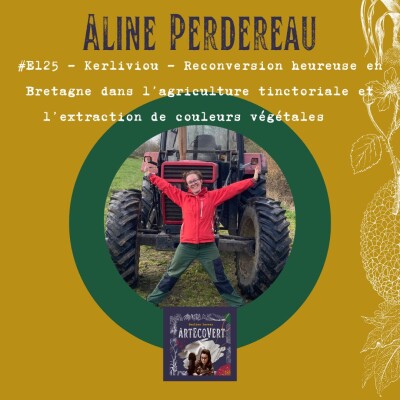- Pauline Leroux ArtEcoVert
Bonjour et bienvenue dans le podcast ArtEcoVert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir sur le podcast à Récovers Charles Giau. Alors Charles, nous nous sommes rencontrés il y a peut-être un petit mois à l'IUT de Béthune, mis en relation grâce à Patrick Martin. On y intervenait tous les deux pour une après-midi couleur végétale, où on a fait pas mal de belles rencontres avec beaucoup de jeunes, des étudiants, des chercheurs. Et tu as fait une intervention sur l'histoire qui n'est pas passée inaperçue et on s'est mis tous les deux d'accord de se dire que ce serait vraiment hyper intéressant que tu puisses intervenir sur le podcast. Alors, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu pourrais raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé à étudier ce que tu étudies aujourd'hui ?
- Charles Giot
Bonjour à tous, merci Pauline, je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui. Mon parcours est un petit peu atypique, parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup d'historiens à intervenir ici, qui plus est plus jeunes. Alors oui, c'est vrai, on s'est rencontrés à Béthune. Alors moi, à l'origine, je suis en Master 1, Histoire Recherche. à l'université d'Artois à Arras. Et donc à la base, j'étudie l'histoire, l'architecture et l'urbanisme dans les villes fortifiées, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très loin de la tâchure végétale. Mais Lurie Carbonier, mon directeur de recherche, m'avait présenté une petite demande du laboratoire d'archive à Arras, qui a fait partie en étudiant, pour faire ce qu'on appelle un état de l'art, donc c'est rassembler les sources, les livres qui parlent, ici c'est des qui parlent de l'inzative artoria, de la oued, de cette plante qui permet de teindre en bleu les tissus notamment. Donc vu que j'étais bien avancé sur mon sujet, mon professeur Yori Carbonier savait que j'aimais bien tout ce qui était l'agriculture, la culture, j'étais très curieux sur ce domaine, je me suis lancé. Et ça m'a permis de faire la rencontre de Patrick Martin, qui est professeur de chimie à l'Unité de l'étude. Il me suit comme assez exceptionnel, j'aime beaucoup Patrick Martin. On a échangé sur le sujet avec Cyprien Fneder, directeur du Centre de recherche. pour élaborer un projet qui était complémentaire à celui de Béthune. Béthune, c'est le projet Valoued. On cherche à valoriser tous les aspects de l'Isatis Tancoria, de cette plante, la Oued, même plus loin que la Tarture. Et donc, mon projet, c'était ça, faire un état de l'art. On ne savait pas trop comment formuler le projet, l'aspect géographique, même les possibilités de l'art. On est parti sur un volume de 300 heures avec l'idée d'un stade rémunéré, donc payé par le CRESS et l'UT de l'étude, en se disant que histoire et science, à un moment, ça peut très bien se croiser, c'est complémentaire, ça permet notamment pour l'idée dans la région de réintroduire massivement cette plante, ça peut nous apporter des informations. et puis permettre peut-être aussi de mieux calibrer, de mieux choisir par exemple les terroirs où on pourrait importer la tente. Alors donc voilà, c'était faire d'abord rassembler les sources, c'est très, c'est assez sommaire cette idée, rassembler les sources, l'historiographie, je vais en parler un peu après ce que ça veut dire. Mais bon, très vite je me suis rendu compte, là j'ai 22 pages uniquement de sources, je me suis rendu compte à la lecture, justement un peu de ces sources, mais qui avaient, et même des livres qui parlent de ces plantes, il n'y avait pas de synthèse générale sur le sujet. Donc je me suis dit, dans l'optique, si quelqu'un un jour veut faire une thèse ou un mémoire sur ce thème, ça peut être bien de commencer à faire une synthèse générale. qui permettra vraiment à celui ou celle qui s'engagera dans cette voie d'avoir une base. Et je pense que ça nous servira parce qu'au début, on est toujours un peu perdu. Déjà, l'idée de faire l'histoire d'une plante, pour certains, quand on leur évoque le sujet, bon déjà, en plus, l'isotéctoria, la ouède, c'est très très connu dans certains secteurs des Hauts-de-France. Donc voilà, c'était mon travail aujourd'hui. Alors un travail qui avait au départ une préférence régionale, mais qui s'est vraiment centré au pays tout entier, à l'Hexagone tout entier, et aussi à quelques pays un peu connexes de la France, parce que les histoires sont très liées dans l'histoire des artistes victoriens. Alors il y a deux choses dont je voudrais parler dans le parcours de l'histoire, parce que moi forcément histoire d'architecture et d'urbanisme, je ne connaissais pas grand chose avant. C'est la question des sources et de l'historiographie en fait. C'est à dire qu'on veut travailler sur un sujet en histoire, en méthode, mais c'est aussi valable je pense pour d'autres domaines. C'est d'abord on s'imprègne des ouvrages qui traitent du thème, du sujet, en faisant des strates de plus en plus particulières, du général en particulier. Et donc nous, moi avec Léorique Armoni, on s'était dit on va d'abord étudier les ouvrages de Michel Pastoureau, l'histoire du bleu, c'est valable aussi pour d'autres. Ça permet d'avoir vraiment une vue. ...global sur le sujet, même de comprendre pourquoi on utilisait le bleu, et si la couleur que nous donne l'isatiste est incroyable. Donc voilà, il y avait Michel Pastoureau qui dressait des périodes, l'époque médiévale, moderne et l'époque contemporaine, avec qui a pu, les deux cultures changeaient pour quelqu'un de ces périodes. Donc voilà, j'avais déjà des indices, et puis après je me suis intéressé, j'ai fait des focus en utilisant des monographies, des ouvrages régionaux, à partir des informations que donnait Pastoureau, donc l'époque médiévale c'est notre région globalement, donc j'ai utilisé l'histoire de la Picardie de Robert Fossier, l'histoire de l'agriculture aussi, des choses plus thématiques, Et puis après une fois que l'on fait ces focus régionaux pour chaque période, bon après c'était clairement étudier les ouvrages, les articles qui traitent directement des artistes intérieurs. Avec le fait, enfin le fait est que ces articles et même les ouvrages ils datent des années 50 aux années 70. Donc c'est très imprégné par l'histoire économique et sociale, c'est-à-dire le commerce, la situation des marchands de pastel notamment dans la région toulousaine. Oui. Donc ça biaise un peu parce que celui qui s'intéresse à la culture, déjà que les sources sont un peu latinaires, j'en parlais, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça nous apporte une mine d'informations, il y a même des figures qui sont très importantes dans ce milieu, je pense à Gilles Castère, dans la région de Toulouse, qui est vraiment une figure qu'on ne remet pas trop trop en cause, tellement ses travaux sont figures d'exemple. Alors aujourd'hui il y a un peu un renouveau et justement je m'inscris un peu dans cela, il faut rester quand même assez modeste parce que bon je suis étudiant, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas encore historien, mais je m'inscris un peu dans ce renouveau, on cherche en fait à faire des connexions entre les pays, entre les thématiques pour mieux voir un peu plus globalement ce qu'on peut en ressortir. Justement il y a une période qui est assez lacunaire, c'est celle du premier empire, donc tout simplement c'est la période de Napoléon. on n'a jamais vraiment étudié la question, alors que pourtant elle est tout à fait particulière, et je vais l'expliquer un peu après quand on débattra un peu de l'aspect historique, vraiment de ce que je vais mettre en exergue, c'est la première fois qu'on oublie à cultiver cette plante, et on ne s'est jamais posé la question de l'originalité, du pourquoi, du comment, c'est toujours resté un peu sommaire. Alors il y a cette question de l'historiographie, donc des ouvrages qui traitent de la question, plus ou moins généraux, Il y a la question des sources. Alors là, je vais simplifier vraiment, s'il y a des gens qui sont historiens, ils vont dire que c'est trop…
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Il y a des archéologues, il y a beaucoup d'archéologues qui écoutent, je le dis, mais ce n'est pas historien.
- Charles Giot
Je m'excuse par avance, mais la question des sources, en histoire, on étudie une période. Par exemple, 1810-1820, les sources, ce sont les documents qui sont produits de 1810 à 1820. D'accord.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
de l'époque excuse-moi mais même les rééditions parce que tu vois moi là je me tape à lire tous les traités et je vois qu'il y a des rééditions de traités alors est-ce que quand tu prends un traité tu prends comme tu dis ta période ou tu reviens au document de base imaginons il y a un traité qui a été réédité en 1810 mais qui date d'avant comment tu gères ça parce que ça arrive souvent
- Charles Giot
Tout ce qui est antérieur à 1810, forcément, est une source. D'accord,
- Pauline Leroux ArtEcoVert
c'est juste que…
- Charles Giot
Après, tout dépend du degré de modification, s'il y a beaucoup de retouches, mais ça sera considéré comme une source. Tout ce qui est plus ancien est une source, forcément. Ok. Il faut se dire tout de suite. Donc voilà, il y a la question des sources, mais le problème, c'est qu'il y a un facteur principal qui entre en jeu dans la question des sources, c'est leur conservation. Et plus est, dans une région comme les Hauts-de-France, on a subi deux guerres mondiales, où par exemple les archives départementales qui étaient dans l'abbaye de Sarva, ont brûlé en 1915. Ce qui fait que quand on veut étudier aussi des sources qui sont médiévales, quand on parle de la Oued ici, déjà qui ont subi l'usure du temps, et les guerres, c'est très compliqué parce qu'il ne reste que des fragments. Et donc on est obligé d'étudier des ouvrages qui ne sont pas forcément considérés eux comme sources. mais des ouvrages des sociétés savantes du 19ème, avant la première guerre mondiale, on est obligé d'utiliser ces ouvrages. On sait forcément que c'est un peu lacunaire, que ce n'est pas forcément objectif. mais ça a bien à prendre et ça fait partie de l'histoire. Donc il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Dans la région toulousaine, c'est l'époque moderne, genre dans le 15e, le 16e siècle, ils n'ont pas eu les conflits mondiaux comme nous, ils n'ont pas eu les destructions, et en plus les sources étaient un peu plus récentes. Donc c'est un petit peu aussi plus facile d'étudier. Et puis pour le Premier Empire, bon là, il y a aussi le phénomène de destruction, c'est aussi conservé dans les... dans les archives. Et puis, vu que ça a été une réintroduction qui a duré quelques années, deux, trois ans, on ne sait pas si toutes les sources ont été produites, du moins s'il y a vraiment un corpus de sources qui doit être similaire dans tous les départements. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça c'est le parcours d'historien, forcément, donc il y a ce biais, un peu mon parcours personnel, où à un moment j'ai rencontré un peu ces... et je n'imaginais pas justement qu'il pouvait y avoir derrière toute une machine autour de la teinture végétale, c'était ma découverte avec Patrick Martin et puis à la Béthune justement, j'ai vu vraiment qu'il y avait tout un rouage qu'on ne soupçonnait pas. Et puis il y a cette idée un petit peu en parallèle parce que c'est toujours compliqué de faire comprendre à des gens qui font de la science dure toute la construction d'une histoire, d'une plante. Et c'est ça que je me suis amusé un peu à faire à Béthune. Alors ce temple ludique qui avait un puits à la fin et c'était… Je pense d'ailleurs que ça a plutôt bien marché parce que c'était une bonne façon de le faire. Mais les gens ont toujours du mal à comprendre et inversement nous les histonnaires ça nous paraît toujours… Quand on est dans un labo vous voyez… un peu le processus qui se met en place. Aussi, c'est justement ce tour de la teinture végétale, enfin du procédé pour teindre, que là, les chemins se croisent le plus. Voilà, j'en parlerai, si possible, un peu à la fin.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Oui, ok. Ok, ben écoute, tu nous as bien donné envie, du coup. Qu'est-ce que j'allais te dire, pour rebondir un peu sur quelque chose qui m'intéresse, parce que comme je t'ai expliqué quand on préparait, moi, je suis dans les traités d'agronomie. tu vois des choses et je voulais rebondir sur un point tu connais Michel Garcia je suppose en tout cas de nom il nous a fait une intervention sur justement le fait qu'il était important de faire attention aux sources qu'on employait parce qu'il expliquait qu'avant je fais un gros raccourci mais qu'avant les écrivains se... se réapproprier des traités d'avant et c'était un peu de la recopie. Sauf que des fois, il y a des ouvrages qui étaient par exemple italiens ou d'autres langues qui ont été mal traduits ou interprétés en étant traduits et qui peuvent conduire à des erreurs, notamment à des procédés de transformation. Et il a parlé, quand on a fait notre quinzaine de l'agriculture teintoriale, il a parlé justement du pastel. en expliquant que pendant 400 ans, on avait dit que le pastel donnait moins de bleu que les indigos, les indigotiers, que la persiquaire, etc. Parce qu'en fait, pendant 400 ans, on a mal traduit le fait qu'il fallait prendre les feuilles du contour quand elles étaient jaunies. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Il faut cueillir avant les jeunes feuilles, avant qu'elles jaunissent. Bref, je te fais un méga raccourci. Mais du coup, pendant... 400 ans, il dit que pendant 400 ans, la même erreur est recopiée dans les traités. Et il y a une dame, alors j'ai oublié son nom, c'est dommage, il a cité une dame qui s'est interrogée en disant, il faut vérifier ce fait-là, est-ce que c'est vrai, qu'il faut attendre que les feuilles jaunissent, etc. Et c'est grâce à cette dame, il faudrait que je regarde les notes, je les ai en plus. Et en fait, ça, ça m'a hyper interpellée, je me suis dit, je voudrais en parler avec toi, parce que du coup, toi, tu as dû te taper plein de sources, plein de documents, etc. Est-ce que tu as vu des... des choses semblables, des trucs qui sont réécrits mais pas forcément vérifiés, ou des choses qui ont été écrites longtemps mais qui ne sont pas forcément vraies.
- Charles Giot
Alors après, la question de la véracité, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours la période charnière du Premier Empire où on a bouleversé le mode de teinture, mais le fait est que à l'époque médiévale et modérale, les procédés tinctoriaux, ça tient souvent à un ou deux traités. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de traités, c'est toujours la même chose que le recopie. Mais c'est vrai que s'il y a une erreur, forcément tout s'emballe. Avec le procédure de répétition, le procédure de répétition, ça ne peut pas trop être compris. Après, le problème c'est d'une région à une autre aussi. On a peut-être voulu adapter un peu les procédés en fonction des climats. Tu te doutes bien, autour d'Amiens et autour de Toulouse, on le voit actuellement, justement, c'est pas toujours le même temps. Et justement, ça se posera la question au premier empire de la productivité. On a démontré que même dans les procédés après de la culture, l'extraction de l'indigo, ça pouvait être du simple au double. D'accord. Le rendement, en fonction de la chaleur ambiante. Après les traités en tant que tels, moi je ne me suis pas focalisé sur ça, dans le sens où avec Patrick Martin c'était vraiment une histoire générale, c'est défricher, pour laisser la place après à quelqu'un qui aura son année à concentrer sur le sujet pour essayer de voir. Et puis le problème c'est les traités de la région, c'est que ceux du 19ème siècle, pour ces antérieurs il n'y en a pas vraiment, et les études historiques sur le sujet. mais pas non plus, à chaque fois on dit toujours qu'il faut faire fermenter la plante, etc. Enfin, les choses très basiques, on a du mal à cerner l'évolution. Tout ce que je sais, c'est qu'au premier empire, effectivement, c'était acté, je parle en 1810-1811, c'était acté qu'il fallait cueillir les jeunes pousses et que c'était elles qui étaient considérées comme les meilleures. Ça, c'était acté, à chaque fois on le répétait, il y a trois ou quatre traités d'agronomie où c'est bien répété. Et qu'après, justement, il ne fallait pas faire trop sauter la plante, faire des sarclages, aérer la terre, etc. Il y a un nombre de... de cueillette qui était un peu conseillé pour que la plante se régénère et qu'on n'ait pas des pousses, des feuilles qui soient de mauvaise qualité. Ça c'est tout ce que je peux dire actuellement, parce que c'est encore une recherche qui est en cours, il me reste encore à aller aux archives nationales, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais c'est bien beau, mais s'il y a des choses, on est dans l'ère de la numérisation, mais tous les archives sont loin d'être numérisées en France, donc ça fait que moi j'ai 300 heures qui me sont allouées, avec un budget aussi qui est limité, je ne peux pas m'amuser, donc je vais me déplacer à Toulouse justement, en plus il faudrait peut-être rester une semaine là-bas c'est très complexe et ce n'est pas une thèse sur le sujet non plus donc après je dois aussi me limiter d'abord je suis allé dans tous les centres d'archives régionaux ce qui est numérisé en France je l'ai consulté donc la BNF par exemple,
- Pauline Leroux ArtEcoVert
BNF, Gallica
- Charles Giot
Gallica, etc même Retro News pour la presse et puis après parce que là ce n'est pas numérisé mais ça reste quand même accessible l'objectif c'est en mai-juin donc d'aller aux archives nationales à Perpite-sur-Seine pour consulter quelques dossiers sur la réintroduction du pastel, etc. et voir si on peut avancer un peu dans les quotas, etc. qui étaient rendus obligatoires. Et peut-être je trouverai des choses sur le sujet.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
et est-ce que t'as contacté Michel Garcia parce que tu vois lui donc il est passionné de couleurs, formateur chimiste, botaniste enfin tout ce que tu veux mais alors en point de vue histoire j'ai des notes beaucoup de notes historiques et lui ça le passionne et c'est lui qui a trouvé cette erreur et il a lu les traités, il nous a même fourni une liste C'est pour ça que je suis une certaine liste de traités d'agriculture à lire, où notamment on parle du pastel, mais tu vois, je pense que ce serait intéressant de la voir, lui faire un mail, sans forcément te déplacer en Bretagne, mais je pense que ça peut être intéressant. Et je pense aussi à toi, dans le sud de la France, on a reçu plusieurs personnes notamment des acteurs, notamment Bleu de l'Ectour, etc., ou Greening, qui, eux, pareil, ont récolté des infos, des manuscrits. On a Dominique Cardon qui pourrait aussi... En fait, j'aimerais bien, entre guillemets, lancer un... Pas un appel, mais tu vois qu'en gros, s'ils ont des infos à te partager, il faudra que tu dises ce dont tu as besoin exactement. Mais je trouve que ce serait bien que tu sois aidée. Et je pense aussi à quelqu'un d'autre, c'est Marianne... Non, comment elle s'appelle ? Marianne Sarda Alina l'Institut National de l'Histoire appliquée ou je ne sais et qui a repris en fait pareil j'en sais pas plus mais j'ai hâte d'enregistrer avec elle apparemment elle a repris énormément de littérature sur les plantes tectoriales et les procédés d'application de la couleur végétale et je pense que peut-être elle qui est historienne du coup pour le coup pourrait être une ressource intéressante enfin tu vois je pense à plein de choses en t'écoutant parler je trouve ça génial
- Charles Giot
Mais de toute façon, l'objet c'est que c'est une recherche en cours et justement, mon dessin ultime, ce serait quand même qu'il y ait une forme de comité, qu'on ait une forme un peu d'organisation pour pouvoir s'échanger des informations, c'est pas du copyright ou... Ah bon, ah bon. mais ça serait vraiment bien de faire plus les directions puissent se rejoindre et j'ai pas une forme de représentants régionaux mais pour cette région il y a un peu...
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Bah ouais non mais t'as raison, tu as une histoire par région, ouais non mais c'est vrai.
- Charles Giot
Oui bah la spécificité de la plante justement dans son histoire c'est que chaque époque elle a été cultivée différemment dans différents lieux donc chacun a un peu sa période et voilà les spécialistes appellent ça sa période donc ça permettrait de comprendre un peu mieux une histoire qui est méconnue encore.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Non top. Bon vas-y, du coup je te laisse nous raconter cette fameuse histoire de l'isatis tinctoria et je me permettrais de t'interrompre si j'ai des interrogations.
- Charles Giot
Non mais oui, de toute façon c'est l'objet, c'est de montrer d'abord à travers cette présentation que l'histoire d'une plante c'est possible et qui plus est quand la plante est tinctoriale, a des vertus tinctoriales. une plante, d'ailleurs c'est ça qui est marrant, c'est que Patrick Martin m'a envoyé encore un article il y a peu de temps, que je n'avais pas découvert, mais qui est vraiment de l'archéologie justement, on avait fait encore des fouilles récentes, et on avait découvert que l'isatiste arcturier était présent en France, non pas au 8ème, mais dès le 5ème siècle, on a fait des fouilles à Roissy, donc voilà, en Europe... Voilà, on est au début de l'ère médiévale, on a l'isatis tinctoria qui débarque mais qui est déjà utilisé précédemment en Délantique. Alors c'est une plante qu'on retrouve principalement, je suis en temps là au XIIe siècle, vers 1105, on la retrouve principalement dans notre région Picardie. Avec une organisation qu'on pourrait dire qui est un peu similaire à celle d'aujourd'hui quand on parle de production, etc. C'est-à-dire qu'il y a des pôles plus importants qui se constituent, qui redistribuent la production de web. C'est Amiens et Saint-Quentin. Amiens, c'est vraiment le centre d'échange qui est total. C'est-à-dire qu'on amène les feuilles de oued qui sont terricotées à proximité, on les transforme, on les broie, on en fait ce qu'on appellera plus tard des boules de cocagne, et on les réexpédie à travers le fleuve Somme vers l'Angleterre. Alors il y a forcément tout un système d'imposition, quand ça marche bien forcément c'est un petit peu le... Voilà, donc il y a un système d'imposition à Amiens même, et puis sur la Somme, notamment à Piquigny. Donc il y a Amiens, vraiment centre d'échange plutôt total vers l'Angleterre, et puis il y a Saint-Quentin, où on ne consomme pas la web sur les lieux. dans la ville, mais c'était une ville très marchande, c'est-à-dire qu'elle faisait partie de la 11 des 17 villes, c'était une grande association marchande à l'époque médiévale, il y avait des foires annuelles, et c'était un peu une forme de connexion, ça permettait la connexion entre le bassin parisien et la Hollande, la Belgique et les Pays-Bas aujourd'hui. Donc c'est une organisation qui tournait à plein régime. Il y avait vraiment des marchands Picard en Angleterre qui servaient de relais. On les avait acceptés, ce qui est un peu exceptionnel en Angleterre. Mais le fait est qu'il y a eu des petites rivalités entre la France et l'Angleterre. Bien avant 1337, date du début de la guerre de Cent Ans, dès 1295, c'est Marchand Picard en Angleterre qui servait de relais. pour acheminer, pour déverser la production en Angleterre, on les avait considérés comme des ennemis. Donc à ce moment-là, forcément, tout le rouage s'enraye. La production de pétards de bois est réclite et l'Angleterre cherche à se fournir en Lombardie, près d'Airport, dans l'actuel Allemagne, aussi dans le Namurois, en Belgique. Donc en France, ça périclite. Alors ça, c'est ce que justement l'historiographie des livres nous dit. Mais quand on se penche vraiment sur la question, et ça, ça fait partie du renouveau que j'ai expliqué, on se rend compte qu'il y avait d'autres lieux où on cultivait la oued et surtout un lieu qui va vraiment connaître un essor fulgurant. Alors d'abord, il y a la Normandie, où on sait que la oued était cultivée davantage sur les lits d'euro que dans la zone plus continentale, dans les terres. Ah ouais ? Peut-être est-ce une... Peut-être qu'il y a une explication dans le sens où le climat était plus doux au bord des côtes. Je pense que c'est ça, mais je ne vais pas l'affirmer. Et donc, cette plante, on la retrouve dans la région toulousaine dès 1250. Alors là, je ne peux pas expliquer clairement le fait qu'on la retrouve dans cette zone. en fait il ya le lien qu'il ya une industrie de rapières qui est aussi en essor dans la région toulousaine autour d'albi donc ça l'implantation de wed là on va la paix pastel justement et ben ça permet d'avoir un colorant à disposition voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher en picardie ou en lombardie donc dès 1250 dans la douzoie 1268 dans le l'orage et autour de toulouse Alors là on l'expédie pour justement l'industrie de rapier de cette région et puis aussi en Catalogne, en passant soit en expédiant soit par Carcassonne, par voie maritime, ou alors par les Pyrénées directement. Mais dès 1305, Philippe le Bel va interdire l'expédition à l'écranger de Pastel, voulant renforcer l'industrie de rapier. et dès 1335, 30 ans après, l'industrie de la pierre justement, profitant de cet accès unique à la Oued, au pastel, cette industrie de la pierre va vraiment connaître un essor fulgurant. qui va se polariser autour d'Albi, qui va être vraiment le centre de Sénégos, où on va acheminer la oued, la transformer, et puis la réacheminer dans les centres de production rapides. Alors voilà, là on arrive à l'époque moderne, au 15e siècle, et justement, toujours dans cette région, c'est Gilles Castère qui l'a démontré, et qui ne s'est pas remis en cause. De 1450 à 1571, c'est ce qu'il appelle le projet du pastel de Coulouzin. où là aussi le pastel, et là les routes ont un peu changé, était de nouveau destiné à l'Angleterre, donc on voit que l'Angleterre a un rôle très important dans la culture du pastel en France, et on l'a cheminé par la Garonne, là aussi il y a tout un système d'imposition. Ce qui fait qu'à un moment, les marchands ont essayé de contourner la voie fluviale pour acheminer par voie terrestre jusqu'à Bayonne et de Bayonne jusqu'en Angleterre. Mais à cette époque, encore même aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que ça serait très coûteux, ça a pris plus de temps. Donc on est revenu sur la Garonne. En France, ce qui faisait qu'il y avait un système un peu particulier, c'est qu'on expédiait depuis Bordeaux, par le bout de la Garonne, l'estuaire de la Gironne, depuis Bordeaux et on faisait revenir par Rouen. parce qu'en fait il y avait tout le bassin parisien qui possédait environ 30% du pastel toulousain, donc on l'aurait expédié par cette zone. Ce qui fait qu'à Rouen, il y avait environ un cinquième de la production toulousaine qui était réaffinée à Rouen. Donc c'est un volume à peu près égal à celui de l'Angleterre.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Et alors justement Charles, pourquoi on expédiait autant le pastel en Angleterre ? Ils étaient plus dans la teinture que nous, ils utilisaient plus de gros volumes, pourquoi eux en demandaient beaucoup ?
- Charles Giot
Justement c'est parce que l'Angleterre était totalement dépendante de la production française. C'est ce que Michel Castoureau démontre, c'est qu'à partir du XIIe siècle, il y a l'essor du bleu dans l'Europe. Toutes les strates sociales des sociétés européennes utilisent le bleu. L'Angleterre, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi, a abandonné la culture du pastel à cette époque-là. Ça a été supplanté par les cultures céréalières, alors peut-être que c'est un volontaire. de faits qui sont arrivés là, mais l'Angleterre a abandonné cette culture et s'est fait qu'elle s'est approuvée complètement dépendante des importations extérieures. Et justement, quand la culture du pastel va péricliter dans la région toulousaine, et presque pour de bon, si on peut le dire comme ça, à partir de 1560, l'Angleterre va être devant le fait accompli qu'il faut maintenant introduire le pastel sur ton sol. Ça va prendre environ un siècle. avec une politique qui est vraiment assez énergétique, avec des ordonnances royales, etc. Et ce qui fait qu'envers 1650, l'Assoir indépendant de ce point de vue. Mais justement, il y a une autre plante qui arrive à ce moment-là, c'est l'indigo, l'indigotier colonial. On en a dit justement, c'était ce qu'on disait avant de commencer le podcast, qu'il produisait, en tout cas pour extraire la molécule d'indigo, c'était quand même plus efficace. que sur la oued, que sur le pastel. Donc forcément, en France, on s'est tourné vers cette plante. En Angleterre, je ne sais pas encore vraiment, mais il semble que, vu qu'on a un pastel assez délicat, l'indigo n'a pas eu le même effet qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on a abandonné la culture du pastel pour deux raisons. L'indigo est arrivé, donc forcément, vous n'avez plus à cuire les petites feuilles de pastel, où ça demandait beaucoup de monde. et en plus ça prenait du temps pour aller à l'indigo c'est quand même plus efficace et il y a eu les guerres de religion surtout dans le sud de la France vous vous doutez bien quand il vous faut une armée de personnes pour cuire les fruits de pastel pour l'acheminer, pour le broyer c'est une organisation très complexe un événement tel que les guerres de religion ça désorganise complètement tout procédé de production et d'acheminement et d'expédition
- Pauline Leroux ArtEcoVert
C'est vrai que dans les traités, notamment Gustave Eusée, etc., ils parlent du nombre de personnes qui sont sur les champs à récolter. Je me dis, mais vu la main-d'œuvre qu'ils avaient, on ne pourra jamais être compétitif aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui étaient là à cueillir femmes, surtout femmes et enfants, dès que c'était méticuleux. Tu te dis, c'est hallucinant.
- Charles Giot
Oui, c'est toujours comme ça. Alors aujourd'hui, justement, peut-être qu'on parlera de David et Hélène Brunel, mais alors eux, même aujourd'hui, ça pose encore des soucis quand on veut réintroduire, parce que si je ne me trompe pas, pour récolter leur oued, ils ont dû bricoler un peu une machine qui était censée récolter des épinards.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Maintenant, tu as des machines soit adaptées d'autres cultures, soit maintenant, il y a même une récolteuse jeune pousse. On a reçu Terratec qui est à l'Étrême, dans notre coin du Nord. Et eux ont travaillé une récolteuse pour justement faciliter ce travail de récolte de la persiquaire, etc. Justement pour limiter ce temps de travail et être ergonomique.
- Charles Giot
Oui parce que j'ai encore vu il y a des reportages, il y a quelques années mais qui font moins de 10 ans, où dans la région toulousienne justement on était encore en train de cueillir à la main, c'était un petit peu particulier. Alors après ça faisait partie de l'idée du savoir-faire à transmettre, justement parce que ça fait deux ans que le procédé de teinture du pastel est au patrimoine immatériel français. Donc il y avait tous cette idée de procéder. C'est vraiment beaucoup plus ancré dans la région toulousaine. Il y a une maison du pastel en plein centre de Toulouse, à côté de l'hôtel, alors si je ne me souviens pas c'est l'hôtel Azena, je ne sais plus où je me retrouve. Bon bref, c'est un hôtel qui a été construit grâce à un marchand de pastel, grâce à ce revenu qui était très important. Donc il y a une mémoire qui est beaucoup plus forte dans cette région que dans la nôtre. C'est pour ça que nous on a toujours un peu l'impression de la redécouvrir cette histoire. Bon et puis après on s'est aussi rendu compte c'est le temps qu'il y avait bien la lumière. Donc c'est un peu plus complexe quand on parle de variation climatique de faire pousser le pastel.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Il n'y a pas une forme de petite guéguerre quand même entre la région de Toulouse et la région du Nord ? Parce que tu vois, j'ai l'impression que ce soit dans les lectures, à chaque fois, tu vois, on oppose, dans les traités, on oppose la culture du côté d'Amiens et la culture de Toulouse. et même tu vois par exemple j'ai eu deux binômes d'agriculteurs Hélène Brunel et David dans le nord et j'avais Jean-Marie Nels du Bleu de l'Ectour et en fait ils disaient on n'a jamais pensé à se contacter alors qu'on travaille la même plante et moi je leur ai demandé de faire une intervention commune entre la culture dans le nord et la culture dans le sud et ils se sont super bien entendus ils ont dit c'est vrai qu'il y a quelque chose qui reste Tu sais un peu de revendiquer un savoir ou une paternité d'une technique ? Je ne sais pas si tu l'as ressenti.
- Charles Giot
Alors, dans les études historiques, forcément, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un peu plus d'objectivité, donc on ne peut pas chercher à montrer son... Mais on peut comprendre, et là ce serait plus un phénomène sociétal, que quand vous êtes dans la région de Toulouse, que l'histoire est présentée, vous êtes attaché à cette histoire, vous pouvez toujours voir d'un mauvais œil, que dans une autre partie de la France, tout d'un coup émerge un sentiment aussi un peu régional autour de cette plante. Surtout que si vous n'avez pas la connaissance que là aussi, à l'époque médiévale, on cultivait la plante, c'est même la première région où on cultivait de manière très importante la plante. bon au début vous ne comprenez pas trop on pense un peu à on vole un peu le patrimoine
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Et est-ce que c'est la cathédrale d'Amiens, justement, qui a été… Ou sur la façade, il y a la représentation des Ouédiers, etc. C'est cette cathédrale-là, je ne me trompe pas ?
- Charles Giot
Oui, alors tout le sous-bassement sur le moteur de Ramette s'est représenté avec des feuilles de Ouède. Et il y a, je crois, la façade nord de la cathédrale qui est dédiée, il y a un pont de la façade qui est dédié aux marchands Ouédiers. On les voit représentés avec une sorte de récipient où ils sont en train de faire de la peinture. là c'est encore la même chose ça c'est vraiment ce qui est même le plus intéressant c'est qu'on peut passer tous les jours devant un monument traverser une ville tous les jours, même si Amiens était assez bien détruite par les guerres mondiales, il y a quand même cette cathédrale, et on a du mal à penser qu'elle a été... Alors aujourd'hui, on tend quand même à réduire le pourcentage, mais qu'elle a été construite grâce aux revenus de la Oued. Et qu'il y a encore des témoignages, et même encore, c'est Roger Ouédi qui le montait, pour Amiens, qu'il y a encore des moulins de l'époque médiévale qui sont présents, notamment le moulin du Passavant, si je ne me trompe pas. qui a été restauré il n'y a pas très longtemps et qui était un moulin qui servait à la transformation de la Oued. Et on ne porte pas tous les jours à ce patrimoine matériel.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Et alors, j'ai entendu quelque chose, enfin j'ai lu surtout parce que je n'ai pas entendu, mais que grâce aux Ouediers, en tout cas grâce aux économies réalisées grâce aux Pastels, ils avaient réussi à payer une rançon. Il n'y a pas un truc comme ça ? Un roi ou un... Je ne sais plus quoi. Quelqu'un d'important qui avait été... Je ne sais plus quoi. Désolé,
- Charles Giot
je t'ai dit que... Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est pour François Ier.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Peut-être. Il faudrait que je retrouve mes notes. Mais en tout cas, j'ai entendu un truc comme ça que c'était tellement important.
- Charles Giot
Soit c'est pendant la guerre de Cent Ans, mais pour moi, c'est François Ier, ou c'est un marquant douette qui a payé la rançon.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Oui, c'est ça. J'avais entendu ce truc-là.
- Charles Giot
C'est pas probable que ce soit François Ier.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
On se met une petite astérisque. On mettra dans les commentaires si on s'est planté, si ce n'était pas ça ou si c'était ça. Pour vraiment dire qu'économiquement parlant, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était... Comment tu l'as bien dit tout à l'heure ? C'était bien organisé. Il y avait du monde qui travaillait. Il y avait une certaine économie. Il y a des bâtiments qui ont été faits. Une rançon qui a été payée qui ne devait pas être une petite rançon.
- Charles Giot
C'est pour ça qu'à Toulouse, en plus, quand vous avez beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur la question, bon, ça a apporté un patrimoine énorme, mais la question, elle a fait beaucoup de travail. C'est par exemple, on a travaillé sur le cycle de trois ans. C'est-à-dire que le pastel, c'est vraiment une culture très particulière. Il faut la cueillir, il faut la faire sécher, ça prend six mois, un an, il faut la broyer. Après, vous l'expédiez à Toulouse, vous l'expédiez depuis Toulouse à Bordeaux. À Bordeaux, il faut attendre que les cours... européens soient intéressants pour l'expédier dans les différents pays. Donc ça fait qu'en fait, un marchand de pastels à cette époque, il devait avoir une capacité financière pour trois ans.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Oui, de trésorerie.
- Charles Giot
Oui, il faisait une culture, imaginons en 1520, il recevait l'argent de cette culture qu'en 1523. avec ce qui engendrait que beaucoup étaient endettés auprès des banquiers italiens basés à Lyon. Et ce qui fait que ces banquiers italiens ont repris les affaires petit à petit, parce que forcément il y en a qui déposaient le bilan, et se sont incroyés petit à petit dans la culture du pastel. Et le fait est que les Italiens, il y avait quand même beaucoup d'entraide, de l'interaction familiale. et donc il y avait marchands et banquiers italiens qui s'organisaient et qui ont un peu noyauté à certaines périodes le commerce dans la région de Toulouse pour le réexpédier en Espagne et même dans les Açores. Donc c'est ça qui fait la particularité de cette période toulousaine, c'est qu'on en sait beaucoup, on en sait beaucoup, on a beaucoup étudié et que nous, dans la région, pas de source. Parfois des travaux qui sont un peu impartiels, qui ont beaucoup de valoriser l'histoire de la cathédrale, d'Amiens, qui réfléchissent pas trop au global, ça nous a un petit peu passé sous le nez. au final la valorisation patrimoniale et moi je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé l'étude c'est que directement tous les articles ça m'a envoyé vers Toulouse et je me suis dit comment je vais faire pour la région et c'est avec la région ça fait 10-15 ans qu'on commence à s'intéresser à la chose, s'il y a bien des produits de David Hélène qui sont en vente au musée Picardie c'est qu'on commence à comprendre qu'il y a un intérêt à la faute économique et historique.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Et tu l'as vu, quand on était à Béthune, tu avais quand même pas mal de monde qui était présent. Tu vois que j'avais reçu sur le podcast, mais d'autres personnes, tu vois que ça bouge dans le Nord aussi, parce que je pense, comme tu dis, on a perdu des sources historiques parce qu'on échangeait sur... le pastel. Et tu sais, avec Patrick Martin, on a parlé de pourquoi il ne ferait pas aussi d'autres recherches sur d'autres plantes. et je lui glisse la première remarque que m'avait fait Michel Garcia il m'avait dit toi t'es dans le nord du côté de l'île il faut absolument que tu cultives de la garance alors que pour moi dans ma tête la garance c'était dans le sud et en fait il dit mais non tu regarderas les traités la Belgique, la Flandre et la région de l'île c'était vraiment un terroir pour la garance alors bon voilà j'ai creusé un petit peu, j'ai eu une historienne belge qui m'a raconté ce qui se passait moi je suis au bout vraiment à la frontière pour le coup et en fait tu vois je me dis ça nous on l'a perdu dans le nord on n'en a jamais parlé du côté d'Arras, du côté de Lille toute cette culture de garance moi j'en ai jamais entendu parler et je me dis tu vois quand tu dis que c'est important que ça nous passe pas sous le nez moi je trouverais ça intéressant que tu puisses aussi avoir un financement toi ou quelqu'un d'autre mais tu vois de continuer à rechercher d'autres plantes tectoriales qui étaient présentes dans les Hauts-de-France quoi
- Charles Giot
De toute façon déjà mon projet il s'inscrit dans le cadre du projet régional Anamorphose, c'est-à-dire qu'en fait on cherche à valoriser un patrimoine un peu méconnu de la région. Donc déjà c'est une pierre qui est posée dans l'édifice, donc on a déjà pris en compte que des plantes pouvaient faire partie d'une histoire régionale, enfin c'est un patrimoine régional. Donc on a fait la oued, c'était la plante par excellence qui était plutôt destinée à ça. la garance, bah oui évidemment et même des plantes qui ne sont pas forcément territoriales, c'est bien de mettre en valeur parce qu'en fait on le fait que de manière dans les sciences dures, de manière scientifique et on oublie toujours un peu l'aspect historique bon l'histoire n'a pas réponse à tout mais déjà pour ce projet avec Patrick Martin c'est qu'on parfois on en parle mais ça se complète quand même et bon parfois ça nous fait rire parce qu'on trouve des choses moi j'avais trouvé des sources sur un village vraiment à côté de chez lui etc donc ça me faisait rire de s'imaginer qu'on pouvait bah ouais et
- Pauline Leroux ArtEcoVert
puis ça nous ouais et puis ça nous ça nous je sais pas comment dire ça nous fait du bien de savoir que Il y a pu y avoir une histoire de notre région. Tu vois, moi, je me dis, c'est quand même fou, il n'y avait rien qui me prédestinait à m'intéresser à la couleur végétale. Et au final, plus je lis les traités, plus j'entends Michel ou d'autres, plus je me dis, en fait, il y a quand même un lien. Il se passait quand même beaucoup de choses dans les Hauts-Trans et c'est en train de revenir tout doucement. On le voit, il y a des événements qui s'organisent, etc. Mais je trouve ça intéressant que l'histoire revienne rappeler tout ça à tout le monde.
- Charles Giot
Mais de toute façon, le problème fondamental dans notre région, c'est qu'il y a eu la première guerre mondiale, et que tant sur le plan matériel qu'au niveau des sources historiques, on a eu des destructions énormes. Et donc c'est compliqué de valoriser un passé quand il y a eu tant de destruction. Et c'est d'où l'image toujours que dans le Nord, pour certaines personnes qui sont une minorité, il n'y a pas grand-chose. Et quand il faut valoriser, c'est quand les gens arrivent sur le lieu qu'ils se disent Ah bah je ne pensais pas que… C'est pour plein de thèmes. Notre région, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était le moteur dans beaucoup de domaines de la France entière, avec le bassin de l'Est. que ce soit pour l'industrie, l'agriculture, ça a vraiment un moteur de notre pays, et aujourd'hui on essaie de la transformer, et le projet de Valoued, c'est de s'inscrire vraiment dans la redynamisation de notre région, et donc forcément quand on veut impulser une nouvelle politique en la matière, et ce n'est pas du tout à des fins de propagande, mais c'est une logique, il faut quand même un appui historique. parce que justement la volonté de réintroduire le pastel ça vient pas d'un claquement de doigts c'est parce qu'on sait que c'était possible et que c'est possible et qu'un temps ça fait la richesse de notre région Après la science est là pour ajuster, c'est ce qui a été fait notamment sous Napoléon, et pour rendre plus efficient le procédé de teinture, la récolte, pour qu'on ait des récoltes plus abondantes, et surtout pour assurer que les récoltes chaque année soient correctes. C'est ça qu'on dit aussi. On a des épisodes très plus vieux que la plante aurait tendance à courir ou pas pousser correctement. On est dans une société à l'heure actuelle où on ne pourrait pas se permettre de manquer de teinture. Et justement, là, peut-être après je pourrais en parler au premier empire, c'est la question qui s'est posée. Napoléon a fait le blocus en 1807. En gros, plus de connexion avec les îles anglaises. C'était bien, le but c'était de fragiliser l'empire britannique. Bon, sauf que c'est une île déjà de base, l'Angleterre. Donc eux, ils s'en sont très bien sortis. Et nous, on en est sortis très affaiblis. plus de canne à sucre et plus d'indigo. Ce qui fait qu'il a fallu introduire la betterave sucrière et le pastel. On l'a rendu obligatoire après une politique incitative, on l'a rendu obligatoire en 1811. Bon, il a fallu justifier, etc. Mais le problème, c'est que le pastel, comment dire, il était un petit peu devenu inconnu. On ne connaissait plus du tout le pastel. Et donc de ce fait, il a fallu trouver des méthodes et des moyens pour le réintroduire. Donc on a beaucoup insufflé de politiques, on a envoyé beaucoup de manuels pour convaincre les agriculteurs que c'était tout à fait réticent. Tout simplement parce qu'on s'est hâté de le faire, parce qu'il n'y avait plus assez de bleu pour peindre les uniformes révolutionnaires qui étaient même à peu près comme pendant la révolution, qui étaient bleus. Et donc même un temps, mais sans référentage, on a voulu mettre les uniformes en blanc, les uniformes de la royauté. Donc sans référentage sous Napoléon, de revenir au blanc pour l'armée, pour les uniformes militaires. Donc on s'est hâté et ça n'a jamais vraiment marqué, tout simplement parce que quand vous ne connaissez rien à la plante, pourquoi les cultiver ? Il y a beaucoup de lettres dans le Pas-de-Calais où vous avez des agriculteurs ou même des maires qui se retrouvent un peu en difficulté. On dit qu'on a planté que un quart des semences qui étaient prévues, les gens les ont reçues avec des modes retard, les semences ne sont pas poussées, les agriculteurs ont refusé parce que la terre est trop fraîche, ils ne voient pas l'intérêt. Ce n'est l'histoire du pastel au XIXe siècle, c'est très compliqué. C'est le lent déclin après une tentative qui prévait être un échec de réimplantation. Le problème fondamental, même aujourd'hui pour l'étude, c'est qu'on n'a pas toutes les sources. Et justement, l'idée d'aller aux archives nationales, ça serait compléter. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fragmentation de les quotas qui a été rendu obligatoire en 1811. Dans le Pas-de-Calais, c'est 40 hectares. En Unilère, une région quand même très montagneuse, ça montre un peu le degré d'inquiétude à l'époque en rapport avec la production du bleu. On avait 1025 hectares. Dans le Vaucluse, 250. Dans la Haute-Garonne, 600 hectares. Donc il y avait quand même cette idée que l'histoire du pastel dans la région toulousaine était quand même plus importante. Et donc... directement on s'est dit que le pastel était une plante qui émet la lumière, une plante qui émet la chaleur. Et c'est justement aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, un patrimoine important dans la région toulousaine, est-ce qu'on aurait tendance à croire aussi ? Bon après dans la région toulousaine, de ce que moi j'ai vu, c'est quand même, certes il y a beaucoup de, il y a des entreprises autour du pastel, qui produisent du pastel, ça m'a vraiment étonné, mais il y a toujours cette idée que c'est une valeur patrimoniale, alors il y a un musée dans un petit village, on fait des démonstrations…
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Mais c'est pas le Bleu Dectour justement ? Non. le tectour je sais qu'ils font des visites aussi de la de la teinture de l'intentu à viser de la peinture d'accord on regarde un match dans la synthèse mais et
- Charles Giot
Honnêtement, ça fait quand même une grande différence avec ce que l'on retrouve dans notre région. Pour l'instant, c'est vraiment David et Hélène qui sont un peu les moteurs. Et je sais que Patrick et Martin, il y a quelques difficultés, mais ils y arrivent, à tester différents terroirs dans le Pas-de-Calais, dans le Nord. Même moi, à titre personnel, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'étais en train de repiquer du pastel dans un petit camp de terrain que j'avais, que j'avais préservé pour la chose, en me disant que j'étais nourri de cette histoire sous le premier empire, où tellement on voulait que tout le monde replante le pastel, on a dit que le pastel était en gros incroyable, il résistait aux tels, enfin tous les intempéries. Et justement, j'ai pu expérimenter qu'il ne faut pas se laisser avoir par les sources.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Ben voilà.
- Charles Giot
et que dès qu'il n'y a pas de soleil, le pastel ne pousse plus, il n'y a pas d'humidité, c'est une plante qui paraît même assez fragile, qui serait facilement grignotée par des petits insectes, etc. Mais là aussi, c'est comme ça qu'on découvre une plante, parfois c'est en la cultivant tout simplement.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
et les graines est-ce que tu sais d'où venaient ces semences de pastels parce que ce que j'ai appris bon je suis un géagro mais je l'ai réappris avec les plantes tectoriales c'est que t'as des variétés adaptées à certains terroirs ça tout le monde le sait mais que en plus tu préserves enfin tu comment on va dire tu adaptes ton patrimoine génétique donc ta graine en fonction de ta région donc est-ce qu'ils ont envoyé des graines de pastels dans les Hauts-de-France qui venaient du Sud et qui sont et dans ce cas là le truc n'était pas forcément adapté comment ils se sont fournis ces fameuses semences de pastels c'est une très bonne question l'objet d'aller aux archives nationales c'est d'essayer d'y répondre pour voir un peu tout le fonctionnement généralement
- Charles Giot
c'est piloté par le ministère de l'intérieur pour vous dire que c'est même pas l'agriculture c'est vraiment une question très importante à l'époque après il y a des phénomènes régionaux le ministère de l'intérieur par le biais du préfet envoie des semences mais comme dans la Somme il y avait un certain Mété Michaud, qui était un petit peu un chimiste qui avait quelques expériences, qui dès 1806 avait réintroduit la culture du pastel autour d'Abbeville. Et lui s'était proposé au préfet pour envoyer des semences à la préfecture et puis les redistribuer à tout le département. Parfois on a un peu des phénomènes comme ça, avec justement, là on parlait de garder une production qui soit assez linéaire, assez constante au fur et à mesure des années, M. Michaud, bien qu'il soit assez compétent en la matière, il a du mal. En 1811, 1812, il y arrive très bien, et en 1813, quand on lui demande s'il peut à nouveau renvoyer des semences, parce que l'État s'était un peu appuyé sur lui, il dit que même pour lui, déjà, recever l'année prochaine, il aura des difficultés, et donc il ne peut pas se permettre d'envoyer des semences. Le problème c'est que c'est une période de 3-4 ans où on essaye de réintroduire une organisation, en plus dans une période de désordre militaire, il n'y a pas eu d'organisation très très carrée. On s'est attenu sur des personnalités à certains endroits, nous c'est Mété Michaud dans la Somme, à Toulouse c'est Marcus de Pumorin, qui a profité de tout l'argent qu'on a déversé pour créer des écoles, former des gens à la teinture. Et puis après, quand on a abandonné avec la Chifle de l'Empire en 1815, qui s'est accrochée, qui a demandé encore dans les années 1830, pour qu'on réduise les taxes sur la culture du pastel, bien qu'en fait on se demandait encore si c'était une forme de culture du pastel. C'est des personnalités qui ont eu une influence. Alors sur les types de semences, bon déjà je ne suis pas agronome, je ne peux pas tellement en parler, mais je n'ai pas d'informations. Mais si j'en ai, bien entendu, je les communiquerai.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Et est-ce que tu sais, à la période faste du pastel en France, à combien d'hectares de culture on était environ ? Parce que j'ai un peu de mal à trouver une info, pour donner un ordre d'idée quand même. Parce que là, aujourd'hui, j'essaye d'appeler chaque agriculteur, un par un, pour savoir les quantités qu'ils produisent de pastel. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, ils ne sont pas souvent sur les réseaux, donc va les trouver. C'est du bouche à oreille, c'est un travail de fourmi. mais j'aimerais avoir une notion de quand c'était une période faste, on était à peu près à combien sur toute la France ? Tu sais pas ?
- Charles Giot
Tu m'entends ? Oui, c'est bon, il y a un petit... C'est bon, c'est bon. En fait, c'est un peu compliqué, dans le sens où, à l'époque médiévale moderne, la notion d'hectare, elle n'existe pas. Et même dans les sources ou dans les articles, c'est le problème en fait, c'est qu'on parle pas tellement de la culture en elle-même. Alors il y a des cartographies qui sont reportées, mais qui sont très larges, donc on a du mal à voir vraiment la zone. Alors moi je voudrais pas faire un mauvais ratio, mais comme à l'époque médiévale, autour d'Amiens, de Saint-Quentin, je pense qu'il y aurait un cinquième, un sixième des cultures qui étaient destinées à la Oued. D'accord. Donc ce ratio-là, de 1 quart à 1 sixième, un peu ce type de ratio. Donc c'est important quand même. Mais l'agriculture, vous êtes vraiment concentré autour des villes et autour des fleuves. On ne s'étend pas trop dans des lieux qui sont un peu perdus.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Pour l'acheminement.
- Charles Giot
Il faut que ce soit efficace.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Oui, c'est de la logistique.
- Charles Giot
Après dans la région de Toulouse, là aussi à la fin de l'époque médiévale, quand on a commencé à cultiver la plante, il y a quelques cartographies, j'en ai vu une sur un article, mais il n'y a pas vraiment les zones et les quotas, enfin la surface qui était cultivée. On mentionne que les zones, mais c'est vraiment des points qui sont assez étendus, donc on peut quand même se dire que c'est assez important. Après l'idée c'est le ratio toujours par rapport aux cultures céréalières, ça permettrait vraiment d'avoir... Le problème c'est quand on n'a pas les sources on ne peut pas deviner. Déjà la cartographie médiévale de Robert Caussier, je me demande comment il a pu la faire. Il n'est pas sourcé, et comme lui il montre pourtant la cartographie assez large, ça montre même le bassin parisien. Et aujourd'hui dans les archives du Val d'Oise il y a tout un dossier ou une abbaye taxée sur la guêde, sur la oued. dans le Val d'Oise. Et Robert Fossil monte pas de culture dans le Val d'Oise. Donc on sait déjà qu'il n'avait pas accès aux saufs. Ça lui a échappé. En plus, on sait qu'on a une culture dans le Val d'Oise. Donc on est entre un quart et un sixième. Et dans la région de Toulouse, on ne peut pas dire, mais c'est des racieux qui sont quand même importants. Et après, pour les hectares, vraiment, on est sûr, en tout cas ce qui était programmé, C'est le premier empire, encore une fois. Les 6 11 hectares dans le Haut de Garonne, 40 pas de palais, etc.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Et ça, tu l'avais trouvé où, les hectares dans les différentes régions ? C'est dans quelles sources, ça ?
- Charles Giot
Ça, c'est les archives du Pas-de-Canet, par exemple. Alors, les archives, c'est classé par lettres, c'est des séries qui renvoient des thèmes et des périodes. Et dans la série M, c'est l'administration générale, 1840. Tu as la sous-série 7M, c'est l'agriculture. Et là, tu as des dossiers sur la reproduction du pastel avec des grilles. ont la betterave sucrière, le pastel et les quotas qui sont mentionnés pour la ville.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Ah ouais, d'accord.
- Charles Giot
Après, la question, c'est que tu as les quotas, mais il faut savoir vraiment ce qui est réalisé.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
C'est vraiment ?
- Charles Giot
Tu as une série de correspondances où tu as les maires qui, ça permet d'avoir un peu un retour, qui disent qu'on a tout planté, on n'a pas tout planté, on a planté un quart, puis après il faut voir le rendement, mais ça, tu ne le sais pas forcément. Après, il y a une autre méthode, ça peut être de voir les annales départementales. Là, ça permet de voir un peu les quotas de culture, mais là aussi, il faut voir ce qui a été conservé.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
D'accord. Donc, ce n'est pas si facile d'avoir une notion globale. Il n'y a pas un chiffre réellement atteint qui est diffusé.
- Charles Giot
À mon échelle... pour mes 300 heures et que je suis, bon après je suis encore un mémoire, j'ai pas mal de projets, je peux pas me permettre. En fait il faudrait aller dans tous les centres d'archives dans les 95 départements de l'Hexagone. C'est un travail énorme, même pour une thèse, mais en plus faut être sûr qu'il y ait des sources, donc c'est compliqué de lancer une thèse comme ça. Et voilà, il y a un vrai travail. Et là, pour le coup, l'idée d'un comité, que chacun pour sa région par exemple travaille sur le sujet,
- Pauline Leroux ArtEcoVert
C'est intéressant, et mettre en commun, carrément. Il faudrait mettre une méthodologie en place, quels documents regarder, comment les faire remonter, les numériser.
- Charles Giot
L'idée déjà d'avoir un tableur Excel en commun, où pour chaque département, chaque région, on ait l'idée d'un quota pour chaque période, ou d'informations assez globales, sur telle année, on sait qu'à tel endroit c'est cultivé, même si c'est très précis, ça pourrait faire avancer la connaissance, et on pourrait sortir un tableau général à la fin. et un article sur le sujet, ça ferait vraiment beaucoup de bien. Parce qu'après, dans le pastel, il y a toujours une figure régionale dans l'histoire du pastel. Donc, il y a forcément pour chaque région, on pourrait trouver quelqu'un qui serait tout à fait capable de le faire et d'échanger des informations.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Bon bah écoute avec l'épisode on lance cet appel on lance mettre à dispo un tableau X7 mais il faudrait que tu expliques la méthode O et après on le met à dispo moi j'ai moyen de mettre à dispo Oui bah oui il y a un tableau X7 qui peut être fait même en train Non mais ce serait vraiment chouette parce que comme je te dis c'est des infos qui manquent pour comprendre la réalité que c'était avant tu vois l'importance que ça avait et qu'aujourd'hui bon donc aujourd'hui clairement il y a moi je ne collecte que quelques hectares par-ci, quelques hectares par-là, pas tout le temps d'une année à l'autre, des fois il y a des parties qui sont mises en culture pour la récolte des graines, d'autres fois c'est pour les feuilles,
- Charles Giot
enfin tu vois c'est compliqué de dire voilà aujourd'hui on en est à autant bah non tu sais pas en fait il y a même une étude sociologique qui peut être faite sur l'idée de la réintroduction du pastel aujourd'hui en comparaison à celle quand on la rejoue obligatoire sous Napoléon Les réactions des agriculteurs, de la société en général ? sur l'utilité d'une plante et de voir les évolutions. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à partir de ce point de vue.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Alors, il y a ça. Et alors, du coup, Charles, là, c'est un débat ouvert. Mais tu vois, on connaît mieux le pastel aujourd'hui qu'on ne le connaissait avant. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je reparle de Michel Garcia, je suis désolée, je n'ai pas d'action. Tu vois, sur l'extraction du pastel, l'histoire d'enlever la cire pour augmenter la dispo de l'indigo, etc. ben en fait tu le ponds pas comme ça il y a vraiment des gens qui ont cherché le meilleur procédé d'extraction j'ai entendu dire que tu disais qu'à l'époque on séchait les feuilles de pastel alors qu'aujourd'hui on sait les extraire fraîches il y a ça aussi tu vois qui change donc moi j'ai l'impression qu'on a une connaissance différente de l'extraction la culture, et donc c'est pour ça que moi je me tape là les traités d'agronomie, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un modèle agricole, en tout cas c'est ce qu'essaye de faire David Brunel, apparemment c'est ce qu'il expliquait dans son épisode, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on sait mieux extraire, mais on ne sait pas forcément mieux cultiver, et tu vois, alors sur le pastel ce n'est pas la même question que sur d'autres plantes tectoriales, la ressource en graines, elle est importante. Tu vois, le pastel, ça te donne des quantités, des quantités de graines. Donc, ils n'ont pas la même problématique que certaines autres ressources où les graines sont hyper précieuses et on n'a pas la ressource. Mais tu vois, je me demande bien aujourd'hui si déjà, il faudrait, pour que ça se réintroduise, ça voudrait dire prendre la place d'une autre culture. On est d'accord ? Quelle autre culture tu enlèves ou tu supprimes pour mettre du pastel ?
- Charles Giot
C'est un débat sans fin, mais de toute façon la terre n'est pas extensible. Et c'est la même idée que quand on parle des biocarburants, etc. C'est forcément des choses qui étaient destinées pour la production alimentaire humaine ou animale, qu'on fait sauter. C'est pour ça que l'idée du biocarburant à 100% pour tout le monde, c'est impossible. Il y a toujours l'idée de la ratio. Comment on organise, comment on fait ses assautements, etc. Après pour l'idée... L'idée de la notion d'information sur la culture, là clairement c'est l'histoire qui parle, c'est le fait que de base on n'a pas beaucoup d'informations de source sur le sujet. Et que probablement, là c'est une hypothèse, il y avait aussi l'idée que c'était un savoir qui se transmetait de manière orale. Dans le nord de la France, c'est fort probable qu'on ait un pays de droit oral, c'est un pays de beaucoup d'oralité. Dans le sud, c'est plutôt un pays de droit écrit. Alors on a l'époque moderne. Tout se met par écrit. Mais il y a peut-être cette idée-là. Alors après, tu vas me dire, vu que tu es agronome, tu vas me dire qu'il y a des traités. Mais quand on est le petit producteur qui ne sait pas lire, ça existe au 19e, le traité, il saute.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Oui, toi, ça, je n'avais pas pris conscience. Tu as raison.
- Charles Giot
C'est vrai que… C'est ce qu'on appelle le laboureur du coin. Le laboureur, c'est l'agriculteur un peu riche qui emploie les gens, qui a des machines. Du coin, qui va dire comment faire, qui va apprendre. assez ouvriers, assez manouvriers.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
comment il faut faire. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de savoir-faire unique d'une personne à une autre, ça devait un petit peu varier. Comme aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas tous la même méthode. Il y a de la méthode générale, on plante à telle période, on met tel amendement. Il y a toujours des variations, chacun préfère mettre un peu, faire différemment, chacun à chez soi en soi. Après pour la transformation de la veine, tu disais que c'était des feuilles fraîches aujourd'hui, c'est le travail de Romain Vautlin justement qui a vraiment rendu plus efficient le procédé, mais là je reviens encore à ma période fétiche, le premier empire, où c'est à cette période-là qu'il y a un basculement, on fait plus s'éclater les plantes, les feuilles. en environ 2-3 jours on a extrait l'indigo mais là on est plus de l'acide sulfurique le procédé devient vraiment chimique et un peu dangereux quand même mais on n'est plus du tout sur un procédé qui était par fermentation qui laissait la nature faire son oeuvre ça a été justifié par le fait que ça les a dépêchés tout simplement par les couleurs et que les agriculteurs n'allaient pas tolérer de repartir sur un procédé qui allait prendre un an
- Charles Giot
ok ok top donc du coup dans ton histoire là on en est où ?
- Pauline Leroux ArtEcoVert
alors là il y a quelques balbutiements après alors ça s'achève en 1815 au moins la culture du pastel dans l'idée d'une plante naturelle il y a quelques bas de bûchiment à la fin du XIXe mais c'est quand on veut la reproduire comme plante fourragère j'avais parlé à Béthune dans une série d'articles ça dure 3 ans 1893 à 1896 On décide de plomber la plante comme une plante fourragère. Dès février-mars, vous pouvez avoir un fourrage, surtout dans les zones où il ne pleut pas beaucoup, pour vos moutons, votre bétail. C'est vraiment la plante de rêve. Les botanistes racontent que pendant la sécheresse de 1893, il faut tomber une graine de pastel sans eau, etc. Elle pousse comme par merveille. C'est un conte de fées. Donc on... On vend la plante et puis à chaque fois, dans les articles, vraiment en tout petit, à travers quelques lignes, on mentionne qu'en vérité, pour que les bêtes mangent la plante, il faut soit les faire jeûner, mettre du sel sur la plante, que les vaches produisent moins de lait en mangeant le pastel. Donc en vérité, ça n'a pas tellement d'avantage, si ce n'est vraiment dans les zones où il est difficile d'avoir de l'herbe, ça fait un complément, ça peut être intéressant. Bon ça n'a jamais marché, ça a duré trois ans. Globalement, c'est des articles qui ont été produits que dans des revues très spécialisées. Est-ce que l'agriculteur, le petit agriculteur du coin qui a son mode de savoir-faire ancestral va s'embêter à lire la revue d'horticulture et de botanique ? Je doute, et de toute façon ça n'a pas pris, donc ça montre bien que ça n'a pas marqué. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on se rend bien compte à travers le cheminement historique qu'il y a eu un siècle où on était dans le creux de la vague. en terme de culture de la oued, d'Elisabeth Istanktoria, et qu'aujourd'hui c'est vraiment un renouveau, il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire, et toi t'es vraiment une actrice de tout ça. Bah non mais il faut le dire comme c'est parce que tu mets en valeur. Moi je fais l'étude historique et je m'insère seulement dans le produit où je découvre, je suis vraiment dans la découverte, je suis dans la machine. Et en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois. et il y a cette histoire qui se crée c'est intéressant de voir un peu les directions que ça peut prendre, c'est comment on conçoit la plante aujourd'hui que dans le sud de la France de ce que je vois en tout cas c'est vraiment le dossier plus patrimonial l'idée de savoir-faire qui est déjà implanté depuis quelques années et que dans le nord, on a quand même le nord en général et la haute France on essaie quand même de promouvoir la plante sur divers aspects parce qu'on a toute une équipe de chercheurs qui sont sur la question et vite sans lasser le début, il y a quand même cette idée qu'on est dans cette émerveillessance justement qu'il y a peut-être eu un peu avant dans le passé toulousain mais c'est un peu le moteur dans le domaine aujourd'hui
- Charles Giot
ce que j'ai remarqué à Toulouse pour faire un parallèle avec ce dont on a parlé dans l'épisode de Patrick Martin sur la valorisation complète de la WED c'est que aussi dans le sud ils valorisaient l'huile qui est donnée par les graines dans des produits de cosmétiques etc mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est la technique il y a vraiment comment je vais dire Ouais, c'est plus, t'as raison, c'est plus du patrimoine, un savoir-faire du patrimoine. C'est plus ça, enfin mon ressenti, encore j'ai pas eu tout le monde dans le sud, mais en tout cas, j'ai trouvé que les échanges, tu vois, ce qui en ressort, c'est que finalement, et le nord et le sud, dans cette fameuse quinzaine tinctoriale, je te dis, j'ai mis deux agriculteurs, un du nord, un du sud, globalement, ils ont les mêmes techniques. le seul truc qui change, c'est des dates, c'est-à-dire décalées de trois semaines dans le Nord, parce que ça a eu le printemps qu'on a eu, bon bref, tu vois ce que je veux dire ? C'est clairement ça, ça veut dire que, quand je te disais tout à l'heure, si on voulait là réintroduire le pastel en grande ampleur, je pense que le premier truc qui manque au-delà d'un modèle d'agriculture, c'est la demande. Et aujourd'hui, tu vois, moi qui suis dans un podcast sur la couleur végétale, j'ai... identifié, franchement pas mal d'applications, c'est ce que j'ai présenté à l'IUT de Béthune, t'étais là. ça ne déchaîne pas les foules des industriels. En fait, ils préfèrent toujours les colorants de synthèse qui ne nécessitent pas de culture, même si ça utilise du pétrole, des colorants azoïques, machin, ils préfèrent toujours teindre leurs trucs avec des produits pas forcément clean. Tu vois, un gain de temps, un gain de financier, et on n'arrive pas encore assez à motiver des groupes à se dire, vas-y, on bascule, quoi.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
En fait le problème c'est que, est-ce que motiver les groupes c'est le bon angle d'attaque ? Parce que généralement aujourd'hui les groupes, les industriels, changent leur mode de production quand c'est les consommateurs qui changent leurs demandes. c'est compliqué parce que faire connaître déjà faire connaître au consommateur la web son intérêt etc ça demande un vrai travail de pédagogie
- Charles Giot
Charles déjà faire connaître la couleur végétale aux gens c'est l'objectif du podcast c'est déjà un chemin de fou c'est à dire qu'il y a et en toute humilité moi ça fait que un an et quelques que je sais qu'on peut faire de la couleur avec les plantes. Alors que je suis passionnée de plantes et je suis ingénieure agronome. Donc tu vois à côté de quoi je suis passée. Donc je me dis, si moi, sensible à la plante et aux vertus, je ne le sais pas, je me dis franchement, monsieur, madame, tout le monde, sauf si tu leur apportes l'info. et comment tu peux leur importer l'info ? et bien qu'un gros groupe, je suis désolée moi je le vois aussi de ce point de vue là si t'as, j'en sais rien, un groupe que les gens aiment, des 4 noms ou j'en sais rien, qui te dit ça y est, nous on lance les chaussettes pour les Jeux Olympiques toutes bleues, au bleu de pastel je peux te dire que ça va faire la différence et moi je pense que oui, il y a la réglementation c'est d'ailleurs l'épisode qui sort cette semaine où on parle de toutes les lois qui vont tomber pour les industries textiles où elles doivent trouver des solutions plus vertueuses. Et là, la couleur végétale a son rôle à jouer. C'est une des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, il y a les lois, oui, il y a les consommateurs, mais le temps qu'on fasse connaître tout ça à tous les consommateurs.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
franchement on aura loupé le train je pense on est dans un monde de la communication donc celui qui on est dans le monde des influenceurs mais c'est toujours la même chose il y a un influenceur qui lance l'idée ça démultiplie les partages etc mais déjà allez voir des enfants je parle de manière générale allez voir des enfants, demandez-leur comment on fait de la couleur Déjà, l'idée qu'avec des pentes, on peut faire de la couleur pour des petits enfants, ça les émerveille, mais c'est insoupçonné pour eux. Donc déjà, des lèvres...
- Charles Giot
T'as plein d'auditeurs qui font ça T'as plein d'acteurs là qui suivent le podcast, qui font des interventions dans les écoles, dans les collèges dans les études supérieures d'art d'art, de chimie, de trucs et moi je te dis, j'aimerais pouvoir intervenir dans mon ancienne école d'ingénieur à Lille à l'ISA, j'aimerais aller à l'institut de Genet, j'aimerais en parler il y a Beauvais, il y en a plein en plus et je me dis si chacun voilà, si chacun porte ça et va faire une intervention juste pour qu'on le sache parce que tu vois moi mon podcast c'est bien beau mais pour connaître qu'il y a un podcast sur la couleur végétale bah tu vois il y a encore un chemin à faire c'est-à-dire que ça doit passer d'abord par le bouche à oreille puis que les gens soient intéressés à écouter des épisodes qui durent quand même longtemps une heure sur des sujets spécifiques tu vois mais je me dis il y a peut-être ouais il y a une forme de retourner dans les écoles en parler en fait il y a plusieurs manières d'attaquer le sujet
- Pauline Leroux ArtEcoVert
mais il faut qu'on se mobilise tous c'est à dire qu'il y a l'aspect pédagogique auprès des enfants de toutes les catégories d'âge il y a aussi que la plante est intéressante dans plein de domaines c'est le travail de Patrick Martin de Jean-Marc Montelain il n'y a même pas que la teinture il y a plein de domaines ça emmène plein d'acteurs sur le domaine historique la teinture en elle-même c'est pour ça que c'était beau dans ce projet c'est de voir qu'on peut réunir beaucoup d'acteurs dans le même objectif, c'est de valoriser la WED et d'en faire la planque régionale par excellence. le chemin on va pas s'en dire le chemin il est encore long non mais il faut être honnête on est pas non mais c'est vrai non mais c'est vrai on est les meilleurs mais déjà de voir qu'il y a une impulsion et comme la journée à Béthune qu'il y a des gens qui sont capables de faire un peu de route de se réunir et d'être intéressés de poser des questions oui carrément c'est riche avec beaucoup d'émerveillement moi c'est ce que j'ai constaté moi déjà moi je soupçonnais pas que ça pouvait être possible honnêtement
- Charles Giot
j'étais déjà assez satisfait tu sais moi ce qui m'a oh pardon je te coupe deux secondes ce qui m'a touché moi c'est de voir je le dis aux auditeurs, tu as 22 ans tu es en études d'histoire, tu t'intéresses à ça. Moi, je te dis, j'étais sur les fesses. Les étudiants de Béthune sont tous... Tu vois qu'ils sont intéressés. Ils sont tous venus entre leurs cours venir écouter ce qu'on était en train de se dire, alors que, franchement, on voit qu'il y a un intérêt de la jeune génération. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants en design, d'étudiants qui s'intéressent à ça. Et je me dis, en fait, il faut réussir à donner la parole. plus aux jeunes. C'est pour ça que j'étais hyper contente que tu viennes, parce que je me dis, tu vois, comme je t'expliquais, moi j'ai quand même des intervenants qui sont plus âgés, d'avoir la jeune génération, des étudiants, je trouve ça top, et c'est ça qu'il faudrait, c'est donner un peu plus la parole à ceux qui sont en train de faire des mémoires de fin d'études, des thèses, des trucs sur ces sujets, montrer que la jeunesse, elle s'y intéresse, et que c'est pas le pastel, la plante de vieux dont on parle dans les vieux traités qui sentent le moisi, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi, quand tu parles de traités d'agronomie...
- Pauline Leroux ArtEcoVert
il y en a plein qui disent ça n'a l'air pas du tout intéressant oui et d'où l'idée même moi de la cultiver la plante des gens viennent chez moi, je me mise à leur montrer et puis même des agriculteurs justement et qui ne connaissent pas du tout et vu que c'est de la même famille du sou fourragé, j'arrive toujours à raccrocher sur les valeurs nutritionnelles et ça éveille toujours des questions, des curiosités parfois on me demande comment ça pousse tout bête, mais de fait je suis content à mon échelle de connaître un peu la plante Et bon, même tout simplement, quand on est plus jeune, après on en parle entre nous. Et puis bon, tout bêtement, la jeunesse, c'est un peu l'avenir de cette génération qui se construit. Et s'il y a une génération, même sans leur faire aimer totalement le pastel, et qu'ils pensent toujours au pastel, si au moins ils connaissent la plante, et qui savent qu'avec ça, on peut faire telle et telle chose, plus tard, si un groupe émet l'idée, on le passe telle, c'est comme ça qu'on crée une impulsion. Il n'y a pas de secret.
- Charles Giot
Tu sais ce qui crée aussi l'impulsion dans la couleur végétale ? C'est un biais très particulier, c'est la sérigraphie. Le fait de se faire des messages, des motifs sur des t-shirts, etc., c'est dans ces domaines-là où j'ai rencontré la plus jeune frange des auditeurs. Et dans mes auditeurs, j'ai beaucoup... d'hommes hyper jeunes. En fait, j'ai des femmes de 35 à plus âgées. Par contre, les jeunes de 18 à 25 ans, ce sont des hommes, et c'est pour la sérigraphie qu'ils viennent écouter le podcast. Donc, je me dis, tu vois, côté cible masculine, donc études, etc., je repense aux écoles, machin truc, je pense qu'il y a deux angles d'attaque. Il y a l'angle sur la sérigraphie, dire qu'on peut faire de la sérigraphie avec des plantes. que c'est des procédés qu'on peut, même maintenant, les cadres de sérigraphie se font naturellement et sans produit chimique. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant de le dire. Et côté cible féminine, c'est plutôt par les plantes. Le truc qui les branche, c'est de se dire Ah bon, une plante peut donner la couleur, je peux le faire chez moi, à la maison, tu vois ? Et en fait, je me dis, il y a quand même deux angles d'attaque, mais c'est intéressant de se dire que, oui, oui, les jeunes hommes, c'est la sérigraphie qui les branche.
- Pauline Leroux ArtEcoVert
tu vois comme quoi les stats des fois ça sert à quelque chose pour le coup oui parce que l'on peut cibler son public et puis on voit quand même ce qui marche et ça permet de mieux comprendre quand même le phénomène non mais ça ça dit bon
- Charles Giot
Est-ce que tu as encore des choses à nous raconter sur la période que tu...
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Au niveau historique, moi, tout est dit. Je me permets de relire. Moi, j'ai bien fait un bon panel.
- Charles Giot
Est-ce que tu veux rajouter des choses sur le projet Anamorphose, le projet Valoued ? Est-ce que tu as des besoins ? Est-ce que tu as des... des appels du pied à faire pour, je ne sais pas, des aides, des infos, des témoignages ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour t'aider dans ton travail ?
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Forcément, on ne va pas lancer non plus un appel du 10 juin, mais c'est presque pour l'idée du comité qui nous est donné du recul. De toute façon, toutes les bonnes ondes, les bonnes armes volontaires sont les bienvenues, déjà au niveau régional et même... dans l'idée de continuer avec cette histoire de l'isatistinctoria. Alors moi pour ma part, les 300 heures, c'est fait clairement. Là c'est plus à titre personnel où j'achève un peu mon travail, et puis par curiosité où je me dis que je vais aller aux archives nationales, je vais aller un petit peu plus loin. De même que la synthèse, la synthèse c'était pas du tout le projet à la base, c'est encore quelque chose en plus. donc voilà donc moi j'en suis un peu j'achève tout ça je fais des corrections etc je fais des cartographies donc c'est un petit peu la fin alors après je sais pas comment on va présenter le sujet à la fin si on va publier quelque chose il y a l'idée d'un article qui se trame c'est
- Charles Giot
ce que j'allais dire comment tu vas restituer tes résultats du coup ?
- Pauline Leroux ArtEcoVert
tu auras la synthèse avec l'état de l'art mais alors Patrick Martin voulait qu'on fasse un article dans la revue A2U apparemment ça va se faire alors après c'est en construction Après moi je ne sais pas si je vais continuer dans le comment on va transformer la chose etc. Si on va continuer même sur un autre plan. Après j'ai mon M2, j'ai mon mémoire et puis même un site personnel et puis je lis un ouvrage etc. Donc il y a toujours plein de choses qui se font. Mais je ne veux pas abandonner comme ça la web de Pastel, je veux quand même rester connecté à tout ça. Donc si je peux même de manière ponctuelle intervenir dans différents domaines.
- Charles Giot
Tu sais ce que j'allais dire ? Bon, on coupera cette partie-là, mais moi, je veux bien que tu travailles, en fait, que tu montes le tableau Excel comme tu aimerais qu'il soit rempli. Moi, je vais le mettre sur le Patreon d'Arrécovert. Tu sais, j'ai 180 membres qui sont, pour le coup, vraiment passionnés. Parce que comme c'est payant, tu vois, ne se retrouvent pas là des gens qui n'en ont rien à faire. Pour leur... En mode document ouvert ou de partage à compléter. Donc ça, on pourrait faire comme première action. Et ensuite, il y a... En octobre, il y a la deuxième vague de la quinzaine de l'agriculture pictoriale. Où on parle... de certains sujets et je me dis est-ce que ton travail serait fini à cette période-là et est-ce que tu voudrais intervenir je ne sais pas 15-20 minutes ça dépendra le temps que tu as besoin mais pour venir parler de cette partie historique sur l'étude d'une plante tu vois et montrer un peu la jeune génération qui vient prendre le relais ça tu vois moi je sais qu'en octobre c'est du 14 au 18 donc du 14 au 18 et pour l'instant j'ai quelques je suis en train de construire mon programme on va le dire clairement donc je me dis que tu vois sur le pastel qui quand même a déchaîné les foules la première session avec Michel Garceau qui en parlait c'était vraiment génial et ensuite il y a eu donc les deux Patrick et Jean-Marie de Bleu de l'Ectour et Bleu d'Amiens. C'était passionnant. Et je me dis, tu vois, ce serait encore top de faire un point sur l'histoire. On aura vu la chimie, l'agriculture, et là, on fera l'histoire. Ce serait vraiment cool. Donc voilà, ça, ça peut être fait. Donc, cette histoire de tableau Excel, ok. Est-ce que tu aurais besoin d'autres choses ?
- Pauline Leroux ArtEcoVert
À vrai dire, non. Là, après... ça fait que des recherches personnelles le tableau de sel c'est vraiment le document en commun par excellence mais j'ai pas de demande et puis bon après moi il faut voir comment on va s'organiser avec Patrick Martin ouais ouais tu me diras de toute façon demande à Patrick d'abord bon
- Charles Giot
bah écoute on va clôturer on va se dire au revoir enregistré et je te garde pour te dire d'autres trucs ok bon bah écoute est-ce que Charles t'as d'autres choses à ajouter ou est-ce que c'est bon pour toi
- Pauline Leroux ArtEcoVert
Non, c'est bon pour moi, puis j'espère que ça vous a beaucoup plu, que vous avez appris des choses sur le pastel, et puis maintenant quand vous entendrez parler de la plante, vous direz qu'une plante a une histoire, une histoire qui peut être un peu complexe, mais qui est parfois réjouissante dans le sens où ça nous fait voyager, ça nous fait voyager, puis ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les modes de culture, dans le sens où les hommes de culture, les méthodes de commerce. Et voilà, on oublie trop souvent qu'une plante ça peut rapporter beaucoup d'argent, et Toulouse dernière en a fait les frais, et ça peut aussi faire tomber de très haut justement. Et parfois c'est compliqué de réintroduire une plante, et c'est pas forcément qu'aujourd'hui on peut avoir des difficultés, il faut beaucoup d'énergie, déjà sous le premier empire un homme qui s'appelait Napoléon il a eu beaucoup de difficultés à la faire, donc justement, bon faut pas dire qu'on est au même niveau que Napoléon, mais... Mais ce n'est pas d'aujourd'hui et on est vraiment dans une démarche qui est aussi historique quand on va introduire du Zist. Le but de ce projet de travail sur l'histoire de la plante, c'est de faire un aspect complémentaire et aussi de prouver qu'on s'inscrit dans une démarche qui prend ses racines depuis l'époque médiévale.
- Charles Giot
top bon bah écoute Charles un énorme merci d'être venu on se tient au courant pour la suite parce qu'il y aura une suite en tout cas je vois que toi tu resteras passionné de ce sujet un grand merci à toi ciao hop alors j'ai Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram ArtEcoVert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous ! Savoir si vous allez aimer, les mots clés du podcast ArtEcoVert : teinture végétale plantes tinctoriales indigo garance encre végétale couleur végétale colorants végétaux pigments végétaux coloration capillaire végétale fibres naturelles colorants biosourcés tanins teinture naturelle plantes artecovert couleurs de plantes design végétal couleur jardin agriculture tinctoriale indigo tendance innovation nuances indigo