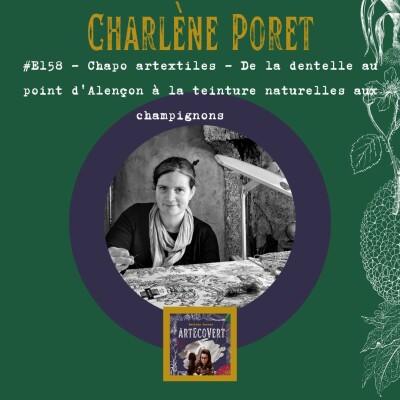Michel GarciaJe te remercie Pauline pour ce forum parce que c'est très intéressant je trouve d'avoir autant de points de vue parce que finalement c'est un sujet à tiroir, c'est un sujet à multiples facettes et donc à nous tous on a beaucoup plus de perdus bien sûr pour y voir davantage et ça illustre bien aussi cet aspect qui me tient à cœur à moi, c'est la vision holistique d'un sujet pareil. C'est-à-dire que si on perdait de vue le côté écologique ou le côté... de la biologie, même de la botanique et d'autres aspects scientifiques encore, on deviendrait des hyper spécialistes et du coup on tomberait dans tous les pièges de nos prédécesseurs. Vous savez que la couleur végétale, vu du poids du petit bout de la lorniette européenne, si on peut dire, elle a été à plusieurs reprises centrée sur le franco-français. Il fallait le produit français, le riz-tâtre, c'est l'abourrage. le pâturage, les deux mammelles de la France. Donc, il fallait relocaliser. L'indigo tropical arrivait à cette époque, mais on ne le saurait que par le pastel, etc. On comprend très bien, dans les temps troublés dans lesquels nous sommes, qu'il y a toujours cette tentation, évidemment, d'éviter l'hémorragie économique, si on peut dire, en achetant tout à l'étranger et en se retrouvant, disons, dans une balance commerciale déséquilibrée. Donc de là, on est passé historiquement à une autre vision, c'est-à-dire la demande absolument incroyable de susciter les merveilleuses de l'industrie. On parlait par millions de tonnes, donc là on n'en était plus au labourage et au pâturage, là il fallait voir les choses différentes. Ça a été une délégitimation de la colonisation en quelque sorte, donc il fallait chercher des ressources partout, du pillage. Et dans les terres, disons, on pourrait dire un peu neuves, comme les États-Unis, on n'a pas hésité à littéralement éradiquer des ressources précieuses. Le chêne Kercitron, par exemple, a payé du prix de son existence, le développement de l'industrie américaine. C'était un jaune, quand on regarde de plus près, il contient un colorant finalement relativement ordinaire, la Kercitrine, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres plantes. À ce moment-là, cette Kercitrine, elle est en... en quantité considérable. Et on a commencé à définir les plantes panctoriales comme étant des plantes qui contiennent des colorants d'intérêt en très grande abondance, ces plantes étant elles-mêmes très disponibles. Alors l'agriculture, elle a joué un rôle très important dans ce secteur, mais il faut bien le dire, on a cultivé ce qu'on considérait comme étant le meilleur. Alors traditionnellement, je vais reparler de la France, mais plutôt de l'Europe, c'est plus juste de parler d'Europe de nos jours. La garance fournissait le rouge végétal le plus solide, le plus beau, et donc les Pays-Bas ont cultivé la garance à une échelle considérable, et puis l'Allemagne aussi, la France bien entendu, surtout le Sud, et là on les a fait ces millions de tonnes. Au prix de l'épuisement des terres, au prix d'une monoculture qui a effectivement été beaucoup controversée, les gens, à l'époque où il n'y avait pas de véhicules motorisés, les gens manquaient de pain parce qu'il y avait trop de terres allouées à la garance et pas assez de terres vivrières. Donc cet équilibre qu'on a un petit peu négligé au niveau du prélèvement des ressources sauvages, Il s'est retrouvé aussi au niveau de la culture. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait cette étude, si on pourrait dire, de disponibilité à l'époque de Spindigo dans les années 2003. Et puis, par la suite, si on ne devait faire que du végétal au niveau du tinctorial, sans parler des beaux-arts et autres. il faudrait 10% des terres cultivables du globe. Donc ce n'est pas possible. Pourquoi ? C'était déjà une horreur à l'époque de la colonisation. Après la Révolution française, il y avait à peine plus de 700 millions d'individus sur Terre. Aujourd'hui, il y a 8,2 milliards, donc on est beaucoup plus que 10 fois plus. Même si les technologies étaient vraiment balbutiantes à l'époque de la Révolution, il faut bien s'imaginer qu'un facteur de 10, c'est énorme. Donc voilà, la place même de la couleur végétale dans le monde. Elle est à discuter. Parce qu'est-ce qu'il faut des objets de consumérisme ? C'est quelque chose d'important. Je me souviens, donc, ces travaux que j'ai pu faire avec des collègues qui font un travail remarquable, Trade of Life, qui font un travail remarquable sur la valorisation du patrimoine local de l'Indonésie. Et donc, le Simplocos, une variété de Simplocos, Simplocos coccinensis, avait un... un rôle crucial, historique, dans l'État traditionnel. Et donc, il était plus ou moins négligé quand Trade of Life s'y intéressait. Donc, c'était extrêmement noble et beau de redévelopper ça, de dire aux gens, ne cultivez pas, ne coupez pas ces arbres. Entretenez-les comme une culture, en fait, une sorte d'arbre, d'arbre culture. Entretenez-les et ramassez les feuilles tombées, parce que le jour où vous le couperez, il n'y aura plus aucune feuille, bien sûr. Vous aurez peut-être un bois de charpente ou autre, mais tant qu'il sera vivant, il vous donnera quelque chose. C'est l'image de la Noix-de-Galle également, les Noix-de-Galle d'Alep en Syrie, en Turquie et dans tout le Proche-Orient. Évidemment, il ne faut surtout pas abîmer les arbres parce qu'on aura des galles tout le temps que ces arbres vivront. Donc ce sont de belles images, des images de pérennité. Et aujourd'hui, je pense que le premier critère qui nous intéresse, c'est le critère... durable. Vous savez tous que bien sûr le bois de Brésil était un bois extraordinaire donc ces alpiniens et quinatas extraordinaires trouvés par les portugais sur les côtes du Brésil et donc il a très très vite remplacé le bois de sapin qui arrivait d'encore plus loin et qui était plus cher en quelque sorte et donc on a littéralement démoli toutes les forêts du Brésil l'arbre aujourd'hui est en danger, il est menacé. C'est très difficile de refaire des forêts une fois qu'on les a coupées. Et le problème se pose encore, je dirais aujourd'hui, d'une façon aiguë avec le Ngalama, le boulot d'Afrique. C'est la base du Bogolan ouest-africain. C'est un peu le mordant canique, si on peut dire, sur lequel on fait tous ces dessins. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'en voulant encourager les artisans et les artistes d'Afrique de l'Ouest. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé là-bas avec le professeur Andari. On avait donc proposé aux artisans locaux de financer ou de co-financer de la mise en culture de ces arbres. Et on leur a dit, vous ne voyez pas tout de suite, mais dans 20 ans, vous aurez presque tout coupé parce que vous ramassez les feuilles. Déjà, effeuiller un arbre au Sahel, c'est compromettre un peu, évidemment, son existence. Mais... Vu la pression sur une ressource rare, vous coupez les branches pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas le temps d'effeuiller les feuilles sur place. Et donc, on mutile maintenant de plus en plus, et donc l'arbre devient rare. Et qu'est-ce qui va se passer ? Encore une avancée du Sahara. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement ces salauds de colonisateurs qui ont fait dans le passé des choses irrémédiables. C'est un réflexe naturel de dire, bon, ma situation familiale s'est améliorée depuis que je fais de l'artisanat. d'art, disons, je ne le fais pas seulement pour une nécessité ménagère d'avoir des textiles à la maison, je le fais pour un export. Il s'est créé un marché. Donc finalement, j'ai une plus grosse demande de matériaux parce qu'il y a une plus grosse demande de mon art. Et voilà, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et donc, c'est l'histoire de la juste mesure. La place à la couleur végétale, c'est extrêmement important. En Asie, c'est les mangroves, vous savez, les mangroves qui retiennent la mer par rapport au tsunami, qui protègent les côtes des raz-de-marée et autres. Si on coupe ces mangroves, on coupe finalement, il y en a aussi en Afrique et aux Antilles, des mangroves et ailleurs. Mais si on coupe cette protection, parce que ces arbres contiennent des taux extraordinaires de tannin, le critère de l'abondance n'est pas le seul critère. Je dirais qu'avant toute démarche, il faut regarder, de s'intéresser bien sûr à des plantes qui contiennent assez de colorants et que ces colorants soient intéressants. Parce qu'on va cultiver, je dirais, nos plantes, mettons le recoup, il y a son rôle à jouer dans la cosmétique, parce qu'on ne se maquille pas pour les six prochaines années à venir. On renouvelle le maquillage, donc les problèmes de durabilité ne sont pas les mêmes que ceux du textile. Mais voilà, ça va concerner des niches de marché, mais dès qu'on voudra l'étendre au textile, on aura des problèmes de solidité. parce que ce sont des absorbeurs d'UV qui vont se détruire au contact des UV progressivement. La plante y trouve son intérêt, mais nous, pour le textile, on veut que ça dure, le textile. Que la couleur se maintienne un certain temps. Les exemples pourraient être multipliés. Il faut très bien choisir quelles plantes on va exploiter, dans quelles mesures, et lesquelles on va cultiver, parce que c'est une question aussi de performance. Alors, durable... qualitatif, bien entendu, et patrimonial, parce que ce qui convient à un endroit du monde, je ne vais peut-être pas prendre d'exemple, parce que je ne vais pas me substituer aux intervenants, mais disons qu'une plante locale, même endémique, qui n'est pas spécialement rare, mais qui est endémique quand même, et qui serait liée à une pratique locale extrêmement emblématique. Pourquoi priver les... les natifs de cette ressource. Je pense au Mexique, quand j'étais, puisque j'ai rencontré par visio ma collègue mexicaine tout à l'heure, quand je suis allé à Oaxaca, on a discuté des plantes accumulatrices d'aluminium. Et alors, il y en a une qui s'appelle la lengua de vaca, la langue de vache. Alors, le nom populaire, vous voyez, j'ai demandé à plusieurs personnes, est-ce que vous connaissez la lengua de vaca ? Oh oui, oui, voilà. Alors, on me montrait un... un rumex, on me montrait un arbuste de tel et tel. Et en fait, ce que je cherchais, bien sûr, c'était le Miconia argentea. Mais enfin, comme chaque vache a sa langue, vous voyez, c'était un petit peu compliqué de tomber d'accord avec des noms populaires. Mais on a très vite identifié la ressource et on s'est dit, c'est une plante remarquable. Elle sert de mordant dans des régions où on n'a pas celle d'aluminium ou autre, pour stabiliser les couleurs. Mais alors, si ça venait... à se développer. Et s'il y a des gens qui prenaient l'idée de commercialiser ça, parce qu'il y a un business, un loisir énorme avec la couleur végétale, il y a du consumérisme, tout le monde veut s'amuser, faire de l'art avec... Alors qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à couper, à exploiter ces arbres. Il faut que ces arbres restent, comme on pourrait dire, la propriété morale, philosophico-morale, culturelle, patrimoniale des artisans locaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais en utiliser. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de les utiliser. Donc, vous voyez, il y a une dimension déontologique à rajouter à tout ça. Et donc, ce qui est très bien pour l'un n'est pas forcément approprié pour l'autre. Donc, une pratique telle que la teinture végétale, elle est patrimoniale. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors l'indigo qui est complètement mondial et tout ça. Oui, on ne peut pas toujours généraliser et on ne peut même jamais généraliser. Mais l'indigo est un exemple de culture, la plante la plus cultivée au monde. Oui, effectivement. Alors là, on va aborder un autre aspect. Je vais très vite parce que je vais devoir partir, j'ai une autre vision derrière. Excusez-moi, c'est un peu cavalier. Mais du coup, il y a un autre aspect, c'est cette dimension de covalorisation. Vous savez qu'en France et dans pas mal d'autres endroits d'Europe et du monde, on s'intéresse bien entendu... Au co-valorisation, c'est-à-dire que je cultive déjà une plante, mettons une plante légumière ou fourragère, ou une plante d'intérêt agricole avéré, et voilà qu'elle engendre beaucoup de déchets. Et ces déchets, il se trouve qu'ils ont des colorants. Alors, s'ils en ont insuffisance, ça paye l'extraction, et donc ça peut être très intéressant. Mais il y a d'autres intérêts, disons, on va dire des intérêts conjugués. C'est par exemple quand la plante améliore le sol. Alors l'indigotier, c'est typiquement une plante qui améliore le sol. Pourquoi ? Elle fait une mycorhize, c'est-à-dire qu'elle s'associe avec des micro-organismes du sol pour apporter de l'azote dans la terre. Et donc une terre pauvre dans laquelle on va cultiver de l'indigotier, elle va s'enrichir progressivement en azote. Et donc on pourrait dire à cet égard que... Un indigotier est une plante pionnière qui va enrichir le sol pour d'autres cultures. Donc, c'est la notion d'assolement que tous les agriculteurs connaissent. On ne va pas faire une monoculture pendant trop longtemps au même endroit, bien sûr, vu que si on a bonifié le sol, c'est pour y mettre autre chose. Il y a d'autres plantes moins bien connues. Par exemple, le datisca. Le datisca, c'est une plante vivace d'une petite famille pas très connue. Les datisca, c'est bon. C'est une endémique de la crête qui a été transportée dès l'âge du bronze dans plusieurs régions du monde pour sa valeur pictoriale jusqu'en Inde. Et donc ce datiscaille, il rajoute de l'azote dans le sol également. C'est très intéressant parce que la plante est vivace, donc on peut la garder quelques années. Et quand on l'exploite, les feuillages contiennent un très beau jaune, très solide. La datiscaïne, c'est un peu comme la morine du murier. Mais il vaut mieux planter des datiscaïnes que des muriers. Parce que couper un arbre pour avoir son bois de cœur, c'est quand même quelque chose. Et le murier des Tinturiers a beaucoup souffert aussi. l'industrialisation, bien sûr. Là, c'est des colorants assez similaires par leur structure, mais la plante est une herbacée qui rejette à 3-4 mètres de haut, et on peut la couper, elle repoussera, et la racine est encore plus riche que le reste. Donc, voilà. Donc, cultiver, ça veut dire aussi penser un petit peu dans un paysage agricole, un paysage où la plante fait partie de l'assolement, finalement. Donc voilà, ce sont quelques pistes, c'est assez difficile de résumer tout ça, mais je voulais aborder un dernier aspect aussi, c'est celui de la façon dont on va utiliser ces colorants. Alors, je dirais que c'est assez dommage de passer à côté d'une ressource précieuse, mais ce n'est pas toujours facile d'encerner les contours, parce que les... Le synonyme de végétal, c'est vraiment diversité. Il y a 280 000 plantes vasculaires dans le monde, des espèces sans compter les variétés. Sur ces 280 000 plantes vasculaires, il y a environ 10% qui contiennent des quantités significatives de colorant. C'est énorme, ça veut dire qu'on a potentiellement 28 000 plantes utilisables en teinture. Oui, potentiellement seulement. Parce que là, c'est à la notion de criblage que je voudrais arriver, parce que finalement, on est devant un très vaste potentiel, mais si on y adapte tous les critères qu'on a déjà abordés, le critère identitaire, patrimonial, rare et précieux, il devrait être laissé seulement aux populations en place, si on peut dire. Le critère de solidité. Le critère d'abondance, parce qu'à quoi bon avoir deux semi-remorques au plein d'une plante pour en sortir quelques grammes de couleur ? Ça ne paye pas évidemment ni la transformation, ça ne légitime pas le massacre, la dépense énergétique, etc. Donc une plante qui a des colorants d'intérêt au niveau qualité et solidité, une plante qui a une certaine concentration de ça, une plante facile d'obtention, que ce soit ramassage, entretien, culture, covalorisation, tout ça, ça tourne autour. Il y a la question des savoirs. Vous savez, il y a un des pièges les plus terribles que j'ai rencontré dans le monde de la couleur végétale depuis que je m'y intéresse. Je suis sur mes 70 ans, je suis tombé dans à l'âge de 17 ans par pur hasard, mais il y a eu une rupture quand même. J'ai dû gagner ma vie, j'ai un peu abandonné à une époque. J'ai eu l'occasion finalement de voir différentes choses. Le pire piège, c'est de se dire qu'il y a les plantes de grand teint et les plantes de petit teint. Ça semble se légitimer par le fait que, par exemple, certains caroténoïdes sont si fragiles comme ceux du safran que ce serait vraiment dommage de faire toute une collection, mettons, de foulards précieux teints au safran, puisque si je les mets à la lumière, en quelques heures, la couleur disparaît. Donc ça, on va dire oui, d'accord, petit teint, on comprend par rapport à... au réséda pour des jaunes qui tiennent. Bon, d'accord. Mais c'est un petit peu plus délicat que ça parce que finalement, même dans des plantes qui ont des structures relativement stables, si je ne sais pas y faire, je n'aurai pas systématiquement quelque chose de bien, quelque chose de bon. J'ai ma meilleure garance, je la confie à 3, 4 ou 5 d'entre nous, on aura 5 résultats différents. On n'aura pas forcément les mêmes solidités. la même qualité de couleur, la même densité, parce que tout le monde aura une approche un petit peu différente, et puis il y en a qui passeront un peu à côté de la bonne opportunité de stabiliser le colorant. Donc il y a cette dimension de savoir-faire qui est très importante, et il faut vraiment communiquer sur cet aspect multiple des savoir-faire aussi, parce que finalement, si on se contente de recettes de base, On va classer les bons et les mauvais en se disant que les mauvais, c'est ceux qu'on ne sait pas utiliser finalement. Mais ça ne les rend pas mauvais pour autant. Il y a finalement un tout petit peu de biologie, un tout petit peu de botanique, un tout petit peu de phytochimie. Ça nous éclaire sur cet aspect-là. J'ai récemment travaillé sur un sorgho. On pourrait se dire, oui, puisqu'il existe du sorgho rouge teinturier, tous les sorghos iront très bien comme ça à partir du moment où il y a un peu de rouge dessus. Mais il y en a qui contiennent donc un colorant, beaucoup d'entre eux contiennent un colorant lapigénidine, qui n'est pas aussi facile à utiliser que la luthéolignidine, le colorant le plus stable du genre sorgho. Et du coup, il y a une astuce, il faut combiner ça avec certains tannins. Sinon, la couleur n'apparaît même pas sur le tissu. Donc, il ne suffit pas d'avoir un sorbo dont le nom du genre, il faut avoir la bonne espèce. Et si vraiment on ne l'a pas, mais qu'on a tout ce qu'il faut parce qu'on fait du fourragé et que là, du déchet fourragé, on en a plein, plein, plein. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Mais alors du coup, il faut développer des savoirs spécifiques. Il faut comprendre que là, du coup, il y a une recette. très spéciale pour ce sorgho qui ne sera pas la recette pour n'importe quel sorgho et ainsi de suite donc on rentre dans un monde immense c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde parce qu'il y en a qui vont se trouver un peu plus la fibre phytochimie végétale sur mon vignage je suis un peu dans ce cas là je m'intéresse de plus en plus à ces combinaisons à ces copigmentations on dirait bien sûr c'est le gros manque parce que quand on est atelier on s'en fiche un peu de tout ça parce que On n'a pas le temps. On a un travail déjà délicat. On a un travail qui est très préprenant. Voilà. Un pharmacien, il n'a pas le temps de faire de la couleur végétale. Pourtant, enfin, pas tout le monde, puisque Henri en fait quand même. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément dans sa vocation première. Lui, il fait des médecines, etc. Et donc, en fait, les passerelles entre les mondes, je dirais que c'est ce qui nous manquera le plus aujourd'hui. Et là, on verra les choses avec un regard neuf. Et je vais juste finir en présentant, vous connaissez ce bouquin, ce livre de Dominique Cardon, qui est un très très bon bouquin. Là, les plantes du patrimoine, vous les avez. Les plantes qui ont une histoire, une belle histoire par rapport au peuple. On pourrait bidouiller deux, trois pages de plus, etc. Laissons le son à l'auteur de le faire, parce que c'est déjà une somme. On avait besoin d'une somme pour parler de patrimoine. parler de ces connaissances. Aujourd'hui, pour covaloriser des déchets, on n'a pas besoin de ça parce qu'il y a des tas de plantes qui ne sont pas dans ce livre parce qu'elles n'ont aucun intérêt patrimonial, parce que ce sont des redécouvertes ou des visions orientées vers cette possibilité de revaloriser. Et là, du coup, il nous manquera quelque chose. Il nous manquera de nous repérer un petit peu. La botanique va nous dire un peu déjà les probabilités de ce qu'on peut trouver dedans par famille. Donc, on ne doit pas être complètement réfractaire à cette botanique moderne, puisqu'elle est prédictive en fonction du lien de parenté génétique, si on peut dire, entre les familles. On a déjà une forte probabilité d'y trouver plutôt une chose ou une autre. Ça, c'est important. Je vous prends l'exemple, l'ordre botanique des cariophilages. C'est un très très gros or. Il y a 10 000 espèces de plantes là-dedans. Et donc c'est quand même très important. Les cactus, les amarantes, les chénopodes, voilà, beaucoup de choses. Mais là, la botanique nous dit qu'à un moment donné de l'histoire biologique, il y a une petite branche de plantes qui s'est développée en développant des stratégies originales. Elles ont fait des colorants azotés très spéciaux, basés sur l'azote. qui sont finalement des colorants ioniques, c'est-à-dire chargés électriquement, les bétalaïnes. Ils sont chargés électriquement, ils aident la plante pour tout un tas de trucs, au niveau de son énergie, etc. Ce sont des sortes de photopiles, en quelque sorte. C'est très très bien du point de vue de la plante, mais pour nous, ce n'est pas très bien. Parce qu'une pile, le problème qu'elle a, c'est qu'elle se décharge si personne ne la recharge. Et ces colorants ioniques, il y a une deuxième... catégorie que tout le monde connaît, ce sont les anthocyanes. C'est beau les couleurs des fleurs, c'est beau les couleurs des baies, vous savez, les myrtilles, les mûres, etc. Mais ce sont des colorants chargés électriquement. Ils se déchargent. Je vous fais une métaphore, s'il y a des vrais chimistes, ils trouveront ça un peu abusif, mais il faut bien faire des métaphores. Ça se décharge et donc ces couleurs feignent très vite et elles sont versatiles. Le teinturier est balotté, alors il a fait un joli vert avec des anthocyanes et puis voilà. Elle tourne au rose dès qu'il fait une tache dessus, puis ça retourne au gris dès qu'il le lave. Et voilà, donc c'est très difficile, un colorant qui n'est pas fiable. Il n'est pas contractuel. Ça peut aller pour un artiste, chacun fait ce qu'il veut, mais si c'est pour être conforme à un catalogue, vous imaginez, si un catalogue c'est vert, et vous le recevez, le premier accident que vous avez, virou rose. Donc, un petit peu de chimie, un petit peu de ces connaissances. Donc, la botanique nous apprend ça. Cherchons au bon endroit. À partir d'une plante donnée, on sait forcément qu'elle appartient à un groupe, et qu'on peut en déduire déjà. Mais il y a d'autres aspects de la vie. qui nous montre, par exemple, comment on pourra extraire ces colorants. Ces colorants, ils voisinent aussi dans la plante avec des quantités d'autres choses. Des fois des colorants, et puis des fois des choses qui pouvaient être indésirables. Alors, je prends l'exemple, je ne sais pas moi, des pots d'agrumes. J'utilise beaucoup les pots d'agrumes pour les pectines. C'est très bien pour monter des cuves d'indigo, par exemple. C'est des réducteurs remarquables. Alors, je mange ces gros pamplemousses chinois, vous savez, les gros gros, là, d'hiver. Je garde les peaux et avec ça, je l'entretiens ou je monte les cuves d'un petit pot. Voilà. Mais périodiquement, on me dit, ouais, mais il y a de la couleur là-dessus. On ne pourrait pas extraire la couleur. Oui, bien sûr. Alors, elle n'est pas soluble dans l'eau. Et donc, il faut l'extraire. On ne va pas commencer à aller chercher des semi-remorques d'alcool pour faire une activité industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre... un alcalie, un petit peu de cristaux de soude, vous voyez, ça se dissout très bien. Seulement, voilà, on sort aussi les pectines, et quand on récupère le bain colorant, on a une espèce de gelée énorme, avec trois molécules de couleur qui se battent en duel. Voilà, donc la composition des plantes joue aussi un rôle. Voilà, donc alors, pour que j'arrive à faire une petite synthèse de tout ce que je vous ai dit là, nous soyons très vigilants pour la sélection des plantes à cultiver. Inscrivons-les dans le vraisemblable. On est dans un monde de consumérisme, on va acheter des t-shirts, on va jeter... On nous les offre même sous forme publicitaire ou autre, tellement le travail humain ne vaut rien dans certaines régions. Ce qui est absolument à dénoncer et à surtout pas cautionner. Donc le monde du consumérisme, il ne faudrait pas qu'il gagne la couleur végétale. Parce que finalement, comme on parle de slow food, on pourrait parler de slow fiber, on ferait attention. à nos choses, à nos affaires. C'est précieux, il y a un respect. Vous voyez, un peu comme les peuples mésolithiques, un peu comme les peuples amérindiens où on remerciait la Terre avant de prélever ce qui nous était nécessaire. Et seulement ça, quelque part, c'est une image, c'est peut-être une métaphore pour le monde d'aujourd'hui qui ne permet plus ça aussi facilement. Mais n'empêche que c'est quand même un petit peu ça, de ça qu'il s'agit, la sobriété. Donc le développement durable, la chimie verte. sont basés sur la sobriété. Donc, cultivons de notre mieux les meilleures choses pour éviter des surdépenses en eau, en énergie, pour l'extraction, bien sûr. Apprenons surtout à s'en servir du mieux que l'on peut. Et moi, il ne me restera pas beaucoup d'années, je pense, à travailler là-dessus, parce qu'il y a le poids des gens qui se fait sentir, et puis, voilà, on n'est pas en bronze non plus. Mais ce que j'aimerais faire, là, je reprends un petit peu l'analyse par chromatographie. Grâce à certains collègues, j'ai eu la chance d'être initié à cette technique d'analyse. Une plante, d'abord, cette technique vous montre la composition d'une plante. Une plante n'est pas une molécule chimiquement pure. C'est un ensemble de choses incroyables qui interagissent dans la plante. Et nous, on va tout démonter et on voudrait remonter une couleur en rajoutant des éléments comme des mordants, des tannins. des acides, des bases, etc. Mais on ne la remonte pas comme elle est dans la plante non plus. Alors, un tout petit peu de phytochimie, la CCM nous montre, nous trie les molécules par polarité, c'est-à-dire nous les décrit comme une échelle à barreaux, les couleurs les plus solubles se retrouvent en bas, les moins solubles se retrouvent en haut. Donc, on a une idée de la polarité des colorants, on a une idée de la nécessité aussi peut-être de traiter un tout petit peu. petit peu la plante d'une façon ou d'une autre. Il y a des plantes qu'on torréfie légèrement avant de s'en servir comme le Sophora, il y a des plantes qu'on va laisser cramper pour laisser les enzymes travailler, etc. Donc il y a tout un savoir-faire à défendre parce que défendre une flore, surtout une flore endémique, mais défendre la flore c'est défendre aussi les savoirs qui sont associés à cette ressource. La ressource n'est pas qu'une ressource monétaire, bien sûr, ou une ressource identitaire, c'est aussi l'ensemble des savoirs associés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce monde des passerelles, avec la biologie, la phytochimie, la botanique, etc., Il se fait ressortir d'une façon spéciale pour éviter justement de faire des erreurs. J'ai vu récemment quelqu'un qui a fait une grosse extraction pour faire un extrait de sorgho, mais il s'est trompé de sorgho. J'ai vu il y a quelques années quelqu'un qui ne voulait pas rentrer dans le monde des variétés, des espèces et tout ça. Il avait commandé des graines de Reseda, sans préciser, il a eu du Reseda luthéa. Il a fait trois hectares de résidence littérale qui ne lui servait à rien du tout. Parce que ce n'est pas le tinctorial, ça en est un autre. Et donc il a payé cher son erreur. Et des erreurs comme ça, le plus terrible, c'est que parfois, elles sont légitimées par de bonnes causes. Je me souviens de m'être passionné pour les tapis marocains, et ça m'intéresse toujours bien sûr, et leur histoire. à une époque de l'histoire du protectorat français, qu'on peut contester, ce n'est pas le cœur du sujet là, bien sûr. Mais l'idée, c'était de survaloriser des produits authentiques et de mettre une espèce de label, un plomb d'authenticité sur des tapis qui avaient été faits de manière absolument traditionnelle, sans occidentalisation, si on peut dire. Donc, ça partait de quelque chose de louable. Puisque la personne qui respectait et qui s'intéressait à ses propres traditions, elle avait une espèce de survalorisation de ses produits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les tapis berbères ont eu une cote extraordinaire, parce qu'il y avait de réels savoirs originaux dans l'Atlas. On avait des systèmes pour fixer les couleurs qui n'avaient rien à voir avec les mordants occidentaux, des choses absolument passionnantes qui ont fait que le marché s'est développé. Les pauvres ont gardé plus de moutons. forcément, puisque du coup, il faut plus de laine, on fait plus de tapis, on met plus de moutons. Mais les moutons, ils bougent tout ce qu'ils trouvent, et l'Atlas qui était déjà passablement déboisé, pelé et tout, s'est désertifié progressivement, parce qu'une génération a vu son quotidien amélioré, parce qu'au lieu de faire un tapis par an pour la maisonnée, parce que quelqu'un, le grand-fils se met en ménage, peu importe, en renouvelle. Là, du coup, on en a fait pour l'export, pour la vente, pour le commerce, un peu comme mon histoire de Beauvolent, mais on n'a pas vu l'écosystème. On n'a pas imaginé que mettre 1 000 moutons en plus, ça va bouffer 1 000 fois plus qu'un mouton, évidemment. Et donc, au bout d'un moment, quand on s'est retourné, c'était un petit peu trop tard, parce que les gens qui ont fait ça étaient morts depuis très longtemps. Ce n'était plus la peine de leur jeter des bières. D'ailleurs, il ne restait plus que ça, des bières. Alors, ce n'était pas la peine non plus. Et voyez, la vision à long terme, cette notion d'écosystème, cette notion de covalorisation et de bénéfice pour les générations futures, c'est ça le durable. Et la sobriété, c'est ça la chimie verte. Ne rien mettre dont on n'a pas besoin et optimiser tout. Voilà. Donc, ces deux notions, pour moi, c'est vraiment, disons, à intégrer dans votre forum et dans votre conversation. Et je vous remercie beaucoup. tout ça, d'avoir eu la patience, d'écouter jusque-là, voilà. Savoir si vous allez aimer, les mots clés du podcast ArtEcoVert : teinture végétale plantes tinctoriales indigo garance encre végétale couleur végétale colorants végétaux pigments végétaux coloration capillaire végétale fibres naturelles colorants biosourcés tanins teinture naturelle plantes artecovert couleurs de plantes design végétal couleur jardin agriculture tinctoriale indigo tendance innovation nuances