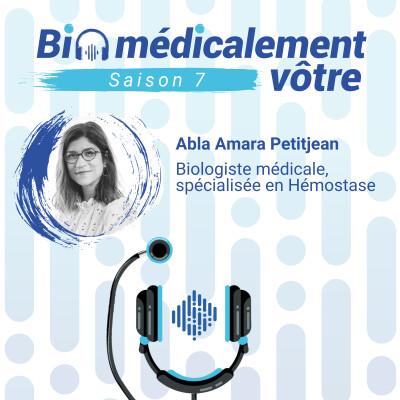- Speaker #0
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Biomédicalement Votre. Nous vous proposons un rendez-vous exceptionnel autour de l'innovation en biologie médicale. Pourquoi exceptionnel ? Parce qu'il incarne ce que notre profession a de plus beau, la capacité à réunir des experts issus de plusieurs horizons, biologistes de différents domaines, médecins, représentants de laboratoires privés et publics, pour travailler ensemble au service d'un objectif commun. Nous avons profité de la tenue des journées d'innovation en biologie pour réunir ces intervenants exceptionnels. Aujourd'hui, nous mettons en lumière ce qui nous unit. Replacer la biologie médicale au cœur du parcours de soins des patients. Autour de la table, vous entendrez des voix passionnées et engagées. Celles de professionnels qui, chaque jour, repoussent les frontières du possible. Nous parlerons des technologies qui transforment nos laboratoires. Des approches innovantes qui redéfinissent notre pratique. et surtout de l'impact de ces avancées sur la prise en charge des patients. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par ces échanges riches et stimulants. Que vous soyez médecin, sage-femme ou biologiste, cette édition est une invitation à découvrir la biologie médicale sous un nouveau jour, celui de l'avenir. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette aventure. Dans un monde médical en perpétuelle évolution, où les défis de la précision diagnostique, de la rapidité des résultats et de l'accès à des technologies de pointe sont cruciaux, l'innovation joue un rôle décisif.
- Speaker #1
C'est changement-amélioration en fait. L'innovation doit permettre une amélioration, un changement dans ce que l'on a l'habitude de faire. Pour moi, c'est ça l'innovation.
- Speaker #2
Aujourd'hui, l'innovation est plutôt celle-là. Aujourd'hui, dans nos laboratoires, on ne fait en général pas la révolution. Ce n'est pas nous qui avons inventé le séquençage à haut débit. Par contre, c'est nous qui inventons les applications de ce séquençage à haut débit. Et donc, je crois que l'innovation, c'est ça aujourd'hui, c'est d'être capable, dans nos laboratoires, d'imaginer de nouvelles manières d'utiliser de nouvelles technologies, le séquençage à haut débit, l'intelligence artificielle, pour améliorer la vie de nos patients.
- Speaker #3
C'est une vaste question. C'est probablement de répondre... aux enjeux médicaux qui ne cessent d'évoluer, de se complexifier, et notamment en pathologie infectieuse.
- Speaker #4
L'innovation aussi, c'est savoir saisir le nouveau rôle du biologiste, investir dans la prévention de tous les jours, que ce soit... par des méthodes de dépistage comme iCoop, des méthodes interventionnelles auprès du patient, par des questions, par des nouvelles recommandations via nos résultats. Mais c'est aussi innover pour nos personnels, savoir leur apporter des éléments clés scientifiques sur la vaccination, sur la prise en charge aussi de leur santé, de leurs aidants.
- Speaker #5
L'innovation, les deux mots qui me viennent, c'est création et nouveauté.
- Speaker #6
Donc, innovation, pour moi, il y a de l'innovation organisationnelle. Il y a de l'innovation technologique, mais il y a aussi de l'innovation culturelle, de l'innovation sportive. C'est tout ce qui nous permet ensuite d'avancer vers de nouvelles choses pour améliorer la qualité de vie des gens qui sont autour de nous.
- Speaker #0
Lors des dernières journées de l'innovation en biologie, un thème central a captivé l'audience, l'intelligence artificielle en biologie. À cette occasion, Claire Vigneault est intervenue pour partager sa vision et ses expériences. Claire Vigneault, c'est un énorme plaisir de vous recevoir dans cette édition spéciale de Biomédicalement Votre. Vous êtes biologiste médicale au sein du laboratoire Biogroupe, spécialisée en médecine de la reproduction et responsable de la recherche clinique. Vous faites également partie du comité d'organisation des Journées de l'innovation en biologie, qui ont mis à l'honneur un thème central qui est l'intelligence artificielle et son impact sur la biologie médicale.
- Speaker #4
Bonjour Abla, merci de me recevoir effectivement pour parler des GIB.
- Speaker #0
Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelle a été la particularité de cette édition ?
- Speaker #4
La particularité, ça a été, et je les en remercie fortement aux membres fondateurs et organisateurs du SD Bio, de donner la voix aux jeunes biologistes et de vraiment être à notre écoute pour changer justement ce programme. Avant, l'ÉGIB était un salon, on a eu la volonté de le transformer en congrès et de donner une nouvelle entité. C'était un peu un all-in pour voir si ça allait fonctionner avec des avis de jeunes biologistes, donc avec des thèmes comme l'IA, la prévention et les nouveaux rôles du biologiste.
- Speaker #0
Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant ces deux jours ?
- Speaker #4
J'étais vraiment ravie de l'engouement des gens à la sortie des sessions sur le ah bah super, je vais pouvoir rentrer avec quelque chose à la maison Et ça, ça me tenait à cœur que ce soit plus juste des discussions à bâton ou en puce. Je voulais vraiment qu'on donne des nouvelles armes aux biologistes pour rentrer chez eux.
- Speaker #0
Très bien. La thématique principale était l'IA, comme vous le dites. Alors selon vous, l'IA est-elle devenue un sujet incontournable dans notre domaine qui est la biologie ?
- Speaker #4
L'IA, c'est devenu un sujet incontournable dans notre société, de toute façon, de base. Qui n'a pas utilisé ChatGPT, à part nos grands-parents ? Et encore, je suis sûre que certaines lettres de Noël vont être écrites avec ChatGPT. Mais par contre, en biologie, en fait, ça serait aussi se leurrer, se dire qu'on n'en entend pas parler. Et d'ailleurs, le but, en fait, d'en parler aux gibes, c'était de se positionner, de se dire qu'il ne faut pas laisser passer le train sans monter dedans, même si ça reste quelque chose d'additionnel à notre profession, ça ne va pas pour remplacer notre profession. Et c'était vraiment le but, en tous les cas, de cette thématique des gibes, c'était de s'en saisir parce que c'est devenu incontournable dans notre profession. Mes inquiétudes, ça serait que certains s'en saisissent sans contour réglementaire suffisant, avec donc effectivement un amoindrissement des contrôles. Par exemple, l'IA, si vous lui donnez à apprendre une image, donc ça serait une cellule, mais une cellule sur laquelle, par exemple, vous avez un lymphocyte, et juste à côté, vous appliquez tout le temps, tout le temps, tout le temps, le même monocyte qu'un autre type de cellule. Eh bien, en fait, à force, l'IA va se dire, je classe bêtement tous les lymphocytes. avec un monocyte à côté, en lymphocyte. Et ça, c'est là où on a vraiment besoin de l'intelligence humaine, encore une fois. Donc, ma crainte, elle est là. Par contre, est-ce que je suis persuadée que ça va être très utile ? Oui, si justement c'est bien maîtrisé.
- Speaker #0
D'accord. Si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire à propos de l'IA en biologie médicale, quel serait le message clé à transmettre ?
- Speaker #4
Si j'avais un message clé, l'IA, c'est un vrai outil qu'il faut savoir maîtriser, encadrer et saisir pour, par contre, dorénavant, donner une médecine. biologique, mais une médecine globale de prévention, de diagnostic et en tous les cas de compétences. Et c'est vraiment nécessaire pour améliorer notre prise en charge du patient.
- Speaker #0
Bien Claire, ce fut un réel plaisir de vous avoir avec moi. Un grand merci encore. Les avancées technologiques continuent de transformer la médecine et parmi elles, le séquençage de nouvelles générations. ou NGS. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Rodriguez, professeur en virologie, pour discuter des applications du NGS tout en explorant ses perspectives. Christophe Rodriguez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette édition spéciale de Biomédicalement Votre. Alors vous êtes professeur en virologie et responsable de la plateforme NGS à l'hôpital Henri-Mandor. Vous êtes spécialisé dans l'adaptation de cette technologie dans le diagnostic des maladies infectieuses. Vous êtes l'auteur de centaines de publications à ce sujet.
- Speaker #2
Oui, tout à fait. Donc, déjà, merci pour cette invitation. C'est un plaisir partagé de pouvoir discuter de ces technologies qui sont passionnantes. Alors, le NGS, déjà, il faut savoir que c'est une technologie qui appartient à la famille de la biologie moléculaire. Donc, c'est une technologie qui peut être rapprochée de la PCR et en quelque sorte, c'est une super PCR, dans le sens où elle est capable d'adresser de très nombreuses cibles en même temps, contrairement à la PCR qui peut en adresser une ou quelques-unes, en tout cas, à un nombre assez limité.
- Speaker #0
Est-ce que vous avez un exemple dans votre expérience professionnelle où le NGS a eu un impact clé dans le parcours de soins d'un patient qui vous aurait marqué ?
- Speaker #2
On a eu un cas il y a 2-3 ans environ d'un patient qui a eu une errance diagnostique de plus de 5 ans, qui était un patient qui présentait des troubles neurologiques graves avec des troubles de la motricité notamment et de la tension. qui était un patient pour lequel on a suspecté pendant assez longtemps des maladies auto-immunes, un cancer, etc. Et en fait, au moment d'installer une chimiothérapie, ils ont eu l'idée finalement d'aller vers un diagnostic plus large, par métagénomique notamment. Et on a pu découvrir un pathogène relativement rare, puisque c'était la première fois qu'on le découvrait en France, c'était le troisième cas en Europe. qu'on a pu traiter par antibiotiques. Et le clinicien qui a pris en charge le patient nous a dit que ça a été spectaculaire puisque ce patient qui n'avait plus de relation avec son entourage s'est quasiment réveillé en moins d'une semaine par un traitement antibiotique adapté. Et comme nous disait la clinicienne, mais c'est vrai pour nous aussi, on fait médecine pour ce genre de choses aussi, finalement sauver les patients. Donc c'est vraiment des belles histoires. Oui,
- Speaker #0
je comprends, très intéressant. Et vous parlez de maladies infectieuses. Le NGS est surtout connu pour le diagnostic des maladies rares, des cancers, etc. Est-ce que son application, du coup, pourrait s'étendre à beaucoup plus que ces pathologies ?
- Speaker #2
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel des maladies qui sont adressées par le séquençage à haut débit sont les maladies génétiques et le cancer. Mais il y a aussi tout un tas d'autres maladies qui sont plus complexes, qui ne sont pas forcément reliées à la génétique, et qui peuvent être diagnostiquées par des approches... différentes de celles que l'on va utiliser pour séquencer l'ADN. Et donc, en fait, le spectre de maladies qui est adressé par le séquençage à haut débit doit être probablement illimité.
- Speaker #0
Alors, avec le séquençage NGS, on est capable de séquencer un nombre très important de gènes. Et j'imagine que vous avez déjà été face à la découverte d'une mutation inattendue qui a potentiellement un impact sur le traitement ou bien sur le parcours de soins du patient. Est-ce que vous pouvez nous raconter un exemple ?
- Speaker #2
Alors en effet, ce sont des problématiques qui sont difficiles à gérer parce qu'aujourd'hui, on a accès à des informations que nous ne recherchions pas, ce qui n'était pas le cas des technologies que nous utilisions avant.
- Speaker #0
Vous dites qu'on peut parfois trouver des choses qu'on ne cherchait pas en analysant le génome. On peut se retrouver face à des situations un peu délicates où notre conscience en tant que praticien est mise à l'épreuve. Comment vous gérez ça au quotidien ?
- Speaker #2
Alors effectivement, c'est une question très compliquée aujourd'hui. qui va certainement relever du cas par cas où il va falloir avoir un petit peu de finesse dans les approches. Ce qui est certain, c'est que de manière générale, lorsque l'on a une suspicion d'une maladie, il faut dans un premier temps se restreindre à la recherche des informations qui sont reliées à la maladie pour ne pas se retrouver dans une situation où on va délivrer un diagnostic différent au patient, celui qu'il était venu chercher pour sa maladie.
- Speaker #0
Et je trouve ça intéressant aussi, le côté un petit peu totipotent de cette discipline, où on peut l'appliquer à quasiment toutes les disciplines de la biologie médicale.
- Speaker #2
Oui, et même je dirais, elle renverse les frontières entre les disciplines. Pourquoi est-ce sectorisé dans chacune des disciplines et que chacun travaille finalement dans son domaine réservé ? Le biologiste pourrait très bien finalement avoir une approche plus globale, travailler de manière beaucoup plus coopérative, et je crois que ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux jeunes aussi. Et finalement, avoir une approche globale et personnalisée du patient, je crois que ça, c'est extrêmement gratifiant en tant que professionnel.
- Speaker #0
Oui, on peut dire que cette technologie révolutionne même le métier de biologiste.
- Speaker #2
Complètement. Oui,
- Speaker #0
super. Merci beaucoup, Christophe Rodriguez, d'avoir accepté de participer à cette édition spéciale.
- Speaker #2
Merci beaucoup à vous d'avoir invité.
- Speaker #0
L'innovation en biologie médicale, c'est aussi faire face aux nouvelles préoccupations en santé publique. Arnaud Jabé, lors d'Égypte, a présenté un éclairage précis sur une dermatophytose émergente qui attire l'attention. Tricophyton, endothinae, sur ses problématiques et les défis qu'elles représentent pour les professionnels de santé. Alors Arnaud Jabé, je suis ravie de vous accueillir dans Biomédicalement Votre. Vous êtes biologiste médical spécialisé en parasitologie-mycologie à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Vous vous intéressez particulièrement aux dermatophytes et aux défis liés à l'émergence de nouvelles espèces.
- Speaker #3
Exactement. Merci beaucoup pour votre invitation.
- Speaker #0
Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez tenu à parler de trichophyton andantinae ? Oui,
- Speaker #3
je pense que c'est vraiment une problématique émergente, une problématique de santé publique, pour laquelle, à l'heure actuelle, les laboratoires n'ont pas forcément tous les outils diagnostiques. Les outils sont en train de se mettre en place, mais il faut qu'il y ait une véritable prise en compte de cette problématique. de santé publique avec un phénomène qui ne peut aller qu'en s'aggravant s'il n'y a pas une prise en compte de ce phénomène avec un risque de diffusion de plus en plus large du pathogène.
- Speaker #0
Et comment est apparue cette espèce ?
- Speaker #3
C'est environ il y a moins de dix ans finalement, en Inde, que des dermatologues ont commencé à s'inquiéter du fait qu'ils commençaient à avoir de plus en plus de cas de dermatoficie qui étaient difficiles à traiter, qui évoluaient de manière chronique, qui récidivaient après traitement. Maintenant, il y a des cas rapportés sur tous les continents. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que maintenant, on commence à avoir aussi la transmission autochtone dans des zones qui n'étaient a priori pas des zones d'endémie initiale du champignon. C'est notamment ce qui est décrit, par exemple, en Chine.
- Speaker #0
Et est-ce que cette pathologie touche une catégorie de patients comme pour certaines pathologies opportunistes ? Est-ce que ça touche plutôt l'immunodéprimé ou est-ce que tous les patients sont susceptibles d'avoir cette dermatophytose ?
- Speaker #3
C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, les dermatophycies étendues, elles étaient effectivement plutôt l'apanage. de patients immunodéprimés. Là, ce sont effectivement souvent des lésions très étendues, mais qui ne sont pas liées directement à l'immunodépression. Ce sont des choses qui ont été regardées. En fait, tout un chacun peut être concerné par une infection par trichophyton endothiné avec des lésions étendues.
- Speaker #0
Très bien. En termes de diagnostic, là on arrive au diagnostic, quels sont les moyens diagnostiques ? Est-ce qu'il y a des défis côté biologie et clinique pour le diagnostic de ces dermatophytoses ?
- Speaker #3
Alors, d'un point de vue clinique, il y a clairement... C'est des difficultés avec souvent des patients qui ont des difficultés de prise en charge, pour lesquelles le traitement peut mettre longtemps à être posé. D'une part parce que la présentation clinique peut parfois être un peu atypique, et deuxièmement parce que, étant donné qu'on ne l'a pas encore dit, alors que c'est probablement le point crucial avec trichophyton et endothinae, il y a une résistance qui est très fréquente à la terbinafine. Un autre point qui explique la difficulté du diagnostic, c'est que le prélèvement mycologique n'est pas systématiquement réalisé. Et donc, il peut y avoir des confusions avec notamment des dermatoses inflammatoires type psoriasis.
- Speaker #0
Et si vous aviez un message à faire passer, que ce soit aux biologistes ou aux médecins qui reçoivent ce genre de patients ?
- Speaker #3
Donc, probablement que le diagnostic doit être suspecté effectivement chez certains patients, notamment des patients qui sont des migrants à partir des zones d'endémie. Également chez des patients qui seraient en échec de traitement, d'un premier traitement par terbinafine.
- Speaker #0
Très bien. Merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté de participer à cet épisode.
- Speaker #3
Merci beaucoup pour votre invitation.
- Speaker #0
Le réseau RELAB incarne une belle réussite de collaboration entre différents acteurs de la biologie médicale, réunissant laboratoires privés et centres nationaux de référence. Ensemble, ils nous partageront leurs visions et leurs expériences. démontrant comme l'union des forces peut véritablement servir les patients et la santé publique. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux experts d'exception qui sont membres du Réseau Rélab, qui incarnent parfaitement la collaboration en biologie médicale. Vincent Hénoux, vous êtes directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Vincent Vieillefond, vous êtes biologiste médical et directeur technique en microbiologie au sein du laboratoire Biogroupe. Un autre participant du Résoré Lab, Benoît Vissot, qui fait partie du laboratoire CERBA, qui a déjà participé à un épisode de notre podcast. Ensemble, vous contribuez à la richesse et à la dynamique du Résoré Lab, qui illustre l'importance de la collaboration pour faire avancer la biologie médicale.
- Speaker #5
Bonjour Abla, merci beaucoup de nous avoir conviés aujourd'hui. C'est un immense plaisir pour nous d'être présents. Aujourd'hui, c'est deux Vincent que vous aurez au micro, mais il y a beaucoup d'autres participants dont on a l'occasion de parler.
- Speaker #1
Bonjour Abla, donc en effet, on a la chance, Vincent, Benoît et moi et bien d'autres, de participer et d'avoir créé en fin de compte ce nouveau réseau qui était essentiel. Réseau qu'on a mis en place suite à l'expérience qu'on avait pu avoir lors du Covid-19, durant la pandémie, pendant 3-4 ans. La super expérience qu'on avait pu avoir avec les différents laboratoires, le groupe SRBA.
- Speaker #0
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le réseau Relab ? Comment il est structuré ? Quels laboratoires font partie de ce réseau ?
- Speaker #5
Relab, qu'est-ce que c'est ? C'est un super projet. C'est une collaboration entre des laboratoires privés et des laboratoires publics. Les laboratoires privés, Biogroupe et CERBA, se sont dit, nous, on a plein de données sur les virus respiratoires. On sait les structurer, on sait les utiliser. Il faut qu'on les donne à des gens dont c'est le métier de les analyser. Et ces gens-là, c'est les centres nationaux de référence, l'Institut Pasteur, les Hospices Civils de Lyon. Et donc, il y a un partenariat, une collaboration qui s'est montée à l'issue du Covid avec, comme projet, D'analyser toutes les données issues des patients qui viennent dans nos laboratoires, c'est 1600 sites. Les deux structures communes, c'est 1600 sites en France. Donc ça fait beaucoup de patients qui viennent tous les jours de l'année pour faire des tests. Et ces résultats-là, les résultats de ces tests, que ce soit pour une PCR grippe, COVID ou VRS, on les transmet au Centre national de référence qui vont pouvoir analyser les données. Mais on ne se contente pas de donner juste des informations informatiques, positifs, négatifs. Ça, ça serait... déjà super, mais ce n'était pas suffisant. On associe à ces données de positivité des données sur les symptômes, des données sur la vaccination et la couche supplémentaire, c'est qu'on ne se contente pas d'envoyer juste des données. On envoie aussi, pour une certaine partie, un échantillonnage. On envoie au CNR, toutes les semaines, des échantillons. Donc le CNR, il va avoir une mine d'informations extraordinaires, à la fois de nos données, juste pour vous donner un ordre d'idées, En un an d'activité, Prelab a fêté ses un an au mois d'octobre, en un an d'activité, on a émis à peu près, Biogroupe et Cerva cumulés, pas loin de 800 000 données, 800 000 patients. Et on a aussi envoyé pas loin de 5000 échantillons, si je ne me trompe pas, qui ont été analysés par le CNR. Eh bien ça, ça n'a jamais existé, et ça n'existe nulle part ailleurs.
- Speaker #1
Quand on dit nulle part ailleurs, c'est nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est le seul réseau, au moins européen, voire mondial, d'avoir des prélèvements, des informations. Être capable d'agréger par âge, par virus, etc. Ça, c'est jamais vu, en fait.
- Speaker #0
Vraiment une innovation organisationnelle ?
- Speaker #1
Oui, c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui aurait dû exister depuis beaucoup plus longtemps. Mais il y avait toujours cette, je ne sais pas, cette peur du public, du privé. Et il faut, on ne l'a pas encore dit, mais tout ça est fait gratuitement. C'est-à-dire que, que ce soit le CNR ou les laboratoires privés, il n'y a pas de financement pour faire ça. Et ça tient aujourd'hui sur quelques personnes, des directions qui, évidemment, ont dit oui, allez-y, c'est génial. On veut participer à la santé publique. On en a besoin et surtout le CNR avait absolument besoin de ces données.
- Speaker #0
Selon vous, quels sont les enseignements que devraient retenir les professionnels de santé ? Je veux dire les enseignements en termes de... Parce que comme vous le dites, on le répète, c'est inédit en termes de travail collaboratif. C'est du jamais vu et ça devrait être, comme vous le dites...
- Speaker #1
Pour être un peu cash, je pense que c'est de se dire les choses. Si on ne s'était pas dit les choses justement entre les différents protagonistes du réseau Relab, il n'existerait pas aujourd'hui.
- Speaker #5
L'enseignement pour les professionnels de santé, c'est peut-être... de se rappeler qu'un patient, avant d'aller à l'hôpital, il est en ville. Donc il n'est pas question de dissocier ce qui se passe à l'hôpital de ce qui se passe en ville. Et les virus, avant d'arriver à l'hôpital, ils sont en ville. Et donc c'est très important de voir ce qui se passe en ville pour anticiper, prévoir, comprendre ce qui se passe après à l'hôpital.
- Speaker #0
Je vous remercie énormément d'avoir participé à cette édition spéciale et merci pour toutes les informations que vous nous avez fournies.
- Speaker #1
Merci à vous en tous les cas.
- Speaker #5
Merci à vous, on viendra fêter les 10 ans de Relab.
- Speaker #0
Oui. Le vieillissement en bonne santé est un enjeu majeur de santé publique et le programme ICOB en est une illustration phare. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Bertrand Fougère qui nous présentera ce programme. Il nous expliquera comment ICOB vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et comment les biologistes médicaux peuvent être acteurs de ce challenge. Bertrand Foucher, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans cette édition spéciale de Biomédicalement Votre. Vous êtes professeur en gériatrie à la Faculté de médecine et chef du pôle vieillissement du CHU de Tours. Vous êtes particulièrement impliqué dans le programme ICOP au service du bien vieillir. Et ICOP, pour rappel, est un programme développé par l'OMS qui a pour objectif de retarder la dépendance en repérant précocement les facteurs de fragilité chez les seniors. C'est bien ça ?
- Speaker #6
Oui. Bonjour Abla. C'est exactement ça. C'est même un programme pour maintenir l'autonomie plus que pour prévenir la dépendance. Mais bon, c'est la même chose. Mais je trouve que c'est toujours plus positif de parler avec des termes de maintenir l'autonomie que prévenir la dépendance. C'est un programme qui est développé depuis 2019 par l'OMS avec l'objectif de se dire que la population mondiale allait vieillir et qu'il fallait qu'on accompagne justement ce vieillissement en faisant en sorte que les gens puissent maintenir leur autonomie le plus longtemps possible.
- Speaker #0
Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce programme ?
- Speaker #6
En fait, l'OMS définit le vieillissement en santé avec six fonctions qui sont considérées comme essentielles pour vieillir en santé. C'est la mémoire, la mobilité, la nutrition, la vue, l'audition et le moral. Et tout ça dans un environnement de vie. Et donc l'idée, c'est de se dire que si vous entretenez vos six fonctions essentielles tout au long de votre vie, vous pouvez espérer avoir un vieillissement en santé. Donc pour ceux, le programme I-COP, à partir de l'âge de 60 ans... Vous pouvez télécharger une application sur votre smartphone pour vous taper iCop sur votre téléphone et vous vous auto-évaluer sur les six fonctions essentielles que je viens de citer. C'est un test qui dure moins de dix minutes. Et puis ensuite, les résultats de ce test, ils peuvent partir. Soit c'est quelqu'un qui est un gestionnaire d'alerte, mais qui est un professionnel de santé, soit directement chez votre médecin traitant qui décide de faire une évaluation plus approfondie s'il voit qu'il y a une fonction qui est altérée. Exemple, vous testez votre mémoire. votre mémoire, en effet, il y a quelque chose qui est altéré, votre médecin traitant dit, il faudrait vous adresser à la consultation mémoire pour pouvoir faire une évaluation plus approfondie et savoir s'il y a vraiment une pathologie ou pas. Vous le refaites tous les six mois. L'idée, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui soit réitéré. Tous les six mois, vous refaites votre auto-évaluation, donc moins de dix minutes. Et l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans un parcours de soins le plus précocement possible. Et si je reviens sur mon exemple de la mémoire, l'idée, c'est de se dire qu'on va essayer d'attraper les gens dès le début des troubles de la mémoire et pas quand les pompiers nous les emmènent parce qu'ils étaient tout nus dans la rue.
- Speaker #0
Qu'est-ce que vous en avez tiré comme résultat ? Est-ce que vous avez des cas particuliers qui vous ont marqué de récupération, si je puis dire, de patients ?
- Speaker #6
Alors, si je dois sortir avec deux gros enseignements importants, mon ressenti, mais pour le coup très personnel, du programme ICOPS, c'est la difficulté à aller chercher au final les gens qui sont vraiment la cible. C'est-à-dire qu'au final, j'allais dire, la vraie cible du programme ICOPS, c'est les gens qui ont entre eux... 60 et 70 ans, parce que c'est eux qu'il faut essayer d'attraper pour que justement, ils continuent à vieillir en santé, qu'ils préparent leur vieillissement qui va arriver de façon un peu plus marquée. Au final, l'âge moyen sur l'expérimentation est autour de 75 ans. Et le deuxième point, c'est qu'initialement, l'article 51, il a été fait pour mobiliser uniquement des professionnels de santé. Et là aussi, c'est difficile en fait. C'est très difficile de mobiliser les professionnels de santé sur un programme comme celui-là, pour plein de raisons. Le temps, c'est clairement une des raisons principales. Le deuxième, c'est... thématique de prévention. Vous allez chez votre médecin traitant, vous allez voir une infirmière, vous allez etc. parce que vous avez une plainte, vous avez mal au ventre, vous avez le nez qui coule, vous avez de la fièvre etc. et vous voulez qu'il réponde à une plainte et en fait il répond à la plainte avec votre symptôme etc. Vous n'allez pas chez votre médecin traitant ou chez un soignant en disant je vais bien, tout va bien et je veux bien que vous me fassiez un test pour voir si potentiellement j'ai une maladie. Donc là on n'y est pas encore aussi dans cette dynamique là, dynamique professionnelle et des gens et donc l'autre enseignement du programme iCop c'est que en mobilisant d'autres professionnels qui sont pas des professionnels de santé, et bien en fait ça a bien marché, on a mobilisé des entreprises de téléassistance, le groupe La Poste, avec les facteurs qui se rendaient au domicile des gens, des agents des conseils départementaux des associations etc. Et là en fait, on a vu que là il y avait une vraie accroche avec les gens, presque beaucoup plus qu'avec les professionnels de santé, et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est pas plus mal qu'on les garde pour la mobilisation à partir de l'évaluation j'allais dire et du plan de soins, et que la partie en fait repérage et la promotion du repérage etc. En final c'est l'affaire de tous...
- Speaker #0
Je vais parler un petit peu du côté d'autres professionnels de la santé que sont les biologistes. Alors les biologistes ont un rôle traditionnel dans tout ce qui est diagnostic de maladie, mais comment cette profession pourrait évoluer pour avoir une place active dans cette prévention primaire ?
- Speaker #6
Alors, ils vont avoir un rôle majeur. Nous, on a fait une expérimentation, justement, avec les laboratoires de biologie médicale sur le programme ICOPE, en se disant, au final, les gens, ils vont au laboratoire de biologie médicale pour faire leur prélèvement sanguin. Quand même, c'est la majorité, la grande partie de l'activité du laboratoire de biologie médicale. Au final, ils sont dans un environnement santé. Ils sont quand même en train d'attendre pour avoir leur prélèvement. Pas forcément très longtemps, mais ils attendent quand même. Donc, c'est peut-être le bon moment pour aller les attraper, sachant qu'en plus, la population cible, enfin, des gens qui vont faire leur prise de sang, bon ben... Oui, il y en a quand même un paquet qui ont plus de 60 ans, qui viennent faire leur prise de sang. Donc, on s'est dit, ça peut être un bon endroit, une bonne idée d'aller faire ça. Et puis, en plus, ça permettait, je trouve, de valoriser aussi l'activité de la biologie médicale. Et donc, on a mené cette expérimentation dans des laboratoires sur nos deux territoires d'expérimentation. Et ça a excessivement bien marché. C'est presque une des actions qui a le mieux marché. Parce qu'il y a un passage important les matins de personnes. Parce qu'au final, ils sont dans cet environnement de santé. Parce que ça ne leur prend que 10 minutes et donc, ça va assez vite. Et donc, c'est un programme qui a très bien marché.
- Speaker #0
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous motive au quotidien dans votre travail ? Quel est votre leitmotiv au quotidien ?
- Speaker #6
J'adore mon travail au quotidien. J'aime aussi une démarche de santé publique. Ça veut dire que je sors même de mon périmètre de santé en se disant, d'ailleurs, le vieillissement n'est pas du tout et ne doit pas rester sur le pan de la santé et même de la solidarité. Le vieillissement, ça doit être sociétal. Et quand on pense à la transition démographique, au vieillissement de la population... on doit penser comment justement je vais adapter des lieux culturels, comment les promoteurs immobiliers vont adapter la façon dont ils vont construire les logements, comment on va adapter les transports urbains, comment on va adapter le regard de la société sur le vieillissement. Et en fait là, aujourd'hui, c'est tout ça qui m'anime, c'est de me dire comment je peux essayer d'amener mes compétences, ma petite pierre à l'édifice de l'adaptation de la société au vieillissement.
- Speaker #0
Un grand merci Bertrand Fougère d'avoir accepté de répondre à mes questions.
- Speaker #6
Merci beaucoup. pour votre accueil et pour toutes ces questions.
- Speaker #0
Alors que nous clôturons cette édition spéciale de Biomédicalement Votre dédiée à l'innovation en biologie médicale, je souhaite vous remercier chaleureusement pour votre fidélité. Ensemble, nous avons exploré les enjeux cruciaux de la biologie médicale et ouvert des perspectives sur l'avenir de notre pratique. Nous restons animés par une conviction forte. L'avenir de la biologie médicale repose sur l'innovation. la collaboration et la mise en lumière de son rôle central dans la santé.
- Speaker #4
Il y a vraiment aujourd'hui tout à faire en biologie, c'est ça que je trouve super encore dans notre spécialité.
- Speaker #2
On voit une révolution médicale qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur de la médecine personnalisée, beaucoup plus complexe que ce qui a été le cas par le passé. Et ça oblige à changer de technologie très régulièrement, à se remettre en question en permanence.
- Speaker #5
On a pris goût à prendre le temps de discuter intelligemment, j'allais dire, avec les CNR, avec tout le corps académique en général.
- Speaker #3
Il peut y avoir des interactions fortes entre les établissements hospitaliers, qui sont les centres d'expertise, et puis les laboratoires de ville, avec probablement des échanges très riches. Et c'est ce qu'on voit notamment, nous, dans notre étude avec les laboratoires du Biogroupe.
- Speaker #5
On n'attendait que ce moment où on allait nous dire allez, viens, on travaille ensemble
- Speaker #6
Comment évoluer ou comment avancer et puis comment prendre une place qui est la vôtre de professionnel de santé et de se dire comment je peux aussi être acteur moi aussi du vieillissement en santé, de la santé des gens, puisqu'au final je les accueille quand même, ils sont là.
- Speaker #4
On sait, comme l'accès aux soins est difficile par tous les patients, je trouve qu'aujourd'hui le biologiste justement doit pouvoir se positionner comme un accès plus facile ou peut-être en tous les cas complémentaire de nos collègues médecins, pharmaciens ou IPA. C'est un monde encore énorme à explorer, avec peut-être un peu d'utopie de ma part, mais beaucoup de belles choses encore à créer pour améliorer nos conditions de travail et nous rendre un élément indispensable dans le parcours du patient.
- Speaker #5
Ça veut dire qu'on est là pour quelque chose et ça remet du sens à notre métier. C'est vraiment fantastique.
- Speaker #0
Pour ne rien rater de nos prochaines saisons et suivre nos actualités, inscrivez-vous à notre newsletter et abonnez-vous à notre podcast. Vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés ? N'hésitez pas à nous contacter sur biomédicalementvotre.com. Nous serons ravis d'y répondre. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt.