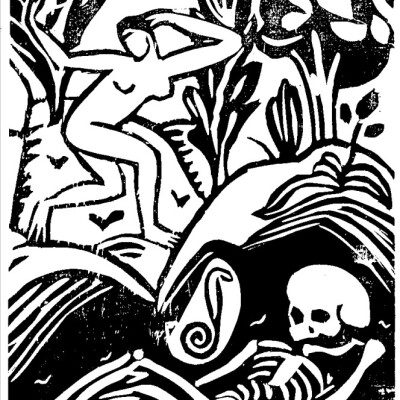Anne LafranAlors, ceux qui étaient à Bucarest savent que le fantôme de Jeanne de Bourbon-Vendôme me poursuit depuis un certain temps.
Mais pourquoi donc cadavre exquis ?
Outre qu'on surnommait parfois cette duchesse ou comtesse Jeanne la Belle, mon enquête, encore lacunaire et composite, peut faire penser au jeu poétique d'André Breton et ses amis. En effet, tant les historiens, les érudits, même les acteurs qui se sont penchés sur la vie de Jeanne de Bourbon-Vendôme, nous délivre à tour de rôle une biographie un peu lacunaire, un peu chaotique, qui laisse beaucoup de zones d'ombre. Il manque aussi des pièces essentielles, vous le verrez, à ce dossier qui est encore à ce stade une historia, au sens étymologique du terme, une enquête en cours donc.
Revenons au transi. Le genre et les représentations macabres, comme vous le savez, se développent à la fin du Moyen-Âge et aboutissent à un type particulier de monuments funéraires et de sculptures funéraires, le transi. La forme fréquente de ces monuments oppose une représentation du défunt ou de la défunte au vif, dont toute sa dignité et son rang social, à un corps en décomposition, un cadavre, souvent attaqué par la vermine.
La pratique des transis se prolongea sous la Renaissance, mais le caractère remarquable de ces figures et monuments ne doivent pas faire oublier leur caractère assez exceptionnel. Les transis féminins sont encore plus rares. même si certains sont bien connus, comme celui de Catherine de Médicis dans la Nécropole royale de Saint-Denis. Un des plus singuliers et remarquables est justement celui de la grand-mère de cette dernière, Jeanne de Bourbon-Vendôme, née en 1465 et morte en 1511. Jeanne, duchesse de Bourbon, puis comtesse de Boulogne et d'Auvergne, est un personnage assez hors du commun, vous allez le voir.
Fille de Jean VIII de Bourbon, comte de Vendôme, elle est princesse de France et descendante de Saint-Louis par son père. Elle se mariera trois fois. En 1487, assez jeune, à Jean II de Bourbon, son cousin, mort en 1488. En 1495, à Jean IV de La Tour, comte d'Auvergne, mort en 1501, avec qui elle aura trois enfants. Et en 1503 , à François de La Pause, vraisemblablement plus jeune, annobli depuis seulement une génération, quasi roturier. Un parcours nuptial et sentimental singulier, sans doute scandaleux, et qui a pu influencer sa sépulture.
On ignore malheureusement le nom de l'artiste qui façonna, entre 1500 et 1525, le tombeau de Jeanne de Bourbon-Vendôme, autrefois dans l'église des Cordeliers de Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme, église aujourd'hui disparue ou presque. Seul un fragment du tombeau demeure, le fameux transi, aujourd'hui conservé au musée du Louvre.
Dérangeante ? intrigante, cette effigie interroge.
Je me propose ici d'explorer les formes singulières mais aussi les canons à l'oeuvre dans cette figure, l'expression du macabre ainsi que ses fonctions. En quoi ce qui pourrait apparaître comme un memento mori assez effrayant est aussi une promesse de résurrection, en quoi c'est bien un tombeau chrétien. Mais nous le savons, le tombeau, le monumentum, comme le portrait, a une fonction mémorielle importante, en particulier chez les grands. Qu'est-ce que ce transi nous dit de Jeanne de Bourbon-Vendôme ? Quoi, c'est aussi une façon de marquer son rang social et son pouvoir. Partons donc à la découverte de ce tombeau et explorons ses formes macabres dans une première partie.
Le tombeau de l'église des Cordeliers était à double effigie. Un gisant, couché sur le caveau, accompagné d'un transi. Le gisant est reproduit par Étienne BaluZe, jésuite. historien, professeur et bibliothécaire de Colbert, à qui on doit fort heureusement une histoire généalogique de la maison d'Auvergne, datée de 1708 et qui a été très précieuse pour nos recherches. Représentée au vif, les yeux ouverts, les mains jointes, Jeanne de Bourbon-Vendôme est habillée en noble dame. Une couronne sur la tête, les pieds posés sur un lion et non un chien, comme il sied en général aux dames, tenant dans ses griffes ses armoiries. que l'on retrouve sur un dais au-dessus de sa tête. Elle est inhumée en seigneur. Autour du gisant court une épitaphe, que je cite, « Ci-git Jeanne de Bourbon, issue de Vendôme, douairière de Bourbon, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, laquelle trépassa le 22e jour du mois de janvier 1511, laquelle donna de beaux vêtements d'église en ce bon couvent, prier Dieu pour son âme. » En dessous, sur le pourtour du sous-bassement, le convoi funèbre, mené par des moines, sans doute des cordeliers. Les historiens s'accordent tous sur la destruction de ce gisant pendant la Révolution. Le transi, quant à lui, fut probablement cédé lors de la vente du mobilier du couvent, comme bien national, le 5 avril 1791 et acquis plus tard par le Louvre en 1899. Ce transi surmontait-il le gisant, comme le supposent certaines sources ? Où était-il au pied du tombeau ? Il est difficile de répondre à la question. La défunte, en tout cas, est debout à l'échelle 1, dans une niche coiffée d'une coquille dont elle tient l'encadrement à pilastre, de la main gauche. Nue, enveloppée d'un sueur qu'elle retient de la main droite, en même temps qu'un phylactère muet ou peut-être effacé par le temps, elle semble aussi soutenir ses entrailles éviscérées, le corps est amaigri, l'abdomen est rongé par les vers, la tête est cadavérique. Alors, il existe, si ce n'est un canon, du moins des conventions pour représenter un cadavre et qu'Alberti, quelques temps plus tard, rappelle dans son "De pictura"(1435), je cite, « Tout pend, les doigts, les mains, le cou, tout sombre, inerte, tout enfin se conjugue pour exprimer la mort du corps. » Or, c'est plutôt l'inverse qui apparaît dans l'effigie mortuaire de Jeanne. La tête de profil, légèrement inclinée mais plutôt en signe d'humilité, ne pend pas. Dressé, le cadavre de Jeanne de Bourbon-Vendôme ne manque pas de noblesse, je trouve, ni même de grâce. C'est à la fin du XIVe siècle qu'apparaissent les transis dans différents endroits de l'Europe septentrionale. Alors, je passe malheureusement sur l'évolution de ces transis, de ces effigies au XIVe et XVe siècle, pour effectivement m'arrêter sur le XVIe, où se développa en France un nouveau modèle, inspiré de la sculpture italienne plus esthétisante, plus humaniste. et qui aboutira notamment aux effigies de Germain Pilon, en particulier celle de Catherine de Médicis, sa petite fille, réalisée en 1573. Le caractère italiennisant de notre transi est indéniable. La coquille et le motif à rinceaux en haut des pilastres peuvent faire penser au Rachel et Léa de Michel-Ange pour le tombeau de Jules II. Quant à la coiffure un peu échevelée de la défunte, elle peut faire penser à la Madeleine en pénitence de Donatello. Des œuvres ultérieures, certes, mais qui montrent bien la sensibilité italienne. Cependant, et c'est là le problème, sans la commande ou le testament de Jeanne, vraisemblablement brûlé le 19 juin 1792 sur la place Vendôme, en même temps que la moitié des titres nobilières du cabinet des ordres, sans ces documents, il est difficile de conjecturer l'identité de l'artiste ou l'influence culturelle. Aucune attribution n'est à ce jour avancée par les spécialistes de l'art de la Renaissance. J'ai eu un contact avec Sophie Jugie, qui est la directrice du département des sculptures renaissance et médiévale du Louvre.
L'auteur reste hypothétique et le musée du Louvre évoque un auteur anonyme. Hypothèse quand même. Le grand maître français Michel Colombe, qui œuvre à cette époque-là, Guillaume Regnault, leurs apprentis, Jérôme Pacherot, des sculpteurs de cette époque, ou les Justes, artistes italiens à la cour de France à ce moment-là. Giovano Francesco Rustici, dont la première œuvre française, est réalisée à Vic-le-Comte pour la fille de Jeanne, Anne de la Tour d'Auvergne. Malheureusement, aucun ne correspond stylistiquement à notre transi. Alors, certains évoquent une certaine similarité avec la vierge de piété du château de Cordès à Orcival, donc pas très très loin, attribuée au "maître d'Allègre" ou à un marbrier italien, Jean de La Barda. qui est présent dans la région entre 1508 et 1512. Là aussi, on n'a aucune preuve. L'hypothèse d'une œuvre précoce de Girolamo della Robbia, qui est présent en France entre 1518 et 1520 et de retour en 1527, n'est pas complètement écartée non plus, mais je reviendrai sur cette hypothèse. En tout cas, effectivement, il reste beaucoup de doutes. Alors, l'expressivité, le naturalisme de cette figure peuvent être inspirés de l'Italie, bien sûr, dont l'Auvergne est proche surtout depuis les guerres d'Italie. Mais il ne faut pas oublier que la cour de Bourgogne qu'on a évoquée tout à l'heure, a aussi fait venir un siècle plus tôt de grands artistes flamands, donc Klaus Slaughter, dont l'influence, le rayonnement artistique, irrigue encore tout l'Est de la France. Donc c'est vraiment difficile de faire une attribution. En tout cas, par l'originalité de sa composition assez spectaculaire, par son réalisme, son vérisme, ce transi, même s'il s'inscrit dans une assez longue tradition à cette époque, témoigne d'une singularité et même de certaines innovations qui interrogent.
De quoi est-il l'histoire ? Comment donc interpréter ce transi ? Pendant tout le Moyen-Âge, les tombeaux chrétiens expriment l'espoir et la foi dans le salut. Les tombeaux à double effigie mortuaire peuvent être interprétés en ce sens comme la mise en regard du corps naturel et donc corruptible, voué au pourrissement, et du corps social et de l'âme immortelle. Cette opposition se retrouve dans le tombeau de Jeanne de Bourbon-Vendôme. Mais dans son cas, c'est plutôt le cadavre qui semble ressusciter, redresser, un pied un tout petit peu hors du cadre, Jeanne semble entrer dans sa nouvelle vie. Du fait de leur caractère spectaculaire, certains historiens, certains commentateurs, ont pu interpréter ces transis comme des memento mori à l'intention des vivants, à la manière des Danses macabres ou des Triomphes de la mort. Le transis sera alors un miroir invitant les chrétiens à la conversion, un outil pour l'édification des vivants. Mais la fonction pénitentielle du transi semble beaucoup plus vraisemblable. En cette fin du Moyen-Âge, où les grandes familles ont accumulé richesse et pouvoir, comme le rappelle Duby, mais où la Mort se rappelle à eux de manière un peu anxiogène, notamment à travers la peste noire, le sentiment de culpabilité, ou au moins le repentir, va s'exprimer dans les pratiques funéraires. Les excès de piété, les legs pieux, les actes d'humilité, voire d'humiliation, qui parfois peuvent être très démonstratifs, sont fréquents, et cohabitent parfois avec les mêmes excès de richesse et d'orgueil. Cette tension contradictoire, voire même un peu schizophrène, se retrouve jusque dans le haut clergé. En se faisant représenter en cadavre, les grands de ce monde nient tout orgueil pour demander merci à Dieu, parfois explicitement dans l'épitaphe, l'état de putréfaction avancé, symbolisé entre autres par les vers nécrophages, apparaît comme une autre expression de l'humilité ainsi que du repentir. Pour les doubles tombeaux, le transi contraste avec le vif. Nus, dépouillés de tout, hormis du linceul, ce dénuement incarne le dénuement nécessaire pour rentrer au paradis. Pour les puissants, cette mortification, cette humiliation même, apparaît comme une vraie forme de contrition. Et pour une femme comme Jeanne, qui avait la réputation d'être belle, disent certains manuscrits, le symbole est d'autant plus fort. Mais cette humilité est-elle sincère ? Il convient de rappeler qu'il n'y eut pas de mode des transis et que ceci reste relativement exceptionnel, 270 en Europe, dans toute l'Europe, du XIVe au XVIe siècle, selon les inventaires, dont celui de Panoski. Et remarquons-le, cet excès d'humilité et ce zèle très chrétien exprimé par le tombeau dispense aussi de le faire dans la vraie vie. Ainsi, le suaire qui enveloppe Jeanne assez élégamment, pourrait-on penser, cache en partie, en partie seulement, la vermine, la putréfaction, et participe, je trouve, d'une certaine manière, à sublimer le corps, ou en tout cas la silhouette.
Là encore, la question du commanditaire se pose. Est-ce l'expression d'un signe personnel, d'humilité, de repentir, ou bien est-ce l'expression de repentir de ses descendantes, Anne de la Tour d'Auvergne ? voire Catherine de Médicis, sa petite fille, soucieuse de préserver l'honneur familial et, pour la seconde, royal.
Revenons à la fonction du tombeau, qui est aussi et surtout un lien entre les vivants et les morts, ce que rappellent souvent les épitaphes, en l'occurrence celle de Jeanne, "Priez Dieu pour son âme". À partir de l'institution de la fête des morts, le 2 novembre 1030, se développe en Occident un "souci des morts" qui s'exprime par une tradition narrative, donc Cluny va être le laboratoire, l'épicentre, qui voit la prière ou le suffrage comme un outil pour libérer les âmes du purgatoire. À partir du XIe siècle donc, l'invasion des revenants, selon la formule de Jean-Claude Schmitt, marque l'imaginaire occidental. Le transi en est quelque part une forme pétrifiée. La commémoration des morts débouche avec la multiplication des dons et une monétarisation du marché funéraire à ce que Jacques Chiffoleau a appelé "la comptabilité de l'au-delà". Ces pratiques renforcent alors l'encadrement institutionnel et aussi symbolique de l'Église. Elles permettent de promouvoir certains monastères, certains ordres, qui vont se spécialiser parfois dans ces activités commémoratives. Les mendiants, les fameux cordeliers, ont pu profiter en Auvergne de la libéralité de certaines grandes familles et étendre le nombre de leurs couvents. Ainsi, le comte Bertrand VII de La Tour et sa femme Louise de La Trémoille,( les beaux-parents de Jeanne), fiire construire un monastère pour cet ordre aux portes de leur domaine sur les terres de Vic. L'église du couvent fut consacrée en 1484, donc dix ans avant le mariage de Jeanne et du comte d'Auvergne. Cette église qui était, disent les témoignages du début du XVIIIe siècle, en forme de croix latine, ça ne se voit pas trop sur le plan et qui date de 1791, en forme de croix latine, elle comptait en tout cas deux chapelles, l'une dédiée à Saint-François et l'autre à Notre-Dame-de-Pitié où furent inhumés le comte et la comtesse donc Jeanne. Les fondateurs avaient richement doté l'église et à la mort de son mari, Jeanne fit de même comme le révèle son épitaphe, elle donna des beaux habits etc etc, mais aussi par la suite, on le sait par certains documents, sa petite fille Catherine de Médicis. L'église devient alors une institution essentielle comme support de la memoria et de la reproduction sociale. La fonction du tombeau devient alors davantage commémorative, manifestation d'un rang social, blason d'une lignée, et comme de nombreux tombeaux nobilières de la même époque, celui de Jeanne de Bourbon-Vendôme est certes un tombeau chrétien, une porte vers le salut, mais aussi une manifestation de son rang social et de son pouvoir.
Alors revenons à cette question lancinante, Jeanne a-t-elle commandé son propre tombeau, y compris le transi ? La tradition historique l'affirme, mais sans s'appuyer sur aucune preuve. L'étude des testaments, en général, tente à prouver que dans la noblesse, et notamment à la fin du Moyen-Âge, les femmes ne sont pas les dernières à diriger leurs funérailles et à être commanditaires de leur tombeau. Sous l'influence des franciscains, Jeanne a très bien pu, effectivement, au moment de son veuvage, à un moment où elle est particulièrement libre en tant que femme, élire sa sépulture dans leur couvent et décider de la forme de son monument, le gisant comme le transi. Alors, cette hypothèse est d'autant plus probable que son dernier mari, le fameux François de La Pause, fils du maître d'hôtel du comte d'Auvergne, annobli depuis peu, n'a sans doute pas le pouvoir et encore moins la légitimité d'établir un tel monument. Une tradition veut pourtant, c'est pour ça que j'évoque cette hypothèse, veut pourtant que ce soit ce troisième époux qui, à l'occasion de la translation du corps, donc du cadavre de son épouse dans le caveau,pris de douleur, de folie, ou effrayé par le cadavre, qui les fait réaliser le transi à ce moment-là. Cette tradition romanesque, qui est sans fondement, va apparaître dans l'historiographie du XIXe siècle. Mais encore une fois, aucune preuve. Quant à ces filles, autre hypothèse possible, autre commanditaire possible, on sait qu'elles sont fâchées suite au troisième mariage, comme en témoignent dans certaines démarches de sa fille, Anne de la Tour d'Auvergne, et surtout son gendre, le duc d'Albanie, contre Jeanne, et la tradition veut d'ailleurs qu'elle n'ait pas été enterrée tout de suite dans son caveau. Jeanne, donc, devrait être la seule commanditaire du monument.
Autre hypothèse quand même. Anne de la Tour d'Auvergne aurait aussi pu être la commanditaire. Une fois la colère, le ressentiment passé, peut-être 10 à 15 ans après la mort de sa mère, elle aurait pu, cette nouvelle comtesse d'Auvergne, puisque c'est elle qui va le devenir, elle aurait pu, pour le salut de son âme et celle de sa mère, commander le fameux transi.
Cette hypothèse d'un transi postérieure, peut aussi pousser sa conception jusqu'à l'arrivée en France de Catherine de Médicis. On sait que la reine hérita du comté d'Auvergne, sa tante Anne et sa mère Madeleine de la Tour d'Auvergne, qui avait épousé Laurent II de Médicis, étant morte sans autres enfants. Et on sait qu'elle dota le couvent des Cordeliers, de nombreux biens, qu'elle s'intéressait aux messes, qui étaient effectivement célébrées dans le couvent. Elle aurait pu, comme elle l'a fait pour elle-même, commander un transi pour son aïeul, alors à la fois pour le rachat de son âme, mais comme mode de légitimation politique en rappelant ses origines françaises. Et pourquoi pas à Girolamo della Robbia, qui permettrait de comprendre peut-être l'audace de l'artiste qui proposa à la reine en 1565 un premier transi, mais que celle-ci refusa parce qu'elle le jugea justement trop décharné, trop macabre, et elle préféra le gisant de Germain Pilon. La sépulture de la comtesse est en tout cas emblématique des stratégies sociales et politiques alors à l'œuvre. L'individu et son sexe s'effacent devant le groupe dont il devient l'étendard, le représentant, jusque dans la mort.
Femme de pouvoir, Jeanne de Bourbon-Vendôme s'inscrit dans une lignée, celle de La Tour d'Auvergne, et c'est peut-être pour cette raison qu'elle paraît être enceinte. Sa main droite soutient en effet son ventre, éviscéré certes, mais à la manière de certaines vierges parturiantes du XVe siècle, ou même comme sur les planches anatomiques de Vésale quelques décennies plus tard. C'est donc comme porteuse d'une lignée, d'une dynastie, qu'elle entre dans l'éternité. Inhumation de prestige, le tombeau et la représentation de la défunte sont clairement une expression de pouvoir. Jeanne de Bourbon-Vendôme, sur son gisant, est couchée avec la couronne comptale, avec le blason héraldique de la maison d'Auvergne mêlée au sien, comme sur le triptyque de l'Annonciation, dit triptyque de Vic-le-Comte, où elle est représentée en donatrice, et on voit que c'était une jolie femme, avec son second époux. On le voit, elle n'a pas renoncé à ses prétentions politiques, son épitaphe le rappelle d'ailleurs. La puissance de Jeanne de Bourbon-Vendôme, princesse de France, descendante de Saint-Louis et régent d'un comté extrêmement puissant à l'époque, s'exprime à travers son monument.
Pour conclure, à travers l'étude du tombeau de Jeanne de Bourbon-Vendôme, on retrouve deux types de commémorations funéraires.
Le premier type renvoie à la mémoire des ancêtres et à la lignée de la comtesse.
Le second type, au souci des morts et au salut de Jeanne.
Une approche rétrospective et prospective, une dialectique entre le souvenir et le devenir du défunt.
Exceptionnellement en avance sur son temps, cette comtesse peu académique a eu sa mémoire un petit peu oubliée dans un angle mort de l'histoire. Son tombeau nous la rappelle et cette enquête en cours nous rappelle aussi, pour citer le grand Aby Warbourg, que l'histoire de l'art et l'histoire tout court est souvent une "histoire de fantômes pour grandes personnes". Je vous remercie.