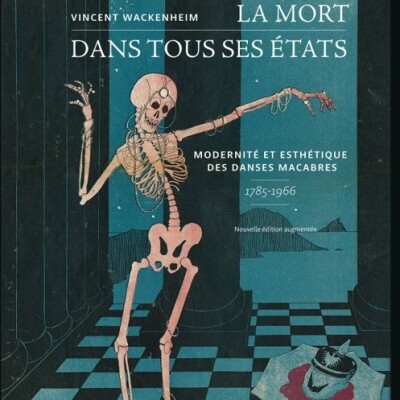Speaker #0Ceux qui connaissent mes travaux savent que mon sujet de recherche favori est depuis de nombreuses années la peinture murale et que je m'intéresse tout particulièrement au contexte historique et iconographique, historiographique, historique-iconographique.
Mon exposé conjugue ces deux aspects. La documentation relative à l'histoire des peintures murales et la fonction des images au sein de l'édifice.
Les Danses macabres peintes tiennent une place importante dans l'art de la fin du Moyen-Âge en France et également dans le paysage artistique de la Bretagne. Tout décor peint est soumis aux modifications de l'édifice qui l'abrite, ce qui augmente sa vulnérabilité. Il faut avoir à l'esprit qu'aucune Danse macabre peinte dans les églises de France ne nous est parvenue intacte. Leur état de conservation est souvent détérioré, lacunaire, surpeint ou restauré. Il faut donc faire une critique d'authenticité et une recherche documentaire.
De la Danse macabre au XVe siècle à sa redécouverte au XIXe siècle.
Le cimetière des Saints-Innocents de Paris a abrité une Danse macabre peinte que l'on peut considérer comme étant la première représentation monumentale du thème qui se mettra en place dès la première décennie du XVe siècle. Le témoignage de l'auteur du journal de Bourgeois de Paris est précieux pour la datation car il indique que la Danse macabre fut peinte entre août 1424 et le carême suivant. Elle couvrait une dizaine d'arcades, mais fut détruite au XVIIe siècle. L'œuvre a marqué les contemporains, que ce soit le moine et poète anglais John Lydgate, qui la vue en 1426, ou l'auteur bourguignon Guillebert de Mets, dont nous avons déjà parlé, proche du duc de Philippe le Bon, qui décrit le cimetière vers 1434 et qui est particulièrement impressionné par les représentations macabres qui y sont peintes et sculptées. Il écrit," Là sont ingénieusement entaillées de pierre les images des trois vifs et des trois morts. Là est un cimetière, moult grand enclos de maisons appelées charniers. Là où les eaux des morts sont entassées, il est son peinture notable de la Danse macabre et autre avec écriture pour émouvoir les gens à dévotion".
La Danse macabre était donc peinte à Paris, mais elle a éveillé constamment et continuellement la curiosité et l'attention des voyageurs, érudits et savants, écrivains et peintres, curés et paroissiens, acteurs du patrimoine.
Le XIXe siècle fut celui de la redécouverte de la peinture murale médiévale dans les églises qui auparavant avaient été badigeonnées ou repeintes.
L'une des plus importantes découvertes fut celle faite à l'église des Dominicains de Strasbourg en 1824. La proximité géographique avec l'Allemagne et la Suisse ainsi que le contexte des ordres mendiants de l'Église devaient rappeler aussitôt la Danse macabre peinte au cimetière de Bâle ou celle de Holbein.
À ce même moment, précisément en 1826, Gabriel Peignot publia les recherches sur les danses des morts, brossant un premier tableau assez large des Danses macabres médiévales au nord des Alpes. Les voyageurs de l'époque découvrent la Danse macabre peinte à la Chaise-Dieu, dont un dessin présentant onze couples de morts et vivants est lithographié par Dauzats en 1831. L'anglaise Louisa Stuart Costello, lors de son voyage en Auvergne, fait une halte à la Chaise-Dieu et admire les richesses de l'abbaye, mais cherche en vain la Danse macabre sur les murs, comme elle dit, moisie.
La première Danse macabre connue en Bretagne est celle de la basilique Notre-Dame du Roncier à Josselin. Ernest de Breillet, habitant du lieu, en réalisant deux dessins en couleur qui portent la date de 1842. Le moment et les circonstances de sa disparition ne sont malheureusement mal connues.
Il faut attendre la fin des années 1850 pour voir se produire d'autres découvertes et non des moindres. À l'époque, la conservation des édifices et de leurs décors peints posaient souvent question, comme on le voit à la chapelle de Kermaria an Iskuit. Charles de Keranflec'h relate dans un article de 1857, la mise au jour des peintures de la nef suite à la chute des badigeons provoquée par l'humidité. Ensuite, Charles de Taillart parle de précieuses peintures représentant un important monument épigraphique. Dès 1858, intervient la commission des monuments historiques car une réelle menace de disparition commence à peser sur l'église et ses peintures. Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, juge la Danse des morts, ou la découverte de la Danse des morts de Plouha, de la plus grande importance. Il décide de confier le travail de relevés cette peinture murale à Alexandre Denuelle, peintre et décorateur. Alexandre Denuelle va réaliser un certain nombre de relevés, 15 relevés, mais aussi 15 calques.
J'insiste sur ces calques qui sont quasi inédits. Je vais vous en montrer plusieurs parce que ce sont des documents très précis et très précieux. Le relevé que vous voyez sur les yeux correspond parfaitement à la découverte ou le témoignage de Jules Geslin de Bourgogne. En novembre 1859, il dit, il écrit à Viollet le Duc et il informe des découvertes importantes à l'église de Kermaria et il dit précisément:" Nous venons d'y trouver des vitraux, un lambris peint et des fresques, le tout du XVe siècle."
Il détaille ensuite toute la Danse macabre en disant:" Nous n'avons rien de pareil en Bretagne, et je crois qu'il en reste fort peu en France et même en Europe, au moins du caractère grave et religieux de celle-ci, antèrieure évidemment aux bouffonneries de Holbein".En mai 1860, le peintre Alexandre Denuelle se dit :" Je suis en compagnie de la danse macabre". Il procède au débadigeonnage de l'église et il va mettre au jour tout le cycle de la Danse macabre peinte. Mais l'état de conservation pose un réel problème. Il alerte tout le service des monuments historiques sur ces problèmes de conservation. Et il dit "l'état sanitaire reste préoccupant. Il vente et il pleut dans la chapelle comme sur la route de Plouha". L'artiste dit pourtant d'être réconforté par l'intérêt réel qu'offrent les peintures. Denuelle réalise donc des relevés et des calques avec une très grande précision, mais il n'est pas le seul. Et Viollet le Duc indique que : "les peintures trouvées dans la chapelle de Kermaria peuvent avoir un intérêt, mais l'édifice n'en a aucun". Donc vous voyez, on a déjà là, à Kermaria des grands acteurs de la commission des monuments historiques, que ce soit Prosper Mérinée, Viollet le Duc, et associé à ces deux grandes figures de la conservation des monuments historiques, Alexandre Denuelle, qui réalise ces relevés. D'autres artistes se sont intéressés, comme vous voyez, Julien Lacaze. On voit aussi un dessin à droite sur l'image montrant Mathurin Meheut en train de réaliser d'autres relevés. On le voit donc sur son échafaudage. Ensuite, il faut attendre longtemps pour avoir une nouvelle restauration parce que le bâtiment et les peintures murales ont pendant longtemps été menacés de disparition. En 1964, le restaurateur Marcel Nicaud intervient et d'ailleurs il doit faire certaines déposes de peintures murales pour sauver celle-ci.
Et la restauration, la dernière qui a eu lieu, a été executée par l'atelier ARCOA en 2013-2014. Mais depuis cette restauration, les peintures murales de la Danse macabre sont beaucoup plus lisibles et on a aussi une trace des différentes interventions.
Les œuvres ont subi les ravages du temps et de l'homme et à Meslay-le-Grenet,il faut rappeler la particularité de Meslay-le-Grenet, est d'avoir un programme iconographique extrêmement riche. Il y a la Danse macabre, mais également les femmes bavardes et le roi mort, et la rencontre des trois morts et des trois vifs. Il faut savoir, quand elle a été découverte, en 1864, les peintures murales étaient détériorées et on s'est servi de gravures de la Danse macabre de Vérard pour au moins reconstituer une partie de cette Danse macabre qui était effacée ou en état de conservation assez usée. Vous voyez la proximité entre cette Danse macabre de Vérard et la partie du mur ouest qui a été restaurée.
À la Ferté-Loupière, on a découvert la Danse macabre en 1910. Et là aussi, le dernier tiers de cette Danse macabre, la fin du cycle, fut assez effacé. Le peintre restaurateur s'est servi des gravures de Guy Marchant pour compléter et reconstituer la fin de la Danse macabre.
Kernascléden, la découverte remonte à 1912. Et là, nous avons un autre témoignage de cette importance de l'usure du temps. Vous voyez, les lacunes sont importantes, mais les lacunes sont restées.
Le deuxième volet de mon exposé s'intéresse à la variété des espaces. À quel endroit la Danse macabre a été peinte dans les édifices religieux ? On a des témoignages de quatorzes danses macabres peintes en France. C'est un chiffre relativement faible quand on le compare à d'autres thèmes macabres, comme notamment la rencontre des trois morts et des trois vifs, dont on connaît 104 représentations en France et sur les quatorzes Danses macabres connues ou documentées, il n'y en a que neuf qui sont conservées.
Vous voyez ici la Ferté Loupière. La peinture monumentale a été un réel vecteur pour l'essor ela diffusion du thème de Paris que j'évoquais. Le thème a été diffusé vers l'Auvergne, vers la Bourgogne, vous voyez ici, ou encore la Bretagne et l'Alsace.
Mais il faut également tideux plafonds peints qui sont moins connus, celui de la collégiale Saint-Salvi à Albi et du château de la Bâtie de Montceaux(Ain) .
Je vais maintenant parcourir quelques Danses macabres pour évoquer notamment leur intérêt historique, mais aussi artistique.
Les espaces diffèrent, et à la Chaise-Dieu, en Auvergne, à l' Abbatiale Saint-Robert, on a choisi la clôture du cœur pour peindre cette Danse macabre. Une Danse macabre exceptionnelle, elle couvre aussi bien les murs que les piliers. Et le cycle commence avec une représentation d'Adam et Ève et le prédicateur. Donc, il y a ce long défilé que vous voyez ici, le début de cette Danse macabre. Vous voyez que la peinture murale a beaucoup perdu de sa matière, mais il reste le fabuleux dessin préparatoire qui nous permet d'apprécier toute la qualité artistique. Donc ce dessin, l'artiste montre un dessin vigoureux, presque nerveux, et ce côté de ce dessin très abouti donne une force majestueuse aux personnagex, qu'ils soient morts ou vivants.
L'amoureux affiche une grande élégance. avec son habit très court et serré à la taille. Et son air juvénile et la beauté de son corps rendent cette séquence tragique, car il se soumet à la mort en laissant tomber la branche fleurie, signe d'abandon de la vie. L'artiste connaissait bien aussi le contexte local, car il reproduit fidèlement l'aumusse que porte ici le chanoine, une aumusse particulière des chanoines du Puy-en-Velay. Et vous voyez de nouveau cette qualité des mouvements et des gestes. En effet, la fin de cette Danse macabre qui montre la fin de ce défilé, jusqu'au dernier mort, qui se penche vers l'enfant, presque dans une position convulsionnée. C'est une incroyable mise en scène que l'artiste réussit très, très bien. Il pourrait être proche du milieu parisien, mais peut-être aussi originaire d'un contexte berrichon. La datation de la Danse macabre de la Chaise Dieu, vers 1430, correspond à l'abbatiat d'Hugues de Chouvigny de Blau, et l'œuvre est donc très près chronologiquement de celle de Paris.
La Danse macabre à Kernascléden nous place dans un contexte ducal. L'église est une fondation du vicomte Alain IX de Rohan, et l'espace qui a été choisi est plus confiné. Vous avez une partie inférieure qui occupe la Danse macabre,et peint au-dessus est peint l'enfer. Là, ce qui est intéressant, cet enfer, je place cette Danse macabre dans le contexte ducal parce que tous les indices convergent pour attribuer ce décor ou le mettre en relation avec Jean V dont les armoiries figurent sur la voûte du transept. Donc une datation vers 1430-1440 peut paraître précoce, notamment pour l'enfer;
Mais on a d'autres représentations, comme ici un site de Lassay-les-Château en Mayenne, qui est assez proche. Cette Danse macabre est introduite par un prédicateur, et ces deux cartouches, mis en évidence, et qui rappellent cet enfer, et qui disent, je mets les textes: " Hélas, ils auront chaud".
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez, ce prédicateur a un rôle essentiel. Il introduit la Danse macabre.
Une autre figure qui est le connetable qui est ici à côté du cardinal rappelle la figure dans un manuscrit Rothschild étudié par Laurent Ungerheuer et là qui nous place plus précisément dans le contexte du connetable de Richemont. Et là, forcément, on est dans un contexte breton, un contexte ducal qui est une hypothèse de ma part, mais c'est séduisant de pouvoir placer ce décor dans ce contexte seigneurial ducal.
Une autre configuration à Kermaria, où l'espace est énorme. Donc cette monumentalité est exploitée par l'artiste, aussi bien qu'il représente la rencontre des trois morts et des trois vifs, mais aussi cette Danse macabre. Là on se rend vraiment compte que l'espace de la nef a été utilisé pour représenter ce long défilé. En dessous de la Danse macabre, il y a des prophètes, tout un cycle de prophètes, et c'est également un point très important qui enrichit le programme iconographique. Et ces prophètes étaient également représentés à Strasbourg, à l'église des Dominicains, que j'évoquais tout à l'heure.
Voilà quelques détails de ce décor extrêmement riche et beaucoup plus lisible depuis la dernière restauration. Vous voyez aussi les donateurs qui sont représentés. Et des recherches toutes récentes que j'ai menées avec Alina Zvonareva marquent un point concernant les inscriptions. Vous avez vu au fil de mon exposé que l'écrit, les textes sont omniprésents dans les peintures murales. Et ici à Kermaria, on est clairement avant toutes les éditions imprimées. J'ai entouré quelques mots qui le confirment. C'est-à-dire, il y a des expressions comme "envahir" "hélas" "bien par soi" qui sont différentes dans les éditions imprimées. Donc la datation, la réalisation des peintures murales à Kermaria est antérieure aux éditions imprimées.
Josselyn, qui a malheureusement disparu, très proche géographiquement de Kernascléden et dont on conserve ses dessins très précieux.
Très rapidement, j'évoque d'autres sites où la peinture murale occupe tout l'espace de l'édifice. Ici à Brianny, une chapelle entièrement peinte avec la Danse macabre est la première fois où on représente les femmes. Donc là, nous sommes plutôt plus tard, nous sommes vers la fin du XVe ou le tout début du XVIe siècle, également à Preuilly-sur-Claise, où il y a également une représentation des hommes et des femmes.
Je me suis toujours intéressée beaucoup à la fonction des images. J'ai conclu ainsi. Donc le parcours chronologique que je vous propose invite à considérer la Danse macabre de Paris comme un point central, voire un point de départ. Elle a marqué les témoins oculaires à l'époque et sa réception un peu plus de demi-siècle plus tard par l'édition imprimée atteste l'intérêt grandissant pour le sujet qui se répercutera ensuite et assez vite sur d'autres ensembles monumentaux. Le retable de Saint-Bertin, de l'abbaye Saint-Bertin, ici commandité par Guillaume Fillastre et peint par Simon Marmion, montre comment on voyait cette Danse macabre. Vous voyez dans ce cloître des laïcs qui la contemplent. Et Simon Marmion réussit à peindre l'image dans l'image.
La Danse macabre dans son aspect monumental a été choisie aussi bien par des commanditaires religieux, que des laïcs et la force réceptive du thème semble résider dans l'union de deux éléments : l'ancrage dans une tradition textuelle et l'expressivité de l'image de la mort. L'un comme l'autre, avait son public, d'hier à aujourd'hui. Je vous remercie.