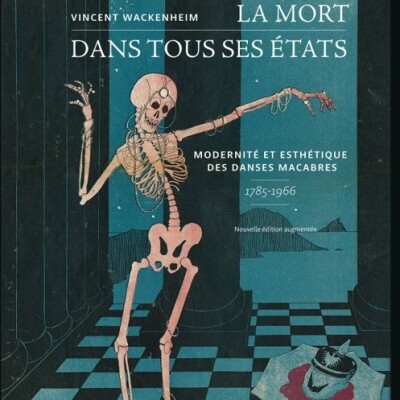Cristina BodganJe vais vous inviter à voyager à travers la Roumanie, puisque c'est mon devoir en tant que roumaine de vous faire connaître le patrimoine culturel, matériel et immatériel de mon pays. Puisqu'au congrès de Paris en 2019, j'ai parlé d'un saint assez peu connu dans le monde occidental. Il s'agissait alors de saint Sisoes, se lamentant devant la tombe ouverte d'Alexandre le Grand. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un saint qui est, je pense, plus connu à l'Occident.
Il s'agit de saint Charalampe. Il a un nom intéressant. L'étymologie grecque de son nom signifie grâce lumineuse ou rayonnement de joie. Ce nom vient de cara joie et lampo briller. Il est très vénéré dans le monde occidental, balkanique, surtout en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie. Et son culte a été rapporté de Grèce au XVIe et au XVIIe siècle, avec une implantation spécifique dans le nord de la France, dans la région picard et en Belgique. Il est d'habitude invoqué contre les maladies infectieuses, traditionnellement contre la maladie de la peste et du choléra. C'est pour cela que je l'ai choisi, puisque vous allez voir dans ses représentations, si l'on parle des représentations dans les enluminures ou dans les dessins des manuscrits, dans les icônes sur verre ou dans les fresques ou dans les peintures des églises en bois du nord du pays, on peut voir que le saint domine une représentation, une représentation horrible, affreuse, de cette maladie de la peste. Les épidémies de peste ont laissé une empreinte indélébile sur les périodes temporelles où elles se sont manifestées. Un tel climat d'effroi ne peut donner naissance qu'à des réactions situées à l'extrême. De tous les types de catastrophes, la Peste semble être restée la plus profondément imprégnée dans le mental collectif, d'autres maladies se cachant en réalité sous le même nom. Les épidémies de peste restent fréquentes dans les pays roumains. Je vous ai mis ici une carte de la terre roumaine du XVIIIe siècle. Vous pouvez voir la partie sud qui est la Valachie, la partie centrale, la Transylvanie et la Moldavie. Mais je vais parler aujourd'hui des représentations du saint Charalampe de la Valachie et de la Transylvanie. Et de l'Olténie, bien sûr, qui fait partie de la Valachie. Les épidémies de peste restent fréquentes en Oltenie, Transylvanie et Maramures jusqu'au milieu du 18e siècle. La dernière épidémie de grande proportion date en 1755. Mais on ne peut pas estimer, dans l'absence de statistiques précises, quel a été l'impact de la peste sur la population des espaces roumains au XVIIIe et XIXe siècles et comment se sont modifiées les courbes démographiques. Chez les Roumains, comme dans le cas des peuples balkaniques orthodoxes, surtout dans les cultures grecques et bulgares, il existe une suite de saints dont la compétence se manifeste dans le domaine médical, étant considérée comme des patrons des maladies. Saint Charalampe est secondé par deux autres saints regardés parfois comme ses disciples, Athanase et Cyril, archevêques de l'Alexandrie, honorés le 18 janvier. À ceux-ci s'ajoutent la sainte grande martyre Marina, le saint grand martyre et thaumaturge Pantéleimon et les saints anargyres Côme et Damien, la sainte martyre Barbara, saint Sabaș le sanctifié, etc.
Mais saint Charalampe reste le seul qui soit accompagné par la personnification de la maladie qu'il a vaincue, la Peste. Célébré à la date du 10 février dans le calendrier orthodoxe, le saint Charalampe est représenté dans les icônes sur verre de l'espace transylvain, dans la peinture murale de Valachie, surtout dans la zone de l'Oltenie et bien sûr de Transylvanie, dans des gravures ou dans les illustrations des manuscrits roumains. Et je veux commencer par deux images. Par deux manuscrits roumains qui se trouvent dans les collections de la Bibliothèque de l'Académie roumaine de Bucarest, quelques-uns des manuscrits contenant la vie et la paraclisis du saint Charalempe, conservés dans les collections de la Bibliothèque de l'Académie roumaine, proposent des dessins à la plume, à l'encre noire et rouge, qui surprennent la relation hiérarchique entre les deux personnages. Le saint apparaît dans la pose de vainqueur de la peste, la tenant solidement enchaînée, histoire de protéger contre l' affreuse maladie tout ce qui le vénère, tout comme atteste le fragment final de la hagiographie. Dans son hagiographie, on a, à la fin une sorte de prière concernant ceux qui veulent échapper à la maladie. Un autre exemple, toujours d'un manuscrit de la Bibliothèque de l'Académie roumaine de Bucarest.
Et je vais passer maintenant aux icônes sur verre. Si nous analysons les icônes sur verre qui représentent saint Charalampe,nous constatons qu'on peut les repartir en quelques types iconographiques. Le plus souvent, le saint est représenté dans la pose d'évêque, en vêtements sacerdotaux, d'après le modèle des icônes avec Jésus-Christ, Grand Hiérarche ou de celles de saint Nicolas. D'ailleurs, on a beaucoup de ressemblances entre saint Nicolas et saint Charalampe.
Ici, vous pouvez voir deux icônes sur verre qui ont été peintes par le même artiste. Ce sont deux icônes faites par le même artiste vers le milieu du XIXe siècle. Assis sur un tronc, donnant la bénédiction avec sa main droite et tenant l'évangile à gauche. À la main qui porte le livre saint est attachée aussi la chaîne qui tient la Peste, liée au pied du saint.
Cette chaîne est perçue dans le folklore roumain, comme un objet magique qui aide saint Charalampe à dominer et à contrôler la Peste. Plus que cela, selon les diverses variantes populaires hagiographiques, le saint a le pouvoir d'enchaîner quiconque et de le délivrer ensuite grâce à l'aide divine reçue comme récompense pour sa longue foi et l'acceptation du martyr, puisqu'il est considéré le plus âgé des martyrs.
Il y a des documents dans lesquels il est mentionné qu'il a vécu 107 ans ou d'autres documents dans lesquels il est mentionné qu'il a vécu 113 ans.
Parfois, d'une part et de l'autre de la tête de saint Charalempe apparaissent, comme dans les icônes dédiées à saint Nicolas, la Mère de Dieu et Jésus-Christ, ou plus rarement, d'une part Jésus-Christ qui le bénit et de l'autre un ange qui est en train de lui poser une couronne de laurier sur la tête.
En guise d'exemple, voilà une icône datant du troisième quart du XIXe siècle d'une collection privée de la famille Mușat de Bucarest.
Le saint peut être figuré aussi en position pédestre en renonçant au trône. En train de faire le même geste de bénédiction, l'évangile dans la main gauche, à laquelle il tient aussi la chaîne qui contrôle la Peste.
Dans la collection privée de la famille Mușat est conservée également une représentation du saint dans lequel l'évangile est remplacé par une icône de la Mère de Dieu avec l'Enfant. C'est un cas vraiment unique dans le patrimoine roumain. Il y a aussi des cas où derrière le personnage se profilent des silhouettes des bâtiments, d'une architecture religieuse et laïque, en suggérant ainsi l'idée d'une cité ou d'une ville, probablement l'espace hanté par le spectre de l'incurable maladie. Et je fais un collage avec des représentations des églises pour voir un tout petit peu l'architecture religieuse, qui d'ailleurs retrace le modèle des églises de l'espace roumain.
Beaucoup plus rarement, l'image du saint Charalampe est intégrée dans une scène complexe, comme la table du paradis ou bien de manière analogue dans des icônes du type iconostase à côté de la Mère de Dieu avec l'Enfant et encore deux saints dont l'on est le plus probablement saint Nicolas.
Ici, vous voyez une icône avec la table du paradis et on peut voir la Mère de Dieu avec l'Enfant, Jésus-Christ, saint Charalampe et saint Nicolas.
À son tour, la Peste est représentée comme un monstre composite à tête humanoïde, la langue fourchue, avec des cornes de bœuf et une queue de serpent, des mains et des pieds griffus, tenant comme d'habitude une faux à la main. Parfois, au-dessus de sa tête est placé un sablier, symbole de l'écoulement du temps, ce qui la rapproche des représentations de Kronos ou de Thanatos du monde occidental. Dans les visions apocalyptiques des périodes où la maladie atteint le paroxysme, le personnage est muni d'un chariot, les roues faites des têtes de grands boyards, le plateau fait des côtes des pucelles, les tressailles faites des os de garçons et les essieux des os des braves. Cette image du voyage victorieux de la Peste rappelle "les Triomphes de la Mort" de la peinture italienne du XIVe et XVe siècle.
Et je vais vous montrer encore quelques exemples. Quelques représentations de la Peste pour voir la manière dont les peintres populaires, les peintres qui ont fait les icônes sur verre l'ont conçu. Squelettes de couleur foncée,( brunâtre, grise, grisâtre,) ou personnages humanoïdes dans des nuances claires, la Peste nous est présentée dans les icônes sur verre peintes par des artistes populaires transylvains, tenant à la main un faux, instrument qui l'approche de la personnification de la Mort, et ayant parfois au-dessus de la tête le sablier, symbole commun du temps dans les représentations occidentales.
Portant souvent des cornes pour marquer l'appartenance à la catégorie du mâle, le personnage peut avoir un corps humanoïde ou zoomorphe. Le fait de le représenter dans quelques icônes sur verre avec des moustaches et une barbe, le situe dans la zone de la masculinité, tout comme dans d'autres situations, le dessin évident des seins et les cuisses saillantes l'incluent dans la sphère de la féminité.
Je vais vous montrer maintenant deux images, qui se retrouvent dans des églises, en bois de Maramures, où on a seulement la représentation de la Peste. Ici, on n'a pas l'image de saint Charalampe, mais on a une sorte de défilement des... des catastrophes. Par exemple, dans l'image d'Ultjug, on peut voir la mort, la peste et la paresse, puisque la paresse était considérée un vice très grave dans la pensée traditionnelle roumaine. Et on peut voir que le personnage de la peste est représenté en tant que femme. Et je veux vous montrer aussi des images qui se retrouvent dans les églises transylvaines de Brașov, surtout dans le département de Brașov où vous allez voir que la peste qui est tenue par sa tête, par ses cheveux, par saint Charalampe, est représentée en tant que monstre sans genre.
Les maîtres peintres de certains des édifices de culte de Valachie, ou du sud de Transylvanie, ont éprouvé le besoin de présenter les deux saints, par exemple ici Charalempe et Christophe, l'un à côté de l'autre, comme pour offrir aux fidèles des respectifs lieux religieux une double protection. Je vais vous montrer quelques cas. Ce sont des églises peintes vers la fin du XVIIIe siècle et vers le début du XIXe siècle. On peut voir la peste enchaînée par saint Charalampe. Et on a aussi des cas beaucoup plus rares avec des icônes sur bois où l'on peut voir plusieurs saints, comme ici saint Jean-Christophe, saint-Charalampe, Nicolas et Grégoire. C'est une icône sur bois dans les collections du musée du village de Bujoreni, dans le département de Vâlcea. Elle a été peinte au début du XIXe siècle.
Bon, je reprends. À l'église Turcenii ,dans le département de Jos, saint Charalempe, placé sur le côté nord de l'exonartex, a à ses pieds un personnage féminin qui peut être interprété également comme une incarnation de la Peste ou de la Mort. Les historiens d'art roumain ne sont pas encore décidés s'il y a la représentation de la Peste ou de la Mort. Dans ce contexte, le personnage semble emprunter quelque chose des compétences de l'infatigable protecteur contre la mauvaise Mort. Dans d'autres espaces culturels aussi, comme celui bulgare ou grec, il y a une relation étroite du type substitutif entre la Peste et la Mort. Dans le même paradigme, on peut inclure également les représentations du choléra.
Vers la fin de mon exposé, je veux seulement mentionner quelques solutions offertes par la thérapeutique ou la magie populaire pour combattre la maladie de peste. Sur le territoire roumain, les mesures prises par la police sanitaire sont accompagnées de nombreuses solutions du domaine de la thérapeutique ou de la magie populaire. À part les fumigations à la résine du goudron ou au phosphore pratiquées sur grande échelle, on utilisait aussi les cataplasmes aux orties bouillies. On croyait aux vertus prophylactiques de l'huile, à usage externe et interne à la fois. À la campagne, certaines pratiques visaient l'entière communauté, menacées par le spectre de la maladie exterminatrice. On faisait le tour du village et on l'enfumait avec divers grains ou mauvais herbes, brûlés dans un crin de cheval, où l'on traçait un sillon autour des confins du village, à l'aide d'une charrue tirée de quatre boeufs noirs pour empêcher la peste d'y entrer.
Les rites de circumanbulation représente un procédé très ancien de protection connu dans toute l'Europe. Une coutume attestée sur presque tout le territoire roumain, c'est une coutume vraiment très intéressée puisqu'elle est commune pour le monde roumain, bulgare et grec, et c'est de la chemise de la peste. En lisant les réponses au questionnaire fait par les ethnologues à la fin du XIXe siècle, on constate l'unité de vision concernant les modalités utilisées pour accomplir ce geste au rôle exorcisant. Le nombre et l'état des femmes qui vont confectionner l'objet vestimentaire, neuf femmes absoutes, la réalisation de la chemise dans une seule nuit, mais aussi les variants d'interprétation de la finalité de l'acte, l'enterrement de la peste, ou le geste de l'éloigner, de la chasser vers un autre espace. Je cite :"les femmes se rassemblent, font une poupée de chiffon à forme de femme. Ensuite, toutes fabriquent pendant une nuit une blouse paysanne, laquelle doit être tissée, cousue la nuit même. Enfin, on vêtit la poupée, à savoir la peste, avec cette blouse. Le lendemain matin, on enterre la poupée près d'une croix dans un carrefour en lui faisant un pommier, arbre traditionnel fait des aumones données lors de la cérémonie d'enterrement. Tandis que les femmes chantent, se lamentent, comme un enterrement réel. C'est l'enterrement vraiment de la Peste".
Ou on a une autre manière de faire éloigner la peste, un échange symbolique entre deux partenaires, une sorte de "do ut des". Dans les formules à valeur de charme prononcées pendant la fabrication de la chemise, revient l'idée du don que la communauté fait au spectre de la maladie pour le radoucir et le déterminer de s'éloigner. Je cite :" J'ourdis, je tisse, je taille, je la couds pour toi seule. Neuf femmes y travaillèrent, non seulement moi. Pour toi, nous l'avons cousue. Pour toi, nous l'avons faite et tu la trouves sur la colline. Prends notre don de notre village, de la colline et ne reviens jamais plus chez nous. Nous t'avons donné sept poules pour te nourrir. Mange-les et nourris-toi. Celui qui les poules mangera et la chemise endossera dans notre village, jamais plus ne passera".
Je vous prie de mémorer.
Bon, je vais fermer. Merci beaucoup.