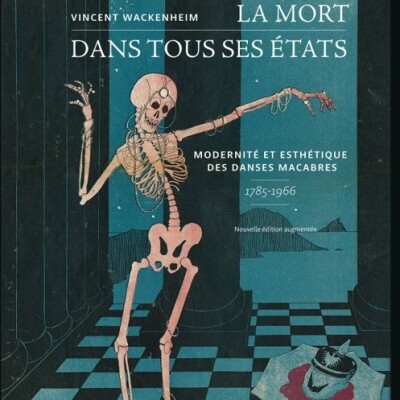Didier JuganMerci beaucoup. J'interviens ici au nom de l'association Danses macabres d'Europe, qui regroupe 130 personnes dans toute la France, et dont le but est de faire des études sur les représentations de la Mort dans l'art, dans la littérature et dans l'histoire.
Le titre de l'exposé : "La Danse macabre entre fiction édifiante et critique du monde structura ma présentation".
Rendons à César ce qui appartient à César. L'expression "fiction édifiante" à propos de la Danse macabre n'est pas de mon cru. Elle est empruntée à l'historien Jean-Claude Schmitt dans son livre sur "Les Rythmes au Moyen-Âge".
Le terme de Danse macabre apparaît pour la première fois à la fin du XIVe siècle, en 1376 dans un livre, "Le respit de la mort", un texte de 3760 vers, qui a été composé par Jean Le Fèvre, procureur du Parlement de Paris.
Dans son texte, il dit :
" Je fis de Macabré la danse,
Qui toutes gens mènent à la tresse (alors la tresse, c'est une sorte de danse),
Et à la fosse les adresses,
Qui est leur dernière maison.
Il fait bon en toute saison
Penser à sa fin dernière".
On ne sait pas si la Danse macabre est une œuvre littéraire dont Jean Le Fèvre aurait été l'auteur. Aucune trace n'en est restée.
Mais plus vraisemblablement, c'est une référence au fait que Le Fèvre, atteint d'une grave maladie, a été confronté à la mort et a eu une proximité avec elle. Il en a réchappé, ce qui explique le titre de son livre, "Le respit de la mort". Cette deuxième interprétation est importante car elle signifierait que l'expression "faire la Danse macabre" était bien connue avant la fin du XIVe siècle et serait une sorte de synonyme de "mourir" ou de "s'approcher de la mort".
A noter que le mot "macabre" était accentué en Macabré, (on le sait par des rimes dans certaines versifications), et c'est sans doute un nom de personne, peut-être l'auteur du texte, où bien un personnage central du récit.
Dans le "Journal d’un bourgeois de Paris" on a pour les événements de l'année 1425 une mention plus explicite "En outre, l’an mil 1424, fut faite la Danse macabre aux Innocents et fut commencée environ le mois d’aout et achevée ou careme suivant" c'est-à-dire en 1425.
Dans un écrit de Guillaume de Mets, à propos du cimetière des Saints-Innocents à Paris, daté de 1434, on apprend que dans ce cimetière, "Il y a des peintures notables de la Dance macabre avec des écritures pour émouvoir les gens dans un rapport à la dévotion". On sait par d'autres écrits que ces peintures accompagnées de textes avaient été réalisées sous 20 arcades du charnier des lingères du Cimetière des Saints-Innocents à Paris, sous les arcades qui longeaient la rue de la Ferronnerie, et qui correspond à peu près au quartier du Châtelet, si vous voyez la fontaine des Innocents, c'est dans ce coin-là.
La peinture a été réalisée en pleine guerre de Cent Ans, alors que Paris était occupée par les Anglais, alliés au duc de Bourgogne. On ne connaît ni son auteur, ni son commanditaire.
Le charnier et les peintures ont été complètement détruits en 1669. Cependant, la peinture parisienne nous est connue par les gravures de l'imprimeur et libraire parisien Guyot Marchant gravure réalisée en 1485 et reprise avec ajout de personnages par Marchant dès 1486. Ça a tellement bien marché qu'il a fait un deuxième volume où il rajoute des personnages. Il fait figurer les textes qui étaient peints aux Saints-Innocents et on suppose que les figures reproduisent plus ou moins fidèlement celle de la peinture murale. De l'édition de 1485, iL ne nous reste qu'un seul exemplaire qui est conservé à la bibliothèque de Grenoble et dont les premières pages nous manquent. Il y avait 30 personnages. On peut, à partir de l'exemplaire de 1486, reconstituer les personnages manquants. Il y avait l'acteur, le pape, l'empereur, mais les quatre morts musiciens qui figurent dans la deuxième page sont une création de 1486.
On sait qu'il n'existait pas sur l'original, comme on peut le voir sur l'imprimé d'Antoine Vérard, qui est un peu postérieur, vers 1491. La gravure a été mise en peinture, sans doute à destination du roi Charles VIII.
On a ici deux des cinq feuillets. L'ensemble représente toute la Danse macabre des Saints Innocents, avec 30 personnages.
On y retrouve l'acteur. Puis vient le pape, le roi, etc... et si on passe à la page d'après, on a le cardinal, le roi, et ainsi de suite, donc toute la société est représentée.
Très vite, je passerai sur ce qui est souvent mis en avant pour expliquer la vision pessimiste de la Danse macabre. On l'explique par les trois fléaux, que sont la guerre, la famine et les épidémies. On est à la fin de la Guerre de Cent Ans, les récoltes ont souvent été ravagées par la guerre, et le souvenir de la peste, la peste noire qui a son apogée au XIVe siècle, sont encore très présents.
Même si ces éléments ont pu avoir leur importance, l'historiographie moderne explique plutôt l'émergence du sujet des Danses macabres par une évolution de la pensée cléricale. J'y reviendrai au cours de mon exposé.
Sur l'enluminure que vous avez sous les yeux, Dieu remet trois flèches qui représentent ces trois fléaux à la mort allégorique. Dieu investit la Mort d'un mandat. Le mandat, c'est le document qu'il tient à la main gauche. Donc un mandat, on voit les trois sceaux de ce mandat, qui est une autorisation pour la Mort d'intervenir pour interrompre la vie des hommes. Un sujet que Jean Mielot,- secrétaire du duc de Bourgogne Philippe Le Bon et homme d'église-, qu'on voit à gauche, a traité dans un autre livre, "le Mors de la pomme", contemporain des Danses macabres, sans doute vers 1460.
Les influences littéraires de la Danse macabre sont à rechercher dès le XIIe siècle, principalement dans les textes à résonance cléricale. Je les ai séparés en trois grandes familles, mais je ne les décrirai pas précisément.
Alors, les trois grandes familles,
- c'est d'abord les textes qui montrent la porosité entre le monde des vivants et celui des morts. Ce sont des récits d'apparition de revenants, demandent souvent aux vivants de prier pour eux, pour soulager leur souffrance purgatoire.
- La deuxième famille de textes est centrée sur les performances jouées. Philippe Le Bon a financé une Danse macabre jouée dans son hôtel particulier à Bruges fin septembre 1449. "De même, on a payé 4 simaisses de vin pour celle qui a été jouée dans l'église cathédrale de Besançon le 10 juillet 1453". Mais aucune précision sur le type de spectacle.
Plus intéressant... L'abbé Miette, au XIXe siècle, découvre dans les archives de Caudebec un document aujourd'hui disparu relatif à une représentation théâtrale qu'il décrit.
Je cite : " En 1393, on avait dansé dans l'église de Caudebec, une danse religieuse fort semblable à un drame. Les acteurs représentaient tous les états, depuis le sceptre jusqu'à la houlette. À chaque tour, il en sortait un, pour marquer que tout prenait fin, roi comme berger".
Cette danse, sans doute, n'est autre que la fameuse Danse macabre. Il sous-entend que les personnages faisaient des tours et qu'arrivé à une certaine position, un personnage s'exprimait peut-être et il disparaissait ainsi, tour à tour, dans l'au-delà. Dans la description, il n'y a pas de dialogue a priori avec la mort. J'ai tenté de représenter ici schématiquement ce que pouvait être la mise en scène.
Par ailleurs, la Danse macabre des Saints-Innocents présente des éléments assez compatibles avec une performance. On a vu qu'on avait un acteur et on a surtout des dialogues. Et donc la présentation de dialogues sur une peinture fait qu'effectivement c'est quelque chose qui devait être joué.
La découverte récente, en 2014 par Georges Fréchet, d'un document conservé aux archives de Chambéry, permet de donner plus de consistance à l'existence d'une Danse macabre comme une moralité qui a pu être jouée.
Ce document est un rôlet de théâtre, c'est-à-dire le texte que doit dire un acteur, sa partition en quelque sorte. De cette pièce de théâtre, on n'a retrouvé qu'un seul rôlet qui correspond aux répliques de l'interprète qu'on appellera "le Mort" ou "la Mort". Les textes des autres personnages ont disparu.
Le rôlet du "Mort" est incomplet, il se compose de cinq feuillets reliés par des ficelles. Certains sont en très mauvais état, le premier feuillet est presque complètement lacunaire, et comme c'était écrit recto verso, il nous manque à la fois les textes adressés aux premiers personnages, (le pape, l'empereur et le cardinal), mais aussi ceux du milieu de la pièce.
Le texte en notre possession commence avec les répliques que "la Mort" ou "le Mort" adresse au roi. On suit après tous les personnages de la Danse macabre des Saints-Innocents, mais les textes sont originaux, complètement différents de ceux de la famille Saints-Innocents.
Première conclusion, on a bien, alors que la Danse macabre nous présente un ensemble de squelettes discutant avec des vifs, on a bien un seul acteur qui joue "la Mort" ou "le Mort", qui va s'adresser à chacun des états.
Je ne m'attarderai pas trop sur cette diapositive qui montre simplement l'organisation des dialogues. À la différence du texte des Saints Innocents où le mort parle d'abord et le vif lui répond, ici on a une structure où le mort interpelle le vif sur un vers, ainsi pour le connétable il dit « connétable chantez droit ». Le vif parle sur un octain, donc huit vers. On ne possède que la fin de la réplique. En fait, la fin de la réplique, c'est ce qui est sur le rôlet du Mort. C'est-à-dire que c'est un moyen de dire à celui qui intervient, c'est à ton tour de parler, parce qu'on voit simplement les dernières phrases, "Dieu failli", les derniers mots de la réplique de celui qui est avant lui.
Puis le Mort interpelle le connétable sur sept vers, avant de s'adresser au huitième vers, au personnage suivant, (ici l'archevêque), avec "Archeveque, chante aussi".
Plus intéressant pour cet exposé est la fin du texte, ce qui est dit après le dernier vif qui est l'ermite.
Le même personnage, le même acteur, celui qui emmenait tous les vivants, parle de ce qu'il était avant de mourir, dans un rapport d'introspection et de réflexion sur le salut. On retrouve ainsi le rôle joué par le roi mort.
Ici, ce n'est pas un roi, mais un simple chevalier qui avait l'habitude d'aller chasser. Voilà ce qu'il dit: "J'avais l'habitude de faire voler les oiseaux et de mener en chasse divers chiens. J'avais bon corps et belle face. Cela ne m'a pas orné longtemps. Voyez comme je suis défiguré. Prenez-en exemple pour vous, afin d'éloigner le péché de votre cœur".
Le texte poursuit avec beaucoup de lacunes, mais on peut reconstituer le sens. "Celui qui n'a de péché cure, (c'est-à-dire celui qui n'a pas souci du péché), doit faire le bien, sinon c'est un fou." Et plus loin: "je suis de vers, de viande et de proie, pour que sache un chacun et voit qu'au monde il n'y a ni plaisir ni joie et que tous ne tiennent cette voie". C'est-à-dire que, personne ne suive la voie du monde. II n'y a ni plaisir ni joie dans le monde.
En résumé, on peut dire que la Danse macabre des Saints-Innocents dérive d'un modèle théâtral. C'est un mort qui va chercher les vivants (et non la Mort allégorique). L'illusion de plusieurs morts que donnait la peinture et qu'on retrouve sur la gravure est un effet qui renforce l'idée d'une armée des morts, une inquiétude qui fera le succès de la Danse macabre. Mais ce n'est qu'un moyen de représenter les dialogues des vifs avec un mort unique. Le roi mort ne serait pas un personnage particulier, mais celui qui a mené les dialogues avec chacun des vivants.
S'il faut voir dans le mort qui entraîne le vif un effet miroir, cette notion de double a ses limites. Comme on a un personnage unique selon la version théâtrale, quand celui-ci s'adresse à l'enfant, il ne prend pas la taille de l'enfant et le déséquilibre spéculaire devient flagrant.
Entraîner les vifs vers la danse de l'au-delà, avec plus ou moins de violence, assimile bien sûr le mort à la Mort allégorique. Et très tôt avec la perte de référence de la version théâtrale la porosité entre un mort et la Mort s'accentue, et dès le début du XVIe siècle, le personnage qui entraîne est systématiquement la Mort allégorique.
Dans cette représentation allemande, c'est le cas, der Tod, c'est un masculin, mais en fait, en allemand, la Mort, c'est un masculin. Dans ce couple mort-vif, c'est dorénavant la Mort qui entraîne chacun des personnages.
À la fin du XVe siècle, la Danse macabre n'est plus seulement le rythme qui accompagne le passage de vie à trépas, quand le mort accompagne son vif ou que la Mort l'emporte. La danse frénétique devient ainsi, dans quelques illustrations, une activité persistante de gesticulation, sautillante d'ailleurs. C'est le quotidien des morts dans une sorte de lieu purgatoire localisé dans le cimetière, où sont enterrés les corps et où les âmes sont contraintes d'évoluer en attendant leur montée au paradis.
Tout le contraire du "Requiescat in pace" (reposez en paix).
La Danse macabre de Jacob Meydenbach débute par cette image d'un cimetière accompagnée du texte de mise en garde d'un des occupants. Je cite: "Toute plaisanterie et tout rire s'évanouit quand nos pas nous mènent à cette maison de danse. Par ces figures, observez et contemplez, où mène la nature de l'homme".
Dans le livre des Chroniques de Nuremberg, on a cette même Danse des morts. La gravure est située dans la partie du livre correspondant au temps dernier, après la venue de l'Antéchrist et juste avant le Jugement dernier. La phrase latine qui accompagne la gravure précise à l'orée du jugement qu'il vaut mieux être mort (dans cette danse frénétique et contrainte, dans ce Purgatoire, car le Paradis approche).
On sait que dans la vision chrétienne des choses, les gens qui vont au Purgatoire ne le seront que jusqu'au Jugement dernier, et leur vocation au Jugement dernier, c'est d'atteindre le Paradis. Donc en fait, il y a une sorte de contentement, comme dans le livre des Chroniques de Nuremberg, où on est très près du Jugement dernier. Finalement, c'est une sorte de plaisir de se dire, on va bientôt connaître Dieu.
Plutôt cette mort donc, que d'être vivant dans le Monde sans contrainte, reprenant l'idée que, pour le salut, une vie facile dans le Monde est pire que les affres de la mort temporaire.
Ce sera l'argument porté encore au XVIIIe siècle par des prédicateurs jésuites comme Jérémie Drexel qui préfère l'homme malade, car il est dans des dispositions, des conditions spirituelles pour penser à la suite, alors que celui qui est bien portant, ne pense qu'à s'amuser dangereusement et danser sans souci de son salut éternel. C'est une logique un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais qui est très cléricale.