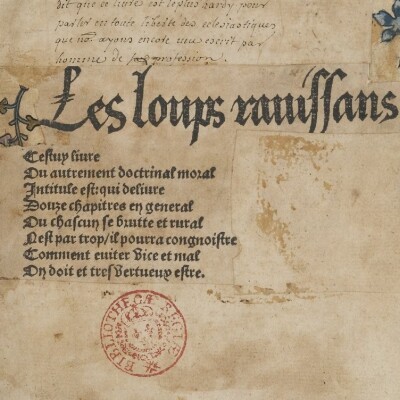Michèle BoccardBonjour à toutes et à tous, j'ai choisi de vous parler des ossuaires en Bretagne, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et évidemment, l'ossuaire, on le lit partout, est dans la région un élément qui occupe une place centrale, essentielle dans l'ensemble ecclésial. Et si les exemples les plus imposants, les plus célèbres aussi, appartiennent à l'époque moderne, les plus anciens remontent a priori au début du XVe siècle et relèvent plutôt à la fois, pas seulement par leur datation, mais aussi par leur style architectural, décoratif, de la période médiévale dont je suis plutôt spécialiste. Je ne suis pas certaine qu'il soit vraiment nécessaire de vo us rappeler ou de vous apprendre ce qu'est un ossuaire, mais imaginons quand même qu'il y a parmi nous des auditeurs qui l'ignorent encore.
Donc, en deux mots, un ossuaire, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est une structure, pas nécessairement monumentale d'ailleurs, dans laquelle on entrepose les ossements lorsque la place vient à manquer pour de nouvelles sépultures. Il se trouve que le plus ancien ossuaire, charnier, que l'on connaisse bien, c'est celui du cimetière des Saints-Innocents à Paris. Et ce charnier, il frappe les contemporains par ses dimensions autant que par son décor. Il a peut-être été construit dans les années 1420. Il se présente comme une succession de charniers, de maisonnettes, pour reprendre les propos de Guillebert de Mets, placé le long de la clôture du cimetière. Guillebert de Mets, vers 1430, parle de maison, où l'on entasse les os, dit-il, les os des défunts. Les galeries sont ornées de décors peints, ce qui est confirmé par l'auteur du "Journal d'un bourgeois de Paris" qui situe la réalisation de la fresque de la Danse macabre, sur laquelle je ne reviendrai pas, en 1424. Des gravures anciennes dont on dispose montrent des galeries,parfois, on voit les murs ornés de fresques au-dessus desquelles sont rassemblés les ossements avec plus ou moins d'ordre sous les toitures. Si l'exemple parisien semble avoir frappé les observateurs contemporains, c'est sans doute plus par sa monumentalité et sa richesse que par son caractère réellement exceptionnel.
À la même époque, on connaît des gravures allemandes,cette fois qui montre qu'il existe dans l'Empire au XVe siècle de petits édicules ouverts le long des murs du cimetière à l'intérieur desquels on voit des crânes soigneusement empilés. Autre exemple, pour revenir dans un secteur géographique plus francilien, à la basilique Saint-Denis, près de Paris, un vitrail du XIVe siècle qui est documenté par une gravure de Bernard de Montfaucon, montrait, puisqu'il a disparu, Saint Louis en train de rassembler des ossements dans un grand sac et il ne faisait certainement pas pour s'en aller jouer au quilles.
Tout ça pour dire que la préservation des ossements est, à la fin du Moyen-Âge, une préoccupation qui ne touche pas seulement le petit monde parisien et que des charniers, des ossuaires, quel que soit le nom qu'on leur donne, on en trouve probablement un peu partout.
Si l'on en croit ce qu'écrit Philippe Ariès, la pratique de construire des ossuaires en galerie, comme aux Saints-Innocents donc, serait apparue au XIVe siècle. Quelle que soit la date précise de cette monumentalisation des ossuaires, il faut sans doute la mettre en relation avec les évolutions des pratiques funéraires à la fin du Moyen-Âge. L'attrait pour l'inhumation à l'intérieur de l'église, au plus près des corps saints, entraîne une pénurie régulière d'emplacements et donc la nécessité de libérer de l'espace en transférant les ossements dans un lieu qui soit plus acceptable qu'une simple fosse commune. Toujours est-il que l'ossuaire n'est pas un phénomène exclusivement breton ou typiquement breton.
On a peu d'exemples de grands aîtres qui sont conservés aujourd'hui. On a évoqué pour démarrer les Saints- Innocents de Paris qui ont disparu. On connaît aussi en Normandie l'aître Saint-Maclou de Rouen, construit à partir de 1526, celui de Brisegaret en Montivilliers (76), sans doute à peu près contemporain du précédent, ou dans le Loir-et-Cher, l'aître Saint-Saturnin à Blois, édifié entre 1516 et 1520, qui sont parmi les derniers exemples en France de ce type d'infrastructures mortuaires. En Allemagne, on l'a vu, les gravures anciennes montrent aussi des ossuaires mais sous une forme nettement plus modeste, de simples édicules remplis d'ossements précédés la plupart du temps d'une marche pouvant être utilisée comme une sorte de prie-dieu.
En Bretagne toutefois, les ossuaires ont reçu un développement particulier, alors pas sous forme d'aîtres comme à Rouen ou à Blois, mais comme des édicules de plus en plus monumentaux jusqu'à devenir des éléments incontournables de ce qu'on appelle l'enclos paroissial à l'époque moderne, où ils occupent une place majeure. Ces ossuaires bretons, on en rencontre deux grands types.
D'un côté, les ossuaires dits reliquaires d'attache, comme à la chapelle Saint-Jauoa de Plouvien, un ossuaire qui flanque l'un des murs de l'église paroissiale, le plus souvent près de l'angle sud-ouest de celle-ci.
Et de l'autre côté, le second type, les ossuaires qu'on pourrait qualifier d'ossuaires indépendants, installés à l'intérieur du placître, mais là encore, plutôt vers l'ouest, même si, dans un cas comme dans l'autre, il existe toujours des exceptions à cette règle tacite.
Un recensement précis de ces ossuaires reste encore à faire, notamment pour les XVe et XVIe siècles, car bon nombre d'entre eux ont disparu et ne réapparaissent qu'au hasard des dépouillements des sources d'archives. D'autres sont documentés, bien connus ou conservés pour les XVIIe ou XVIIIe siècle, mais rien ne dit qu'ils n'avaient pas de prédécesseur, qu'ils n'en existaient pas avant cette date, sous la même forme ou sous une autre.
Bref, de nombreuses questions restent encore en suspens, d'autant que les sources ne font aucune distinction entre l'un et l'autre type. Elles évoquent indifféremment des charniers ou des reliquaires, les deux termes étant parfaitement interchangeables. Le dernier dénombrement réalisé par Georges Provost dans le cadre de la demande de classement des enclos paroissiaux du Finistère au patrimoine mondial de l'UNESCO fait état de 166 ossuaires encore conservés dans l'ensemble de la région Bretagne pour une période qui va du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À ces 166 ossuaires conservés, il faudrait encore pouvoir ajouter tous ceux qui ont disparu, pour lesquelles il est beaucoup plus aléatoire de pouvoir établir un chiffre à l'heure actuelle.
On note quand même de fortes disparités d'un département à l'autre dans la région, avec une concentration beaucoup plus forte dans la partie occidentale de la péninsule, c'est-à-dire dans les anciens diocèses de Cornouailles et de Léon. C'est là que leur usage paraît avoir été le plus courant, encore qu'il faut quand même se garder de tirer des conclusions trop hâtives à partir de ce qu'on a conservé à partir de ce qui est encore debout, les paroissiens de Haute-Bretagne semblent en effet avoir privilégié d'autres choix de construction un peu plus modestes, par exemple un espace charpenté installé au-dessus du porche méridional de l'église. C'est ce qu'on observe encore à Miniac-sous-Becherel, en Ile-et-Vilaine. À Yffendic aussi, mais là c'est une structure avec un porche en pierre, avec un étage en pierre. Et cela semble avoir été aussi le type d'infrastructure choisie par exemple pour l'église paroissiale d'Iffs, où la documentation, les sources écrites évoquent l'existence d'un ossuaire surmontant le porche jusqu'en 1837. Le choix d'un tel type de structure, charpentée, plus fragile, pourrait expliquer que peu d'exemples d'ossuaires haut-bretons nous soient aujourd'hui parvenus.
Il ne veut pas nécessairement dire qu'on construisait moins d'ossuaires en Haute-Bretagne jusqu'au XIXe siècle. Il n'empêche, les ossuaires de Basse-Bretagne ont, de manière assez nette, fait l'objet d'investissements plus importants que ceux de la partie orientale de la péninsule bretonne. Traduction, sans doute d'une autre perception de la relation entre le monde des vivants et celui des morts. Il apparaît aussi que les deux types de ossuaires rencontrés en Bretagne ont été édifiés simultanément. En même temps, il n'y a pas de solution de continuité entre les deux types, dans des paroisses qui peuvent parfois être très proches les unes des autres, et sur l'ensemble de la période concernée.
Le plus ancien exemple conservé dans la région pourrait être le reliquaire d'attache de l'église de Brélevenez, en Lannion dans l'ancien diocèse de Trégueir.
Il n'est pas daté, mais sa grande modestie avec ses ouvertures rectangulaires ornées d'une simple accolade et sa couverture en dalle de schiste plaîde plutôt pour une datation ancienne. D'une manière générale, ces ossuaires d'attaches bretons occupent une superficie réduite. Ils sont de plan rectangulaire, à l'exception notable de l'ossuaire de Trégastel, qui au XVIIe siècle est construit en suivant un plan circulaire tout à fait inhabituel.
Ils sont plus souvent ouverts sur leur façade principale par une série plus ou moins importantes,d'arcatures séparées par des colonnettes,ou par de courtes piles quatrendulaires. Il n'est pas rare non plus que le simple pan de toiture , qui les recouvre comme dans l'exemple de Saint-Jaoua à Pluvien, soient le prolongement de la couverture de l'église elle-même.
Les exemples les plus simples me disposent pas de porte d'accès; les ossements étaient simplements déposés avec plus ou moins de précautions à travers les ouvertures.
A Saint-Mélaine de Morlaix, la reconstruction de l'ossuaire d'attache qui a aujourd'hui disparu en 1476,1477 est documenté par les comptes de la fabrique paroissiale, il semble que l'on ait remis en place, en tout cas si l'ordre dans lesquelles apparaissent les lignes de comptes respecte l'ordre des opérations,er bien il semble que l'on ait remis en place les ossements, et qu'après seulement, on ait construit, on ait installé la toiture de l'ossuaire, c'était un ossuaire qui ne disposait pas de porte pour pouvoir accéder à l'intérieur.
A une date tout aussi ancienne,on construit donc aussi des ossuaires indépendants, comme par exemple celui de Locmaria-an-Het,en Saint-Yvi, dans l'ancien dioscèse de Cornouailles,de plan rectangulaire lui aussi, il ne possède pas de porte d'accès, mais est percé d'arcatures en arc brisé au dessin assez complexe, que l'on retrouve presque à l'identique dans les arcades du cloître des Carmes à Pont-l'Abbé disparu, mais sans doute édifié dans la première moitié du XVe siècle.
Le modèle, si je puis dire, le plus courant, est le type que l'on retrouve dans un autre exemple ici à l'enclos paroissial Saint-Yves de Plougenven. Je pourrais multiplier les exemples, le but c'est quand même pas de faire un catalogue des ossuaires bretons. A Plougenven, il est de manière tout à fait coutumière, cet ossuaire, situé le long du mur du placître, au sud-ouest de l'enclos. Il se présente comme une véritable petite maison, avec sa porte placée au centre de la façade, encadrée par un nombre équivalent d'arcatures très fines. Le vocabulaire décoratif, en particulier les crossettes, qui décorent les rampants, ainsi que les gargouilles, se rapprochent du vocabulaire décoratif qu'on retrouve sur l'église paroissienne elle-même, sans doute autour de 1510.
D'ailleurs, c'est bien souvent l'analyse de ce décor qui rend possible l'établissement d'une datation, parfois avec une fourchette chronologique assez large, pour nombre d'ossuaires d'ossuaires qui sont dépourvus d'informations précises sur la date de construction. Pour autant, que ce soit pour les ossuaires indépendants ou pour les reliquaires d'attache, même s'il existe bien un schéma d'ensemble qui paraît avoir été privilégié, sans doute à la fois pour des raisons pratiques et d'esthétiques, le fait est qu'il semble avoir autant de variation qu'il existe d'ossuaires: avec ou sans portes,avec plus ou moins d'ouvertures, parfois répartis sur plusieurs cotés, voir sur plusieurs niveaux, avec ou sans inscriptions, etc, etc,....
Certains ossuaires indépendants se présentent comme de véritables petites chapelles avec une apside et un autel intérieur. On pourrait supposer que la conservation des ossements s'y doublerait donc d'un culte aux morts, ou en tout cas en relation avec eux. On cite souvent l'exemple de l'ossuaire de Saint-Thégonnec, construit entre 1672 et 1682. Pourtant, il n'a certainement pas été conçu pour recevoir les restes des défunts, une fonction qui était dévolue sur le placître,à deux autres ossuaires aujourd'hui disparus. On sait que l'un d'entre eux était en usage vers le milieu du 17ème siècle en tout cas il n'est pas documenté avant cette date et l'autre, le second donc, est construit en 1727, soit quelques années,seulement après l'édification de la chapelle. Ce dernier point suffit à questionner la véritable fonction de celle-ci.Dès 1686, elle dispose d'un autel installé au dessus d'une petite crypte sans doute conçu pour abriter un groupe sculpté de la Mise au Tombeau ou un Sépulcre, disent les registres de compte, livré en 1702 par le sculpteur morlaisien Jacques Lespaignol. Finalement, c'est à la disparition des deux véritables ossuaires de l'enclos que l'on doit le transfert sémantique du terme ossuaire à la chapelle reliquaire de la fin du XVII° siècle.L'inscription qui court sur la frise et qui encourage les passants à prier pour les défunts a pu faciliter, effectivement ce basculement. Néanmoins, il existe d'autres exemples pour lesquelles la question pourrait être posée d'une utilisation simultanée comme ossuaire et comme chapelle.
A Lampaul-Guimiliau en 1667, les paroissiens décident de construire en remplacement d'un ossuaire sans doute jugé vétuste un nouvel édifice qui ressemble fort à la chapelle du Saint-Thégonnec que je viens d'évoquer. A l'intérieur, un autel surmonté d'un retable rappelent la fonction cultuelle du lieu et une crypte abrite également une Mise au Tombeau daté de 1667.
Ces cryptes sont assez peu nombreuses a être documenté dans la région, il en existait une à Goulven (dont l'accès a été obstruée à la fin du XIX° siècle) et sans doute une aussi à l'église paroissiale, Saint-Mathieu de Morlaix, où les archives mentionnent en 1624 l'existence d'une chapelle dédiée à Sainte-Marguerite, servant de reliquaire, munie d'une crypte dans laquelle on trouvait également un Sépulcre, donc à priori une Mise au Tombeau.
Mais y cumulait-on les deux fonctions, chapelle et ossuaire? il est assez difficile, en l'absence de sources supplémentaires, d'être catégorique sur ce point. Même la présence d'un autel et d'un retable peut correspondre très souvent à un ajout postérieur à la construction de l'édifice, et ne peut donc pas toujours être considérée comme une preuve tangible d'une double fonction qui aurait été prévue dès l'origine. En revanche, ce qui paraît évident, et en particulier en Léon, c'est qu'à l'époque moderne nombreux sont les ossuaires à prendre au moins l'allure de véritables chapelles, à défaut d'en avoir forcément la fonction. L'aspect même du monument, avec un clocheton sur l'un des pignons, le percement d'une grande baie sur l'autre, à la manière d'une maîtresse-vitre, renforce ce parallèle avec l'architecture des églises et chapelles de la région. Citons par exemple la chapelle Sainte-Anne de Landivisiau qui est aujourd'hui isolée au milieu du cimetière municipal, mais qui lors de sa construction vers 1585 était l'ossuaire de l'ancienne enclos paroissial avant qu'elle ne soit déplacée au milieu du XIXe siècle. Ces ossuaires, traités comme de véritables chapelles reliquaires, sont concentrés dans l'actuel département du Finistère et plus particulièrement dans ce que les guides touristiques appellent aujourd'hui les enclos paroissiaux de la vallée de l'Elon. C'est là en effet qu'ils prennent au XVIe et XVIIe siècle des proportions inédites avec une théâtralisation qui vise sans doute à montrer aussi la richesse des paroisses. À Guimiliau, un ossuaire indépendant est ainsi venu doubler en 1648 le reliquaire d'attache pourtant spacieux installé à l'ouest du porche méridional de l'église, sans doute au début du XVIIe siècle. Il est clair qu'une fonction particulière était dévolue à cette chapelle reliquaire, comme en témoigne la chaire extérieure, installée sur sa façade près de la porte d'accès.
Dans les enclos des XVI et XVIIe siècles, la monumentalisation de l'ossuaire se traduit aussi dans l'emploi du décor. A Guimilliau, à Lanhouarneau, à Sizun, à Pencran, à la Roche-Maurice, à Saint-Thégonnec encore, on suit la progression du vocabulaire classique de l'architecture et l'assimilation progressive des ordres tels qu'ils sont définis dans le traité d'architecture de Philibert de L'Orme dès 1567. Mais à Saint-Thegonnec par exemple, l'abside à pan coupé déploie tout un répertoire qui reste gothique flamboyant, avec soufflets, mouchettes et trilobes dans le réseau des baies, ou avec des rampants ornés de crochets qui se mêlent à des thèmes beaucoup plus Renaissance, comme des pilastres ou des volutes adossées qui sont là pour le coup plus typiques de ce qu'on trouve à la Renaissance. Les chevets à pans coupés, très en vogue dans la région dès la fin du XVe siècle, semblent avoir été perçus comme des marqueurs visuels très forts du sacré. Et par ailleurs, ils représentaient un bon moyen de monumentaliser des édifices aux dimensions modestes, ce qui pouvait fort bien correspondre aux souhaits des paroissiens. Le décor architectural se doublait aussi sur la plupart des ossuaires de l'époque moderne, de motifs macabres, tête de mort, tibias entrecroisés, comme ici à Lampaul-Guimiliau, ou représentations issues de la Danse macabre à Pencran par exemple. Et à côté de ces représentations plus ou moins précises de la Mort, on trouve aussi en Basse-Bretagne celle de son fidèle serviteur, ici nommé l'Ankou, représenté à Landivisiau, Ploudiry, Brasparts, sous la forme d'un squelette tenant au choix une faux ou une flèche.
À la Roche-Maurice, au-dessus du bénitier, il assène au passant un « Je vous tue tous » que l'on retrouve aussi à Brasparts, faisant pendant à un ange trompettiste dont le phylactère porte l'inscription "Réveillez-vous" Ces inscriptions, qu'elles soient en français, en latin ou en breton, jouent un rôle central dans le message véhiculé par le décor des ossuaires. Elles insistent sur l'égalité de tous devant la mort et sur la nécessité de rester humble devant elle. Les Mmemento mori se multiplient sur les façades en même temps que les invitations à prier pour les défunts, par exemple à Ploudiry en 1636, un "bonnes gens qui par icy passez, prizt Dieu pour les trépasséz".
Mais le registre macabre n'est toutefois pas réservé dans l'ensemble ecclésial au seul ossuaire. On trouve aussi à l'intérieur même de l'église, et en particulier dans les sablières, mais pas seulement, de nombreuses scènes ou de simples motifs qui rappellent la proximité des morts. Elle fait donc partie, la Mort, d'une partie intégrante du monde des vivants et doit inspirer autant la crainte que le respect. En Basse-Bretagne, l'attention portée aux défunts semble avoir été particulièrement exacerbée et pourrait expliquer le développement qu'on y donne aux ossuaires, indépendamment de la richesse économique des paroisses.
Néanmoins, et je terminerai là-dessus, il semble tout de même clair que, dans les paroisses les plus modestes, une fois que l'ossuaire a été construit, on ne semble guère s'en préoccuper autrement que pour des opérations de petit entretien courant. L'essentiel du budget disponible reste consacré prioritairement, et c'est assez logique, à l'embellissement de l'église plutôt qu'à ses annexes. Toutes les paroisses ne disposent pas, en effet, du budget de la fabrique de Saint-Thégonnec qui lui permet d'enchaîner au XVIIe siècle une succession ininterrompue de travaux visant à embellir tous les éléments constitutifs de l'enclos. Malheureusement, nos connaissances de la place occupée par les ossuaires dans les budgets paroissiaux dépendent de la conservation extrêmement aléatoire des comptabilités de ces fabriques paroissiales. Par ailleurs, la nature même de ce type de source ne nous permet pas percevoir la place qu'on accorde aux défunts au sein de la paroisse, pas plus que ne le permettent les procès verbaux de prééminence, par exemple, qui se focalisent sur la place des armoiries, plutôt que sur la place des morts proprement dit. Si l'on revient à Saint-Mélaine de Morlaix à la fin du XVe siècle, lorsque l'ossuaire est reconstruit, vers 1476, on ne semble pas se soucier, par exemple, de la manière dont seront stockés les ossements pendant la durée du chantier.Ce n'est pas un chantier qui dure très très longtemps, mais tout de même, On ne se préoccupe pas beaucoup de l'endroit où ils vont être stockés, dans quelles conditions ils vont être stockés, ces ossements. Et aucune cérémonie n'est organisée lorsque les reliques réintègrent leur emplacement. Il leur paraît en revanche qu'on ne souhaite pas les exposer à la vue de tous dans cet ossuaire d'attache, puisque des ouvriers sont chargés de les enterrer sous le sol. Ce qui donnerait à cette ossuaire d'attache plutôt l'aspect d'une sorte de "fosse habillée", si l'on peut dire, assez à l'opposé des descriptions et des témoignages fournis par les voyageurs au XIXe siècle. Alors pas pour Morlaix, puisque l'ossuaire semble avoir disparu à la fin du XVIIIe, mais au XIXe siècle, on évoque les entassements d'os visibles dans les charniers et les ossuaires. En tout cas, à la fin du XVe siècle, dans certains d'entre eux, il ne semble pas si évident que cela, qu'il soit à ce point visible de tous et on pourrait se questionner et c'est un travail qui est une piste de recherche qui reste à faire sans doute, se questionner sur qu'est-ce que l'on veut montrer et qu'est-ce que l'on veut donner à voir, sans vraiment montrer peut-être à l'intérieur de ces ossuaires, il n'est pas aussi simplement question de rappeler la présence des morts sans pour autant la rendre précisément palpable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.