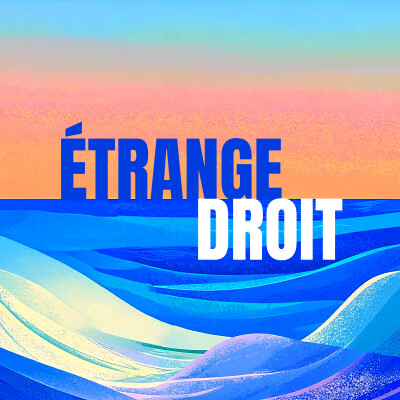- Speaker #0
Bonjour et bienvenue dans Étranges Droits, le podcast consacré aux droits des étrangers, par et pour celles et ceux qui le font vivre. Pendant la prochaine demi-heure, je vous emmène au cœur de ce droit et de sa pratique. Je suis Salomé Bensadi, je suis avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis et j'enregistre cet épisode dans les locaux de mon cabinet à Pantin. Pendant l'épisode, vous allez aussi entendre ma chère consoeur Fleur Boixière pour sa chronique. Et sachez que le son du podcast est composé et réalisé par des musiciens exilés qui ont repris le chemin de la musique grâce à l'association Pax Musica. Aujourd'hui, on va ouvrir les portes d'un des lieux les plus méconnus et les plus redoutés du droit des étrangers, le centre de rétention administrative, le CRA, avec Lauriane Auchard-Oceini. qui est chef du service juridique de l'équipe de France Terre d'Asile, qui intervient au CRA de Wassel en Normandie. Bonjour Lauriane.
- Speaker #1
Bonjour Salomé.
- Speaker #0
Avant de commencer, je vais faire un point terminologique pour rappeler qu'ici, on va bien parler de centre de rétention et pas de centre de détention. Alors c'est une distinction basique mais importante, puisqu'il faut préciser que dans un CRA, c'est un lieu d'enfermement, mais dans lequel l'administration va placer des personnes étrangères pour mettre en œuvre leur éloignement, à la différence d'une prison où les personnes y sont enfermées pour des crimes ou des délits. Et à ce jour, en France, il y a 25 crats, dont 4 en Outre-mer, pour une capacité totale d'environ 2000 places. Je continue avec quelques chiffres pour qu'on comprenne la réalité de ces lieux. En 2024, il y a eu environ 40 000 personnes qui ont été retenues dans des crats dans l'attente de leur expulsion. Et la durée moyenne de rétention d'une personne sur cette année-là était de 33 jours. Et j'en profite pour rappeler que la durée maximale actuelle de rétention est de 90 jours, sauf dans un cas bien particulier, en cas d'acte terroriste, où la rétention peut durer jusqu'à 210 jours. Lauriane, ton expérience dans un CRA va être très précieuse pour nous, parce que je l'ai dit, les CRA, ce sont des lieux méconnus, même par les avocats qui défendent des personnes retenues, retenue puisque souvent l'avocat Il va voir son client au tribunal directement pour son ou ses audiences, parfois même en visioconférence seulement. Et donc, il ne sera pas physiquement avec son client. Et donc, ce sont les associations qui sont présentes sur place et qui vont, entre autres activités, faire l'intermédiaire entre les personnes retenues et leurs avocats. Et justement, je précise qu'il y a cinq associations présentes dans l'ECRA aujourd'hui en France, qui se répartissent l'ECRA. dont France Terre d'Asile qui est présente dans CICRA actuellement. Et à ce propos, je conseille vivement la lecture de leur rapport annuel à ces associations qui a été publié en 2024, d'où je tire les chiffres que j'ai cités en introduction. Lauriane, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ?
- Speaker #1
Merci Salomé pour l'invitation. Je suis Lauriane Ocharossaini, chef de service pour France Terre d'Asile au centre de rétention de Wassel. basée en Normandie. Donc j'interviens pour l'association qui elle-même intervient dans les centres de rétention qui sont encadrés dans le cadre d'un marché public pour garantir l'accès au droit des personnes retenues. Voilà, donc on a une mission essentiellement juridique puisque notre mission consiste à informer, conseiller. accompagner les personnes qui sont placées en rétention dans l'exercice effectif de leurs droits.
- Speaker #0
Et votre mission elle est d'autant plus cruciale puisque comme je l'ai dit l'accès au CRA il est assez difficile pour les acteurs extérieurs et comment vous en tant qu'association vous êtes perçue à la fois par les personnes retenues et par l'administration comment vous arrivez à vous positionner dans ces lieux ?
- Speaker #1
Alors effectivement nous on on travaille donc on travaille Nos bureaux sont basés dans les centres de rétention. Donc, on travaille avec une présence policière, enfin, omniprésence de la police. On ne travaille pas directement, mais disons que les différents acteurs, on est amené à croiser les différents acteurs dans le centre de rétention. Donc, la police, l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et l'UMCRA, donc l'unité médicale dans les centres de rétention, notamment. et puis Puis nous intervenons auprès du public, les personnes retenues, avec lesquelles nous nous entretenons. Chaque personne nouvellement arrivée au centre de rétention est accueillie en entretien par l'association pour faire le point sur sa situation et voir un petit peu ce qu'on peut faire pour elle, lui donner l'information qui est adaptée à sa situation en fonction de ses déclarations. et de contexte de son placement.
- Speaker #0
Et Lauriane, à quoi ressemble un CRA, précisément ? Est-ce que tu peux nous décrire l'environnement, l'atmosphère de ces lieux et le quotidien des personnes qui y sont retenues ?
- Speaker #1
Alors, tout à l'heure, tu l'as rappelé, le centre de rétention administrative, c'est un lieu d'enfermement, donc qu'on peut facilement assimiler à une prison, mais finalement, c'est totalement différent, puisque... Tu l'as rappelé aussi tout à l'heure, les personnes sont enfermées parce qu'elles n'ont pas de papier et non pas parce qu'elles ont commis un crime ou un délit. La différence, c'est qu'effectivement, les personnes peuvent se déplacer dans des zones de vie, ce qui n'est pas le cas en prison. Toutefois, il faut quand même rappeler que c'est sous surveillance policière constante. Et puis, les conditions matérielles sont très précaires dans les centres de rétention. Avec des perspectives incertaines et un stress continu au fil des jours. Pour donner un exemple, à Oacel, par exemple, en termes de conditions, on a une grosse problématique d'accès à la communication avec l'extérieur. La particularité d'Oacel, c'est que le CRA est situé dans l'enceinte de l'École nationale de police. qui est elle-même en plein milieu d'une forêt, donc en termes d'accès par les transports, c'est très compliqué pour les visites notamment, même pour le déplacement des avocats. Peu d'avocats font le déplacement notamment par la distance géographique et puis il y a aussi le fait que ça soit en forêt, pas de réseau téléphonique, pas d'Internet. Donc c'est très compliqué pour les personnes de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et puis, en fait, c'est un lieu où, finalement, beaucoup de personnes qui sont passées par la casse-prison, par exemple, disent que les conditions de vie en rétention sont beaucoup plus difficiles qu'en prison, notamment parce qu'il n'y a pas d'activité. Il y a beaucoup d'insalubrité, malheureusement, dans beaucoup, beaucoup de centres de rétention. Pour donner quelques exemples, j'ai des collègues qui interviennent dans des centres de rétention où il y a des punaises de lit, des cafards, des vers. Les conditions sont assez compliquées pour les personnes.
- Speaker #0
Et Lauriane, qui sont les personnes retenues en centre de rétention ? Quels sont leurs profils, leurs parcours ? nous décrire sans faire de statistiques, mais voilà, quelles sont les populations qu'on y trouve ?
- Speaker #1
Alors, les personnes retenues sont majoritairement des hommes jeunes, mais on rencontre aussi des femmes, des personnes âgées ou des personnes qui sont malades. En métropole, on a 98% de places qui sont réservées pour les hommes et donc 2% qui sont réservées pour les femmes. Ce sont des personnes qui ont un parcours souvent marqué par l'exil, par la précarité et par des ruptures profondes. Pour donner un exemple, on a des personnes qui peuvent être arrivées sur le territoire... de manière très récente et notamment l'année dernière, mes collègues de Coquelles ont eu plusieurs situations de personnes qui ont été placées en centre de rétention alors qu'elles faisaient du tourisme. À Ouassel, on a eu des situations de personnes qui sont arrivées mineures sur le territoire français, qui ont suivi leurs parents dans un parcours d'exil. avec des craintes en cas de retour dans le pays d'origine, et donc qui ont toute leur vie finalement sur le territoire français, qui ne connaissent même pas parfois leur pays d'origine dans lequel on veut les renvoyer. J'ai l'exemple d'un monsieur qui était arrivé en France à l'âge de 9 ans, qui avait quitté le Rwanda en suivant son père parce qu'il y avait la guerre. et qui n'avait aucune perspective d'éloignement puisqu'en plus il était en procédure de demande d'apatridie. puisqu'en fait, ils ne connaissaient pas du tout le Rwanda. Et donc, placés deux fois sur 2024 et 2025 avec aucune perspective d'éloignement. Voilà, ce sont deux exemples de personnes qui peuvent être retenues en rétention.
- Speaker #0
Donc, il y a quand même une diversité, parce que l'image qu'on en a, c'est que ce sont des personnes qui seraient arrivées récemment sur le territoire français, qu'on voudrait expulser parce qu'elles n'ont pas de droit au séjour. mais il y a quand même un peu de Des situations un peu plus complexes que celles-ci dans ce que tu décris. Et puis je vais préciser aussi que chaque crâne a des spécificités. J'ai dit qu'ils étaient 25 et donc par exemple au crâne de Wassel, je sais qu'il y a une zone pour les femmes, ce qui n'est pas le cas dans tous les crânes. Et puis je voudrais citer un autre exemple qui est bien répertorié dans le rapport de 2024, le crâne de Pamanzi à Mayotte. où 22 000 personnes ont été retenues en 2024 sur les 40 000 dont j'ai parlé, dont 13 % de ces personnes qui étaient des personnes mineures, puisque à Mayotte, il est encore possible d'enfermer des enfants dans les crats, ce qui a été interdit en métropole. Et dans le même crat de Mayotte, il y a un taux d'éloignement de 80 %, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, on le verra. Et puis il faut dire que ce taux il s'explique par l'existence d'un régime juridique dérogatoire en outre-mer, pas que concernant l'enfermement des enfants, mais vraiment un régime général dérogatoire qui notamment prive les personnes enfermées de la possibilité d'un recours contre les décisions prises à leur rencontre qui soit suspensif de leur éloignement. Ce qui veut dire qu'on peut, si je résume bien, on peut... exécuter une mesure d'éloignement, donc expulser la personne, alors même qu'un juge n'a pas encore statué sur la légalité de cette décision, à Mayotte, encore une fois. Donc c'est pour quand même déjà montrer que finalement, une personne sur deux a été retenue en Outre-mer et dans ce territoire-là. Et puis les spécificités de chaque CRA qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui en détail. Je voudrais te parler maintenant du placement rétention. Puisqu'il faut rappeler que seulement 20% des personnes qui font l'objet d'une mesure d'éloignement vont être placées en centre de rétention. Environ 25% des personnes qui ont des mesures d'éloignement vont être assignées à résidence et puis les autres finalement vont rester en liberté, ne vont pas avoir de mesures privatives de liberté. Donc on se demande pour quelles raisons une personne est placée en CRA et pour quelles raisons une autre personne ne l'est pas.
- Speaker #1
Alors effectivement, la rétention, elle concerne des personnes qui sont en instance d'un déloignement. Souvent, donc à la suite d'une OQTF, c'est la mesure la plus connue. Il y a d'autres mesures, mais effectivement, c'est celle qu'on rencontre le plus régulièrement. En principe, l'administration, elle doit démontrer un risque de fuite pour pouvoir placer en rétention, puisque la rétention est une exception à la liberté, en fait, d'aller et venir. En pratique, on se rend compte quand même que certains profils sont placés quasi systématiquement en centre de rétention. Et à ce sujet, en fait, on observe une dérive finalement sécuritaire puisque la rétention devient un outil de communication politique. La préfecture, quand elle place en rétention, est censée examiner de manière concrète et individualiser la situation des personnes. On se rend bien compte avec le nombre d'OQTF et de placements en centre de rétention que les examens sont superficiels et qu'on est dans une politique du chiffre finalement pour pouvoir justifier un petit peu de ces placements-là. Tout à l'heure, tu parlais de la durée de la rétention. Moi, je voudrais quand même ajouter qu'au fil des années, il y a eu quand même un allongement de la durée de la rétention. Aujourd'hui, tu l'as rappelé, elle est de 90 jours, sauf profil dérogatoire. Mais l'allongement des délais de la rétention n'est pas un gage pour assurer l'éloignement effectif des personnes. puisque dans le rapport, on l'a bien rappelé, on a beaucoup de libérations dans les quatre premiers jours par le juge, ce qui démontre bien que ces personnes-là, leur situation n'a pas été examinée correctement par la préfecture et qu'elles n'auraient pas dû être placées en centre de rétention. Soit elles sont libérées, soit elles sont assignées à résidence, mais en tout cas, elles ont été enfermées pendant... Au moins quatre jours pour rien.
- Speaker #0
Tu parlais du risque de fuite. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la menace à l'ordre public et de l'articulation entre les deux motifs de placement en rétention ?
- Speaker #1
Oui, alors effectivement, la loi de 2024 a introduit la menace à l'ordre public pour justifier un placement en rétention. C'est une notion qui n'est pas... définie par les textes et donc sujette à interprétation. Donc, on se rend compte dans la pratique qu'effectivement, elle est utilisée quasiment tout le temps pour des situations, ça peut aller vraiment d'une personne qui a été en détention plusieurs mois ou plusieurs années. comme pour une personne qui a été interpellée pour un vol et placée en garde à vue sans condamnation, sans poursuite judiciaire. Donc on a vraiment tout type de profils qui sont finalement intégrés dans cette menace à l'ordre public, un peu fourre-tout, si je peux dire les choses comme ça.
- Speaker #0
Une fois à l'intérieur d'un centre de rétention, quels vont être les droits fondamentaux des personnes retenues ? Et comment les associations assurent l'effectivité de ces droits ?
- Speaker #1
Les personnes retenues ont effectivement des droits fondamentaux. Elles ont l'accès à un avocat commis d'office lorsqu'elles n'ont pas d'avocat privé pour les assister aux audiences. Elles ont accès aux médecins ou en tout cas à l'unité médicale au sein du centre de rétention, à un interprète lorsqu'il y a besoin. Elles ont aussi le droit de contacter leur famille, leur consulat. et Je l'ai expliqué en donnant un exemple que ça peut être parfois compliqué. Et puis, elles ont l'accès aux associations qui interviennent dans les centres de rétention pour garantir l'effectivité de leurs droits. Nous, c'est notre rôle principal, malgré les obstacles matériels et humains parfois. moi je dirais qu'on a quand même un rôle central et je le dis par rapport à l'actualité brûlante de vouloir évincer les associations dans les centres de rétention puisqu'on fait le lien entre beaucoup de personnes, entre les différents acteurs et la personne qui est retenue. On a pu débloquer des situations de par notre présence au sein du centre de rétention et ça c'est assez crucial pour garantir l'effectivité des droits des personnes.
- Speaker #0
et et On disait dans le rapport qu'il y a effectivement certaines situations qui se débloquent de manière gracieuse, c'est-à-dire finalement avec des échanges avec l'administration. Donc vous avez bien des échanges, je dirais, de qualité avec l'administration en centre de rétention, parce que si je fais le parallèle avec le droit des étrangers plus classique, les personnes ont du mal à contacter leur préfecture et même les associations sur le terrain, les avocats. On a souvent un mur ou un silence. Comment ça se passe en CRA ?
- Speaker #1
C'est vrai que nous, la première chose qu'on dit aux personnes qu'on reçoit en entretien, c'est qu'on ne travaille pas avec l'administration. C'est important pour établir le lien de confiance. C'est pareil, on leur dit clairement qu'on ne travaille pas avec la police, même si on peut avoir des échanges avec la police pour justement débloquer des situations. Mais vraiment, c'est important qu'ils puissent nous identifier comme des acteurs qui sont là pour les accompagner. et pour participer à leur éloignement. Sauf quand il y a des personnes qui souhaitent repartir. Mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est vraiment de garantir l'effectivité de leurs droits. Et donc, on leur explique qu'effectivement, on peut faire le lien avec les différents acteurs. Et oui, on peut être amené à contacter l'administration qui répond ou qui ne répond pas. je veux dire on n'a pas forcément de de liens privilégiés avec les autres acteurs. Mais effectivement, on essaye, quand on peut, de pouvoir débloquer les situations. Et ça fonctionne, en fait. C'est ça qui est important de dire, c'est que notre rôle, il est vraiment important puisque, effectivement, ça fonctionne.
- Speaker #0
Lauriane, je voudrais quand même parler d'un autre lieu de... rétention qui s'appelle les locaux de rétention administrative qui sont en fait des lieux d'enfermement qui se trouvent souvent dans les commissariats en tout cas c'est le cas à Bobigny où je suis ce sont des lieux qui sont prévus pour enfermer les personnes de manière très courte avant un éventuel transfert dans un CRA et le Le rapport des associations indique que les LRA offrent des droits drastiquement réduits par rapport à ceux des ECRA et qu'aucun accompagnement juridique n'est obligatoire face à cette situation. Comment les associations évaluent l'utilisation croissante des LRA par les services de l'administration ?
- Speaker #1
C'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de situations de personnes qui sont placées en LRA avant d'arriver au centre de rétention. L'analyse que j'en fais, c'est que ça précarise encore plus l'accès aux droits des personnes qui ne sont pas garantis en LRA, puisqu'il n'y a pas systématiquement d'association qui intervient en LRA. L'administration se défausse en disant qu'elle donne les numéros de téléphone. On sait bien qu'un numéro de téléphone ne garantit pas le recours effectif devant le tribunal judiciaire, par exemple, pour contester son placement. Donc, voilà, il y a un double impact. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est que quand les personnes, en tout cas, arrivent jusqu'au centre de rétention, ce qui n'est pas systématique, mais en tout cas, quand elles arrivent jusqu'au centre de rétention, nous, ça nous oblige à travailler encore plus dans l'urgence, puisque le travail de nos associations, c'est de l'urgence quotidienne, mais encore plus quand les personnes sont placées, passent par le LRA. Et puis malheureusement, et encore une fois c'est mon analyse, mais ça permet des possibilités de renvoi illégaux qui ne seraient pas forcément contestées par les associations puisque les personnes ne voient pas les associations.
- Speaker #0
Lauriane, je te propose d'écouter ma consoeur Fleur Boixière pour sa chronique. Fleur, c'est à toi.
- Speaker #2
Bonjour, je suis Fleur Boixière, avocate au barreau de Marseille. J'exerce tout comme Salomé. en droit des étrangers. Et j'enregistre cet épisode depuis mon cabinet qui se situe donc à Marseille. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique où l'on va s'intéresser d'un peu plus près à l'objectif premier d'un placement en crâne. Le CZA est très clair et prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Et c'est cette formule-là sur laquelle j'ai envie de me concentrer aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Vous l'aurez compris, le but d'un placement en CRA est de s'assurer que le ressortissant étranger reste à la disposition de l'administration le temps que son départ soit organisé. Le Conseil d'État l'a rappelé, il ne peut pas y avoir de rétention sans perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. C'est-à-dire qu'à chaque placement et à chaque demande de prolongation de la rétention administrative, la préfecture va devoir démontrer qu'il existe bien une perspective d'éloignement de l'étranger et va devoir justifier que d'avoir effectué des démarches en ce sens. Qu'est-ce qu'on entend par le mot « démarche » ? On distingue deux situations. Tout d'abord, lorsque l'étranger dispose d'un passeport et qu'il l'a remis aux autorités, la préfecture n'a alors qu'à faire une simple demande de routing, c'est-à-dire qu'elle va essayer de placer l'étranger sur un vol à destination de son pays d'origine. Mais dans la majorité des cas, comme vous le savez, l'étranger n'a pas de document de voyage ou refuse de le donner pour des raisons qui sont évidentes. Dans ce cas, la préfecture va donc entreprendre des démarches afin d'obtenir un laissé-passer consulaire de la part des autorités du pays concerné. Un laissé-passer consulaire, comme ce nom l'indique, c'est un document qui permet de voyager sans avoir de document de voyage, de passeport, de carte d'identité. Pour obtenir ce laissé-passer consulaire, la préfecture va devoir contacter le consulat ou l'ambassade concernée, leur transmettre les éléments d'état civil de la personne concernée et surtout leur demander de la reconnaître comme l'un de ses ressortissants. Ça paraît fastidieux, mais en pratique, il s'agit très souvent d'un mail adressé au consulat ou à l'ambassade concernée la veille ou l'avant-veille de l'audience. Là où ça devient vraiment problématique, c'est que dans certaines situations, il est parfois difficile de justifier de l'existence de cette perspective d'éloignement. On a plein d'exemples en ce sens. On pense bien évidemment tout d'abord aux pays en guerre, qui sont jugés trop dangereux pour permettre un retour forcé. Le tribunal administratif de Paris a par exemple déjà annulé à plusieurs reprises des placements en cra visant des ressortissants afghans ou soudanais et a estimé que les conditions de sûreté et de sécurité rendaient leur retour impossible dans leur pays d'origine. Mais il n'y a pas que pour les pays en guerre que cette difficulté se pose, puisque certains pays n'entretiennent par exemple pas ou plus de relations consulaires avec la France. On pense notamment à la Russie actuellement, mais ça a également été le cas de l'Erythrée. On a un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. qui considèrent qu'un ressortissant érythréen ne pouvait pas être maintenu en rétention, étant donné qu'il n'y avait pas d'accord de coopération entre la France et l'Érythrée, et que l'Érythrée refusait systématiquement la délivrance de laissés-passés consulaires. Et enfin, on a certaines ambassades qui refusent de délivrer des laissés-passés consulaires, et ce de manière un petit peu aléatoire. L'exemple le plus flagrant est celui des ressortissants algériens, bien évidemment, compte tenu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie qui dure depuis plusieurs mois maintenant. L'Algérie se montre extrêmement réticente à reconnaître ses ressortissants et à leur délivrer un essai passé consulaire. Cette tendance se ressent très clairement dans les chiffres, puisque en 2024, alors que les Algériens représentaient près de 32% des étrangers en CRA, seuls 25% de ces ressortissants étrangers ont effectivement été renvoyés. Donc en réalité, les perspectives d'éloignement des ressortissants algériens, elles deviennent rapidement illusoires lorsque le consulat ne répond pas. à une première sollicitation de la préfecture ni à une seconde sollicitation. Pour conclure sur cette chronique, je pense qu'on peut se dire que lorsque les démarches consulaires piétinent que le pays d'origine refuse de laisser passer ou que le retour mettrait gravement en danger la sécurité de la personne, il y a vraiment lieu de remettre en cause l'existence de cette perspective raisonnable d'éloignement qui est le fondement même d'un placement en crat. Et donc dans cette hypothèse, si l'on raisonne en cascade, la rétention perd alors toute justification et la personne concernée doit ou devrait immédiatement être mise en liberté. En théorie, évidemment. Le placement en CRA soulève beaucoup de problématiques et il existe vraiment une multitude de moyens juridiques à soulever devant le JLD, mais je trouve que cette exigence de temps strictement nécessaire est bien plus qu'une formule. C'est une condition sine qua non du recours à la rétention administrative tout d'abord, mais c'est aussi une vraie garantie et un vrai garde-fou contre les détentions arbitraires. Et c'est la raison pour laquelle cette exigence de perspective raisonnable d'éloignement est vraiment à utiliser sans modération. Je vous laisse sur ces éléments et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.
- Speaker #0
Lauriane, il y a des personnes vulnérables qui sont placées en centre de rétention. On pense par exemple aux personnes malades, aux personnes avec des troubles psychiatriques. Comment ces personnes sont-elles prises en charge médicalement, psychologiquement, dans un CRA ? Tu as parlé du droit à avoir un médecin, mais pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, comment ça se met en place tout ça ?
- Speaker #1
Alors on rencontre de plus en plus malheureusement de situations de personnes vulnérables avec des problèmes... psychiatriques notamment, liées aussi à leur parcours de vie. La prise en charge est parfois compliquée, puisque l'unité médicale est composée de médecins et d'infirmiers, parfois d'une psychologue ou d'un psychiatre, rarement d'un psychiatre. Nous, à Wassel, par exemple, la prise en charge n'est que par une psychologue qui n'a pas un emploi du temps. elle n'est pas là Elle n'est pas sur place tous les jours de la semaine, du matin au soir. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément d'interprète non plus conventionnée avec l'unité médicale pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Avec des personnes étrangères qui ne parlent pas français, ça peut être compliqué. Voilà, on a eu des problématiques. Alors, je vais parler pour Wacel, puisque je ne connais pas forcément la réalité dans les autres centres de rétention. mais... À Wessel, on a une zone femme-famille. C'est un des seuls centres de rétention avec une zone femme où France Tardasil intervient. Et on a eu, par exemple, le cas d'une dame qui a été placée. C'était une mère allaitante, placée sans savoir où était son bébé. Et donc, il y a eu sa montée de lait. Et donc, c'était branle-bas de combat pour lui trouver un tire-lait. pour la soulager, puisqu'elle était en souffrance. J'ai un autre exemple de collègues qui ont eu un monsieur avec une sclérose en plaques et qui avait besoin d'un fauteuil roulant. Les centres de rétention ne sont pas du tout adaptés pour ce type de situation. Et d'ailleurs, ce monsieur n'a pas eu de fauteuil roulant et son état de santé s'est dégradé. Il n'avait plus de sensation dans ses jambes. donc C'est des situations qu'on rencontre et malheureusement de plus en plus.
- Speaker #0
Je voudrais qu'on parle des demandes d'asile qui peuvent être faites par les personnes retenues. Comment ça se passe si une personne qui est placée en centre de rétention, elle exprime sa volonté de demander l'asile en France ? Est-ce que c'est une procédure qui est fréquente ? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir lorsque la demande d'asile est faite en CRA ?
- Speaker #1
Alors la demande d'asile, effectivement, en centre de rétention, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter du placement. On est dans une procédure accélérée et donc une procédure d'urgence. C'est une situation qu'on rencontre... Alors fréquemment, oui et non, dans le sens où effectivement, les personnes sont dans un état de stress en fait, quand elles arrivent au centre de rétention, donc ne vont pas forcément penser à nous expliquer en fait et à nous exprimer leurs craintes en cas de retour. Les entretiens sont parfois assez rapides en fonction de l'activité, en fonction des délais aussi à tenir. Il faut savoir que En tout cas, l'année dernière et je crois les années précédentes, le taux de réussite d'obtenir l'asile en rétention est nul, c'est 0%. Donc c'est 100% de rejet en rétention. Et donc, une demande d'asile finalement déposée en rétention, c'est clairement une perte de chance pour les personnes, et notamment lorsqu'elles ont des réelles craintes actuelles. de retour, enfin en cas de retour dans le pays d'origine. Donc, c'est compliqué. Les demandes d'asile sont compliquées. C'est pas forcément notre... C'est pas la plus grosse partie de notre activité. On en a quand même, mais malheureusement, avec un taux d'échec criant.
- Speaker #0
Tu dis que c'est une perte de chance parce qu'une fois qu'on a eu un premier rejet au titre de l'asile, si on redépose une demande, ce sera un réexamen. d'une première demande d'asile, et on en parlera dans un autre épisode, mais il y a des garanties moindres dans le cadre d'un réexamen, et finalement, c'est des personnes qui vont deux fois être placées dans une procédure d'urgence, une procédure accélérée, si elles déposent une première demande en CRA, et puis une demande de réexamen à leur sortie. Est-ce que tu peux nous parler des grandes difficultés qui sont rencontrées par les personnes retenues, et puis aussi des défis qui sont humains pour le personnel des associations qui travaillent en CRA ?
- Speaker #1
Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé déjà. On se rend bien compte, dans la pratique, que les moyens sont insuffisants. Tout à l'heure, je parlais de l'unité médicale. Eux aussi sont en souffrance parce qu'ils manquent de moyens. Les personnes qui ont des vulnérabilités et qui ont besoin de soins, c'est compliqué à organiser en rétention, puisqu'il n'y a pas les professionnels qui sont là. adaptée, la prise en charge est compliquée. Tout à l'heure on parlait des UMCRA mais elles sont reléguées finalement au second plan dans les politiques de santé publique alors que finalement en rétention on se rend bien compte que la santé c'est un gros sujet quand même. Nous en tant que professionnels La plus grosse difficulté, ça va être d'être confronté à la détresse des personnes qui sont placées en rétention avec un sentiment parfois d'impuissance face à une administration qui peut s'acharner sur certaines personnes et notamment sur les étrangers de manière plus générale.
- Speaker #0
Je voudrais maintenant parler de la sortie du CRA, en tout cas de l'issue possible lorsqu'une personne est placée en rétention. Comment est-ce qu'on sort d'un CRA et quelles sont les proportions des différentes situations ?
- Speaker #1
Alors on sort d'un centre de rétention, ce qu'il faut retenir c'est principalement par la libération ordonnée par le juge, l'éloignement forcé. ou l'écoulement du délai légal du placement en rétention. Rarement, mais quand même, je dois le préciser, on peut avoir aussi des libérations par la préfecture qui se rend compte qu'elle a placé une personne pour que le placement n'était pas nécessairement justifié. Les proportions, elles varient selon les centres de rétention et selon les périodes aussi. donc... Je ne vais pas forcément donner de chiffres, mais effectivement, les rapports, les différents rapports annuels sont assez précis sur les chiffres. Donc, en tout cas, pour l'année 2024, je peux renvoyer vers le rapport interassociatif qui fournit des données assez précises sur le sujet.
- Speaker #0
Et justement, le rapport, il explique qu'il y a des expulsions illégales de personnes. Donc, parmi le pourcentage de personnes qui seront expulsées. Il faut se rendre compte qu'il y a des expulsions qui n'auraient pas dû avoir lieu, et le rapport parle même de multiplication de ces expulsions-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ?
- Speaker #1
Oui, on... On est confronté aujourd'hui malheureusement à des tentatives d'éloignement illégaux. Et j'ai un exemple en tête qui est arrivé l'année dernière à Ouassel. Un jeune qui était passeporté, qui sortait de prison, qui a été placé en rétention, qui avait contesté son OQTF en fait. Donc le recours était pendant devant le tribunal administratif. Il faut savoir que c'est un recours qui est suspensif de l'éloignement. Donc tant que la personne n'a pas vu le juge administratif, il n'est pas censé quitter le territoire français puisque potentiellement son obligation de quitter le territoire peut être annulée. Ce monsieur, comme il était passeporté, a été éloigné. Vers l'Algérie, l'audience du tribunal administratif a tout de même eu lieu et l'obligation de quitter le territoire a été annulée. Donc l'État a été condamné à faire revenir la personne sous astreinte par jour de retard. il faut savoir que que lorsque nous, France Tardasil, avons été alertés de cette tentative d'éloignement illégal, on s'est activés dans l'urgence pour informer les escortes, pour informer la préfecture que ce monsieur avait un recours pendant. et le monsieur avait tout à fait la possibilité de sortir de l'avion parce que c'était 20 minutes avant le départ. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Le tribunal administratif aussi avait été informé. Mais voilà, ce sont des situations malheureusement qui arrivent et qui effectivement se multiplient. C'est le constat qu'on fait de plus en plus.
- Speaker #0
Est-ce que tu peux définir passeporté ?
- Speaker #1
Passporter avec un passeport.
- Speaker #0
C'est ça, c'est une personne qui a son passeport et donc ça facilite pour l'administration son éloignement, c'est ça ?
- Speaker #1
Oui, puisque l'administration n'est pas obligée de demander un document de voyage, donc un laissé-passé consulaire. Donc sans autorisation du consulat, le passeport suffit pour pouvoir mettre la personne dans l'avion.
- Speaker #0
Lauriane, pour terminer, je voudrais élargir un peu le propos. Je voudrais te demander si tu as observé, toi et les associations, vous avez observé des changements dans le fonctionnement des centres de rétention, dans le profil des personnes retenues ces dernières années et surtout depuis la loi immigration de janvier 2024 dont on a déjà parlé ?
- Speaker #1
Oui, depuis cette loi de 2024, effectivement, on observe une intensification finalement au recours aux placements dans les centres de rétention. euh... Les centres de rétention deviennent, je l'ai dit tout à l'heure, un outil de démonstration politique, instrumentalisé au détriment de la vocation initiale d'un centre de rétention qui doit permettre l'éloignement le plus rapidement possible d'une personne. Et puis, les préfectures... On se rend compte dans la pratique qu'elles placent parfois par précaution. Donc détournent totalement l'objectif d'un centre de rétention. Et c'est très lié à l'actualité puisqu'elles ont peur d'être mises en cause en cas de fait divers, comme ça a été le cas récemment et qui a donné lieu aussi à... à la volonté de créer des lois pour répondre à une actualité, mais qui est totalement en décalage avec l'objectif premier d'un centre de rétention.
- Speaker #0
Et au-delà de l'aspect politique, la loi Darmanin a aussi supprimé des protections contre l'éloignement. Donc auparavant, un étranger malade, un parent d'enfants français, une personne en France depuis des années en situation régulière, il y avait plusieurs protections contre des mesures d'éloignement qui n'existent plus. Et donc j'imagine qu'on retrouve aussi maintenant ces personnes-là dans des crats alors qu'avant on devait en moins en trouver. Et notamment les étrangers malades dont tu nous parlais, peut-être que ça aussi ça a conduit au placement de personnes malades davantage dans les crats ?
- Speaker #1
Hum. Tout à fait, on se rend compte que les vulnérabilités, en tout cas, elles ne sont plus, je ne vais pas dire plus, mais elles ne sont pas prises en considération par l'administration. Alors, est-ce que ça a été exacerbé par cette loi ? Je n'arrive pas trop à m'en rendre compte. Mais en tout cas, effectivement, on a de plus en plus de personnes étrangères malades placées en rétention. Et puis, oui, les parents d'enfants français, on en a énormément en rétention. D'ailleurs, on a aussi des victoires au tribunal administratif par des annulations d'obligation de quitter le territoire de parents d'enfants français et notamment les Algériens qui ont une convention bilatérale avec la France. et on se rend bien compte que les préfectures examine de manière très rapide les situations puisqu'elles n'appliquent pas du tout les bonnes dispositions par rapport aux situations des personnes et qu'elles ne vont pas du tout en profondeur sur les situations pour notamment les parents d'enfants français. On en a énormément.
- Speaker #0
Merci Lauriane d'avoir répondu à toutes mes questions. Je précise qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur la réalité des centres de rétention et qu'il y aura un épisode davantage centré sur les procédures contentieuses. On a été amené à en parler, mais ça sera l'objet d'un épisode à part entière avec un avocat qui nous parlera des procédures devant le juge judiciaire et le juge administratif, parce que le placement en rétention crée une vraie bataille judiciaire devant ces juridictions. Donc on aura l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Merci à vous d'avoir écouté Étranges Droits. Avant de se quitter, je rappelle que les informations qu'on partage ici ne remplacent pas les conseils personnalisés d'associations et d'avocats. Et je vous renvoie vers le site du GST pour une assistance près de chez vous. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble cet étrange droit qui est le droit des étrangers.