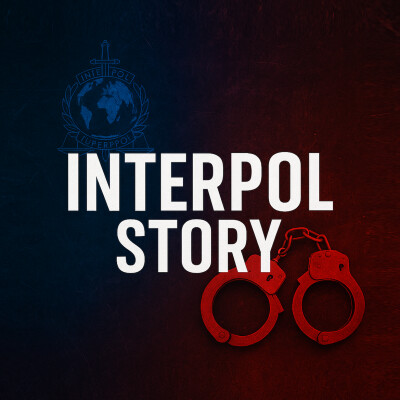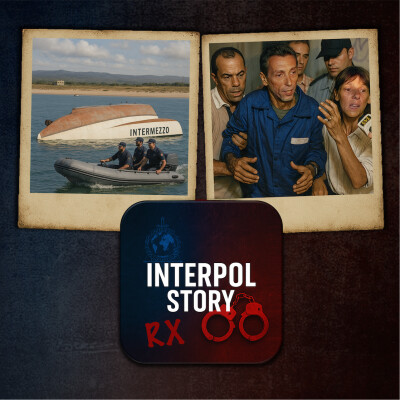Description
En 1975, deux hommes peu connus du monde scientifique mettent au point ce qu’ils présentent comme une technologie de rupture. Aldo Bonassoli, un ancien réparateur de télévisions italien, et Alain de Villegas, ingénieur belge issu de l’aristocratie, affirment pouvoir détecter des gisements pétroliers depuis un avion, sans forage, simplement en survolant le terrain. Le procédé, mystérieux, prétend identifier aussi bien du pétrole que des nappes phréatiques ou des sous-marins. L’idée est séduisante. Elle échappe à la logique scientifique mais séduit par son audace. Le contexte est favorable. La France, frappée par le choc pétrolier de 1973, cherche désespérément à s’affranchir de sa dépendance énergétique. Le projet est introduit dans les sphères du pouvoir grâce à Jean Violet, ancien agent de renseignement, qui convainc Elf Aquitaine d’y investir. En mai 1976, un premier contrat est signé. Les vols de démonstration s’enchaînent, à Brest, au Maroc, dans le golfe du Lion. À chaque étape, les inventeurs prétendent détecter des gisements. En réalité, ils ne font que reproduire des informations déjà connues, soigneusement sélectionnées pour renforcer l’illusion. L’appareil est entouré de mystère, protégé par un secret quasi militaire. Aucun examen technique approfondi n’est autorisé. Les experts sont tenus à distance. Le dispositif est scellé, entouré de secret, et les tests sont peu documentés. Malgré plusieurs forages infructueux, notamment en Afrique du Sud, les responsables d’Elf maintiennent leur confiance. À Paris, les plus hautes autorités de l’État ferment les yeux. Valéry Giscard d’Estaing est informé sans intervenir. Raymond Barre, Premier ministre, est accusé plus tard d’avoir contribué à enterrer l’affaire. En tout, plus d’un milliard de francs sont investis. Aucun contrôle rigoureux n’est effectué. Les arguments techniques sont rares. Les décisions reposent sur des rapports favorables, mais très superficiels. L’espoir d’un miracle technologique prend le pas sur la rigueur scientifique. En mai 1979, un rapport scientifique produit par le physicien Jules Horowitz met fin aux illusions.
Le système est truqué. Les tableaux de détection sont manipulés à la main. La technologie ne repose sur rien.
En juillet, les contrats sont rompus, mais l’affaire est enterrée. Elle ne ressurgira qu’en décembre 1983, grâce à un article du Canard Enchaîné. La presse révèle l’ampleur des sommes engagées, le laxisme des contrôles, et le silence organisé autour de l’échec. Une commission parlementaire est constituée.
Les auditions s’enchaînent. Chacun tente de se défausser. Certains documents ont disparu. Personne ne sera poursuivi. Les inventeurs quittent discrètement la scène. De Villegas retourne en Belgique, ruiné. Bonassoli, lui, reprend son métier d’origine. L’État choisit de ne pas engager de poursuites pour éviter un scandale plus large. Elf, entreprise publique, reste muette. L’affaire des avions renifleurs devient alors un exemple des dérives possibles lorsqu’un système choisit de croire plutôt que de vérifier.
Elle révèle les failles d’un État séduit par une promesse technologique sans fondement, incapable de reconnaître l’imposture tant qu’elle s’aligne sur ses besoins. Ce n’était pas un complot. C’était un aveuglement collectif, prolongé par l’opacité, le silence, et la peur d’avoir trop cru.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.