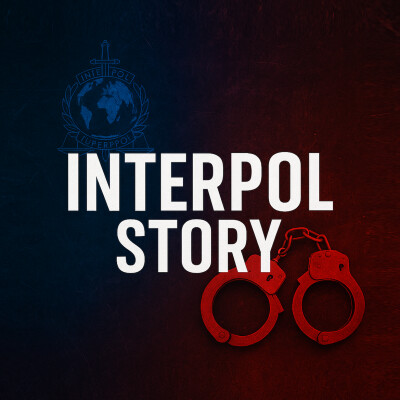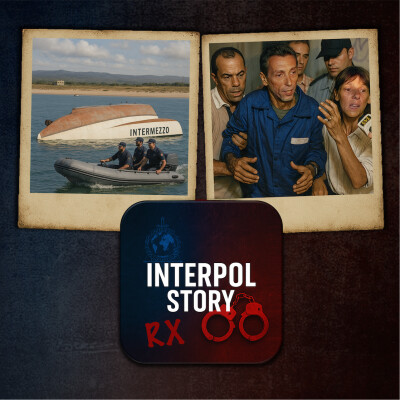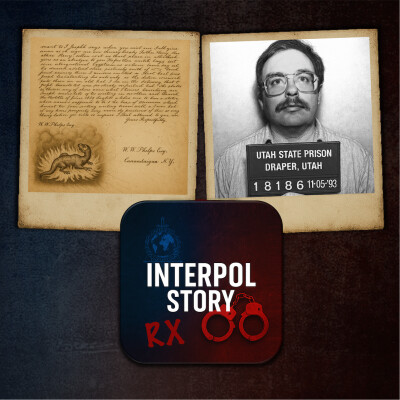Description
Kim Jong-nam, fils aîné de Kim Jong-il, voit le jour en 1971 à Pyongyang, dans un contexte familial complexe.
Sa mère, l’actrice Song Hye-rim, n’est jamais officiellement reconnue comme compagne du leader nord-coréen, et leur relation reste longtemps secrète.
Jong-nam est élevé à l’écart, entouré de précautions. Dès son plus jeune âge, il est désigné comme successeur potentiel. Dans les années 1980 et 1990, il est envoyé à l’étranger pour étudier. Il vit notamment à Moscou, puis en Suisse, où il fréquente une école internationale.
Il y développe une vision du monde différente, apprend plusieurs langues, s’intéresse aux nouvelles technologies, à l’économie de marché et à l’internet, alors balbutiant. De retour à Pyongyang, il se voit confier certaines missions techniques et économiques, en lien avec des projets de modernisation. Il évoque parfois la possibilité d’une réforme inspirée du modèle chinois.
Son demi-frère cadet, Kim Jong-un, est alors discrètement préparé à lui succéder. Il conserve des liquidités, vit dans des hôtels, et change fréquemment de lieu. Bien qu’écarté du pouvoir, il incarne une alternative génétique au régime. Pour certains, cela suffit à faire de lui un danger latent. Le 13 février 2017, il se rend à l’aéroport international de Kuala Lumpur, pour un vol vers Macao. Dans le terminal, il est abordé par deux femmes. L’une le distrait brièvement. L’autre lui plaque un tissu sur le visage, puis s’éloigne. Moins d’une heure plus tard, Kim Jong-nam meurt dans une ambulance. L’autopsie révélera l’utilisation du VX, un agent innervant classé comme arme de destruction massive.
Le poison agit en bloquant les signaux nerveux. Il provoque une asphyxie rapide, souvent en quelques minutes. Son usage en plein aéroport international provoque une onde de choc mondiale. Leurs versions convergent. Elles sont inculpées pour meurtre, risquent la peine de mort, mais leur comportement intrigue. Elles ne fuient pas. Elles coopèrent. L’une revient même sur les lieux le lendemain, pensant poursuivre le tournage. L’enquête révèle que quatre ressortissants nord-coréens ont fui la Malaisie juste après l’attaque. D’autres suspects, liés à l’ambassade de Corée du Nord, sont protégés par l’immunité diplomatique. La Malaisie demande leur extradition.
La Corée du Nord nie toute implication, conteste l’autopsie, et refuse de reconnaître Kim Jong-nam comme victime. La Corée du Sud, elle, accuse directement Pyongyang. Les relations diplomatiques entre la Malaisie et la Corée du Nord sont temporairement rompues. En 2019, Siti Aisyah est libérée après l’abandon des charges. Đoàn Thị Hương plaide coupable pour une accusation moindre, et sort quelques semaines plus tard.
Le crime, quant à lui, reste officiellement non élucidé. Les auteurs présumés de l’opération n’ont jamais été jugés. L’utilisation d’un agent chimique, dans un lieu public, n’a donné lieu à aucune sanction internationale majeure. Le choix du lieu de l’attaque n’est pas anodin. Un aéroport international est un espace hyper-sécurisé, filmé, symboliquement neutre.
En y perpétrant un assassinat aussi sophistiqué, le régime nord-coréen – s’il est bien à l’origine de l’opération – transmet un double message : il n’existe aucun refuge pour ceux qu’il considère comme traîtres, et aucun endroit n’est hors de portée de sa volonté.
La terreur n’est pas seulement une arme intérieure. Elle peut être projetée, exportée, emballée sous forme diplomatique. Cette affaire met aussi en lumière la vulnérabilité des individus à être instrumentalisés. Deux jeunes femmes, issues de milieux modestes, ont été embarquées dans une mécanique qu’elles ne comprenaient pas.