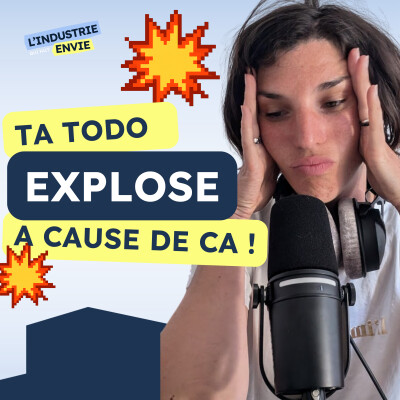- Speaker #0
Hello les passionnés d'industrie et de RH, bon ce podcast je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tenayou, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie. Enfin, surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois deux invités qui vous présentent chacun quatre thématiques et donc quatre épisodes. Alors, c'est un shot de bonne pratique et de benchmark que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute ! Hello Olivier, tu vas toujours bien ?
- Speaker #1
Toujours bien !
- Speaker #0
Bon. Ah, donc bienvenue dans ce deuxième épisode ! Je repose un petit peu de contexte, tu es Olivier Luancy, auteur de Réindustrialiser, le défi d'une génération mais pas seulement, en tout cas si vous voulez en savoir plus sur Olivier, filez écouter le premier épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui, tu le sais, me tient vraiment particulièrement à cœur. C'est non seulement l'essence même du podcast, c'est aussi l'ambition que je porte pour l'industrie dans mon quotidien. auprès des RRH, des dirigeants industriels. En fait, c'est un peu mon job. Comment rendre l'industrie française désirable ? Ou pour faire référence au podcast, comment redevenir l'industrie qui fait envie ? Parce que oui, tu posais le cadre dans le premier épisode. Après 40 ans de désindustrialisation conscientisée, volontaire, aujourd'hui, l'ambition, la nécessité de réussir notre renaissance industrielle passera par la désirabilité de l'industrie. comme tu le nommes dans ton livre. Forcément, quatre décennies de désintérêt, de valorisation, de tertiarisation sont venues ternir l'image de cette grande famille de l'industrie. Alors, on a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est que, nécessairement, dans ce monde de surconsommation, on n'a jamais été autant entouré de produits manufacturés. Et pourtant, si on regarde les choses en face, l'industrie ne fait pas rêver. Elle est souvent perçue comme polluante à... archaïque, masculine, trop peu en phase avec les aspirations modernes. Ok, j'y vais pas de main morte. Alors, comment on change ça ? Comment on recrée un lien entre l'industrie, les citoyens, entre l'industrie, les territoires, entre l'industrie et ses futurs collaborateurs ? Tout ça, c'est l'intention de cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a ?
- Speaker #1
Un vaste programme. Question ambitieuse.
- Speaker #0
Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on avance. Dans ton livre, tu écris, je te cite donc, pour que l'industrie redevienne désirable, il faut changer notre regard. Mais alors, par où on commence ? On commence par changer son image, on s'attaque à la réalité, au terrain. Enfin, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on fait ?
- Speaker #1
Alors, c'est un sujet que j'ai exploré. Ce que je vais proposer, c'est... plus une méthode pour... Enfin, ma réflexion m'amène à plutôt proposer une méthode que des réponses toutes faites. Donc, je me permets de le dire à l'avance parce que c'est quelque chose qui est encore devant nous. Il y a des bouquins qui vont sortir sur le sujet. Il y a des réflexions. On n'a pas encore, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, on n'a pas encore les réponses après 40 ans de désindustrialisation, de dénigrement de l'industrie. On n'a pas encore toutes les réponses sur comment faire. Alors, il y a un premier point pour moi qui est clé, c'est... Il faut rappeler les finalités de l'industrie tout le temps. C'est-à-dire, on ne fait pas des usines pour faire des usines. Il y a des gens, mais on n'est pas si nombreux que ça. Et puis, ce n'est pas nécessaire qu'on soit non plus la majorité, qui adorent la transformation de la matière, la matière en fusion. Moi, j'ai été directeur d'une usine de Saint-Gobain dans laquelle j'avais 2000 tonnes de verre en fusion dans une espèce de cocotte minute qu'on appelle un four revêtu de céramique parce que c'est à 1200 degrés. Voilà, il y a des gens qui aiment ça. J'en fais partie. mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir le même goût esthétique, les mêmes goûts. En revanche, il y a quelque chose qui nous réunit derrière l'industrie, c'est ces finalités qui maintenant sont claires, je pense, et qu'il faut continuer à les diffuser, mais on réindustrialise pour des questions de souveraineté et donc d'avoir entre nos mains notre destin collectif, la notion de communauté qui décide de ses valeurs et de la façon dont elle veut avancer. Pour réduire notre empreinte environnementale, 6 des 9 limites planétaires dépassées, on ne peut pas continuer comme ça, on le sait. Voilà. Et puis, pour une troisième chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur et qui est peut-être mon moteur, enfin mon petit moteur intérieur, c'est la notion de cohésion territoriale. Quand on a décidé d'aller dans une économie tertiaire, je ne sais pas si on a été vraiment conscient d'avoir concentré comme ça la richesse dans les métropoles. Il y a une étude de l'OCDE qui dit qu'entre 2006 et 2016, la concentration de richesse dans les métropoles, la France est là, elle est en haut du podium. Et les pays qui sont en position 2 et 3 sont un peu particuliers, parce qu'au sein de l'OCDE, parce que c'est l'Irlande et le Danemark qui sont des pays, je dirais, monométropoles. C'est la capitale métropole, donc il y a un effet cumulatif. Et c'est ça, le Royaume-Uni qui est celui qui nous ressemble, le plus, c'est simplement en quatrième position. Donc, on a concentré la richesse dans les métropoles, on a paupérisé des territoires, et l'industrie est un outil pour faire la cohésion sociale par l'insertion, mais aussi et surtout territoriale. en donnant des bons jobs, de la création de valeurs ajoutées dans tous ces territoires, ceux que j'appelle les territoires de sous-préfecture. Donc la première chose dans laquelle il faut changer notre façon de voir les choses, et encore une fois, je sais que c'est totalement incomplet, qu'il faudrait mettre des images et pas que des mots, des romans et des films et pas que des concepts, c'est de se dire, voilà, l'industrie, ce n'est pas juste poser une usine quelque part au fond de mon jardin. ou dans un coin de mon territoire, c'est un outil productif qui, en fait, sert les fidélités de notre société, de notre projet de société, de notre communauté. Voilà un premier point de réponse. Et puis, après, moi, je bascule, et c'est peut-être là où il y a le chaînon manquant, encore, ce qu'il faut construire. Ça fait un petit moment que j'essaye de travailler avec des gens qui font de l'image, des documentaires, des films. Je travaille avec des scénaristes pour essayer de combler entre le concept Ce que je viens de dire, la finalité ultime de l'industrie et puis notre vécu au quotidien, mais il y a ce trou à remplir. Par contre, ce qu'on a véritablement et sur lequel on peut s'appuyer, c'est toutes ces expériences qui se passent dans nos territoires, dans des PMI, dans des entreprises. Et là où on voit des témoignages, notamment de jeunes, j'en avais mis quelques-uns, je crois, dans mon bouquin, mais il y en a plein d'autres, qui expliquent comment ils s'épanouissent dans l'industrie et que ce n'est pas ce qu'ils vivent. est complètement décalé par rapport à l'image qu'on véhicule. Et là, il y a un travail assez simple finalement à faire. Encore une fois, on n'a pas complété toute la carte du grand concept jusqu'à la vie du quotidien, mais au moins sur la vie du quotidien, il y a vraiment des choses à faire sur rappeler que l'industrie, ça paye bien, parce qu'on travaille aussi pour gagner sa vie et se donner une capacité, voire d'achat. Je n'aime pas trop le terme parce qu'il a pris une connotation. une capacité d'acheter des choses et de se sentir bien dans la vie en tant que consommateur. On travaille aussi, et c'est le deuxième point, parce qu'il y a une image de l'industrie qui n'est pas la même que celle qui est réalité. Et là, on peut travailler sur cette image. Et puis, il y a un troisième chantier dont tu vas me faire parler, Jean, je suis sûr, qui est celui de l'organisation, parce qu'il est vrai. Et tu l'as dit, il n'y a pas qu'une image qui est négative. Il y a aussi une réalité de l'organisation qui correspond à du travail dans l'usine. qui est issu des modèles mécanistes de Ford, de Taylor, et qui ne correspond pas, qui ne correspond plus à ce qu'on a envie de vivre. Voilà, plusieurs éléments de réponse. Encore une fois, je sais que je n'ai pas fini ma réflexion, qu'on n'a pas fini cette réflexion collectivement sur comment on rend l'industrie désirable. Et j'ai donné ça un petit peu des colorations à droite et à gauche.
- Speaker #0
Et tu nous parles aussi... Des différents leviers, tu vois, comme par exemple la promotion du Made in France, que c'est aussi l'un des leviers d'attractivité. En vrai, tu en cites plusieurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En quoi est-ce que tout cela, finalement, va dans le sens de l'image de l'industrie ? Et tu parles aussi d'un postulat hyper important, c'est… À nouveau, je vais te paraphraser, mais on n'a pas besoin de rendre l'industrie désirable juste pour la rendre désirable. On en a besoin parce qu'on pose des faits, des constats, qu'aujourd'hui, on a en moyenne par an 60 000 postes qui sont vacants, qui sont non pourvus, qui ont un impact colossal, un manque à gagner colossal et donc un impact sociétal, comme tu l'as déjà dit, sur les territoires. etc. Donc encore une fois, il y a un objectif derrière. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Ce n'est pas juste parce que toi et moi, on adore l'industrie. C'est bien plus que pour cela. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
- Speaker #1
Je vais essayer de structurer ma réponse en trois temps. Tu as parlé du Made in France. Ce qui est super impressionnant aujourd'hui, c'est que quand on pose des questions aux personnes qui vivent dans des territoires où il y a des usines, ces usines font partie de l'identité du territoire et de la fierté qu'ils ont en appartenance. Donc, la dimension, je dirais, identitaire d'un territoire industriel, on la vit. Par contre, la fierté pour le produit, elle est plus faible. C'est assez étonnant parce qu'on est fier et on appartient à son territoire, mais la fierté pour le produit made in France, quand on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui, elle est plus faible. Et là-dessus, il y a pourtant des choses fantastiques à faire. Et c'est, encore une fois, un levier, un boulevard même, à la fois économique, parce que si on produit en France, on aura moins d'importations et on aura plus de jobs et plus de créations de richesses domestiques, endogènes, nationales, mais aussi un véritable facteur de fierté. en disant, voilà, ce produit, il a été fait dans mon territoire, dans mon pays. Et là, il y a quelque chose à travailler. Et ce qui a été commencé, par exemple, par Origine France Garantie, puisque le petit logo Made in France ou Made in Vietnam ou Made in ailleurs, en fait, le référentiel derrière est un référentiel douanier. Et il faut être conscient de ça, il ne dit rien sur la part de valeur ajoutée ou sur le nombre d'emplois qui ont été faits dans le pays qui est marqué sur l'étiquette. Il dit juste que la dernière étape de transformation essentielle principale a été faite dans ce pays-là. Dans le textile, par exemple, il y a des débats entre différentes administrations sur savoir si, quand on met l'étiquette, quand on met le bouton, est-ce que c'est la dernière étape de transformation essentielle. Mais j'illustre ça pour dire, en fait, ça ne nous dit rien, le Medin. C'est un code douanier. C'est un code, en fait, pour gérer les transactions et des questions de taxes douanières. Là-dessus, il y a un autre... Label qui a été créé, par exemple, qui origine France Garantie et qui vous assure globalement qu'il y a 50% de la valeur ajoutée d'un produit qui est fait en France. Donc, on commence simplement à proposer à nous, citoyens, mais aussi consommateurs, une manière de lire nos produits qui permettent de le relier à une territorialisation, à des emplois, à véritablement une origine territoriale. C'est un début et je pense que là, on a beaucoup à gagner. Je rêve, moi, d'une réindustrialisation qui passerait par le fait qu'on trouverait des corners de produits made in France dans tous nos magasins étiquetés comme ça. Ça peut paraître un peu étonnant, mais je pense que ça fait partie d'une politique de réindustrialisation qui nous redonnerait cette fierté pour le produire en France. Voilà, ça, c'était l'aspect made in France. Et le potentiel, en fait, est énorme. Je peux retourner sur des quantifications, mais c'est des dizaines de milliards d'euros que nous... pourrions relocaliser sans changer les textes, avec un impact très faible sur le pouvoir d'achat et même avec de la création de valeurs collectives pour notre pays, pour les entreprises qui le font, pour la commande publique, pour l'État. Il y a de véritables leviers. Ce n'est pas simplement le romantisme du Made in France, de la marinière d'Arnaud Montebourg, qui a été super pour incarner ça, mais ce n'est pas juste le côté flamboyant et romantique. Il y a une réalité économique derrière aussi profonde. qui s'appuie sur cette identité-là, sur cette fierté qu'on pourrait avoir pour le produire en France. Oui,
- Speaker #0
c'est un sentiment d'appartenance aussi derrière.
- Speaker #1
Tout à fait. On a sur le territoire, qu'on voit dans les enquêtes sur le territoire, mais qui est moins lié au produire made in France, à l'étiquette made in France. Peut-être encore une fois, parce que quand on va dans un magasin, nous on le sait parce qu'on a étudié le sujet, mais inconsciemment... On sait que l'étiquette dite made in France ça ne vaut pas grand-chose, ça ne dit pas grand-chose. Et c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut passer à un label. Aujourd'hui, c'est Origines France Garantie qui permet de sécuriser qu'il y a une partie, plus de la moitié, la majorité de la valeur ajoutée des emplois qui sont derrière ce produit-là sont localisés en France. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect que tu as évoqué, qui est celui de l'image des métiers industriels. Et c'est là où je disais tout à l'heure, il ne faut pas arrêter de répéter, les métiers industriels à niveau de formation équivalent payent en moyenne 20% de plus que dans les services. Certes, on veut changer le monde, mais on veut aussi vivre avec un certain niveau de confort et on travaille aussi pour gagner sa vie. Et l'industrie paye. Voilà, ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas assez. Il y a une forme peut-être de pudeur à parler d'argent, mais c'est une première réalité. La deuxième sur les métiers et leur attractivité. qui est sans doute à mon avis l'une des raisons pour lesquelles il y a ces postes vacants, ces 60 000 postes vacants encore aujourd'hui, même s'il y a plein de plans sociaux qui sont en train de s'annoncer, c'est qu'on a collectivement une image de ces métiers industriels qui s'est bloquée dans les années 80. Alors comme je le dis souvent, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu cette façon de présenter les choses, l'image que les Français, que nous avons des métiers industriels, c'est pas germinal, ça c'est terminé c'était sympa le film, je viens de le revoir récemment, ok c'est pas non plus Charlie Chaplin qui arrive plus tard, d'accord mais n'empêche que entre la réalité des métiers la façon dont ils sont exercés et l'image qu'on en a collectivement, il y a à peu près 40 ans d'écart, 40 ans d'écart c'est 40 ans d'automatisation de robotisation, de cobotisation pour enlever les tâches pénibles et répétitives Encore une fois, c'est celles-là ou ces outils-là sont à la fois les plus performants pour la qualité du travail et économiquement. Donc, il y a 40 ans d'efforts qui ont été faits pour améliorer les conditions de travail qui ne sont en fait pas reflétés dans l'image qu'on en a. Voilà, collectivement. Et ça, c'est une question de com. La com a des défauts, mais elle a aussi beaucoup de vertus et notamment de permettre de reconnecter une réalité avec une image. Et là, on a un boulot de com à faire. Il y a plein de choses qui se font sur ce sujet-là. Je suis, à titre personnel, très optimiste, je le dis. Il y a de plus en plus d'usines qui s'ouvrent, qui accueillent des jeunes, de chefs d'entreprise qui vont vers l'éducation nationale. J'essaye de faire passer un message aussi. Si vous êtes un chef d'entreprise qui a mon âge, enfin, si vous avez mon âge, envoyez aussi votre jeune apprenti ou votre jeune recrut, enfin, votre dernier recrut, parce qu'il y a un gap générationnel sur les modes de communication. Et donc, pour communiquer avec des lycéens ou des collégiens, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a 5 ou 10 ans de plus que eux, que moi qui en ai 30 ou 42 plus. Ça marche beaucoup mieux. Et il faut être capable d'avoir cette sorte d'humilité. Certes, on est le patron, on est engagé, on est passionné, on a une passion qu'on veut communiquer. Mais des fois, on n'a pas les bons mots, les bons codes. Et dans ces cas-là, il vaut mieux faire un pas de côté et laisser quelqu'un de son équipe parler. Mais ce boulot-là, il est en train d'être fait partout en France. Il y a plein d'initiatives. Il y en a même tellement qu'un jour, on m'a dit, il ne faudrait pas rationaliser. Non, non, surtout pas. Tous les territoires sont différents. Toutes les initiatives sont différentes. Il faut cet engagement. Il va porter. La mayonnaise va prendre à un moment donné. Et j'appelle de mes voeux à ce qu'on ait un truc chapeau. Pour l'instant, ça s'appelle Avec l'Industrie. Je ne sais pas si vous avez vu les campagnes de com sur le sujet. C'est super. Mais il y a deux limites. Je suis très exigeant dessus. Je sais, c'est mon rôle. Je veux toujours pousser plus loin. Un, on y met 5 millions d'euros par an pendant 3 ans. Pour l'instant, elle a été financée sur 3 ans. Le manque à gagner avec 60 000 postes vacants en France, c'est 5 à 6 milliards d'euros par an. Même si on est dans de la communication, que les taux de multiplication ne sont pas ceux de la production, etc. On s'imagine bien que si on investit 5 millions d'euros d'un côté pour résoudre un problème à 5 milliards, il y a un petit ordre de grandeur qui manque quelque part. Et j'aimerais bien qu'on fasse une campagne de communication beaucoup plus puissante, comme avec l'industrie, mais fois dix. Ça, c'est une question de quantité. Et ça, ce n'est pas à l'État de payer le marketing des jobs industriels. C'est bien la famille de l'industrie. C'est à elle de se mobiliser pour montrer qu'elle est belle, qu'elle est attractive, qu'elle est désirable. On ne délègue pas son marketing à une administration. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième. C'est une question aussi de culture. L'industrie a été très, très introvertie. Et je vous propose un exercice. Si vous êtes intéressé, vous allez sur Internet, vous mettez d'un côté de l'écran une page de la pub S'engager de l'armée et une page de la pub Avec l'industrie Il y en a une, vous la voyez. En une demi-seconde, vous avez compris le message. S'engager Après, il y a des déclinaisons, mais on parle à l'émotion, on parle au cœur, on parle aux valeurs. Et quand on regarde la pub ou l'image, l'affiche de Avec l'industrie Il y a du petit texte. Il faut dix secondes pour le dire. Je ne dis pas que c'est un bouquin, un roman, mais on parle encore à l'intellect, à la rationalité. On n'a pas encore dépassé le fait que pour rendre désirable un secteur, certes, il faut qu'il ait des fondamentaux, il faut qu'il y ait un raisonnement derrière, il faut qu'il y ait des valeurs, il faut qu'il y ait une feuille de route, il faut qu'il y ait des objectifs, c'est certain, mais il faut être aussi capable de parler à l'émotion. Et ça, la famille de l'industrie, elle n'a pas encore passé le pas. C'est quelque chose qui lui reste à faire. Elle est en chemin, encore une fois. Mais voilà, là, on a un sujet à travailler ensemble sur comment on fait cette reconnexion. à la fois factuelle et aussi émotionnelle, entre la réalité des jobs industriels et l'image que nous, parents, que les profs, que les conseillers d'orientation, que les élus, que les gens qui ont de l'influence sur les trajectoires de nos enfants et des jeunes, on est en train de transmettre. Et cette image-là, encore une fois, aujourd'hui, elle a 40 ans de retard sur la réalité. Voilà un deuxième aspect. Et puis, un troisième aspect sur cette question d'attractivité des métiers. C'est une question plus profonde. C'est un chantier à ouvrir qu'on a un peu refusé pour l'instant. L'industrie, c'est celui de l'organisation du travail. L'industrie, elle est organisée essentiellement sur des modèles d'organisation qu'on appelle mécanistes. Ils sont issus de Ford et de Taylor. Alors, c'est normal que l'industrie les ait adoptés. Quand Ford a mis en place son organisation, sans innovation technologique particulière, Il a construit une voiture en huit fois moins de temps qu'avant. Pour toute personne qui connaît un tout petit bout de notion de productivité, ou même pas du tout, vous fabriquez le même objet en huit fois moins de temps que la fois précédente.
- Speaker #0
C'est difficile de s'asseoir sur ça.
- Speaker #1
On comprend que cette organisation du travail, elle s'est diffusée de partout. Elle a été le modèle, le modèle quasiment unique, universel. Bon, aujourd'hui, on a une véritable question. C'est que ce modèle-là ne répond pas aux attentes de la société en termes de flexibilité, d'équilibre de vie, travail, vie pro. Alors, je le mets dans une petite capsule un peu provoquante aussi. Je dis, vous allez voir un jeune et vous lui dites, vous avez un boulot dans le service, il est rémunéré 20% de moins, mais vous avez deux jours de télétravail. Et vous allez en industrie, vous avez 20% de plus de salaire, mais vous êtes posté en 3-8. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez ? Quand une fois, c'est juste pour provoquer la réflexion. Je pense que la famille de l'industrie, et ça concerne autant les dirigeants d'entreprises que les syndicats, c'est un sujet pour moi de démocratie sociale, c'est pas un sujet pour l'État, c'est pas un sujet pour une réglementation ou une loi. On doit se remettre autour de la table et se poser la question, comment est-ce qu'on fait évoluer nos organisations afin qu'elles répondent à ces nouvelles attentes sociétales, des jeunes mais aussi des moins jeunes. Il y a des enquêtes très intéressantes qui disent que les jeunes revendiquent ça de manière un peu vocale, mais que les moins jeunes seraient ravis d'en profiter, en fait, d'attendre que ça. Donc, ce n'est pas qu'un truc générationnel. Non, ça,
- Speaker #0
ce n'est pas un principe génération. Ça aligne tout le monde.
- Speaker #1
Ça aligne tout le monde. Voilà. Alors, certains sont plus vocaux et revendicatifs, d'autres le sont moins. Ça, par contre, il y a un mode de communication qui est différent entre les générations. Mais on a un vrai sujet là. Et je crois que la promesse qu'on devrait faire aux jeunes pour rendre ces métiers attractifs, une promesse raisonnable, réaliste, mais aussi inspirante, en tous les cas aspirante, serait de dire, OK, on n'a pas les organisations, on reconnaît que c'est le fait aujourd'hui. On se donne deux ans, trois ans, quatre ans, mais un laps de temps limité en disant, on va y arriver. Voilà la période qu'on se donne pour adapter nos organisations, certes à l'enjeu de productivité, mais aussi à l'enjeu d'équilibre de vie professionnel pro. Et on rentre dans cet exercice-là et c'est une promesse qu'on vous fait. Si vous rejoignez l'industrie aujourd'hui, on sait qu'on ne vous délivre pas ça, mais dans quelques années, on s'engage à le faire. On s'engage à avoir ce même type d'équilibre, ce même type de flexibilité. Voilà trois sujets. L'industrie, ça paye bien. La réalité des jobs industriels en termes de répétabilité, de pénibilité, et il y en reste, il ne faut surtout pas dire le contraire. Là, on serait dans le déni, mais c'est beaucoup amélioré et bien meilleur que ce qu'on vous raconte. Venez voir. visiter des usines, discuter avec des gens qui y sont. Et puis la troisième chose, on sait qu'on a un point dur, qui est l'organisation du travail, et bien on l'attaque. Et on le dit et on s'engage publiquement que c'est le sujet qu'il faut qu'on traite dans les années à venir, parce que sinon nos métiers resteront non attractifs. Voilà un petit peu. Et puis j'avais un troisième sujet, mais j'avoue que je l'ai oublié en chemin, dans ce que tu avais évoqué pour rendre... notre industrie plus désirable ?
- Speaker #0
Écoute, je ne sais plus non plus. La question m'était venue comme ça, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai un quatrième. Pour moi, dans les trois points que tu abordes, il en manque un gros pavé qui est tout ce qui tourne autour de la stratégie RH des entreprises, des industriels. Si tu veux, mon constat, puisque tu sais que c'est mon cœur de métier, c'est que... On a, pour les entreprises, les industries qui vont travailler leur communication, que ce soit leur communication employeur, comme produit, etc. Il y a souvent un décalage. Alors, moi, je l'observe côté candidat ou collaborateur. Encore une fois, je n'ai pas du tout d'orientation produit, tu le sais. Mais j'observe très souvent un décalage entre ce sur quoi l'on communique et ce qui se passe vraiment, qui s'explique par plusieurs facteurs. Souvent, l'envie de se montrer sous son meilleur jour, on est parfait ou on tend à l'être. Et il s'avère que dans les faits, on ne l'est pas forcément. Et les impacts derrière sont énormes. C'est-à-dire qu'on va avoir une campagne de marque employeur aux petits oignons. Et derrière, moi, j'ai des RH, des recruteurs. qui ne parviennent pas à répondre suffisamment vite aux candidats, par exemple, à traiter tous les messages, à travailler une intégration qualitative pour les accueillir en bonne et due forme, pour les former en bonne et due forme. Et tout ça, d'abord, c'est des sujets de process RH. Je pense que la partie process va te parler. Donc, si tu veux, il y a une forme de distorsion. Ça ne peut pas... Ça, ça ne peut pas marcher pour moi. C'est déjà, travaillons correctement. Et j'ai tendance à considérer, si tu veux, sur ces sujets RH, sur ces sujets de communication de marque employeur, que c'est un output. Les inputs, c'est les process, la manière dont on bosse. C'est notre culture d'entreprise. Qui sommes-nous ? Quelle est notre identité ? Quelle est notre promesse ? Qu'est-ce qu'on a raconté ? Qu'est-ce qu'on vit dans les ateliers ? Qu'est-ce qu'on vit ? sur nos sites, tu vois ? Je trouve que c'est des maillons qui sont manquants. Et effectivement, tu en as parlé. Et les trois, pour moi, les trois sujets que tu as abordés rentrent sur la partie RH, sur ce qu'on appelle l'EVP, l'Employee Value Proposition. C'est quoi ? C'est la promesse employeur. Et cette promesse-là, elle, c'est en fait simplement qu'est-ce qu'on offre aux salariés en échange de leur travail. Donc, évidemment, il y a le salaire, mais il va y avoir les conditions de travail. l'organisation. Et en fait, finalement, c'est un vrai travail sur ça. Et donc, appliquer à une démarche plutôt marketing, et tu en as très bien parlé quand tu fais le parallèle entre, d'une part, l'armée, la campagne s'engager et avec l'industrie, c'est la promesse. Je suis une entreprise. Quelle est ma promesse employeur ? Une phrase, un mot. Qu'est-ce qui résume véritablement qui nous sommes ? Quelle est notre ambition ? Qu'est-ce qu'on vous offre ? Tu vois, je me suis un peu emballée sur le sujet. Mais c'est le mien.
- Speaker #1
En fait, tu fais le lien entre le point que j'avais omis, que je vais reprendre là. Il y a un espace de jeu que la famille de l'industrie n'a pas investi encore, qui est celui de l'engagement et du débat public. C'est-à-dire, pour rendre notre industrie attractive. Et je vais revenir après sur tes processus RH, et je n'ai pas ton expertise. J'y donnerai un regard, si tu veux, le regard que j'ai sur les questions que tu poses. Mais pour rendre les métiers attractifs, il faut qu'on soit fier de notre industrie. Il faut que ces représentants, les chefs d'entreprise, prennent position dans le débat public pour dire, ben voilà, vous nous présentez comme des sales pollueurs, mais encore une fois, l'industrie textile, l'entreprise que j'ai vue hier, mais moi, je suis à 100% de recyclabilité de mes produits. Et j'y suis déjà et je le revendique. Et je le revendique comme chef d'entreprise et comme citoyen. Moi, je l'incarne comme homme, femme, jeune, moins jeune, etc. Nous l'incarnons collectivement, cette envie d'apporter une valeur, pas simplement économique, pas simplement du PIB, dans notre société. Et cette prise de parole-là, elle n'existe pas assez. Elle n'existe pas assez. Elle peut être positive, comme je le dis, ou bien défensive. Là, vous êtes en train de prendre un texte qui nous plombe totalement.
- Speaker #0
Ok, il est très bien pour l'environnement et j'adhère avec l'intention, mais la manière dont vous le mettez en œuvre, ça nous plombe. Et on a encore toute cette démarche-là à faire dans la famille de l'industrie qui est de rentrer dans le débat public. On a longtemps cru que le discours rationnel entre le dirigeant et les représentants de l'industrie suffirait pour résoudre tous les problèmes, pour trouver le bon point d'équilibre. Encore une fois, on a changé d'univers, on est dans un univers. de rapport de force, de communication. Et il faut que la famille de l'industrie se projette là-dedans, complètement. Et après, ça, la déclinaison que tu évoques sur la partie RH, avec un autre bémol ou un autre regard sur ce que tu dis, un regard complémentaire sur ce que tu dis, c'est que quand on se projette dans ce monde de la communication et qu'on ne connaît pas, on a tendance à s'emballer, à dire que tout va bien. parce qu'on nous a vendu du rêve. On a été dans un monde un peu de Disneyland. On nous a dit qu'on allait devenir les plus forts, les plus grands, les premiers, etc. Donc, on veut reprendre ça. Il y a un deuxième message qui est très fort. À la fois, il faut s'embarquer dans ce monde de communication à l'extérieur. Il faut ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, faire tomber les grilles, s'exposer, s'engager en tant que personne, dirigeant, RH, entreprise. Mais aussi, il ne faut pas cacher la réalité. C'est ça. Et ça, c'est difficile parce que pendant des années, toutes les pubs qu'on a vues, on fait tous 1m80, on a des muscles de partout, on est beau. Mais comme toi. D'accord, ok, merci. La prochaine fois, tu seras sincère. Et voilà, en fait, il faut rentrer dans un monde dans lequel on colle à la réalité. On peut faire des promesses, on peut faire des engagements. mais sur lesquels, derrière, on déroule des plans d'action, mais surtout ne pas dire que tout va bien. Sur les engagements environnementaux des entreprises, par exemple, il y a quelque chose sur lequel tous les gens que je connais ont témoigné. C'est, tu prends un engagement, tu recrutes quelqu'un. Tu dis, par exemple, je suis zéro déchet. OK, très bien. Tu recrutes des gens, notamment des jeunes, très branchés sur les réseaux sociaux. Ils découvrent que tu as un dépotoir derrière, que tu as bien caché entre cinq armes. Tu tues ta marque, tu tues ton adhésion, tes employeurs. tes employés, les gens qui travaillent avec toi, sont ton premier vecteur de communication externe. Certes, tu peux faire de la com interne, mais elle doit être totalement en adéquation avec ta com externe. Et ce sont tes premiers vecteurs de communication qui doivent être embarqués. Donc, tu peux leur dire ce que tu veux faire, le monde idéal vers lequel tu veux aller, mais tu ne peux pas non plus leur cacher la réalité. Comme une fois, c'est une double étape pour une famille de l'industrie qui n'a pas appris à communiquer à l'extérieur, qui commence à l'apprendre. et qui prend des schémas de communication, tout va bien, année 90, on est tous Claudia Schiffer, dans un monde où il faut communiquer, mais, tu vois, j'ai pris une référence, année 90. Excuse-moi,
- Speaker #1
tu as vu que je rigolais.
- Speaker #0
Oui, mais par contre, on ne peut plus utiliser ces codes de communication, il faut assumer qui on est, comment on est, l'âge de ses os, etc. C'est un véritable défi pour... ce que j'appelle la famille de l'industrie, j'utilise ce terme à dessein parce que ça concerne autant les chefs d'entreprise que les cadres, que les opérateurs ou les employés, que aussi les syndicats et leur représentation. On a tout un exercice de repositionnement dans une société de communication dans lequel on a évité de rentrer ensemble, je dirais, individuellement et collectivement. Et qui est maintenant... essentielle si on veut aller vers cette désirabilité, encore une fois qui n'est pas une désirabilité fictive sur un monde repeint en rose, mais qui est simplement voilà ce que je suis aujourd'hui, voilà à ce point je m'engage, voilà quelle est ma quête, voilà quel est mon objectif et est-ce que vous voulez venir avec moi dans mes équipes pour remplir cet objectif qui peut être technologique, environnemental de développement, donc rage territorial.
- Speaker #1
Ouais mais tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que forcément moi j'ai l'anglais rage mais... Mais en fait, la déclinaison de ta stratégie, de ta vision, de ton ambition, de ton projet d'entreprise, alignée aux valeurs aussi de ce monde d'après et qu'on est en train de construire collectivement, c'est juste cette déclinaison, la dimension RH. Tu vois, c'est justement comment on décline ça pour le transposer aux attendus de nos candidats. de nos collaborateurs pour les attirer, enfin, dans l'ordre, les fidéliser, puis les attirer. Tu vois ? Et je trouve que souvent... Alors après, ça dépend. Moi, je travaille dans des entreprises de structures très différentes, de tailles très différentes. mais je pense qu'il y a un vrai boulot aussi derrière. On a besoin de transformer nos pratiques RH. Je fais le parallèle avec ce sujet sur la partie organisation industrielle. Je trouve que, alors tu parlais évidemment de notre héritage, Fordisme, Taylorisme, etc. Je vois aussi quand même certains changements plutôt vers le modèle Toyota. Donc, je viens de chercher là-dessus parce que c'est toi l'expert en organes industriels. Bon, même si j'ai pas mal bossé là-dedans, tu vas te connaître largement mieux que moi. Donc, est-ce que pour toi, ces courants peuvent s'opposer ? Est-ce que Toyota reste le modèle, l'incontournable ? Parce que force est de constater que ça fait des décennies qu'ils sont premiers sur bien des podiums. Est-ce qu'il faut faire un copier-coller ? Est-ce que pour nos PMI, nos ETI, c'est le goal ultime ? Et est-ce qu'on s'éloigne vraiment de ce modèle du fordisme, du terrorisme, qui, je partage tout constat, n'est plus franchement adapté aux attentes des jeunes générations, mais pas que. Voilà, je me suis...
- Speaker #0
vraiment emballé dans une question. Il a beaucoup été étudié. Je n'en suis pas un spécialiste. J'en retire deux éléments que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Le premier, qui n'est pas directement dans ce que tu évoques, c'est la relation avec un écosystème de fournisseurs.
- Speaker #1
Achats responsables,
- Speaker #0
etc. Achats responsables, achats de proximité, relations non-termes, etc. Et très clairement, je suis très impliqué dans les achats. Je suis membre du Conseil national. Je suis membre du conseil d'administration du Conseil national des achats. Et je travaille beaucoup avec les acheteurs. Et on voit cette fonction-là, qui était une fonction purement transactionnelle, incarnée par M. Lopez, l'acheteur de Volkswagen dans les années 90, et qui a baissé les coûts en mettant en zone une concurrence rude entre les pays développés, les pays en voie de développement, etc., où c'était purement du transactionnel. Aujourd'hui, cette profession en revient et sait qu'elle créera de la richesse, et pour l'entreprise. et pour la société en créant d'autres modes de relations, de coopération. On n'aime pas utiliser le terme de collaboration, qui veut dire travailler avec à cause d'une connotation historique, mais c'est véritablement ça. C'est travailler avec sur le long terme, dans la confiance, avec un écosystème de fournisseurs et sortir de cette économie transactionnelle dans laquelle je te fais des spécifications et je choisis le moins cher. Ça, c'est une première partie du modèle Toyota qui est sur, je dirais, l'extérieur. Et puis l'intérieur, le modèle Toyota, c'est le champion du Lean. Et sur le Lean, on a une difficulté en France, c'est qu'il a sans doute été très mal appliqué ou très mal interprété. Il y a dans le Lean toute une dimension de proposition faite par les personnes qui sont sur la tâche. Il y a une valeur énorme de descendre dans l'atelier. On ne pilote pas d'en haut de son bureau, on va à l'écoute des gens.
- Speaker #1
Le cercle, on pose le cercle au milieu de l'atelier.
- Speaker #0
Voilà. Et nous, on a retenu du Lean, je vais être un peu méchant, mais c'est les cabinets de consultants et JET qui passent derrière vous, qui chronomètre une tâche et qui dit, bon, tu l'as fait en 15 secondes, donc tu devras pouvoir le faire toute la journée en 15 secondes. Mais on a donc appliqué le Lean comme une forme de taylorisme poussé jusqu'au bout, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que le Lean est la réponse aux enjeux qu'on a énoncés aujourd'hui ? Si c'était le cas, je pense qu'on le saurait. C'est un élément de la réponse. Et notamment toute la partie qu'on a occultée en France avec une culture manageriale de participation, d'autonomie des équipes. On l'a complètement occultée dans la manière dont on met en œuvre le Lean souvent en France. Encore une fois, c'est une mauvaise traduction du Lean, une mauvaise adaptation à notre culture, à notre pays.
- Speaker #1
Parce qu'on est sur un modèle pyramidal en France, beaucoup. dans cet héritage-là. Donc, la position du sachant, du manager sachant, etc. On est dans cet héritage.
- Speaker #0
Voilà, donc il faut... Il y a des concepts d'écoute, d'autonomie que tu retrouves dans le Lean. Encore une fois, je pense qu'il y a une base qui nous permettrait de réfléchir en dépolluant de l'image qu'a eu le Lean, mais il faudra sans doute aller plus loin. Il y a des très belles études qui ont été faites sur le stress au travail et liées à la capacité qu'a une personne d'influer sur son travail. Tu vois ? Est-ce que j'ai les moyens de faire la tâche qui m'est donnée en termes de temps, en termes de machines, en termes de ressources ? Première question, et de bien la faire. Et deux, est-ce que j'ai la capacité dans mon organisation d'influer sur la manière dont je le fais pour en améliorer et le confort pour moi, ou même la productivité naturellement de l'entreprise ? Et cette deuxième dimension-là, on sait que les deux sont essentielles pour avoir un confort psychologique au travail, une qualité de vie au travail. Et là-dessus, je pense qu'on a énormément de progrès à faire. C'est l'invitation que je faisais tout à l'heure à re-réfléchir sur nos organisations. Et encore une fois, le Lean peut être une brique, le Lean profond, le vrai Lean, pas la manière dont on a eu un peu beaucoup l'habitude de le traduire en France. Mais il faut sans doute aller plus loin et réinventer des modèles. Le modèle Toyota, très bien. Est-ce qu'il va jusqu'à la réponse complète de nos attentes sociétales ? Je ne suis pas sûr. Et donc, il faut peut-être réinventer un autre Lean à Lean 2 ou un autre mode de management. Ce qui est important là-dessus, juste pour le dire, c'est que ce qu'on dit, il y a plein de gens qui l'ont... Enfin, on ne découvre pas quelque chose tous les deux. Et il y a plein de gens qui ont essayé d'inventer des nouveaux modèles d'organisation. L'organisation Opal, l'entreprise Libéré, etc. Ce qui me marque aujourd'hui, c'est qu'aucun de ces modèles-là n'a réussi à s'imposer. Je ne dis pas qu'il y aura le modèle qui remplacera le modèle universel, Taylor, mécaniste, Taylor, Ford. Ma conviction, c'est qu'il y aura plusieurs modèles en fonction de ton modèle d'affaires, ton positionnement dans la chaîne de valeur, de ton type de processus.
- Speaker #1
Ta culture d'entreprise, ton histoire.
- Speaker #0
La culture d'entreprise. Donc, il ne faut pas penser qu'on va revenir à un truc qui va remplacer le Fordisme et qui va s'appliquer à tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'a pas été... encore jusqu'au bout de la démarche, et ceux qui l'ont fait n'ont pas réussi à convaincre complètement. Ça fait un peu long feu, si on prend cette expression, ces tentatives. Il y a des travaux qui sont faits par l'École des mines de Paris sur le sujet, en disant, bon, on a un peu bricolé sur le sujet, on a fait des explorations, essayons de reprendre un peu plus académiquement, alors on peut apprécier ou pas la démarche, mais toutes ces questions-là sur les nouveaux modes de management et d'organisation. des travaux qui sont en cours, qui ont cartographié ça, qui ont essayé de les classer. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, on les présente comme nouveaux, mais ils vont chercher des valeurs, ce travail qu'on retrouvait chez les utopistes du 18e et du 19e siècle. Juste pour dire, il y a une forme de continuité dans cette aspiration à être bien au travail, à avoir l'impression d'être utile, qui est en fait beaucoup plus profonde. On n'est pas en train de faire une révolution. Mais on doit s'adapter à un nouveau contexte.
- Speaker #1
Et tu vois, je reviens sur effectivement le lean et les dérives et la manière dont effectivement ça a pu être interprété. On en revient à l'histoire un peu de ce clivage col bleu, col blanc, le sachant, l'opérant. Effectivement, c'est un modèle qui commence à avoir ses limites, à ne plus convaincre. a généré une forme de désintérêt, finalement, des opérateurs qui ont le savoir-faire et qui se détachent d'un sens au travail. Et là où, tu vois...
- Speaker #0
Pour un instant. Oui, excuse-moi. Tu as utilisé le terme opérateur. Il y a une idée que j'aime beaucoup, qui est portée par Thomas Uriès, qui est le patron de 1083, l'entreprise de Jeanne, qui a pas mal communiqué. Elle est relativement connue. et qui, en fait, dit, pour avoir cette reconnaissance, même de soi pour soi, dans son métier, la reconnaissance extérieure, mais aussi, je dirais, une fierté propre, il faut qu'on remette au goût du jour le nom des métiers. On a uniformisé les gens qui travaillaient dans une usine sous le terme d'opérateur. Alors certes, il y a de la polyvalence, mais en fait, en termes de définition, de positionnement, on a fait de l'uniformisation et ça ne... C'est très difficile si on est tous exactement appelés les uns comme les autres, même si on sait au fond de soi, de se trouver une position, une fierté, une identité. Et donc, il souhaite qu'on réactive tous ces très jolis mots qui pouvaient exister dans le textile, notamment, de tous les différents métiers, de tous les différents savoir-faire. Remettre en visibilité, en mots, en noms, en intitulés, les savoir-faire qui sont derrière les processus industriels. Je trouve que cette démarche est très intéressante parce qu'elle montre combien il faut aller rechercher des choses qui étaient préexistantes. L'industrie de masse n'a été qu'un temps assez limité de l'industrie. L'industrie existe depuis très longtemps. Elle a été souvent associée à l'ingéniosité, aux gestes. Industria, quand on va voir les racines sémantiques, ça veut dire l'inspiration, l'idée intérieure qu'on projette à l'extérieur. On conçoit un produit. Et on va le réaliser. Il y a cette idée-là, sémantiquement, dans l'industrie. Et donc, il faut qu'on aille rechercher, au très fond de notre histoire et de nous-mêmes, cette fierté qu'il y a dans les savoir-faire. Et encore une fois, on ne fait jamais... La première chose qu'on fait, c'est nommer un savoir-faire pour lui donner une existence. C'est des choses, je dirais, toutes simples, qui sont à notre portée. mais qui demande de faire un pas en avant dans cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'industrie, quels sont les savoir-faire qui y sont liés.
- Speaker #1
Oui, et puis ça participe à la valorisation des métiers. Tu as raison. C'est sûr. Tu as raison. Et alors, du coup, il faut qu'on parle d'autres sujets aussi. J'ai envie de venir te chercher sur un autre sujet qui me tient à cœur. C'est tout ce qui est... Et je pense qu'il... qui fait partie des obstacles de l'attractivité de l'industrie, du manque d'attractivité, du manque de projection qu'on a à travailler dans l'industrie. Moi, la première, je vais te dire, j'ai grandi dans un environnement culturel plus plus d'un père directeur d'une école de musique. J'ai baigné dans le théâtre et la musique. C'est très étonnant que j'arrive aujourd'hui dans le secteur de l'industrie. Je ne l'ai jamais envisagé. Je n'ai jamais envisagé de faire des études scientifiques. ni de maths puisque j'étais convaincue d'être nulle en maths et en sciences tu me vois venir donc ma question voilà, comment on peut faire pour que réussir à féminiser l'industrie, en quoi est-ce que c'est nécessaire, comment on a pu en arriver là et comment moi et d'autres on a pu ne même pas l'envisager.
- Speaker #0
C'est une question qui est difficile à répondre honnêtement. J'aimerais bien avoir une réponse. D'abord, la conviction que j'ai, naturellement, il y a le principe que nous avons tous de diversité, d'égalité qui s'exprime. Mais je vais aller un petit peu plus loin dans des expériences professionnelles. J'ai eu l'occasion de diriger une usine, une industrie en Roumanie pour Saint-Gobain et j'avais un comex de cinq personnes dont moi avec deux expatriés, deux femmes. Donc on était un mélange et de culture, de langue et de genre et un peu d'âge, mais c'était un peu plus homogène. J'ai été estomaqué par la richesse de cette diversité dans un lieu de direction. C'est-à-dire que... Tu as le principe que tu apprends, qui est autour de toi, que tu lis dans les journaux, qui fait partie de ton bagage culturel, de tes valeurs. Mais quand tu l'expérimentes dans ta vie professionnelle, pour moi, ça a été lumineux, si tu veux. Je n'aurais pas réussi l'expérience que Saint-Gobain m'a confiée en Roumanie si je n'avais pas eu un comité de direction avec cette variété de profils, de genres, de cultures, d'âges, etc., d'approches. J'en suis absolument convaincu. Donc... La richesse de cette diversité, elle est essentielle et dans l'industrie et ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas qu'un principe qu'on pose pour le poser. C'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté, que j'ai vécu dans la réalité de ma vie professionnelle. Donc ça, c'est un impératif. Comment on y arrive ? Après, pour moi, c'est une question qui est à peu près du même ordre que celle que tu m'as posée sur la désirabilité de l'industrie. C'est-à-dire, j'ai des pistes, j'ai des idées. Mais je ne sais pas si c'est la recette miracle. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui doute des grandes valeurs, qui doute des grands discours. Et que là où on trouve de la conviction, là où on trouve de l'engagement, là où on fait piner de l'engagement, c'est par la démonstration, par la réalité. Et donc, il y a par exemple une initiative qui est portée par Elena Jerome, qui s'appelle les meufs de l'industrie, qui fait témoigner... Des jeunes femmes qui ont rejoint l'industrie ou la sphère de l'industrie et qui expliquent tout ce qu'elles y trouvent, que ce n'est pas seulement un monde qu'on décrit comme machiste. Certes, encore une fois, il y a des comportements qui sont hérités d'une autre vision de la société qui perdure. Encore une fois, il ne faut pas dire que tout est rose. Il faut aussi accepter cette réalité, mais qu'elles y trouvent leur épanouissement, leur équilibre perso, leur équilibre de famille. Je suis énormément pour la... L'illustration, tu vois, le témoignage. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu soupés tous des grands discours, des grands objectifs, des grandes lois, des discours verbeux, etc. Ce qu'on a envie de retrouver, c'est une forme d'authenticité, de sincérité, de témoignage et de gens qui disent vraiment ce qu'ils vivent. Et on sait tous que dans la vie, il y a une partie d'éclate et puis il y a une partie plus difficile, mais qu'on ne vendra pas que l'éclate. Et c'est important. Que tu aies quelqu'un qui soit en face de toi et qui te le dise de la manière. Voilà un petit peu ouvrir, faire témoigner. Moi, je pars beaucoup là-dessus en proximité. Encore une fois, je reviens sur une réflexion, mais qui sert. pas simplement sur la féminisation de l'industrie. Globalement, où est-ce qu'aujourd'hui, dans quel type de discours, dans quel type de propos, nous avons confiance ? Plus ça s'éloigne de nous, moins on a confiance. Quelqu'un qui habite dans un territoire, je vais prendre l'exemple de la politique, a relativement confiance dans son maire, a moins confiance dans son conseiller régional, moins dans un leader national, et encore moins quand il est européen. Pas moi qui le dis, c'est les sondages d'opinion. Donc il faut retrouver cette proximité. Voilà, s'ouvrir, ouvrir les usines, faire témoigner les jeunes femmes qui travaillent dans l'industrie auprès des jeunes femmes qui sont en train de choisir leur parcours professionnel ou leurs études. Je pense que c'est ça qui est le plus porteur. Ce n'est pas encore une fois la grande solution. On ne va pas dire Ah, on va faire la révolution J'adorerais, mais je n'ai pas trouvé la façon de l'exprimer. C'est peut-être moi qui suis en défaut là-dessus. Mais ce petit témoignage, ce travail de terrain… travail pointilliste, comme je l'appelle, qui finira par nous faire un très joli tableau plein de couleurs et plein de sens.
- Speaker #1
Tu en parles plusieurs fois dans ton livre pour différents sujets, pas forcément ce sujet spécifique, mais d'apporter la preuve. C'est peut-être pas exactement le terme que tu utilises, mais sur d'autres sujets, plutôt en référence à l'épisode 1, sur notamment le sujet des nuisances de l'industrie, il faut apporter des preuves. Effectivement, ça fonctionne, cette notion un peu de quick win. Donc voilà, c'était juste pour réagir. Je trouve ça intéressant. Et je souhaite faire le lien maintenant avec un sujet qui est hyper important, qu'on n'a pas trop, voire juste balayé dans l'épisode 1 aussi. C'est le sujet de la partie formation. Donc le sujet de la féminisation, de la diversité, de l'inclusion. Forcément, on fait le lien parfait. On en a discuté. plusieurs fois, donc c'est 60 000, 70 000, c'est 60 000, le chiffre un poste vacant. On peut penser de manière un peu candide que la formation, c'est la solution à tous nos problèmes et pourtant, on a dans l'industrie, alors tu sais que je sors en plus d'un centre de formation, on a un taux d'évaporation qui est colossal, bon, des difficultés à attirer, évidentes aussi. sur nos parcours. Et je l'ai constaté chaque jour, un décalage entre les beaux parcours que l'on fait parce qu'on n'a pas franchement non plus la main mise sur les certifications, etc., qui finalement, quand on va sur le terrain pour comprendre les enjeux et le job demain qui sera réalisé, il y a un décalage. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler de ça ? Comment on explique ce taux d'évaporation ? en quoi c'est un problème et voilà, si tu les as t'épistes un peu de solutions En quoi c'est un problème,
- Speaker #0
c'est évident parce que tu as des boîtes qui refusent des commandes parce qu'elles n'ont pas les talents disponibles et le quantifier macroéconomiquement encore une fois on perd 5 à 6 milliards d'euros de valeur ajoutée par an là-dessus 60 000 post-vacances et aussi 60 000 personnes qui pourraient trouver un emploi et une place dans la société en tous les cas sur la partie économique Donc ça, c'est assez clair. Le premier sujet, on l'a pas mal abordé. Pour moi, c'est l'attractivité. Mais il y a aussi la question vers laquelle tu m'amènes, de la carte des formations et des formations. Quand on a commencé ce travail, on s'est dit, il y a 60 000 postes vacants. Les chefs d'entreprise n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ne trouvent pas les bons talents en continu. On ne doit sans doute pas former à cette personne au métier industriel. On s'est dit, c'est un problème quantitatif. Simple, offre-demande, ça ne m'appartient pas. Et alors, on a commencé nos petits calculs. Et je me souviens, il y a des chiffres qui existent. Il y a beaucoup de chiffres dans la formation qui ne sont pas rendus publics. On avait essayé d'avoir accès à des bases de données qui existent et auxquelles on nous a refusé l'accès. Il y a encore de la transparence à avoir sur les chiffres de la formation. Mais il y en a pas mal qui sont publics. Et stupéfaction, on a découvert que pour rester... au niveau où on était d'industrie, c'est-à-dire autour de 10%. Il faut avoir 80 000 à 90 000 personnes qui rentrent dans l'industrie chaque année. C'est pour remplacer les gens qui partent à la retraite essentiellement. Bien sûr. D'accord. Bon, alors, il y a des plus, il y a des moins. Il y a des activités qui ferment, il y a des activités qui ouvrent aussi. Mais globalement, c'est ça. Donc, on en formait 125 000 par an. Nous avons 125 000 places de formation au métier industriel par an en France entre le CAP et le bac. plus 3.
- Speaker #1
Mais alors, Olivier, la belle aubaine, on a une autre solution !
- Speaker #0
Donc, encore une fois, tu rencontres le miracle dans un pays qui est complètement traumatisé par ces questions de budget public. Ce n'est pas un problème de budget public. Si on préserve cette enveloppe-là, on a toutes les ressources nécessaires. La véritable, donc il y a un problème, c'est qu'on forme des gens qui ne vont pas. On a parlé de l'altréactivité, mais il y a un deuxième problème qui est le petit, mais qui est celui qui nous excite beaucoup, qui est celui de la carte des formations. Former aux bonnes compétences, aux bons endroits. Et en fait, ce qu'on a constaté, on a proposé de renverser la table, en tous les cas de renverser le système de formation. Il y a plusieurs éléments. Un, notre système de formation ne prend pas en compte que nous, Français, sommes très peu mobiles. C'est à la fois culturel et économique. On est facilement propriétaire de notre logement. Quand on le vend, il y a des frottements fiscaux énormes, etc. Donc, en fait, quelque part, poser la question autour de vous, nous, on changera plus de métier que de maison. Et donc, faire des grands équilibres de formation au niveau national. C'est bien pour caler les enveloppes du budget, mais si on veut aller dans la vraie vie, en fait, il faut former dans un territoire pour les besoins du territoire. Cette réalité sociologique qui est structurante, elle n'est pas prise en compte dans nos politiques publiques qui sont dessinées nationalement et en plus par statut. Vous avez les demandeurs d'emploi d'un côté, les apprentis de l'autre, la formation initiale, les formations pro, les formations techniques. On a mis tout ce beau monde dans un silo. Alors qu'en fait, la réalité et de notre aspiration en tant qu'individu, en tant que citoyen et le besoin des entreprises, elle est dans le territoire pour le territoire. Donc, on a proposé de réfléchir complètement différemment à cette logique de formation. Et puis, le deuxième point qui est marquant aujourd'hui, j'espère que c'est que temporaire, c'est que notre système de formation, il ne va pas aussi vite que l'évolution de notre système de production. Avec des nouvelles compétences, quand il faut, il y a... où est-ce qu'on forme, est-ce qu'on forme au bon endroit et aux bonnes compétences. Donc j'ai traité comment former au bon endroit, s'attacher à la dimension territoriale. On ne va pas former un soudeur à Lille en pensant qu'il ira bosser à Marseille. Je fais la caricature, mais juste pour que ce soit clair. Et puis il y a comment est-ce qu'on forme aux bonnes compétences. Et là, on a un système de formation qui sera toujours derrière le besoin économique qui va plus vite que lui. Et on est dans un écart qui devient aujourd'hui très très grand. avec beaucoup d'entreprises ou des groupements d'entreprises qui font leurs propres écoles parce qu'ils ne trouvent pas la formation qui correspond à leurs besoins. On est rentré dans un cycle là qui est très fort. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec une chef, une entrepreneuse de Normandie qui a 20 personnes, une petite PMI de mécanique, qui me disait je vais ouvrir une école. Je lui ai dit waouh, mais pour une PMI, ouvrir une école, c'est un... Oui, elle m'a dit mais je n'ai pas d'autre solution pour former les gens dont j'ai besoin. Je me suis dit bon... Je pense qu'on peut mutualiser, mais c'est pour dire jusqu'à quel point ce besoin de formation aux compétences et en proximité est arrivé. Aujourd'hui, la formation, c'est le tissu économique qui est en train de s'en emparer. D'ailleurs, ça doit nous faire réfléchir en allant un petit peu plus loin sur le rôle de l'entreprise dans la société. Elle a été cantonnée à celui de créer de la valeur économique. Et aujourd'hui, naturellement, elle est un outil de la diversité, de l'inclusion, on en a parlé, mais aussi de la formation. Et il y a une réflexion assez profonde d'un certain nombre de philosophes qui se posent la question à l'avenir. Pour nous, les institutions, il y a le spirituel, il y a le temporel, il y a l'église et la préfecture, je dirais. Mais quel est le rôle de l'entreprise dans notre équilibre de société ? Est-ce qu'elle ne devient pas une institution dans le sens où elle est la réalisatrice d'un certain nombre d'enjeux ou d'intérêts généraux et pas simplement celle de faire du fric de l'économique ? On est aussi dans cette évolution-là. Je nous emmène très loin, mais revenons à la formation. Aujourd'hui, la formation est beaucoup de plus en plus assurée par le monde économique. Et encore une fois, nous avons suffisamment de place, y compris dans le système public, pour remplir ces 60 000 postes et même nous réindustrialiser. Il faut qu'on arrive à mobiliser cette ressource. Souvent, sur les sujets de réindustrialisation, j'arrive toujours à la même conclusion. Ce n'est pas un problème de ressources, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de tuyaux ou de manière dont ces ressources-là sont mises en œuvre. C'est quand même vachement plus facile. On ne va pas avoir besoin d'augmenter par deux ou par trois le budget de la formation publique dans les comptes publics qui ne le supporteraient pas. Il suffit qu'on utilise bien ce qu'on a. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'industriel, on ne s'y connaît pas trop mal en tuyau, en mécanique, en organisation et au process.
- Speaker #1
Donc,
- Speaker #0
là-dessus, ça veut dire qu'on va y arriver. On retrousse les manches de manière collective, par des initiatives sur nos territoires. Olivier, l'heure tourne. Je pense que même si je n'ai pas envie de... de te lâcher. Tu as bien d'autres choses à faire que de discuter avec moi.
- Speaker #1
C'est très plaisant. Moi, j'aurais bien continué aussi. On va user la patience de nos auditeurs.
- Speaker #0
D'ailleurs, y a-t-il encore quelqu'un qui nous écoute ? Non, je pense que oui. Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier point avant que l'on se quitte ?
- Speaker #1
Moi, j'ai toujours ce dernier message. Vous l'avez compris en nous écoutant. Vous verrez, moi, on est des passionnés d'industrie, on aime ça. On ne peut pas demander à tout le monde d'aimer l'industrie. En revanche, souvenez-vous toujours, un outil productif, ça sert à un projet de société. Si aujourd'hui, nous, on aimerait qu'il y ait plus d'industrie, avoir cette renaissance industrielle, c'est parce qu'on aime l'environnement, ce qui peut apporter la transformation de la matière, les organisations, les savoir-faire, tous ces travaux collectifs, ces enjeux qui ont été dépassés de réalisation, etc. Ça, nous, on adore. Mais aussi... pour vous et pour chacun des citoyens ne jamais oublier qu'un outil productif, c'est de la souveraineté, donc la maîtrise de son destin. C'est retrouver la maîtrise de son empreinte environnementale et donc pouvoir la réduire quand on a 50% de nos émissions d'effets de serre qui sont liées à nos importations. Essayer de les réduire, c'est vachement compliqué si c'est pas impossible. Et puis la troisième chose, c'est que l'industrie, ça permet de répartir la richesse sur l'ensemble du territoire, de faire cette cohésion qui met si cher. Parce que je ne pense pas qu'une société qui soit fragmentée ou aussi fragmentée socialement, territorialement, comme elle l'est aujourd'hui en France, puisse s'affronter dans les meilleures conditions, les défis qui sont devant nous et qui sont magistraux, que ce soit des crises environnementales, des crises économiques, des crises politiques et peut-être même des crises militaires, hélas. Voilà, je me permets toujours de faire ce petit rappel, parce qu'on est des amoureux de l'industrie, mais il y a des gens qui, peut-être, regardent ça avec un peu plus de distance. En revanche... Il y a un consensus autour de ces trois choses-là. Environnement, souveraineté, cohésion.
- Speaker #0
Olivier, tu ferais un autre de podcast formidable puisque tu viens de faire une très belle conclusion sur laquelle je n'ai absolument rien à ajouter. Donc, je te laisse ces beaux derniers mots que forcément j'approuve mille fois. Un immense merci. J'ai adoré passer ces deux épisodes avec toi, même si j'étais stress au début. J'ai réussi à me détendre.
- Speaker #1
Oui, tout à fait. Dégarde.
- Speaker #0
Donc, merci. Merci à toi. Et puis, on se retrouve bientôt, alors.
- Speaker #1
Merci à toi pour ton invitation. Et j'espère que nos auditeurs auront eu du plaisir, autant de plaisir que nous, on a eu d'enregistrer cet épisode. À très bientôt.
- Speaker #0
Ils nous diront tout ça. À bientôt. Bye. Et voilà, nous sommes donc à la fin de cette série. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité pour débuter une nouvelle série. C'était Claire Tenayau, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'Industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'Industrie qui fait envie !