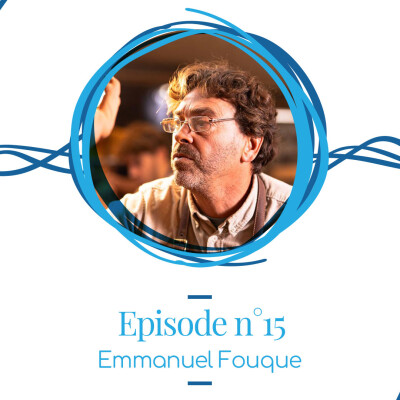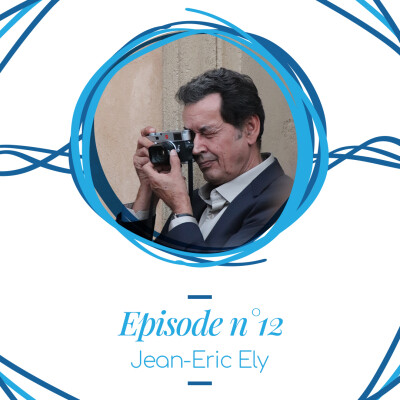- Speaker #0
Bonjour, je suis Frédéric Paul, guide conférencier et créateur des visites Le Visible est Invisible, à Aix et en Provence. Peut-être que vous me connaissez comme guide dans les rues d'Aix ou d'autres villes provençales que j'aime faire découvrir à mes visiteurs. J'aime leur montrer des détails que l'on croit. croise mais que l'on ne regarde pas. C'est ce métier de guide qui me permet de rencontrer des gens de tous horizons et j'ai eu envie de donner la parole à certains. C'est ainsi qu'est née l'idée de ces interviews. Bienvenue dans Les gens d'Aix, le podcast qui fait parler les Aixois. Ce podcast se veut une galerie de portraits d'Aixois plus ou moins connus, qu'ils soient vivants ou morts, qu'ils soient artistes, sportifs, entrepreneurs, politique ou simples citoyens, ils ont tous leur place dans les gens d'Aix. Et pour ce septième épisode de la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir une figure majeure de la vie culturelle aixoise, Bruno Elie. Depuis 17 ans, il est le directeur et conservateur en chef du musée Granet. Avec passion et exigence, il a profondément transformé ce musée emblématique d'Aix-en-Provence en le faisant rayonner bien au-delà de la ville. Expositions de prestige, enrichissement des collections, partenariat international, Bruno Eli a su faire du musée Granet un acteur culturel de tout premier plan. Homme discret mais engagé, il nous ouvre aujourd'hui les coulisses de son parcours, son regard sur l'art, sur Aix et l'exposition Cézanne au jas de Bouffan. Que vous soyez chez vous, en balade ou sur la route, je vous souhaite une bonne écoute de cette conversation passionnante avec Bruno Eli. Bonjour Bruno Eli, merci de me recevoir au musée Granet. Vous êtes le conservateur et le directeur du musée depuis 2009. Quel a été votre parcours pour en arriver jusque là ?
- Speaker #1
Oui, précisément janvier 2008, puisque j'ai été nommé à ce poste en janvier 2008. Mon parcours a été exo-exois, que je revendiquais d'ailleurs, parce que je voulais rester vraiment à Aix, qui est ma ville, que j'aime, que je connais, et qui surtout est une ville extraordinaire, dont on n'a jamais épuisé tous les trésors. Donc je voulais faire toute ma carrière à Aix, c'est fait. Et j'avais comme objectif, je m'étais donné comme objectif, quand je suis entré au musée Granet en 1981, après avoir fait un stage de six mois en 1980, donc ça fait très très longtemps que je connais le musée Granet, c'était de peut-être un jour, peut-être, devenir directeur de ce musée. Donc ça c'était mon ambition. Et de mieux se réaliser. Je suis arrivé, objectif réalisé. Et j'y suis resté d'abord comme conservateur adjoint avec Denis Coutagne pendant neuf ans. Jusqu'en 1989 et en 1990, j'ai été nommé au musée des tapisseries au Pays-Montvendôme. J'y suis resté 16 ans, c'est une longue période aussi. J'en suis occupé de ces musées plus petits certes, mais dans lesquels j'ai fait aussi beaucoup de choses autour des arts du spectacle, autour notamment de l'art contemporain, qui était vraiment... nécessaire de prendre en main et en compte dans la ville d'Aix à cette époque, notamment au niveau muséal. Et puis donc en janvier 2008, je suis revenu comme directeur au Musée Grané.
- Speaker #0
Donc c'était après l'année Cézanne, après l'exposition. Bruno Elie, le nom Elie, c'est un nom qui est connu à Aix-en-Provence. J'évacue de suite la question puisqu'on la pose souvent. Vous avez un lien avec la famille Elie de photographe.
- Speaker #1
Oui absolument, je suis un héritier qui n'a pas suivi la bonne voie, c'est-à-dire qui n'a pas suivi la photographie, puisque j'ai laissé ça très volontiers aussi à mon frère Jean-Éric, qui continue aujourd'hui d'être la quatrième génération de cette dynastie de photographes depuis 1887. Donc c'était une longue histoire, là encore, installé au passage à gare en 1903 et déménagé le passage à gare en 2023. Donc ça faisait 120 ans que la photo Elie était là, évidemment c'était chargé d'histoire, chargé de mémoire. Et nous continuons évidemment avec mon frère à travailler sur ce projet d'un centre de la photographie ou d'un musée de la photographie. Peu importe le titre qu'on donnera à ces établissements, il faut qu'il existe pour mettre en valeur justement cette collection, ce fonds exceptionnel de plus de 2 millions de clichés. C'est énorme, c'est considérable et qui parle d'une période sur quasiment 140 ans, bientôt un jour à 150 ans. Donc c'est assez remarquable, voire même très remarquable puisque j'ai cherché un petit peu en France. Je n'ai pas vraiment trouvé d'équivalent de quatre générations comme ça, de photographes sur un même lieu. Il m'est arrivé de trouver par exemple quatre générations de photographes, mais par exemple les deux derniers étaient des photographes de grands reporteurs par exemple. Et donc d'abord ils sont partis dans le monde, mais ils ne sont pas restés dans un seul endroit, comme c'est le cas pour la famille Elie. Et c'est sa particularité, avec notamment d'avoir suivi tous les événements, les grands et les petits, la petite histoire, mais la grande histoire aussi. Par exemple les visites présidentielles de 1903. Mon arrière-grand-père, Henri, le créateur de la photo, a dit un jour à un journaliste qu'il interrogeait « Je suis en train de constituer les archives pour la Ville d'Aix de demain » . C'était prémonitoire en 1903 de dire ça. Il ne savait pas que trois générations le suivraient encore. Et donc, évidemment, c'est un fonds très important que j'aimerais bien travailler aussi avec un peu plus de temps, puisque la retraite va sonner bientôt et que ça me libérera beaucoup de temps. pour pouvoir justement travailler ce sur quoi j'ai jamais pu vraiment faire ou très sporadiquement, c'est-à-dire pas vraiment dans le détail comme je le souhaitais. Et donc travailler sur ce fonds et puis évidemment travailler certainement aussi avec l'associéte Paul Cézanne autour de la question cézannienne, développer des dossiers importants que j'ai toujours laissés de côté pensant que j'avais le temps. Effectivement le temps est passé et je ne les ai jamais traités, notamment des recherches particuliers j'ai mis de côté je dois avoir un de classeurs rempli de d'hypothèses, de questions qui seront intéressantes justement à traiter avec plus de temps.
- Speaker #0
Vous parlez de la société Cézanne, vous avez parlé de Denis Coutagne. Actuellement, au moment où on se parle, on a 135 œuvres de Cézanne qui sont sur les murs du musée Granet. La plus grosse exposition de tableaux de Cézanne à ce jour, si je ne me trompe pas, vous me dites. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir pu organiser cette exposition ?
- Speaker #1
C'est d'abord en nombre. 135, c'est le nombre d'œuvres de Cézanne qui sont sur nos cimaises. Donc c'est effectivement une grande satisfaction, une immense satisfaction. En 2006, pour Cézanne en Provence, c'était 116 œuvres, si j'ai bonne mémoire. Mais c'était avec la National Gallery de Washington, c'est-à-dire vraiment un partenaire prestigieux, que le projet avait pu être porté, développé. Et c'était vraiment des œuvres remarquables, venant là aussi des quatre coins du monde. En 2025, c'est aussi une exposition importante, plus importante en nombre par rapport évidemment à... au côté numérique de la chose. Cela dit, on pourrait discuter longtemps sur l'importance de telle oeuvre par rapport à telle autre. Donc je me souviens par exemple de la salle en 2006 avec notamment la mer à l'Estac et les vues de l'Estac. Il y a une salle somptueuse, alors évidemment on ne l'a pas cette année, mais à la même place on a d'ailleurs une salle somptueuse sur les natures mortes. Donc je pense qu'on a quand même évidemment avec Denis Coutagne bien travaillé puisqu'on reste ce tandem qui a toujours travaillé sur la question sésanienne depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 80, même 1980. puisque finalement Denis était déjà au musée en 1980 comme directeur. À l'époque on ne disait pas directeur, on disait conservateur en chef. Et je suis arrivé comme conservateur adjoint, donc un an plus tard en 1981, et on a vraiment travaillé ensemble sur la première exposition Cézanne, qu'on oublie un petit peu, en 1982, qui a fait partie des premières opérations qu'on a pu monter autour de Cézanne, et qui était une exposition qu'on reprenait d'un projet de la ville de Liège. et qui présentait une centaine, une petite centaine d'œuvres de Cézanne, ce qui était déjà beaucoup. Et puis il y a eu en 1989 ce terrible incendie de la montagne qui nous a amené à proposer en neuf mois de temps, ce qui était à l'époque encore possible, la preuve on l'a fait, mais aujourd'hui complètement irréalisable, d'avoir en 90, donc l'été 90, une exposition sur le thème de... La montagne Sainte-Victoire, qu'on a appelée Sainte-Victoire-Cézanne 1990, puisque évidemment c'était un renouveau qu'on espérait de cette montagne, qui est arrivée, mais qui est arrivée plus lentement, dans la trentaine d'années qui a suivi, pour que la nature reprenne ses droits. Enfin, pas complètement, puisqu'il y avait beaucoup de pinèdes à l'époque, et que la pinède, on le sait, n'était pas de l'époque de Cézanne, par exemple. La pinède, c'est quelque chose qui s'est développé après que les campagnes aient été plus ou moins abandonnées. en termes d'agriculture notamment, et puis ce pastoralisme qui faisait aussi que les animaux, les chèvres, les moutons, arrasaient la végétation et donc régulaient un peu les risques d'incendie notamment. Et donc cette pilade avait proliféré, s'était développée, et que ce soit sur le flanc nord ou que ce soit même sur le flanc sud, malgré la falaise, il y avait beaucoup de végétation à brûler. C'est ce qui a brûlé en 89 en réalité.
- Speaker #0
5000 hectares ont brûlé...
- Speaker #1
Pendant trois jours et trois nuits. Alors il y avait un côté dantesque... Absolument, mais c'était absolument terrible aussi. Et puis le bilan après était tout à fait désastreux. C'est-à-dire que c'était replanter ce qui a été fait. Et je me souviens même que l'exposition en 1990 avait pu dégager un million de francs à l'époque pour replanter les arbres et la végétation sur la montagne Sainte-Victoire. Donc on avait atteint notre objectif aussi dans un temps vraiment encore record. Je pense que c'est inimaginable d'avoir fait ce qu'on a fait. Il fallait y croire, il fallait se lancer dans l'aventure. Alors il y avait un traumatisme profond. dans le monde autour de cette question sésanienne. Et je pense que ça a aidé aussi pour obtenir des prêts que peut-être on n'aurait pas obtenus sans ce drame avec l'incendie.
- Speaker #0
Vous me parliez de cette exposition de 82 qui, effectivement, est passée sous silence. On en parle très peu, je n'en avais jamais entendu parler d'ailleurs. On parle souvent des expositions de 56, 61. et de l'exposition 90-2006. Est-ce que justement, le fait que la montagne ait brûlé, ça n'a pas créé un choc dans l'opinion publique et ramené Cézanne un peu chez lui ?
- Speaker #1
Oui, on peut dire que tous ces événements concourent à faire que Cézanne revienne chez lui. Donc c'est un long chemin qui a été engagé, commencé, on peut dire, à la mort de Cézanne. Et à la mort de Cézanne, il n'y a qu'un seul officiel qui prend la parole. Sur sa tombe, c'est Victor Leydé, qui est un ami de Genèse, de Zola et de Cézanne. Donc, c'est vrai que c'est un long chemin depuis la mort de Cézanne pour que Hex, qui était la ville sans Cézanne, quand on regarde les articles de presse des années 1940, 1950, même encore 1960, les journalistes, surtout parisiens, il faut bien le dire, se gargarisent du fait que Hex est la ville sans Cézanne. Et ils avaient raison. Il n'y avait pas de Cézanne dans le musée de sa ville natale, ou s'il y en avait à partir de 1937. pour une aquarelle très belle d'ailleurs, mais qu'on ne peut pas exposer en permanence, c'était aucune peinture à l'huile, par exemple. Il a fallu attendre 1984 et la mise en dépôt de l'état de huit peintures à l'huile, certes de petits formats, mais qui permettent de jalonner quand même toute la carrière de l'artiste, pour que Cézanne soit de nouveau sur le... enfin, de nouveau. pour la première fois sur les cimaises du musée qui s'est appelé Granet. Pourquoi en 1948-1949 quand Louis Malboise qui était conservateur à l'époque a décidé de donner ce nom ? Parce qu'on ne pouvait pas lui donner le nom de Cézanne parce qu'il n'y avait aucun Cézanne. Donc c'était compliqué. Donc on l'a appelé Granet parce qu'évidemment c'était le centenaire du leg de Granet à sa ville natale. Et évidemment c'est un peintre important, c'est un peintre important de la première matière du 19e siècle et qui serait sans doute un artiste très important s'il n'y avait pas eu Cézanne. Mais depuis, on va dire que Granée est un peu éclipsée, même beaucoup, par Cézanne en termes de réputation, en termes de renommée. Donc le rêve qu'on pourrait avoir, ce serait d'un jour appeler ce musée non plus musée Granée, mais musée Cézanne. Ce serait très bien. Mais il faut encore faire quelques efforts, il faut encore progresser. Avec la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir acheter des Cézannes de la maturité, de ce qu'on appelle les beaux, les grands Cézannes, à cause de leur prix, évidemment. Et même l'État français, aujourd'hui, ne peut... plus offrir ce luxe-là sinon par dation, c'est-à-dire en paiement de droits de succession, et sinon en termes d'acquisition, c'est 100 millions d'euros par exemple, jusqu'à 250 puisque les joueurs de cartes, il y a une dizaine d'années, ont été vendus 250 millions de dollars. Alors c'est-à-dire que ce n'étaient pas des euros, c'était des dollars, mais enfin, à ce niveau-là, je pense que c'est beaucoup, et que donc effectivement, on ne peut plus du tout s'aligner. Alors les acquisitions qu'on a pu faire récemment, elles étaient importantes, elles étaient intéressantes. C'est celle notamment du portrait de Zola. que l'on a pu acquérir il y a une quinzaine d'années maintenant. C'est un petit format, c'est une œuvre de jeunesse, mais c'est le seul portrait de Zola conservé aujourd'hui. On sait que Cézanne en a fait un grand un jour, mais que de rage, pour ne pas pouvoir l'achever, il va le détruire. C'est Zola qu'il raconte dans ses lettres. Et donc Cézanne, lui, va garder ce petit portrait, ce petit portrait qui a une histoire assez rocambolesque, qui serait peut-être trop longue à raconter, mais qui est assez extraordinaire et romanesque aussi. puisqu'il a été enfermé dans un coffre de 1939 jusqu'au début des années 80. Et puis ensuite, il y a eu un long procès-fleuve entre les ayants droit d'un certain Éric Shlomovitch, qui avait mis cette œuvre dans le coffre, et puis les ayants droit de volar le marchand, qui était donc a priori propriétaire de cette œuvre, puisque le jugement qui a été rendu donnait cette propriété aux ayants droit. C'est donc aux ayants droit de volar que nous avons pu acquérir pour 400 000 euros à l'époque. ce tableau de Zola qui est symboliquement très important parce que c'est la seule trace vraiment tangible que l'on puisse conserver encore de la présence à Aix de Zola et puis surtout de cette amitié profonde entre les deux hommes.
- Speaker #0
A ce prix là on peut dire que c'est un bon prix ?
- Speaker #1
Alors disons que c'est un bon prix mais c'est une oeuvre de jeunesse, c'est pas non plus une oeuvre de maturité. Mais aujourd'hui le musée d'Aix ne peut vraiment s'offrir à la limite que ce genre d'oeuvre. On a encore acquis il y a maintenant 4-5 ans avec une procédure juridique qui a été un peu longue. Marie Cézanne en prière, qui est Marie, donc la sœur de l'artiste, qui est en prière. C'est un petit tableau qui est dans l'exposition d'ailleurs, et dans lequel tableau on voit cette jeune fille, mais déjà empreinte de religion, puisqu'elle sera extrêmement proche du clergé. Elle amènera sans doute son frère aussi, dont elle s'occupera de ses affaires. Après 1886, c'est la mort du père, puisque c'est elle qui va s'en occuper de ses affaires, et pas la femme de Cézanne, ou même le fils de Cézanne, il s'en occupera pour ses affaires. de vente de tableaux, mais pas pour la vie courante. La vie courante, c'est Marie Cézanne. Et cette Marie Cézanne habitera à la fin de sa vie sur la place Saint-Jean-de-Malte, de l'autre côté du musée. Et donc, ce petit tableau avait déjà été tout à fait en proximité. Et puis, il était parti très loin, parce qu'il était parti à Hong Kong. Et il a été racheté à Hong Kong par des Français qui l'ont ramené et qui l'ont vendu ensuite au musée Granet. Donc, c'est une belle acquisition aussi en Corse. C'est encore une œuvre de jeunesse. Et aujourd'hui, je dirais que le musée Granet ne peut plus faire que ce type. d'acquisition. Et c'est intéressant parce que si on doit parler de quelque chose à Aix-en-Provence, avec Cézanne, c'est aussi de la jeunesse. Puisque la jeunesse est importante pour comprendre un artiste de toute façon, mais aussi parce que la jeunesse de Cézanne va se passer au Collège Bourbon, on le sait, où il rencontre Zola, mais aussi au musée Granet, enfin qui s'appelle pas Granet, qui s'appelle le musée d'Aix à cette époque-là. Et au rez-de-chaussée, il n'y a pas le musée, il y a l'école de dessin, l'école gratuite spéciale de dessin où Cézanne va se former de 1857 jusqu'à 1862. par intermittence, puisqu'entre temps il va remonter à Paris à cette époque-là. Et puis au premier étage, on montait un des escaliers et on se trouvait dans le musée. Et le musée était assez modeste à cette époque, c'était vraiment le premier étage du Priory de Malte. Donc c'est-à-dire un espace très réduit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de collections. Et puis au fur et à mesure que les collections se sont agrandies, on a créé de nouvelles ailes, avec notamment l'aile... Cranais, qui a été construite dans les années 1860-1865. Et aussi l'aile Bourguignon de Fabregoule, quand le donateur Bourguignon de Fabregoule a donné plus de 600 peintures et 300 pièces de sculptures et d'archéologie, ce qui était évidemment considérable. Alors on va l'exposer provisoirement dans la chapelle des pénitents blancs, là où se trouve la collection Planck en ce moment, qui était déjà une extension, un agrandissement provisoire à l'époque du musée d'Aix, et qui mettent est une extension pérenne de ce même musée mais devenu grainé. Donc on voit que l'histoire se répète parfois et Cézanne quand en 1865 il va visiter cette exposition écrit tout de suite à son ami Zola qui est à Paris à ce moment là en lui disant c'est très réconfortant j'ai tout trouvé mauvais mais c'est l'époque où Cézanne avec son ami Pissarro pense aussi qu'il faut brûler le Louvre pour essayer d'écarter comme ça trop de références d'oeuvres du passé. Ce qui est en fait complètement fou par la suite dans l'œuvre de Cézanne, puisque Cézanne c'est toujours un pied dans la tradition, un pied dans la modernité. C'est ça vraiment qui le caractérise. Mais là, il y avait un peu comme ça cet élan, cet engouement d'un jeune artiste. Un peu comme de la jeunesse. Voilà, les grandes références pour créer quelque chose de fondamentalement neuf. Il était un petit peu dans cet esprit-là, même complètement, quand on lit la correspondance de Cézanne et de Zola, il parle beaucoup de monstruosité, il parle toujours d'être excessif en tout. Et finalement, dans leur littérature en tout cas, parce qu'ils échangent beaucoup par leurs lettres interposées, ou même en peinture pour Cézanne, il y a cet excès. La jeunesse de Cézanne est marquée par une œuvre excessive, excessive dans les sujets, le meurtre, l'orgie, le viol, mais excessive aussi dans la manière de peindre, le couteau à palette. Ce fameux couteau à palette qu'il utilise et qui lui permet d'écraser vraiment la couche picturale sur la toile et de faire une œuvre très épaisse, parfois jusqu'à un centimètre. 1,5 cm d'épaisseur de peinture, c'est considérable. Et finalement, plus de sculpter que de peindre, ça c'est aussi une des particularités de cette époque, mais qui a l'avantage extrême, c'est d'obliger à Cézanne à trouver des solutions, des solutions plastiques qui l'obligent à simplifier sa peinture. Il se rappelle souvent que c'est Gustave Moreau, qui est le grand peintre symboliste, qui dans son atelier avait à ses débuts le jeune Matisse, et il lui avait dit « vous serez le grand simplificateur de la peinture » , ce qu'il a été d'une certaine façon évidemment. Mais on peut dire que Cézanne, à sa manière, dans sa période de jeunesse, est déjà un grand simplificateur de la peinture. À cause justement de cette technique du couteau à palette, qui l'oblige à aller à l'essentiel, c'est un peu la différence entre la gravure au burin, qui permet d'être très très fin, de détailler dans le détail, et la gravure sur bois, qui avec la gouge et le travail de la gouge, oblige d'aller à l'essentiel. Pour la peinture, je trouve que le travail du couteau à palette, c'est à peu près ça pour Cézanne. Sauf que l'expérience du couteau à palette, il va ensuite la continuer. avec le retour à la brosse et au pinceau, mais en gardant ce qu'il a découvert avec le couteau à palette, c'est-à-dire cette simplification, cette synthèse des formes, ces plans qui déjà structurent sa peinture et qu'ensuite il développera après son expérience impressionniste, c'est-à-dire après encore 10-15 ans de passé, avec sa période de maturité, où là, effectivement, le plan coloré, qui est à mon avis l'héritier direct de cette première expérience avec le couteau à palette, va lui permettre de faire une peinture architecturée, construite. solide et durable comme l'art des musées. C'est ce que disait Cézanne quand il parlait de l'impressionnisme. Il voulait faire quelque chose de solide et durable comme l'art des musées.
- Speaker #0
Et pour revenir à cette exposition, la genèse d'une exposition comme ça, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Denis Coutagne qui le disait lors de l'inauguration. L'idée... Elle était déjà là dans les années 80 ? Oui,
- Speaker #1
c'est de ce qu'elle a parlé, parce que de fait, je crois que c'était en 87, il y a un courrier qui avait été fait du musée Granet, donc à l'époque avec Denis Coutagne comme directeur, qui proposait ou qui voulait réfléchir sur un projet d'exposition sur Cézanne au jas de bouffon. Il faut dire qu'à cette époque, le jas de bouffon est encore en main privée, est encore la propriété de la famille Granel-Corsi, qui donc avait acheté. à la famille Cézanne en 1899, et qui va rester propriétaire pendant 100 ans. Et donc le dernier des Corsi, qui s'appelle André Corsi, le docteur André Corsi, va vendre ensuite, sous réserve du Juffry, ce qui fait que la ville ne sera pleinement propriétaire qu'en 2002, la propriété du jas de bouffant. Et donc dans ce laps de temps de ces, on va dire, 10, 15 dernières années avant 2002, il est question de faire quelque chose d'important avec le jas de bouffant. Il est question de peut-être acheter, vendre et acheter la propriété et de faire quelque chose qui soit notable par rapport à Cézanne puisque c'est dans ce lieu que Cézanne a vécu le plus longtemps de sa vie, ça c'est bien certain, puisque Louis-Auguste Cézanne, le père, achète en 1859 que la propriété est vendue en 99, donc ça fait 40 ans, c'est long 40 ans dans la vie de l'artiste, dans sa vie personnelle mais aussi dans sa création et donc il était évident. dès les années 80, fin des années 80, qu'il fallait faire quelque chose de cette propriété, qui était encore, je le répète en main privée, il a fallu là encore évoluer, il a fallu encore avancer pour que les décisions soient prises. À l'époque, c'était Jean-François Pichral qui était maire d'Aix-en-Provence. Et je me souviens de rencontres chez le docteur Corsi pour dialoguer, pour échanger, pour parler de l'avenir de cette propriété qui était une vraie préoccupation pour le docteur Corsi. Il a toujours eu conscience d'avoir dans ses mains... Quelque chose qui était important pour Rex et évidemment important pour Cézanne. Et il a été assez généreux pour considérer que cette propriété pouvait rentrer dans le domaine public. Alors sous réserve du Juffry parce qu'il voulait en garder la jouissance toutes ses vies, et on peut le comprendre quand on connaît le jas de Bouffan. Mais d'avoir la volonté de faire de ce lieu un lieu culturel, un lieu dédié à Cézanne. Ce qui l'a été petit à petit là aussi, c'est un long cheminement. Je me souviens qu'en 2006, on avait ouvert en l'état la Bastide, c'est-à-dire qu'elle n'était pas restaurée, elle n'était pas vraiment réhabilitée du tout. Et donc, on voyait dans son jus, comme on dit dans le monde des musées, les œuvres qui n'ont pas été touchées, qui n'ont pas été restaurées, mais qui avaient quand même l'avantage de présenter une certaine poésie. Et moi, j'avoue que je suis toujours sensible à ces lieux un peu déshérités ou un peu abandonnés, mais qui portent quelque chose de magique aussi, et puis de poétique. Et évidemment... Le chemin a été long aussi pour mettre en place les budgets, pour mettre en place le projet de réhabilitation et surtout aussi de faire des découvertes au fur et à mesure de cette restauration qui ont amené aussi des décalages dans le temps par rapport à l'achèvement de cette restauration. Il vaut mieux aller lentement et faire les choses bien, surtout quand on découvre quelques mètres carrés de peinture de Cézanne, comme ça a été le cas au mois d'août 2023, et qui a obligé les restaurateurs à travailler encore plus lentement, qui nous a obligés à être encore plus patients. Et encore une fois, même aujourd'hui en 2025, quand on rentre dans ce grand salon par exemple, on s'aperçoit qu'une partie seulement a été dégagée, une partie seulement a été restaurée, et qu'il faut encore être un peu patient, peut-être 2026, peut-être 2027, pour arriver à achever totalement la restauration de ce grand salon, qui est vraiment un des temps forts de la visite de cette Bastide.
- Speaker #0
Tout dépendra en fait des découvertes qu'on y fera.
- Speaker #1
Notamment.
- Speaker #0
L'expo a démarré il y a une quinzaine de jours maintenant. Est-ce que vous avez déjà pu prendre un peu de recul sur la fréquentation ?
- Speaker #1
Oui, on a déjà des chiffres. L'exposition marche bien. Elle marche en fonction de ce qu'on avait prévu. Donc, c'est toujours satisfaisant aussi. On a à peu près entre... 2500 et 3000 personnes par jour, ce qui est beaucoup, mais avec la satisfaction et c'est le retour que j'en ai régulièrement, notamment en matière de sécurité, il a fallu monter de 3 ou 4 niveaux par rapport à ce qu'on avait connu dans les années précédentes, notamment en 2006, les conditions sont encore plus draconiennes aujourd'hui pour la sécurité. Et donc on a essayé de mettre en place quelque chose qui est à la fois très efficace, un peu comme dans les aéroports, avec notamment des RX, des rayons qui déterminent ce qu'on porte dans les sacs, Et notamment aussi une fluidité qu'on a cherchée. non seulement dans l'accueil, avec notamment externaliser sur la place Saint-Jean de Malte beaucoup justement de ces services que l'on doit rendre au public, et aussi quand on est à l'intérieur du musée, de créer une scénographie, de travailler sur une scénographie qui n'a pas de blocage. C'est-à-dire qu'on est en continu, du début jusqu'à la fin, si on voulait marcher régulièrement pendant tout le parcours de l'exposition, on pourrait le faire sans rencontrer jamais aucun obstacle. Ce qui n'était pas le cas précédemment, parce qu'on aime bien dans les musées mettre des cimesses perpendiculaires au sens des salles. qui créent justement des appels, qui sont des mises en valeur esthétiques aussi par rapport à un tableau, par rapport à une œuvre, mais qui là étaient évidemment contre-productifs par rapport à la fluidité du public. Donc on a beaucoup travaillé sur cette dimension. Ce qui a été aussi important, c'est qu'il y a une réservation horaire, journalière et horaire, et qui permet de fluidifier aussi. Alors qu'avant, quand on allait à la billetterie acheter son entrée, et bien À certaines heures, 11h par exemple et 15h, c'était la foule, 4-5 personnes devant chaque tableau en rang serré. Et donc c'était impossible à voir et j'ai tellement horreur de ça que finalement j'ai trouvé que c'était bien de ne pas en arriver là avec notre exposition et d'essayer de trouver toutes les solutions possibles pour fluidifier au maximum justement cette circulation.
- Speaker #0
Et c'est réussi ?
- Speaker #1
Ça marche. Donc aujourd'hui, au bout d'une bonne quinzaine de jours, puisque c'était le 28 juin, l'ouverture au public, les inaugurations avaient lieu avant, mais l'ouverture au public, je pense qu'on a déjà atteint le quota qu'on s'était fixé. Donc c'est évidemment très satisfaisant. On a eu aussi beaucoup de soirées au musée, qui sont un moyen aussi d'équilibrer financièrement un budget extrêmement lourd. Et puis on a aussi beaucoup de... de prise en compte de notre audio guide qui est en cinq langues comme chaque fois que nous faisons des grandes expositions l'été audio guide audiophone aussi mis à disposition du public pour les visites guidées aussi que nous avons très régulièrement tout au long des journées donc on peut dire que cet accueil a été particulièrement travaillé comme toujours dans nos expositions on essaye d'être très attentif au public à ses attentes et de de répondre justement au mieux à ce qu'il peut avoir comme besoin. notamment en termes de connaissances. C'est pour ça que dans l'exposition, par exemple, on a mis régulièrement des fragments de biographie qui permettent de prendre connaissance, tout en restant très lapidaire, très simple aussi, parce que sinon, on passe trop de temps à lire et puis on ne regarde pas les œuvres non plus. Mais de trouver le bon équilibre entre, justement, l'information nécessaire et puis, évidemment, une lecture rapide pour ne pas alourdir non plus trop la visite. Donc, il y a à la fois les éléments de chronologie et puis il y a à la fois aussi les textes de salles, qu'on appelle tout simplement, et qui sont pratiquement dans chaque salle pour raconter et résumer ce que porte cette salle sur ses six maises, même si encore une fois, évidemment, il vaut mieux regarder les tableaux, mais c'est utile aussi, quand on n'a pas une connaissance très précise de l'œuvre de Cézanne, de pouvoir savoir à quel moment il a abordé tel sujet, ou comment il a travaillé à telle époque, quelle était sa vision, quelles sont les grandes époques de la vie de Cézanne. En fait, il y en a quatre, si on veut les résumer. La première, c'est ce qu'on appelle les années de jeunesse. avec notamment à partir de 1864-65 le couteau à palette, j'y reviens mais c'est très important, qui permet à Cézanne de basculer de l'imitation des maîtres anciens, de la copie plus ou moins servile des références au passé, c'est ce qu'il commence à faire sur les murs du Grand Salon du Jazz de Bouffant, vers justement quelque chose de plus personnel, tellement personnel d'ailleurs qu'il fait une peinture qui n'existe pas à cette époque, elle est expressionniste avant la lettre. Et on sait que l'expressionnisme, c'est le début du XXe siècle, donc Cézanne a 40 ans d'avance, même dans sa période de jeunesse. Ensuite, c'est la période impressionniste. La période impressionniste, 1870-1880 à peu près, qui est une décennie dans laquelle il va être en contact avec les impressionnistes de façon plus immédiate, notamment Camille Pissarro, qui sera vraiment son père en peinture, il le dénomme ainsi, et il va s'essayer à l'impressionnisme. Mais on sait aussi que très vite, avec la touche structurante, il va notamment dépasser l'impressionnisme. On l'appelle d'ailleurs touche structurante ou constructive. Ça veut bien dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Cézanne ne se contente pas de faire de la peinture impressionniste. Il veut dépasser cet impressionnisme. Il dit qu'il veut faire du poussin sur nature. Faire du poussin sur nature, c'est l'expérience de l'impressionnisme, d'aller sur le motif et de travailler d'après la nature, mais revu, retravaillé, repensé, avec la référence à Nicolas Poussin. ce grand artiste français du 17ème classique français. Donc c'est cette évolution que l'on voit très bien dans l'exposition aussi et qui amène dans les deux décennies suivantes, c'est-à-dire les années 1880 à 1900 grosso modo, qui sont ce qu'on appelle la période de maturité. La période de maturité, c'est le plein développement, la personnalité de Cézanne qui s'exprime pleinement. Et pendant cette période-là, il va osciller encore entre la Provence et Paris. Même si petit à petit la Provence va l'emporter sur Paris, il retournera pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. À Paris, ça on l'oublie souvent, mais il y a aussi cette régularité, d'abord parce que sa femme et son fils habitent Paris et que de temps en temps il va aller les voir, mais aussi parce qu'il aime travailler à Paris, il a un atelier, des ateliers à Paris. Quand il fait le portrait d'Ambroise Vollard, par exemple, son marchand, en 1899, il le fait parce qu'il est à Paris et parce que Vollard pose pour lui à ce moment-là. Et puis la dernière période, les dernières années, c'est effectivement 1900-1906, pour simplifier, on pourrait dire même 1902-1906 avec la période de l'atelier des Louvres. Donc voilà, on s'aperçoit que Cézanne, en quelques grandes parties de vie, quelques grandes périodes de travail, va réaliser son œuvre. Une œuvre immense, alors quand on dit immense, ce n'est pas forcément en nombre d'œuvres, puisqu'aujourd'hui on compte à peu près autour de 850 peintures, peintures à l'huile. Si on rajoute les dessins et les aquarelles, ça fait encore évidemment beaucoup plus, mais ce n'est pas énorme en termes de production. Mais on sait que Cézanne travaille lentement, extrêmement lentement, il met beaucoup de temps pour peindre un tableau. Émile Bernard, qui est un de ces jeunes artistes, qui vient le voir à la fin de sa vie, notamment en 1904 et 1905, dira qu'il peut mettre cinq minutes entre chaque touche. Et Cézanne dit que peindre, c'est méditer le pinceau à la main, c'est une très jolie expression, mais pour lui, c'est une réalité. Je pense qu'il a médité chaque moment de sa peinture, chaque instant de son tableau. Et lui qui était plutôt emporté... Il a un caractère méditerranéen, il a le sang chaud, bouillant, on le voit dans sa période de jeunesse. Et d'ailleurs, sur sa période de jeunesse, on a très peu d'informations sur son temps de travail. On ne sait pas s'il travaillait assez vite, ou même si déjà à cette époque il travaillait lentement, on n'a aucun élément. Peut-être qu'un jour on en trouvera, mais en tout cas pour le moment on ne le sait pas. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que dès sa période impressionniste, peut-être encore une certaine rapidité, mais dès sa période de maturité, c'est la lenteur. C'est la lenteur, voire même l'impression d'un travail besogneux, mais dans toute la noblesse du besogneux. Ce n'est pas quelqu'un qui va être dans la médiocrité du besogneux, mais c'est quelqu'un qui va être dans le travail sans cesse repris, sans cesse médité, sans cesse retravaillé, recouvrant régulièrement certaines parties de ses tableaux parce qu'il n'en est pas satisfait. C'est pour ça que parfois, même s'il a depuis longtemps abandonné le couteau à palette, on retrouve parfois des épaisseurs de matière tout à fait impressionnantes dans ses peintures.
- Speaker #0
Je vous écoute parler de Cézanne et je me disais, mais si vous aviez Cézanne en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
- Speaker #1
C'est une grande question, c'est une belle question. Moi je pense que je serais abominablement intimidé d'abord de me dire mais qu'est-ce que je vais lui demander un tel monument connaissant aussi son caractère parce que rétrospectivement on sait aussi comment était Cézanne, il était pas de grande colère avec cette idée qu'il ne voulait surtout pas qu'on lui mette le grappin dessus. Donc je ne voudrais surtout pas qu'il ait l'impression que je lui mette le grappin dessus. Peut-être que ça serait la première des choses, la première précaution. que je prendrai, et puis après, je pense que je rentrerai dans le détail. Plutôt que de parler de grands principes, de grandes idées, Cézanne n'aimait pas d'ailleurs théoriser, il dit qu'il faut fuir les théoriciens. D'ailleurs, il reproche parfois à Émile Bernard de trop écrire et d'être trop théorisé. Je pense qu'il a un peu raison quand même, quand on regarde tout ce qu'Émile Bernard a pu écrire. Il aura un jugement assez sévère aussi au final avec Joachim Gasquet, donc il critiquera le côté trop littéraire certainement aussi. Donc je lui poserai des questions sur plutôt sa manière de peindre concrètement. Le fait qu'effectivement il met beaucoup de temps entre chaque touche, et bien à quoi pense-t-il dans ces moments justement de réflexion, de méditation ? Est-ce qu'il pense purement technique ? Est-ce qu'il pense aussi ce que je croirais plutôt, notamment aussi quand il fait un paysage de la montagne Sainte-Victoire ? il se souvient de... de tout ce qu'il a vécu sur cette montagne. Et pour moi, le côté sentimental, mais au sens noble encore, très beau du terme, compte beaucoup dans le travail de Cézanne. Et pour moi, chaque fois qu'il a fait une montagne Sainte-Victoire, il a pensé à ses promenades, à ses escapades, d'abord avec Zola, mais aussi qu'à la fin de sa vie, vers 1895, il ira encore une dernière fois avec Achille Empereur. Achille Empereur qui est un ami de jeunesse, enfin ils ne se sont pas connus à Aix, mais ils se sont connus à... à Paris, lorsqu'ils étaient eux-mêmes à fréquenter la même académie pour travailler d'après le modèle vivant, mais sans maître, puisque ça c'était le grand privilège de l'Académie suisse, c'était de travailler sans maître. C'est d'ailleurs là que Cézanne a rencontré Renoir, a rencontré la plupart de ses amis impressionnistes, mais il rencontre aussi Achille Empereur. Achille Empereur c'est un ex-soi, mais qui on le sait était contrefait, avait été atteint de nanisme, c'est-à-dire que vraiment il avait les jambes très grêles. très petite, très courte. Et le pauvre homme, on le sait parce qu'on nous l'a rapporté, tous les jours, toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, s'est suspendu à une perche qui était dans son appartement pour essayer de grandir pendant quelques minutes. Donc c'est assez terrible et c'est un personnage très émouvant. Cézanne a fait des portraits remarquables. Il y a ce grand tableau qui se trouve au musée d'Orsay, que nous n'avons pas pu avoir pour des raisons de conservation, parce que justement il n'est pas en très grande épaisseur et que la conservation était très difficile. pour des transports notamment, mais il a fait des très beaux dessins, notamment une très belle tête que nous avons dans l'exposition et qui représente Sachy L'Empereur et qui se trouve au musée d'Orsay, conservé par le cabinet de dessin au Louvre, et qui est une tête magnifique, qui est une tête de mousquetaire avec un brillant, avec un côté bravoure qui se dégage de ce dessin qui montre que Cézanne avait cette amitié particulière pour ce petit homme qui n'a pas réussi et qui n'a surtout rien réussi dans sa vie en tant que peintre, alors qu'il était... avec des idées qui le dépassaient vraiment. Et Cézanne admirait chez Ampereur cette capacité de faire des nues qui était hors norme, le côté excessif. Quand on parlait de l'époque de Genèse de Cézanne, on le retrouve d'une certaine façon dans l'œuvre d'Ampereur, tout au long de l'œuvre d'Ampereur, qui d'ailleurs par manque de moyens peignait souvent recto verso ses toiles. Il n'avait pas de moyens à utiliser de la mauvaise peinture, c'est pour ça que son œuvre se conserve. extrêmement mal aussi. Donc l'artiste me dit, quand on dit que Cézanne est un artiste me dit, je pense pas qu'il représente vraiment cette dimension là. Cézanne a eu un père qui lui a toujours donné les moyens de faire de la peinture, les 150 francs, c'était pas beaucoup par mois surtout quand on avait femme et enfant et qu'il cachait à son père l'existence de cette femme et de cet enfant et que malgré tout ces 150 francs lui permettaient de faire la peinture qu'il voulait faire, de ne faire jamais aucune peinture alimentaire et de finalement être intransigeant.
- Speaker #0
C'est la chance qu'on a, c'est d'avoir eu un peintre qui n'avait pas besoin de plaire.
- Speaker #1
C'est ça, et ce fait de ne pas plaire lui a permis d'être un grand peintre, qui va être d'ailleurs une qualité qui lui sera assez vite reconnue. Quand on va reconnaître à Cézanne qu'il est un grand peintre, on va lui reconnaître d'abord cette liberté et cette façon d'imposer sa vision, ce côté intransigeant. C'est peut-être par là même que les choses commencent. On ne va pas dire que Cézanne est un grand peintre en tant que tel. On va dire qu'il a une éthique, on va dire qu'il a une forme de morale de l'art qui est un modèle. Et par exemple, quand Picasso parle de Cézanne, il n'en parle pas d'un point de vue plastique, très très peu, à ma connaissance vraiment pas. Par contre, il dit que ce qui l'intéresse chez Cézanne, c'est l'inquiétude de l'homme. C'est l'expression qu'il utilise, l'inquiétude de l'homme. Et donc ça veut dire le caractère, le tempérament. Et Cézanne disait que pour être un peintre, il fallait avoir du tempérament. Donc les grands esprits se rencontrent, les grands artistes aussi se rencontrent. Et on ne peut pas dire que Picasso n'avait pas de tempérament, et Cézanne aussi avait un grand tempérament. Mais ce grand tempérament de Cézanne a pu s'exprimer grâce au fait qu'effectivement, ce père lui a d'abord donné cette rente de 150 francs par mois, qui était insuffisante, puisqu'on sait que l'ami Zola va aider Cézanne, et notamment sa femme et son fils, dans les années 1880, en prêtant de l'argent justement à Cézanne. Mais ensuite, à partir de 1886, quand le père meurt, le banquier meurt, il laisse à ses trois enfants, lui, donc Cézanne et ses deux sœurs, un héritage substantiel qui va permettre à Cézanne de vivre très correctement. Ses amis disent d'ailleurs qu'il a divisé en trois la rente mensuelle qu'il reçoit, une part pour sa femme, une part pour son fils, une part pour lui, et ça suffira largement pour lui permettre de continuer à faire la peinture qu'il veut faire.
- Speaker #0
Il y avait ce mot du père de Cézanne qui disait « avec la gloire on vit, avec l'argent on mange » .
- Speaker #1
Oui, ça c'est la grande question qui va être débattue entre le père et le fils dans la période de jeunesse. Quand Louis-Auguste le banquait, puisqu'il est banquier depuis 1848, ce n'est pas un banquier ancien, auparavant il était ouvrier-chapellier, puis après il a eu une chapellerie, c'est un homme d'affaires, il a le sens des affaires. Il va faire suffisamment d'argent pour qu'en 1848, même si le capital n'est pas celui des banques aujourd'hui, lui permette d'acheter en 1848 donc une banque. Il s'offre une banque avec l'argent qu'il a pu déjà épargner, accumuler. Donc c'est un homme d'affaires. Et il a le sens des affaires. Et Cézanne dit toujours à ses amis, et parlant de son père aussi, que ce qu'il admire chez ces personnes-là, c'est leur assiette. C'est le terme que Cézanne utilise, avoir de l'assiette. C'est-à-dire avoir une stabilité de bien... poser sur la table l'assiette en question et d'avoir une vie à la fois réglée, à la fois efficace, à la fois qui permette aussi une progression, puisqu'il a toujours observé que son père avait progressé dans toute sa carrière. Sauf que Cézanne, lui, il ne veut pas être banquier, il ne veut pas être juriste, il ne veut pas être avocat, ce que pensait sans doute son père. Il veut être peintre. Donc évidemment, le hiatus va être énorme et ils vont mettre beaucoup de temps à s'entendre et à pouvoir travailler ensemble. Quand j'ai travaillé, c'est travailler à cette relation. de père-fils, qui est difficile puisqu'on sait que lorsque Cézanne a plus de 40 ans, son père ouvre encore son courrier, le courrier qui arrive au jas de bouffant. Ça veut dire aussi qu'on est dans une autre époque. Il faut se remettre dans le contexte. Le pater familias en Provence au XIXe siècle, c'est encore quelque chose qui compte beaucoup. Je ne dis pas qu'il a le droit de vieillement, mais presque. Quand vous écoutez Mireille, l'opéra de Gounod et évidemment de Mistral, ce qui vous frappe, c'est la puissance paternelle. C'est la force du père dans la famille. la représentation du père. Et c'est ce que Louis-Auguste vit et fait vivre à son fils aussi. Et donc, comme son fils est tributaire de cette pension qu'il lui sert, il ne va jamais contester vraiment la puissance paternelle. Et donc, il va lui cacher des choses. Il va lui cacher pendant 14 ans l'existence de son fils, la relation avec cette femme qui est Hortense Fiquet, qu'il rencontre en 1869, le fils né en 1872. Et le père acceptera, in extremis, puisqu'il meurt la même année, en 1886, le mariage de son fils. Et pendant ce temps, il ouvre son courrier. Et pendant ce temps, Cézanne, qui rate le train à Marseille, va faire 30 kilomètres à pied pour arriver au jas de Bouffon, à la maison familiale. Et ça, on le sait, puisque c'est Cézanne qui le raconte. Donc, on ne peut pas dire que c'est inventé. C'est une légende. Ce n'est pas une légende. Cézanne le raconte dans sa correspondance. Donc, il l'a vécu. Et toute cette relation est une relation assez complexe, difficile. de respect de l'autorité paternelle aussi. Ça, c'est la première période. Et après la mort en 1986 du père, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que quand il amène dans le grand salon du Jazz de Bouffon Joachim Gasquet, il voit dans l'Alcove, qui est au nord et qui est la place d'honneur de ce grand salon, le portrait du père. Et il dit à Joachim Gasquet « le papa » , mais avec effectivement de l'émotion dans la voix. parce que pour lui c'est quelque chose d'important. Donc il y a la crainte, il y a le respect de l'autorité dans un premier temps, et après la mort du père, on pourrait dire qu'il y a la reconnaissance.
- Speaker #0
Je vais revenir par tiers de Cézanne et revenir un petit peu à vous. Vous avez donc dirigé le musée Granet pendant toutes ces années, vous allez laisser la place bientôt, et en dehors des expositions Cézanne, quelle est l'exposition que vous avez lu le plus ?
- Speaker #1
C'est beaucoup de questions là en soi, en tout cas j'ai beaucoup de réponses. En donner une ça va être très difficile, j'ai quelques grands moments comme ça qui m'ont permis de faire pour moi de très belles expositions. Je vais en citer quelques-unes parce que c'est des souvenirs qui me plaisent beaucoup. Je me souviens par exemple d'une exposition avec Pierre Alechinsky. Pierre Alechinsky qui est un grand artiste contemporain, toujours vivant aujourd'hui. avec lequel j'ai eu grand grand plaisir à travailler. C'était de l'art contemporain mais c'était déjà un artiste très reconnu et pour nous cette exposition qui s'appelait les ateliers du midi c'était comme une préfiguration de ce qu'on allait faire pour l'année 2013 avec la capitale européenne de la culture. Donc c'était une exposition qui a compté. Il y a eu par exemple la collection de Frieder Burda aussi qui était un collectionneur allemand à Baden-Baden qui est un très beau musée privé à Baden-Baden. et on avait pu faire sortir d'Allemagne cette collection. C'était la première fois que cette collection sortait d'Allemagne, qu'elle venait notamment en France. J'ai un grand plaisir à me souvenir de ce projet-là. Et puis, il y a eu aussi la collection Perlman. Quand en 2014, elle est venue ici à Aix, et je ne parle pas des 24 Cézannes, puisqu'il y a quand même 24 Cézannes dans la collection Perlman, dont 16 aquarelles absolument superbes, mais aussi Modigliani, mais aussi Manet, mais aussi Pissarro, mais aussi... Beaucoup d'artistes notamment de la modernité qui intéressaient ce Perlman. Je pense à des artistes notamment comme Soutine, qui a été vraiment largement collectionné aussi par Henry Perlman. Donc là aussi, c'était un grand moment. Et avec notamment la trois œuvres majeures de Cézanne, dont la Sainte Victoire, la seule Sainte Victoire verticale, qui faisait partie de cette collection Perlman. Donc la collection Perlman, ça a été un grand moment pour le musée. Les grands moments aussi du musée sont ceux autour de l'archéologie, puisqu'on a un patrimoine riche archéologique. Et là, avec la direction de l'archéologie d'Aix, on a fait de grands projets, notamment l'Aix-Gal-Romaine, par exemple, qui était une belle exposition. Là, je me souviens du côté pondéreux de la chose, puisqu'on a déplacé des tonnes et des tonnes de bouts de colonnes, de chapiteaux, et qu'il a fallu même renforcer les planchers, parce que sinon on craignait que... Les 400 kg au mètre carré ne résistent pas. Et puis, parmi les autres grands projets, évidemment, il y a autour de Cézanne ou de Picasso, ou Picasso et Cézanne, puisqu'en 2009, c'était Picasso-Cézanne, là aussi, grande exposition internationale, qui, trois ans après 2006 et Cézanne en Provence, a permis d'accueillir au musée plus de 370 000 visiteurs, ce qui était aussi tout à fait considérable, sur un thème qui me tenait à cœur, j'adore Cézanne, j'adore Picasso, c'était de lier les deux et de montrer comment Picasso a été et Un fan incroyable de Cézanne, comment il a pensé Cézanne, comment un jour il s'est frappé la poitrine en disant « le petit-fils de Cézanne, c'est moi » ou comment il disait avec Matisse « Cézanne, notre père à tous » par exemple, ou quand il disait « moi ce qui m'intéresse chez Cézanne, c'est l'inquiétude de l'homme » et en fait c'était le doute. Je pense que Picasso était fasciné par le doute, lui qui affirmait qu'il ne cherchait pas et qu'il trouvait. Donc quand on ne cherche pas, on trouve, c'est qu'on ne doute pas a priori. Je pense que fondamentalement, il y avait quelque chose au fond de lui qui le fascinait chez Cézanne, c'était ce doute, le doute cézannien. Cézanne est convaincu d'être un grand artiste, il le dit, je suis le seul grand artiste vivant, il l'affirme à un moment donné, de façon un petit peu orgueilleuse aussi, c'est certain. Mais aussi à beaucoup d'autres moments, il dit, arriverai-je au but de temps recherché et si longtemps poursuivi ? C'est-à-dire qu'il se pose des questions. Quand on regarde par exemple la correspondance de Cézanne, quand il parle de ses œuvres, il ne dit jamais des tableaux. Il ne fait jamais des tableaux Cézanne, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne fait que des études, comme si finalement c'était toujours quelque chose en devenir, quelque chose qui était en attente. Et cette dimension-là, je pense qu'elle est fondamentale pour bien comprendre l'œuvre de Cézanne, la portée de l'œuvre de Cézanne. Et par son inachèvement, même si elle est aboutie cette œuvre, mais elle est inachevée, on peut dire qu'elle ouvre sur le XXe siècle, pleinement sur le XXe siècle, qui est un siècle comme le XXIe d'ailleurs. où la remise en cause fondamentale de l'art, la remise en cause des techniques classiques de l'art, de la peinture notamment, font que Cézanne anticipait, ouvrait déjà. Regardez le dessin de Cézanne, il est discontinué et ouvert. C'est une œuvre ouverte qu'il nous livre. Ce n'est pas un dessin parfait qui enferme la forme, il la libère la forme. C'est en ça que Cézanne est encore très moderne. Mais on lui a reproché à son époque de ne pas savoir dessiner, de ne pas savoir peindre, de ne pas savoir terminer, de ne pas savoir finir ses tableaux. Et de fait, quand on regarde l'exposition au Musée Granet, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, et plus il laisse du blanc, des parties non peintes sur ses toiles. Et ces parties non peintes, longtemps on s'est posé la question de savoir si c'était de l'inachèvement, s'il n'avait pas pu les terminer et qu'il les avait laissées comme telles. Alors je pense que ça peut être le cas, mais fondamentalement, quand on écoute la réponse que Cézanne va faire à Ambroise Vollard, Quand Ambroise Vollard lui demande, au sujet de son portrait de 1899, pourquoi il n'a pas peint deux petits millimètres carrés sur sa main droite, c'est un tableau qui se trouve au musée du Petit Palais à Paris, on peut le voir, il est en général toujours exposé, et bien Cézanne répond, si je me trompe sur ces deux petits millimètres carrés, je serai obligé de refaire tout le tableau. Et ça aussi, c'est encore une fois l'éthique de Cézanne, c'est la démarche de Cézanne, c'est cette volonté de ne pas se tromper, et en tout cas d'être dans la vérité. Un jour il a dit, je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai. Voilà quelque chose qui fait qu'on comprend fondamentalement que Cézanne est quelqu'un qui est en profondeur et en intériorité. C'est quelqu'un qui veut penser la peinture non pas dans son clinquant, dans sa superficie, mais en profondeur. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, quand il va alléger sa technique picturale, il va notamment faire des couches si fines, si transparentes, que la lumière va traverser la couleur, frapper le blanc de la toile et revenir. de l'intérieur de la matière. Et ça, c'est très important parce que même quand vous êtes un grand impressionniste, comme Monet, comme Renoir par exemple, la lumière s'arrête à la surface de la peinture, parce qu'elle est un peu épaisse, parce qu'il y a la petite touche impressionniste, et que cette lumière nous est reflétée par la superficie de l'œuvre. de la peinture. Alors que chez Cézanne, elle traverse la couleur et nous revient de l'intérieur de la matière. Et donc après, vous imaginez une nature morte, un portrait, un paysage, avec une lumière qui semble irradiée de l'intérieur de la matière, ça change tout.
- Speaker #0
Je souris parce que même si je vous dis de laisser Cézanne de côté, vous y revenez encore. Alors on arrive à la fin de notre interview, j'ai une question à vous poser, c'est une question un petit peu rituelle dans cette... dans ce podcast, si vous deviez choisir un lieu un lieu qui vous plaît à Aix-en-Provence lequel ce serait ?
- Speaker #1
Je dirais le lieu où j'habite parce que j'ai la chance d'habiter à Saint-Marc-Jeune-Garde ou à Maud-et-Bonfillon c'est-à-dire vraiment la partie la plus lointaine par rapport à Aix et là au sommet d'une petite butte j'ai la chance de pouvoir tous les matins en ouvrant mes fenêtres, voir la montée de Sainte-Victoire et la voir Pas comme Cézanne l'a vu, puisque ce n'est pas ce point de vue-là que Cézanne avait choisi, mais c'est la montagne Sainte-Victoire, c'est celle de Cézanne, c'est celle de Picasso. Et j'ai toujours plaisir, tous les jours, à ouvrir ces fenêtres et à la découvrir.
- Speaker #0
C'est beau. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, parce que quand j'ai créé ce podcast, vous faisiez partie de la liste d'invités rêvés. Et donc, je suis ravi que vous ayez accepté. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre... Futur retraite.
- Speaker #1
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
- Speaker #0
À bientôt. Voilà. C'est ainsi que s'achève cet épisode des gens d'Aix. Un immense merci à Bruno Ely pour son accueil, sa disponibilité et surtout pour la richesse de ses réflexions sur l'art, la transmission et notre ville. Si cette conversation vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, fait sourire ou réfléchir, alors parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui fait vivre ce podcast et c'est aussi simple que de partager cet épisode à un ami, un collègue un amoureux des musées ou tout simplement un amoureux d'Axe. Les gens d'Axe est un projet personnel, bénévole et indépendant et vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître en laissant un commentaire, un like ou 5 petites étoiles sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Chaque geste compte et permet à ce podcast de remonter dans les suggestions. Et puis j'aimerais aussi vous lire. Qu'avez-vous retenu de cet épisode ? Une phrase, une anecdote, une émotion ? Dites-le en commentaire ou venez-en discuter avec moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouvel épisode avec un invité qui, je vous le promets, va faire parler des Exois.