- Speaker #0
Et au début, on me traitait un peu de fou. J'ai dit le Covid-19, en fait, c'est une maladie vasculaire qui m'a marqué profondément. C'est la une du Parisien le 5 avril 2020. Quand on demande à la population générale « Pensez-vous que l'hydroxychloroquine soit efficace ? » Et là, en fait, on s'est dit « Il y a un problème. La science et la santé, ce n'est pas une croyance, en fait. » Et je me suis réveillé quand j'ai vu à quel point les fausses informations circulaient. Il faut qu'on ait des influenceurs TikTok de la science. Il faut qu'on ait des gens. qui explique ce que les instituts de recherche font. Aujourd'hui, ça doit faire partie de notre job. On ne peut pas faire comme si les réseaux sociaux n'existaient pas.
- Speaker #1
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PharmaMinds. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec le professeur David Smadja.
- Speaker #0
Bonjour.
- Speaker #1
Bonjour. David est hématologue à la base. Il travaille à l'HEGP, l'hôpital Georges Pompidou. Et pourquoi j'ai voulu la voir à ce micro aujourd'hui ? Parce que dans le cadre de son activité d'hématologue, il a travaillé sur le Covid et récemment sur des données de micro-circulation sur le Covid. Et en fait, ce sujet qui a l'air hyper technique en apparence, touché à la notion de Covid et aussi la notion de vaccin qu'il y a eu derrière le Covid. Et ce qui est passionnant dans ce parcours, c'est que David est quelqu'un qui est aussi tombé du coup dans la spirale de la désinformation en santé, avec ses sujets. Et donc voilà, c'est un épisode qui, je pense, va nous amener très loin, en tout cas très haut, pour parler à la fois de Covid, d'innovation, de science, et surtout peut-être de perception publique, d'image de la science.
- Speaker #0
Je pense que c'est important aujourd'hui de savoir expliquer la science, de savoir expliquer la santé, de savoir expliquer ce qu'on fait dans nos labos de recherche, comment ça arrive à une pratique clinique, que ce soit une pratique clinique ou même comment un médicament arrive sur le comptoir d'une pharmacie. Je pense que cette pandémie Covid qui nous a tous surpris a donné lieu, c'était la première pandémie à l'ère des réseaux sociaux. Ça a donné lieu à des spéculations, des discussions qu'on ne pensait pas voir un jour arriver au grand public. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut reprendre les bases de notre débat public, je dirais presque du débat démocratique autour de la santé et de la science, et c'est hyper important.
- Speaker #1
Bon, alors moi, j'ai hâte de cette discussion, de comprendre comment l'innovation scientifique peut nourrir la prévention et la confiance. Pour commencer, peut-être que vous allez me parler un peu de votre parcours, Simon ?
- Speaker #0
Oui, pour vous expliquer peut-être pourquoi j'en suis arrivé à réfléchir sur ces sujets. Moi, je dirige un laboratoire d'hématologie à l'hôpital Georges Pompidou, et notre spécialité, notre focus dans l'équipe a toujours été, que ce soit l'équipe clinique que l'équipe de recherche, a toujours été les anomalies du vaisseau sanguin, et notamment la thrombose, plutôt la thrombose veineuse. on a aussi des approches de thrombose artérielle. Et pourquoi une somme de facteurs de risque fait qu'on arrive à avoir une thrombose ? C'est comme ça que quelqu'un qui fait de l'hémostase s'est intéressé au Covid. On n'est ni infectiologue, ni immunologiste, et on est resté sur notre spectre de ce qu'on savait faire. Et quand en février 2020, on a été inondé par cette infection par SARS-CoV-2, on s'est rendu compte que de nombreux patients faisaient des embolies pulmonaires et rapidement, on s'est rendu compte qu'énormément de petits caillots dans la micro-circulation se mettaient en place. Donc, dès le début, et au début, on me traitait un peu de fou, j'ai dit que le Covid-19, en fait, c'est une maladie vasculaire. Alors, on me disait, évidemment, ton dada, c'est les maladies vasculaires, ton dada, c'est la thrombose, alors tu veux nous mettre de la thrombose partout. Je dis, on va le faire bien et on va le démontrer. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup travaillé dès les premiers malades. Le premier malade français, il est passé par chez nous quelques heures à l'hôpital Georges Pompidou. Il avait une embolie pulmonaire. Il est parti ensuite dans un centre de maladies infectieuses. Et on s'est dit, mais pourquoi ? Est-ce que c'est un hasard ? Et on s'est rendu compte quelques semaines après que ce n'était pas du tout un hasard, que ces patients avaient une propension à faire des thromboses et notamment des embolies pulmonaires de manière très importante. Donc, il fallait comprendre pourquoi. Pourquoi ce virus, atropisme respiratoire, entraînait des caillots dans la circulation, faisait des épisodes vasculaires. Et donc on a comme ça essayé de décortiquer d'abord la physiopathologie pour comprendre ce qui se passait et ensuite verser, bien entendu, sur le versant thérapeutique, comment prévenir cette maladie vasculaire avec des surprises, puisqu'on a eu, bien entendu, de nombreuses stratégies anticoagulantes chez ces patients. Alors on a compris qu'il y avait une cinétique d'anticoagulation particulière chez ces malades à avoir pour être efficace et pas verser sur le versant hémorragique. et puis surtout... On a pu comprendre que des traitements qui avaient été choisis pour le Covid, qui étaient efficaces, soignaient l'infection Covid, en tout cas les effets inflammatoires de l'infection Covid, c'est le cas donc des corticoïdes, et qu'en fait, si les corticoïdes avaient permis de faire disparaître cette épidémie d'embolie pulmonaire de la première vague, c'était aussi parce qu'ils avaient un effet vasculaire. Et donc on sait aujourd'hui que ces corticoïdes, ils n'ont pas un bénéfice qui est à la fois inflammatoire et à la fois vasculaire. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a occupés en 2020 jusqu'à aujourd'hui sur les compréhensions des corticoïdes. Et c'est comme ça que j'ai versé dans ce Covid qui m'occupe depuis maintenant 5 ans. Ça commence à faire long.
- Speaker #1
Un nouveau dada. Et du coup, c'est à quel moment que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait à la fois un tropisme respiratoire, mais il y avait aussi du vasculaire ?
- Speaker #0
Alors le vasculaire, vraiment, ça a été immédiatement. Immédiatement. Alors forcément, avec le prisme que j'ai dans la littérature scientifique par rapport à ce qui se passe en clinique, je vais aller regarder ce qui se passe au niveau vasculaire et en l'occurrence, notamment sur un paramètre biologique, qui est les dédimers, qui est devenu très à la mode depuis la pandémie, puisque tout le monde l'a utilisé dans plein d'indications sûrement à tort. Et donc ces dédimers, dès les premiers cas chinois, on a vu qu'il y avait énormément de dédimers. Il n'y avait aucune raison. D'avoir autant de délimers, on a l'habitude d'avoir des patients qui ont la grippe l'hiver, des patients qui ont des syndromes de détresse respiratoire en réanimation l'hiver. On ne voyait jamais des activations de la coagulation de ce niveau-là. Donc il y avait un vrai, dès les premières publications chinoises, un vrai truc qui m'a fait dire, il faut qu'on regarde. Et avec ce qu'on savait faire au labo, il fallait qu'on s'y intéresse.
- Speaker #1
Et après, les microtromboses, c'est arrivé, vous avez creusé ? En fait,
- Speaker #0
on a creusé. J'ai travaillé en binôme beaucoup avec un réanimateur, Jean-Luc Dille, qui avait les moyens cliniques d'explorer cette microvascularisation. Et on a tenu bon de février 2020, où on disait, bon, ce match-là, Jean-Luc Dille, vous exagérez. À aujourd'hui, oui, en fait, la microtrombose, c'est le centre de la pathologie. Les formes graves, elles ont toutes cette microtrombose. c'est cette microthrombose qu'il faut prévenir, c'est cette microthrombose qu'il faut traiter et qui est pronostique sur les formes graves. Qui arrive aujourd'hui quand même beaucoup moins, bien entendu. On n'est plus du tout dans cette première phase 2020. Mais par contre, on a pu montrer qu'au travers des différentes vagues, même si on avait de moins en moins de patients graves, fort heureusement... eh bien, ceux qui persistaient à avoir une forme grave avaient toujours cet intérêt vasculaire. Et donc, c'est un vrai signe de la maladie.
- Speaker #1
Ça veut dire aller en réa, mais en fait, on allait en réa et après...
- Speaker #0
Et on avait cette maladie vasculaire. Au-delà des embolies pulmonaires, on a vraiment cette maladie des petits vaisseaux qui persiste. Et donc, c'est vrai qu'au niveau thérapeutique, clairement, aujourd'hui, on doit réfléchir à des stratégies de préservation vasculaire. Ce qu'on le voit bien avec les corticoïdes, c'est flagrant. Les corticoïdes, vraiment, baissent le niveau d'activation de ces vaisseaux sanguins. Et on a des stratégies qui sont très efficaces. Et c'est grâce à ça que les corticoïdes ont fait vraiment disparaître les embolies pulmonaires du Covid.
- Speaker #1
D'accord, d'accord. Ça a été immédiatement accepté, en fait, même d'un point de vue international ? Il y a tout de suite eu des discussions ? Alors,
- Speaker #0
tout le monde, les gens qui faisaient de l'hémostase, se sont beaucoup intéressés à la pandémie. Il faut voir que le monde s'est arrêté, tout le monde. on ne s'est intéressé qu'à ça. Donc bien sûr que beaucoup de monde s'y sont intéressés. C'est retombé un petit peu, notamment quand les essais thérapeutiques avec les anticoagulants n'ont pas tous fonctionné comme ce que tout le monde avait imaginé qu'ils fonctionneraient. Mais par contre, on a beaucoup appris parce que ceux qui ont persisté, nous, on a vraiment essayé d'avoir une approche de vraie physiopathologie en parallèle de la clinique. On a l'habitude de ces approches translationnelles et on s'est rendu compte, ce qui a été confirmé dans les essais randomisés, que l'anticoagulation, que clairement il fallait mettre en place chez ces patients qui activaient la coagulation, elle était efficace surtout chez des formes plutôt modérées et qu'il fallait en fait prévenir la formation importante de ces caillots. Et que quand on venait à une phase de Covid grave, donc en Covid en réanimation, si on mettait des fortes doses d'anticoagulants, en fait on versait très vite dans le versant hémorragique. Et donc en fait les essais thérapeutiques en parallèle des essais physiopathes nous ont permis de comprendre à quel moment c'était important d'agir.
- Speaker #1
Ok, très bien. Et les corticaux là-dedans, vous venez de montrer que les corticaux agissent en limitant la réactivité vasculaire.
- Speaker #0
Tout à fait.
- Speaker #1
C'est quand même un vieux médicament.
- Speaker #0
Tout à fait.
- Speaker #1
Donc vous avez redécouvert des choses sur ce produit ? Bien sûr.
- Speaker #0
Ce qui est génial avec la pandémie, c'est que comme il a fallu comprendre cette maladie qui était très étonnante et qui est encore très étonnante, on découvre encore plein de choses sur cette infection à SARS-CoV-2, eh bien on a redécouvert un effet de ces corticoïdes, encore une fois en allant dans la recherche, en confrontant ce qu'on avait en recherche fondamentale préclinique. et ce qui se passait chez les malades. Donc vraiment, on a besoin de cette confrontation. Je crois que ça a été la preuve ces cinq dernières années que tout le monde doit se parler. La recherche fondamentale, la recherche thérapeutique, la recherche préclinique, la recherche clinique, tout ça doit être un continuum. Et c'est, je crois, ce qu'on a réussi à faire bien ces derniers mois, ces dernières années et qu'il faut qu'on continue. Après la crise, du coup. Bien sûr, après la crise, parce qu'en fait, on sait très bien qu'un jour, il y aura une autre pandémie. On ne sait juste pas quand elle sera. Ce sera peut-être un autre virus, ce ne sera peut-être pas un virus. En attendant, ce qu'on a découvert aujourd'hui va nous permettre d'avancer aussi sur d'autres maladies respiratoires. Il va falloir maintenant trouver des comparaisons entre le Covid-19 et les autres infections respiratoires. Pourquoi le SARS-CoV-2 se comporte différemment de la grippe, par exemple ? On est au début de l'histoire seulement. Et puis aussi, et ça c'est un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui, sur les conséquences au long terme de cette maladie, puisqu'on le voit bien, le Covid-Lons a concerné énormément de gens. Aujourd'hui, avec assez peu d'investissement dans la recherche sur le Covid long, et on ne peut pas laisser ces malades tomber, il faut qu'on s'intéresse à ces séquelles du Covid. Pourquoi dans le Covid-19, on a autant de patients qui ont des séquelles de la maladie, ce qu'on n'a pas ou peu avec d'autres infections virales ?
- Speaker #1
Vous avez des pistes déjà ?
- Speaker #0
On a des pistes, on a commencé à démontrer qu'en tout cas, certaines formes de Covid long, parce que j'aime bien dire qu'il n'y a pas un Covid long, il y a des Covid longs, Donc on ne peut pas mettre tous les patients, je dirais vulgairement, dans le même sac. Je crois qu'il va falloir qu'on s'intéresse à chaque symptôme. Et nous, on a pu montrer, on a deux travaux déjà publiés sur les formes respiratoires de Covid long, et on a pu montrer que, notamment, on avait certainement une persistance de la formation de vaisseaux sanguins, en tout cas d'un signal angiogénique qui persistait après la phase aiguë. C'est d'ailleurs cette recherche translationnelle qui va nous permettre de débuter dans quelques semaines un essai thérapeutique, puisqu'on va essayer de bloquer cette angiogénèse chez ces patients qui ont des séquelles respiratoires, pour voir si cette part vasculaire a un rôle vraiment en clinique, et si en bloquant ce qu'on pensait être une persistance d'un signal angiogénique, permet de réparer ce poumon qui reste malade et cette dysfonction respiratoire. On a aussi d'autres... pistes, notamment sur la fatigue, avec certainement d'autres formes de maladies vasculaires, mais aussi des maladies des neurotransmetteurs, peut-être des voies de la sérotonine. Donc on est en train d'explorer et il y a maintenant des consortiums qui sont en train de se mettre en place et j'espère qu'on va pouvoir avancer rapidement pour trouver des solutions thérapeutiques, parce qu'aujourd'hui on n'a rien à proposer à ces patients. On fait du, je dirais, presque palliatif du symptôme sans en comprendre les causes. Il va falloir qu'on réussisse à avoir des stratégies thérapeutiques. Et je reste convaincu que comme le Covid aigu était une maladie vasculaire, en tout cas, certaines formes de Covid long sont des maladies vasculaires aussi.
- Speaker #1
OK. Et par exemple, la compréhension que vous avez eue sur les corticaux, en quoi ça a modifié les protocoles ? Pendant la crise, ça a modifié ? Aujourd'hui, non,
- Speaker #0
parce qu'en fait, cette explication, on l'a eue après la pandémie. La première observation, c'est une observation de l'hiver 2020, où on s'est rendu compte que quand on a comparé les profils thrombotiques de avant et après corticoïdes, les patients ne faisaient plus d'embolie pulmonaire. Et donc, entre ça et les résultats qu'on avait eu in vitro, on s'est dit, il faut qu'on regarde. Pourquoi ? Parce que que les patients aillent mieux, ok, mais les embolies pulmonaires, ce n'était pas forcément au décours de la maladie. ... Des fois, les patients arrivaient avec leur embolie pulmonaire, donc n'avaient pas encore de corticoïdes. Et là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à comprendre sur cette activation vasculaire endothéliale.
- Speaker #1
Ok. Du coup, ça veut dire que les industriels devraient être un peu plus impliqués sur ces histoires de Covid long ? Peut-être qu'il y en a déjà qui travaillent ? Clairement, je pense qu'aujourd'hui,
- Speaker #0
en tout cas avec l'approche que nous on a dans notre équipe, clairement, le ciblage de l'endothélium, du vaisseau sanguin, doit pouvoir être exploré avec les industriels. Ce qui est hyper important aujourd'hui sur ces formes où on a des preuves, qu'on a des formes vasculaires. De la même manière qu'on a repositionné des vieux médicaments à la phase aiguë comme les corticoïdes, on doit pouvoir repositionner des médicaments à tropisme vasculaire sur du Covid long. Donc aujourd'hui, on a cet essai qui va démarrer dans quelques semaines sur le Bevacizumab qui bloque le VEGFA. Mais je pense que la compréhension de cette maladie vasculaire pourrait tout à fait nous faire essayer d'autres drogues à tropisme vasculaire. et donc l'industrie doit pouvoir... en partenariat avec de la vraie recherche préclinique, réfléchir à des stratégies de préservation vasculaire pour soigner ces patients. Donc, je pense que oui, on doit re-réfléchir, pas forcément à des nouveaux médicaments, mais à repositionner des médicaments qui auraient un tropisme vasculaire au regard de ce qu'on trouve aujourd'hui en recherche sur ces anomalies vasculaires.
- Speaker #1
Là, ce qui me vient, c'est que, par exemple, les corticaux, étant donné que c'est un vieux... produit. C'est difficile aussi d'aligner des investissements derrière de recherche sur même des pistes qui pourraient être prometteuses ?
- Speaker #0
Bien sûr. Aujourd'hui, sur le versant vasculaire, il n'y a pas que... Bien sûr, c'est corticoïdes, mais c'est difficile aujourd'hui d'expliquer à des patients, parce que les patients Covid longs, par exemple, ne sont pas inflammatoires. Donc, aller mettre des corticoïdes alors que ce sont des patients qui ne sont pas inflammatoires, je pense qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Même si les corticoïdes ont un effet d'entropisme vasculaire, je pense qu'aujourd'hui, aller dire qu'on va mettre des corticoïdes, par exemple, dans le Covid-19, n'a aucun sens. Les patients ne sont pas inflammatoires, les corticoïdes, on les a mis parce qu'ils étaient inflammatoires. Et on explique un phénomène et on a utilisé ces corticoïdes d'abord chez les formes oxygénorécurantes et on a eu l'effet surprenant sur le vaisseau. Aujourd'hui, maintenant qu'on a vraiment cette stratégie et ces résultats sur le laboratoire vasculaire, il y a d'autres stratégies thérapeutiques. On est en train d'en tester une, mais il y en a sûrement d'autres. Et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire de la préservation vasculaire.
- Speaker #1
Ok. Donc, j'imagine qu'à cette période-là, vous avez été en fait pas mal, même peut-être challengé entre la rigueur de la science et tout le monde qui attend une réponse, une solution immédiate. Exactement.
- Speaker #0
Évidemment. Non, c'est... Ça a été une période très étonnante et qui, à la fois, nous a fait prendre conscience, en tout cas, qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on communique mieux. Je pense que si on redécoupe l'histoire de la pandémie, je dirais que février-mars, on n'a pas vu le jour. On travaillait à essayer déjà de s'occuper des patients qui étaient à l'hôpital, de trouver des nouvelles stratégies thérapeutiques et aussi de faire de la recherche en version accélérée pour essayer de... de comprendre. Et pour répondre à votre question, il y a, je pense, un épisode qui nous a tous marqués, moi en tout cas, qui m'a marqué profondément. C'est la une du Parisien le 5 avril 2020. Quand on demande à la population générale « Pensez-vous que l'hydroxychloroquine soit efficace ? » Je crois que c'est dans l'histoire des médias et dans l'histoire de la science, c'est la première fois qu'on demande en une Non. d'un média généraliste, est-ce que vous croyez que ça marche ? Et là, en fait, on s'est dit, il y a un problème. Au-delà de tout ce qu'on a pu raconter, et on ne va pas refaire l'histoire de l'hydroxychloroquine aujourd'hui, ça n'a pas de sens, je pense qu'on avait aujourd'hui un système médiatique qui ne parlait que de Covid, le monde s'est arrêté, et qui du coup, on était à demander l'avis à la population générale, alors sans même les expliquer. ce qu'il fallait faire comme recherche pour que ce médicament, un jour, arrive à être utilisé dans la vie de tous les jours. Et c'est à cette époque-là que je me suis dit, là, on a un petit problème de communication. Et je crois que là, les médias sont allés un peu vite à demander à la population si on pouvait utiliser ce médicament. Et c'est aussi pour ça que je commençais à m'intéresser et à regarder ce qui se racontait un peu sur les réseaux sociaux. et notamment parce que Même si on a eu cette période où on était tous enfermés, à un moment donné, on sort de notre bulle et on se rend compte de ce que notre famille, nos amis, nous demandent sur les traitements, de ce qui peut se raconter dans les médias, dans les cercles familiaux. Et là, on se rend compte qu'en fait, tout et n'importe quoi a été raconté sans expliquer comment on générait de la donnée et comment on pouvait croire à ce qu'un médicament était efficace. D'abord, la science et la santé, ce n'est pas une croyance, en fait. La science et la santé, ça se démontre. Et la vérité scientifique, elle est évolutive. La preuve, pendant le Covid, on l'a vécue en réel. Et donc, à un moment donné, on peut croire que quelque chose est efficace, on démontre qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Mais pour que ça devienne de la routine clinique, il faut le démontrer correctement, dans des vrais essais, randomisés, en l'occurrence pour des médicaments, pour des stratégies thérapeutiques. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour reprendre cet exemple de l'hydroxychloroquine, Tous les essais bien faits, randomisés, qui ont été réalisés, aucun n'a montré le moindre effet, la moindre efficacité sur l'hydroxychloroquine. Donc aujourd'hui, il faut remettre dans le débat public, expliquer que la science, ce n'est pas une opinion. La science, la santé, ce n'est pas une opinion. On doit... Les gens doivent se rendre compte que pour utiliser un médicament, pour dire qu'il fonctionne, on doit le démontrer. On doit le démontrer dans des stratégies cliniques qui sont établies. Et il faut aussi remercier nos autorités de santé qui ont été... Quand je parle d'autorités de santé, c'est notamment nos autorités de régulation, que ce soit l'Agence du médicament européenne ou l'Agence de la FDA, puisqu'on a quand même des institutions qui ont résisté. qui ont résisté à cette explosion médiatique, notamment, et on l'a vu, c'est sûrement un point qu'on va aborder, sur la deuxième partie de la pandémie, sur les vaccins, où les vaccins qui ont été validés, qui ont été commercialisés, eh bien, c'est des vaccins qui ont été validés par l'EMA, par la FDA, qui étaient des vaccins efficaces, qui avaient été testés dans des grandes phases 3. Je pense qu'aujourd'hui, aucun vaccin n'a été testé. testés et validés aussi bien que les vaccins ARN messagers. On a eu un développement clinique remarquable, dans une phase accélérée, mais parce qu'évidemment, les institutions ne se sont occupées que de ça. L'EMA, la FDA, toute la recherche clinique en dehors du Covid était arrêtée pendant cette période. Donc c'est pour ça que c'est allé vite. Et donc, il faut expliquer aux gens, il faut expliquer aux gens que quand la FDA donne un avis sur une... une commercialisation, il y a un dossier à préparer, il y a des essais cliniques qui se font, les industriels connaissent très bien ce processus, et on a une agence européenne et une agence américaine qui ont quand même relativement bien résisté, et le vaccin, pour ne citer qu'eux, le vaccin russe, le vaccin chinois, ne sont jamais arrivés en Europe ou aux États-Unis. Alors, c'est deux exemples très différents, puisque le vaccin russe, on sait aujourd'hui... n'a jamais montré une quelconque efficacité. Le vaccin chinois, dans certaines situations, a pu montrer une efficacité, mais ne remplissait pas du tout les critères d'un vaccin qu'on pouvait diffuser correctement. Donc, je pense qu'il faut expliquer tout ça. Les institutions scientifiques, les institutions médicales doivent être expliquées au grand public, pour qu'ils comprennent que, quand on dit qu'un médicament est efficace ou ne l'est pas, il y a des vraies bases scientifiques.
- Speaker #1
J'aimerais juste qu'on s'arrête un petit peu sur ce temps de recherche qu'il y a eu quand on était en phase de Covid. La France a fait du coup des protocoles de recherche. D'autres pays aussi ont mis en place des protocoles de recherche. Il y a eu des choses plus ou moins fructueuses qui sont sorties. En tout cas, la France n'a pas trouvé de médicaments efficaces tout de suite.
- Speaker #0
Clairement, c'est vrai que si on se compare notamment à l'Angleterre, l'Angleterre a mis toutes ses forces dans un essai thérapeutique, recovery, et donc a pu publier très tôt dans la pandémie l'inefficacité de certains traitements, l'hydroxychloroquine, l'efficacité des corticoïdes. C'est l'essai anglais qui l'a démontré en premier. En France, on a un peu saupoudré les forces. Alors, on a des grands essais. On a un grand essai, en tout cas, en l'occurrence. qui est parti de la France, qui est un essai remarquable, qui est Discovery. Mais on a eu aussi énormément de petits essais thérapeutiques. Et peut-être, c'est facile de dire ça cinq ans plus tard, mais peut-être qu'on aurait pu concentrer nos forces sur certains essais thérapeutiques pour ne pas s'opoudrer et peut-être aller plus vite. Clairement, je pense que ça, c'est une leçon à avoir pour l'avenir.
- Speaker #1
Vous pensez que ça nous a fait rater des cartes de chance ?
- Speaker #0
certainement que quand on a c'est toujours la même chose que quand un grand CHU a on lui propose 10 essais thérapeutiques et qu'on prend la décision d'inclure dans 10 essais thérapeutiques forcément qu'on est moins efficace que quand tout le monde en inclut dans un essai thérapeutique donc je crois qu'on en a un qui fait consensus, qui a été ultra bien fait qui a laissé Discovery je pense que si tout le monde n'avait fait que Discovery on aurait inclus plus dans Discovery Oui, et... C'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres essais qui ont été de grande qualité en France. Mais il y a aussi eu beaucoup de petits essais qui n'ont malheureusement pas donné l'effet escompté et qui tous étaient de bonne qualité, avec des hypothèses qui étaient valables.
- Speaker #1
Ça veut dire quoi ? En fait, il faut prendre un choix ? Il faut faire un choix ? Je pense qu'il faut faire un choix.
- Speaker #0
Il faut peut-être... Renoncer aussi ? Bien sûr, renoncer. De toute façon, en science, on doit toujours renoncer de temps en temps. mais peut-être avoir une stratégie beaucoup plus concertée, notamment entre les différentes institutions qui organisent et qui font la recherche, entre l'Inserm, la PHP, les universités. Tout ce monde, en fait, doit se parler. Alors, ils se sont parlé pendant la pandémie, mais je pense qu'il faut qu'à l'avenir, on soit organisé pour que sur les Exemple de recovery, on l'a laissé anglais, que si jamais en cas de pandémie, que tout le monde puisse inclure sur une même possibilité, pour vite affirmer ou infirmer cette hypothèse, passer à autre chose. Mais je crois qu'on a une vraie vision de long terme à avoir sur l'organisation de la recherche en urgence. Alors c'est facile de dire ça en 2025, en 2020... On avait une urgence sanitaire. Tout s'est fait un peu en catastrophe. Mais je crois que tout s'est bien fait. Parce qu'il y a eu une organisation de la recherche qui était remarquable pendant la pandémie en France. Mais je pense que certainement, s'il fallait le refaire, il faudrait concentrer le nombre d'essais thérapeutiques, bien sûr.
- Speaker #1
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une réforme institutionnelle ? De la recherche d'urgence ?
- Speaker #0
Je ne sais pas si c'est une réforme institutionnelle d'urgence. Parce qu'en fait,
- Speaker #1
ils se sont parlé, ils ne se sont pas allés jusqu'au bout de réduire la voilure, ou justement d'avoir une stratégie un peu gagnante.
- Speaker #0
Je pense qu'on doit certainement envisager une refonte de comment on organise la recherche clinique en période de pandémie, pour qu'il n'y ait pas 30 décideurs. en tout cas sur l'aspect thérapeutique, et prioriser les moyens, prioriser les moyens, clairement. Il faut qu'on puisse avoir une priorisation des moyens.
- Speaker #1
C'est une histoire d'ego, de structure, de confiance ?
- Speaker #0
Je pense que c'est un peu de tout. Je pense qu'il faut être réaliste. Je pense qu'il y a la résistance à la crise, il y a bien entendu les égos... de chaque investigateur qui veut avoir son essai. C'est un mélange d'un peu tout. Je crois qu'il faut qu'on ait cette réflexion aujourd'hui. En plus, la désinformation qu'il y a autour de la science aujourd'hui nous oblige à structurer la recherche et à expliquer comment les décisions sont prises. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui passer par d'autres chemins. On doit expliquer comment les décisions sont prises, on doit expliquer comment on organise tout ça, et le grand public doit comprendre le cheminement d'un essai thérapeutique. Et pour ça, il faut que tout ça soit bien sûr organisé.
- Speaker #1
Ça s'explique aussi le choix de... Pourquoi on fait un TLC plutôt qu'un autre, et que du coup, on fait un choix ?
- Speaker #0
La recherche, c'est une question d'hypothèse. Et est-ce qu'on prend le risque de le faire ou pas ? Quand il y a de très nombreuses hypothèses qui justifient de faire un essai clinique, on ne fait jamais un essai clinique sans avoir des hypothèses très solides. Et après, c'est une question de gouvernance et de décision, clairement. Et puis de financement. Il ne faut pas oublier qu'un essai clinique bien fait, ça coûte extrêmement cher. Et donc, c'est aussi pour ça... que je pense qu'on doit réfléchir à une meilleure recentralisation des décisions autour des essais, c'est qu'il y a eu de l'argent dépensé dans le Covid, et qu'on doit éviter à l'avenir le saupoudrage. Il faut des grands consortiums qui puissent centraliser les moyens publics et privés.
- Speaker #1
Oui, c'est ça, ma question c'est, est-ce que l'industrie pharmaceutique rentre dans ces champs de décision ?
- Speaker #0
Alors, dans les champs de décision, l'industrie pharmaceutique fait des essais thérapeutiques. En urgence ? En urgence, bien entendu. Il y a eu des essais thérapeutiques, il y a la recherche institutionnelle. Je crois qu'il ne faut pas séparer la recherche institutionnelle de la recherche de l'industrie. Il faut laisser la main aux universitaires pour organiser la recherche clinique, c'est clair. Mais il faut faire ça en bonne intelligence avec l'industrie pharmaceutique. Et il faut qu'il puisse y avoir des allers-retours et des discussions entre l'industrie et les investigateurs dans les centres hospitaliers.
- Speaker #1
J'aimerais... Merci beaucoup parce que c'est vrai que même si on ne peut pas refaire l'histoire, c'est toujours important aussi d'être capable de dire si je dois faire quelque chose de différent, qu'est-ce que ce serait ? L'exercice n'est pas simple.
- Speaker #0
C'est communiquer. On va sûrement reparler de communication au grand public, mais aussi communication... entre institutions et partenaires privés. Oui, j'aimerais revenir sur le vaccin, les premiers vaccins qui sont sortis. Vous, du coup, vous avez travaillé aussi sur les données de tolérance.
- Speaker #1
Pas tout à fait données de tolérance, je vais vous expliquer.
- Speaker #0
Données de pharmacovigilance ?
- Speaker #1
De pharmacovigilance. En fait, c'est vrai que moi, je fais de l'hémostase, donc je m'attendais, début 2021... à pouvoir retourner à mes sujets de recherche. Et effectivement, le vaccin est arrivé. Mais ça a changé votre vie. Et ça a effectivement un peu changé ma vie. Donc en fait, début 2021, les vaccins arrivent et on a un signal début mars sur des potentielles thromboses. Et donc, dès qu'il y a ce signal, la cellule de pharmacovigilance de l'OMS me contacte pour analyser tous les premiers cas, milliers de cas. de thrombose qui avaient été retrouvées dans cette période, dans le suivi des patients après vaccination. C'est à nous, comme on avait beaucoup publié et beaucoup expliqué les phénomènes thrombotiques de la Covid-19, c'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à nous. Et donc, on a épluché en un temps record tous les cas qui avaient été déclarés à la cellule de pharmacovigilance de l'OMS. Et on a pu montrer que pour ce qui est des vaccins ARN, Il n'y avait absolument pas de signal d'un risque thrombotique, qu'il soit veineux ou artériel, avec pour le risque veineux, qu'on connaît bien dans l'équipe, même une fréquence d'événements thrombotiques veineux déclarés qui était en dessous de ce qu'on pouvait attendre en population générale quand on rapportait au nombre de patients vaccinés dans tous les pays qui avaient déclaré des cas. donc clairement c'est C'est ce risque thrombotique qui n'existait pas sur les ARN messagers. Ça a été retrouvé après dans des études cliniques, dans des registres. Donc on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sur-risque thrombotique. On avait vu dans cette première analyse qu'il y avait certainement des cas de thrombose qui étaient un peu étonnants, mais sur le nombre de cas, on ne pouvait pas en dire grand-chose sur les vaccins post-AstraZeneca. Et au même moment, on a les premiers cas qui ont été décrits et on avait eu le premier cas français à étudier. de thrombose post-vaccin AstraZeneca. Et ces thromboses post-vaccin AstraZeneca n'étaient pas du tout dues à la vaccination anti-SARS-CoV-2, puisque c'était des vaccins très efficaces pour immuniser contre le SARS-CoV-2, mais étaient dues à la manière de fabriquer le vaccin. C'était un vecteur adénovirus, et c'est ce vecteur-là qui induisait la formation d'anticorps qu'on connaît bien en hémostase, puisque c'était les mêmes anticorps qui provoquent la thrombopénie induite à l'héparine. C'est ces anticorps anti-PF4 qu'on a étudiés maintenant de manière extrêmement approfondie. La différence avec la thrombopénie à l'héparine, qu'on appelle TIH, c'est que ces anticorps apparaissaient sans exposition à l'héparine, mais entraînaient à la fois une thrombose et une thrombopénie. Ça vous a permis de comprendre aussi ? On a compris très vite. La recherche internationale s'est encore une fois très vite mobilisée autour de ces thromboses post-AstraZeneca. Et on a très vite pu mettre en place des stratégies thérapeutiques appropriées. Le vaccin AstraZeneca aujourd'hui n'est plus utilisé pour vacciner contre le SARS-CoV-2. Et ça a ouvert tout un pan de recherche. Puisqu'aujourd'hui, on a pu découvrir qu'il y avait une maladie auto-immune à auto-anticorps anti-PF4, indépendamment de l'héparine, indépendamment du SARS-CoV-2 et de la vaccination anti-SARS-CoV-2. et donc... On a encore là, une fois, un exemple que la recherche est toujours utile, puisque cette recherche qu'on a faite dans les mois qui suivent l'instauration du vaccin nous a permis de comprendre pourquoi certains patients avaient des thromboses qu'on n'expliquait pas avant la pandémie. Et aujourd'hui, on sait qu'on a une vraie entité à anticorps anti-PF4 de patients qui thrombosent. Donc ça, c'est vraiment la démonstration que cette recherche je... La clinique, elle est utile. Et pour revenir à la vaccination, du coup, travailler sur ces épisodes thrombotiques post-vaccination, alors là, pour le coup, c'est là, à cette période, que je me suis rendu compte, grandeur nature, de la désinformation et de la folie qui régnait autour de la vaccination, puisque dire qu'il n'y avait pas de thrombose post-vaccin C'était quasiment un crime sur certains réseaux sociaux. Et surtout, on a vu arriver sur les réseaux sociaux énormément de fake news, énormément de choses complètement abracadabrantesques sur de potentiels effets thrombotiques du vaccin, avec tous les complots imaginables derrière les stratégies vaccinales. Et ça, ça a commencé en 2021. Et en vrai, ça ne s'est pas fait. jamais arrêté. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des énormes communautés mobilisées sur les réseaux sociaux, sur des stratégies anti-vax, et en France, on est pour le coup là, très fort là-dessus. On voit bien qu'en France, ça a des conséquences désastreuses en termes d'opinion sur la santé publique, sur les stratégies vaccinales, sur les campagnes de vaccination qu'on a du mal à faire décoller aujourd'hui. Puisqu'on a, je pense, laissé faire en 2021-2022, l'idée que les vaccins pouvaient cacher des effets secondaires. Et ça, je trouve qu'il faut s'y attaquer. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à laisser grandir cette désinformation en santé. On a ça sur les vaccins, mais je pense qu'il faut s'y intéresser dans la science en général.
- Speaker #0
Du coup, c'est lié en fait à cette balance bénéfice-risque ? Ou là encore, c'est même pire que ça ? Ah non, là c'est pire que ça,
- Speaker #1
puisque là vraiment on invente dans les fake news, dans la désinformation. Et puis aujourd'hui, c'est en plus accéléré avec l'IA qui est accessible à tous pour tout le monde, ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, ça permet de générer du contenu complètement erroné, complètement faux, qui paraît plus vrai que nature sur des données scientifiques. Et maintenant, on a en plus un peu de recul. On sait que des messages convaincants sur les réseaux sociaux, notamment de plus de 100 mots, permettent de convaincre une audience incroyable par rapport à des petits messages. Et là, maintenant, on a la création de ce qu'on appelle des deepfakes, de choses complètement créées par l'intelligence artificielle et qui permettent de faire croire à des pseudo-vérités. Il faut qu'on lutte vraiment tous, la communauté scientifique, médicale. Il va falloir lutter, il va falloir mettre des moyens Pour lutter contre cette désinformation, ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, ça fait partie de notre environnement. Mais pour lutter contre cette désinformation, qui s'est mise en place beaucoup pendant les vaccins, ce n'est pas nouveau, la désinformation, ça a toujours existé. Mais elle s'est, je dirais, structurée pendant la pandémie. Et aujourd'hui, il faut pouvoir lutter contre cette désinformation pour la population générale, mais aussi et surtout pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont très vite accès à... aux réseaux sociaux, alors que je crois qu'il ne faut plus vraiment appeler des réseaux sociaux, c'est devenu des vrais médias aujourd'hui, et ces nouveaux médias, il va falloir que les pouvoirs publics, que les institutions scientifiques prennent conscience qu'on doit communiquer, on doit jouer avec ces algorithmes, les institutions publiques de la santé, de la science, doivent envoyer des messages d'explication sur ce que c'est la science, comment on découvre un médicament. comment on fait un protocole de recherche, comment un médicament arrive sur le comptoir d'une pharmacie, comment un médicament est dit efficace ou non efficace. Tout ça doit être expliqué au grand public. On doit prévenir, on doit éduquer nos enfants à ça, mais on doit aussi éduquer toute la société. Il y a un vrai programme d'éducation à la santé, mais aussi aux médias, et on doit tous en prendre conscience, et on doit tous être acteurs de ça.
- Speaker #0
Vous, vous l'aviez vu venir ? Comment vous étiez dedans ? Alors,
- Speaker #1
avant la pandémie, clairement... Vous ne faisiez pas gaffe à ça ? Je ne faisais pas gaffe à ça. Et puis, au-delà de ça, il faut faire son mea culpa, je ne me sentais pas concerné. Je ne me sentais pas concerné par ça. C'est vrai que nous, scientifiques... Vous étiez chercheur,
- Speaker #0
médecin dans votre...
- Speaker #1
Mais si vous voulez, nous, on a une stratégie de publication. On publie dans des revues internationales. Finalement... C'est ça,
- Speaker #0
bien faire son travail.
- Speaker #1
Avant la pandémie, c'était ça, bien faire son travail. On communiquait au grand public très peu, souvent. Puis on savait faire ça moyennement, il faut être honnête. Il faut avouer. Mais voilà, ce n'est pas notre métier. On était super contents quand on faisait un super article. On réfléchissait à la suite, qu'elle soit de la recherche fondamentale ou de la recherche clinique. Mais notre première idée, c'était pas il faut qu'on communique. Et ça, il faut que ça change.
- Speaker #0
Et vous, vous avez communiqué pendant le Covid, par exemple ?
- Speaker #1
Alors très peu, au début de la pandémie, honnêtement. Et plus la pandémie a avancé, plus je me suis rendu compte qu'il fallait communiquer. Aujourd'hui, mais encore une fois, c'est facile de refaire l'histoire, je pense que c'était une erreur de ne pas communiquer dès le début de la pandémie. Et je me suis réveillé quand j'ai vu à quel point les fausses informations circulaient. Je pense que c'était trop tard. En tout cas, à titre individuel, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience institutionnelle, gouvernementale, sur cette désinformation. Bien sûr qu'il faut que chacun individuellement... On prenne le temps d'expliquer, de communiquer, mais il faut surtout que ça vienne d'en haut. Il faut que les gouvernements, que les ministères organisent des stratégies de communication. Il faut que nous, dans nos centres de recherche, on ait des vraies stratégies de communication globales, sur les réseaux sociaux, pour le grand public. Tout le monde doit jouer sa part là-dedans. Et clairement, c'est quelque chose, jamais j'aurais tenu un discours comme ça avant 2020. pour être honnête, jamais et je crois qu'aujourd'hui ça doit faire partie de notre job on peut pas faire comme s'il y a comme si les réseaux sociaux n'existaient pas parce qu'une information mal interprétée mal comprise, mal expliquée et bien elle va faire le nid bien sûr donc il faut qu'on s'y mette tous mais il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience collective et collective
- Speaker #0
Oui.
- Speaker #1
Parce que tout seul, de toute façon, les algorithmes de tous ces nouveaux médias, ils sont faits de telle sorte que quelqu'un tout seul dans son coin, s'il n'a pas une énorme communauté derrière, c'est très difficile de faire passer des messages. Donc je pense que pour tourner l'algorithme à son avantage, il faut que ce soit des choses organisées, il faut que ce soit étatique. Quand on est chercheur hospitalier ou universitaire, on dépend d'une autorité de santé, d'une autorité d'enseignement supérieur. il faut qu'on ait des messages de santé publique. sur TikTok, sur Instagram. Quand on regarde... Je travaille beaucoup sur ces questions aujourd'hui avec Nathalie Sonnac, qui est professeure d'information et de communication à l'université d'Assas. Et quand on regarde comment s'informent les jeunes générations, ils s'informent sur TikTok et Instagram. Ensuite vient YouTube et Twitter, mais ça reste TikTok et Instagram. Il faut qu'aujourd'hui, on ait des stratégies de communication sur TikTok. C'est indispensable. On ne peut pas laisser les réseaux sociaux que aux désinformateurs.
- Speaker #0
Je voyais, vous expliquez dans un papier que les scientifiques quittent X Twitter.
- Speaker #1
C'est une énorme erreur pour moi.
- Speaker #0
Pour des raisons...
- Speaker #1
Pour moi, c'est une erreur parce que ce n'est pas parce que nous, la bien-pensance, on quitte Twitter parce que vraiment, ce n'est pas bien. Et je ne suis pas en train de dire que ce que fait Elon Musk et ce qui est fait sur Twitter est bien. Pas du tout. mais aujourd'hui C'est un des premiers médias au monde. Il faut comprendre ce que c'est la puissance. Bien sûr, et si on laisse Twitter, mais n'importe quel autre média, aux mains des désinformateurs, mais en fait, on n'arrivera jamais à prêcher la bonne parole. Et on ne pourra jamais, c'est bien de se plaindre de l'algorithme, mais si on ne participe pas à ce que l'algorithme puisse promouvoir la science, et la vraie science, et la santé, et la santé publique, On n'y arrivera jamais. Et je pense qu'on ne doit pas louper le coche, post-pandémie, de l'information, de l'explication scientifique, de l'éducation à la science, de l'éducation aux médias. Tout le monde doit prendre conscience de ce que sont devenus les médias, ces nouveaux médias, non pas pour lutter contre ça. C'est merveilleux. Notre époque est merveilleuse. On peut diffuser des informations, on peut s'informer en temps réel de tas de choses. Il faut juste comprendre que le monde a changé, qu'on est en 2025, avec des outils qui sont différents, des outils de communication qui sont différents. Et nous, scientifiques, hospitalo-universitaires, on ne peut pas passer à côté de cette révolution. Ça a changé,
- Speaker #0
je pense, depuis les cinq ans, les cinq dernières années, ça commence vraiment à changer. Il y a des médecins qui prennent un peu leur bâton. Bien sûr, bien sûr,
- Speaker #1
ça commence à changer. Il y a plein de gens, et puis même pendant la pandémie, il y a des gens incroyables qui ont lutté contre ça. Oh, yeah, yeah. Je peux en citer quelques-uns, Mathieu Mollimard, Nathan Pessor-Simadja, Jérôme Barrière, qui ont beaucoup œuvré pour que la désinformation s'arrête, ou pour au moins expliquer certains phénomènes scientifiques médicaux. Mais aujourd'hui, ça ne doit pas être le travail de quelques individus. Aujourd'hui, il faut que ce soit une décision nationale, européenne. Il faut qu'au niveau européen, on réussisse à comprendre qu'on doit communiquer sur... sur la recherche en santé et juste sur la santé publique. Et ça doit recommencer dès le plus jeune âge. On doit pouvoir, les enfants, dès l'école primaire, leur expliquer comment un médicament arrive sur le comptoir d'une pharmacie. Je pense qu'il faut l'expliquer avec des mots simples à tous les âges, pour tout niveau socio-économique, culturel, il faut réussir à expliquer. Il faut que les gens reprennent confiance dans les professionnels de santé. La pandémie pour ça a été révélateur de quelque chose qui certainement était latent depuis plusieurs années.
- Speaker #0
Une attente, oui, c'est ça, un besoin aussi de comprendre ce qui est légitime. Il y a un besoin de comprendre. Parce que ça reste quand même des secteurs aussi hyper techniques, hyper complexes. Donc, il y a un côté, c'est aussi normal que ce sont des profils qui ne sont pas forcément des communicants qui font ce genre de métier en plus. Bien sûr,
- Speaker #1
on doit avoir des communicants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les centres de recherche devraient avoir un communicant. Parce que là, aujourd'hui, on le fait tous de notre côté. Nous, le directeur du centre de recherche auquel j'appartiens fait ça extrêmement bien. C'est la communique sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. Donc, on est en train de s'organiser, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, quand on fait ça, parce que ça prend quand même un peu de temps, quand on fait ça, on n'est pas dans notre service hospitalier ou dans notre labo de recherche. Ça prend du temps. C'est un temps qui est indispensable, mais il faut l'accompagner. Et aujourd'hui, oui, je crois que tous les grands centres de recherche, devrait avoir des community managers à l'avenir. Et aussi dingue que ça puisse paraître, parce que si on m'avait dit il y a 5-6 ans que je dirais ça, je dirais mais David, arrête. Et non, je crois qu'aujourd'hui c'est indispensable, même pour le rayonnement scientifique en fait, pour aller chercher des financements. Et on parlait tout à l'heure des liens qu'il doit y avoir entre le public et le privé. Je pense qu'il y a énormément de choses incroyables qui se font dans les centres de recherche qui ne sont pas forcément connues. aussi des industriels et que communiquer, non seulement permet d'expliquer au grand public ce qu'on fait avec l'argent public, mais permettra peut-être aussi d'attirer des industriels et des fonds privés dans nos centres de recherche pour aller plus vite, pour encore plus... pouvoir aller plus vite sur nos projets de recherche, pouvoir avoir d'autres projets de recherche à visée thérapeutique. Et je pense que tout le monde sera gagnant. Mais c'est un nouveau métier. Et ça n'existait pas dans notre vie... tous les jours avant 2020.
- Speaker #0
Bien sûr, c'est un nouveau levier de promotion, de démarchage, de création de liens aussi. Pourquoi ça n'a pas été fait aussi ? Parce que c'est des sujets qui sont souvent aussi complexes, un peu difficiles d'accès.
- Speaker #1
Je ne sais pas si c'est qu'une histoire de complexité, c'était juste pas dans notre logiciel en fait. On a déjà des emplois du temps euh... compliqué, on a plusieurs casquettes. On a la casquette d'enseignant, on a la casquette de chercheur, on a la casquette d'hospitalier, en tout cas pour les hospitaliers ou universitaires. Si en plus, il faut avoir la casquette community manager, ça devient difficile, en fait. Puis c'est un vrai métier, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et puis on l'a vu pendant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé à tort et à travers. On devrait avoir le droit de parler de ce qu'on connaît vraiment. Et donc, Donc... Je pense qu'il y a des nouvelles règles dans cette nouvelle partie de notre métier. Il y a des règles à avoir. Il y a une éthique à avoir de communication. Mais ça doit faire partie de notre métier, je pense, dans les années à venir. Il faut qu'on prenne l'habitude, quand on fait un papier, de toujours avoir... de réussir à savoir l'expliquer avec des mots simples, pour le communiquer. nos recherches, elles sont faites... La plupart du temps, dans nos hôpitaux, nos centres de recherche, beaucoup avec de l'argent public, ça me paraît normal d'expliquer au grand public ce qu'on a fait avec de l'argent public.
- Speaker #0
Et si on devait retenir... Peut-être trois apprentissages durables de ces cinq dernières années ? Il y aurait ça là-dedans ? Il faut apprendre à communiquer ?
- Speaker #1
Clairement. Il faut être réactif. Je pense qu'il faut savoir être réactif. Il faut bien sûr apprendre à communiquer.
- Speaker #0
Être réactif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire...
- Speaker #1
Réactif, savoir...
- Speaker #0
Dans la communication ou dans l'action ? Non,
- Speaker #1
dans l'action scientifique et médicale.
- Speaker #0
Ça a été fait quand même, non ?
- Speaker #1
Bien sûr, ça a été fait. Mais je pense qu'il faut que ce soit généralisé. Tout le monde doit apprendre à être réactif. dans nos routines qu'on a tous. Bien sûr que ça a été fait, mais je pense qu'il faut que ça devienne un réflexe de santé publique. Vraiment. Pour toutes les spécialités, pour tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné quand il y a une crise sanitaire. Donc vraiment, la réactivité, ça doit faire partie de l'essence de notre métier. Bien sûr, la communication, évidemment. hum hum Réactivité, communication et le troisième, je redirais communication, mais la communication entre spécialités, entre disciplines. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à être transversal. On l'a vu pendant la Covid-19. Moi, je fais de l'hémostase. J'ai longtemps travaillé sur l'hémostase, la Covid-19, le vaccin. c'est que très tardivement que j'ai échangé de manière importante et scientifique et quotidienne avec des infectiologues. Nous, dans notre équipe, on a beaucoup travaillé, parce qu'on est déjà une équipe multidisciplinaire avec des réanimateurs, des pneumologues, des hémostasiens, des biologistes, des chirurgiens. Donc on avait cette vision multidisciplinaire dans mon équipe, mais qui est un microcosme, je dirais. Mais à l'échelle plus globale, il faut que les différentes spécialités puissent se parler plus. et qu'on ait beaucoup plus de projets transdisciplinaires. Très clairement, je pense qu'on aurait gagné à plus parler entre différentes spécialités et disciplines dès février 2020. Tout le monde est un peu resté dans son couloir, et ça c'est quelque chose qu'on a appris, et bien entendu qui a été réparé depuis, mais je pense qu'il faut qu'on ait ce côté transdisciplinaire de manière beaucoup plus importante. avec la réactivité et la communication, bien entendu.
- Speaker #0
Ok. Parce qu'en fait, c'est des interlocuteurs avec qui vous n'étiez pas forcément en contact, que vous ne connaissiez pas, donc c'est aussi un peu le rôle d'une communication externe d'être capable de reboucler vers l'interne. Exactement, vous voyez que tout est lié, en fait.
- Speaker #1
Et bien sûr que si on communiquait un peu mieux, on aurait sûrement parlé un peu plus tôt. Juste d'opportunité, oui. Évidemment. On aurait perdu tout.
- Speaker #0
Non,
- Speaker #1
mais... Donc c'est vrai que la communication ouvre tout ce champ-là. Quand on fait connaître son travail, eh bien, bien sûr qu'on pourra mieux avancer. Mais bon, après, je pense sur le point de désinformation, si on revient sur le point de désinformation, il y a une vraie stratégie à avoir de communication pour le grand public. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence, je pense, de santé publique. Et donc, on doit apprendre à communiquer à titre individuel, à titre institutionnel pour le grand public. Et on doit, en plus de cette communication, mettre en place une vraie éducation aux médias et à la science dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, mais aussi, notamment dans les écoles de journalisme. Avant, on avait des journalistes très spécialisés dans chaque domaine. Aujourd'hui, un journaliste est ultra... je dirais presque omniscient, s'occupe de plein de thématiques différentes. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus d'interaction avec les écoles de journalisme pour cette éducation aux institutions scientifiques, notamment, mais aussi à la science, que tout le monde puisse avoir des bases de ce que c'est de la recherche scientifique, comment marche la recherche médicale, comment on organise un protocole de recherche clinique. On doit l'enseigner aux écoles de journalisme, vraiment. Je pense que c'est un point important.
- Speaker #0
Après, si ça a été supprimé, c'est certainement parce que tout le monde doit être un peu une petite casquette.
- Speaker #1
Je pense qu'il faut repenser à notre modèle économique, mais il y a aussi notre modèle social et sociétal. Aujourd'hui, on doit informer le grand public le plus justement possible. Donc nous, en tant qu'acteurs et professionnels de santé, en tant que chercheurs, mais Les professionnels de l'information aussi doivent avoir un minimum de base technique sur les institutions pour participer. C'est eux les acteurs de la communication réellement. Et donc je pense qu'il faut que, notamment sur l'organisation de nos institutions, il faut que ce soit des choses qui soient connues. Et si on réussit à faire cette éducation aux médias, à la science, à la santé dès le plus jeune âge, à infuser chez les professionnels de la communication et de l'information, peut-être qu'on arrivera, je ne dirais pas à endiguer la désinformation, parce que ça a toujours existé, mais à se réapproprier l'espace public. Je pense qu'on s'est rendu compte pendant cette pandémie que l'information et la santé, c'est des biens démocratiques. C'est des biens démocratiques et on ne peut pas laisser faire n'importe quoi avec la démocratie. avec l'accès aux soins, l'accès à la science. Et aujourd'hui, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, sont quand même une source de troubles à l'ordre public, de troubles à la démocratie qui sont importants. À côté, encore une fois, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, pas du tout. À côté des choses extraordinaires qu'elles apportent. Mais il faut qu'on réussisse à utiliser ces outils. pour que la population générale ait confiance, ait confiance de la même manière qu'il faut que la population ait confiance en sa justice, il faut qu'elle ait confiance en sa santé, il faut qu'elle ait confiance en ses instituts de recherche, et ça, il faut qu'on fasse le job. Et ces industries, bien entendu, il faut rétablir, je dirais, oui, la confiance de la population dans tous les acteurs de la santé et de la science.
- Speaker #0
Plutôt que l'aide des sciences, oui.
- Speaker #1
Bien sûr. Il faut répondre à la défiance générale qui existe aujourd'hui.
- Speaker #0
Qui exprime aussi quelque chose, peut-être. Bien sûr, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
- Speaker #1
Avant 2020, je ne me suis jamais dit, « David, quand tu fais un papier, dépêche-toi de l'expliquer. » Jamais. Alors, des fois, quand on en faisait un très beau, on se disait, « Bon, il faut qu'on communique un peu. » Mais ce n'était pas dans notre logiciel. En tout cas, moi, ce n'était pas dans le mien. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut plus faire. Comme si on ne savait pas que se raconter tout et n'importe quoi. Et en plus, je pense qu'on a un vrai devoir de... Il faut qu'on redonne l'information qu'on génère, beaucoup avec de l'argent public. On doit pouvoir expliquer au grand public ce qu'on fait.
- Speaker #0
Oui, parce qu'il y a forcément des choix, il y a des renoncements, il y a des parties prises, des stratégies.
- Speaker #1
On est très libre dans nos sujets de recherche. On va chercher des crédits publics, privés. On doit pouvoir expliquer. ce qu'on fait dans nos projets et en quoi ça a fait avancer la science et la santé publique.
- Speaker #0
Vous avez aussi parlé d'une citation qui est « la science, c'est du temps long même dans l'urgence » . Donc ça, c'est quelque chose que…
- Speaker #1
C'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens.
- Speaker #0
Qu'on garde en tête que… C'est vrai que le chercheur a toujours tendance à dire que la conclusion, soit elle va venir ou elle arrive ou elle…
- Speaker #1
Mais quand on arrive à une conclusion… Il faut savoir l'expliquer. Et respecter le temps long aussi. Mais bien sûr qu'il faut le respecter.
- Speaker #0
Et l'expliquer peut-être aussi, du coup.
- Speaker #1
Expliquer le temps long. Je me rappellerai toujours, vous savez, il y a eu le premier, et c'est drôle parce que vraiment, c'était incompris, les appels d'offres flash Covid de l'ANR, qui étaient tout début mars 2020. On avait tous, il y a eu plein de projets qui ont été sélectionnés. Et donc, la sélection de ces projets a été publiée, c'était un samedi matin. Dans la journée, j'ai assailli de coups de téléphone de gens qui voulaient que je leur raconte tout ce que... Donc j'avais eu cet appel d'offre FlashCovid, et dans la journée, plein d'appels de téléphone. Expliquez-moi ce que vous faites, c'est quoi les résultats ? Je dis mais attendez, je n'ai rien à vous dire, je viens d'être financé.
- Speaker #0
Un protocole.
- Speaker #1
Et justement, le travail va pouvoir commencer. Et donc aujourd'hui, j'ai rien à vous dire. Mais si, si, si, vous allez nous parler ? Non. Laissez-nous travailler, en fait. Et après, on pourra raconter. Bon, dans les faits, on n'a sûrement pas assez raconté. Mais cet exemple était très drôle. C'est que vraiment, ce samedi, le téléphone n'a fait que sonner en disant, il faut qu'on sache, il faut qu'on sache. Mais non, mais il faut qu'on bosse, en fait. Mais c'était une époque où il y avait des gens à la télé toute la journée qui allaient raconter, qu'on allait traiter comme ci, comme ça. Et on aurait tous dû rester à bosser. Mais pour faire comprendre aux gens qu'on doit bosser, Il faut qu'ils comprennent ce qu'on fait.
- Speaker #0
Vous m'avez expliqué que vous avez été auditionné par le ministère de la Santé sur ces questions. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Qu'est-ce que vous leur suggérez de faire ?
- Speaker #1
Nous, on a des propositions qu'on a publiées il y a un peu plus d'un an avec Nathalie Sonnac. Il y a, on va dire, trois points. C'est un peu ce qu'on vient de discuter. Il y a vraiment trois points qui ressortent du travail qu'on a fait avec Nathalie Sonnac. Le premier, c'est vraiment renforcer l'éducation aux médias et à la santé dès le plus jeune âge et à tous les acteurs qui communiquent, dont les écoles de journalisme. Donc vraiment renforcer que cette éducation aux médias qui existe déjà à minima soit renforcée et que l'éducation à la santé fasse partie d'un socle des choses qui doivent être infusées dès le plus jeune âge. pour que... Tous nos enfants, nos adolescents connaissent les règles de comment on fait la science, comment on organise la santé. Nos institutions de santé, par exemple, ne sont jamais enseignées à l'école, au collège, au lycée. Non mais personne n'étudie. Et des fois même par certains professionnels de santé, nos institutions ne sont pas bien comprises. Donc je pense qu'il faut qu'on explique à la population générale, dès l'enfance, comment fonctionnent nos institutions de santé. Donc ça, ce premier point, c'est vraiment éducation. Le deuxième point, c'est un point, je dirais presque réglementaire. On a un règlement européen, on a le Digital Service Act, qui a été mis en place il y a deux ans ou trois ans, et qui est en vrai assez peu mis en place. Les plateformes jouent moyennement le jeu. On a tous reçu dans la... Pendant la pandémie, des menaces de mort, étaient intimidés, etc. On a à peu près tous porté plainte et il ne s'est rien passé. Et je pense que tant qu'on ne peut pas, si je dis que le vaccin ARN ne fait pas thromboser et que je reçois une menace de mort parce que j'ai dit ça, pourquoi est-ce qu'il y aurait une impunité totale ? Et ça, il va falloir que ça change. Donc il y a vraiment ce point de sanction. Et encore une fois, il n'est pas du tout question de... Régulation, c'est pas de la censure. Non, c'est de la régulation. Il n'est pas question de limiter la liberté d'expression. Pas du tout. Mais à un moment donné, il n'y a pas de raison que ce qui est... Quand on légifère dans la vie de tous les jours... Bien sûr, exactement. Donc il faut que les gens, lorsqu'ils dépassent... les limites de l'acceptable soient... Notamment, il y a un point, c'est-à-dire l'anonymisation de tous ces comptes, de tous ces bots, il faut qu'on puisse avoir les identités sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir réussir à mettre en place, mais de manière concrète. Et le troisième point... C'est mettre en place cette communication, la communication à titre individuel, donc des chercheurs, de tous les universitaires, des chercheurs, mais aussi la communication étatique, gouvernementale. Il faut qu'on ait des influenceurs TikTok de la science. Il faut qu'on ait des gens qui expliquent ce que les instituts de recherche font sur TikTok. Donc il y a le stade centre de recherche, mais il y a le stade gouvernemental. Il faut qu'on ait des influenceurs gouvernementaux. Là, l'hiver commence, on a les campagnes de vaccination. On devrait avoir des messages en boucle sur les réseaux sociaux, sur la vaccination. Aujourd'hui, les quelques personnes qui essayent de promouvoir la vaccination sur les réseaux sociaux, notamment, on pense à certains, un ancien ministre de la Santé qui s'est mis en photo sur Twitter en train de se faire vacciner, allez regarder ce qu'il y a en dessous de son tweet. C'est hallucinant, cette haine déclenchée par un essai de promotion de la vaccination. Et donc on doit communiquer. Il faut que quand on ouvre Twitter, quand on ouvre TikTok, quand on ouvre Instagram, on ait des tas de messages qui nous disent « allez vous faire vacciner » , qui expliquent la santé publique, des messages redondants qui eux aussi utilisent l'algorithme à leur avantage. Et donc, vraiment, ce point de communication, il doit être pris en compte au niveau national, au niveau européen. Il n'y a pas que la désinformation qui doit pulluler sur les réseaux sociaux. On sait très bien, et ça, c'est des travaux qui datent même d'avant le Covid, il y avait un très beau papier en 2018 qui expliquait comment une fausse vérité était diffusée beaucoup plus vite qu'une vérité. Mais il faut qu'on le tourne à notre avantage. Mais ça, pour ça, il faut que les institutions, les gouvernements puissent investir et qu'on joue avec les règles de 2025.
- Speaker #0
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage qui donne un peu de vertige.
- Speaker #1
Non, je pense qu'à travers ça, il faut être optimiste. Il faut avoir un message d'optimisme. Bien sûr que ça peut faire peur, mais aujourd'hui, c'est devant nous et nos enfants nous reprocheront de ne rien faire. Aujourd'hui, il faut agir. Alors on n'est pas forcément formé à ça, on n'a pas forcément l'habitude de ça, mais d'un autre côté, le monde a tellement changé en 20 ans, on a tous dans notre poche aujourd'hui un ordinateur plus puissant que l'ordinateur qu'on utilisait il y a 20 ans, mais le monde il a changé, donc adopte-nous à ce nouveau monde. Moi je suis assez plutôt optimiste, mais il faut bosser, il faut bosser et il faut que surtout il y ait des décisions au-dessus de nous, pour que tout ce que les gens font au niveau individuel puisse être... appuyé par l'État.
- Speaker #0
Merci de nous partager qu'Excellence scientifique doit aussi rencontrer un engagement citoyen. Je pense. On doit passer à une autre manière de faire, une autre dimension. Merci de nous avoir éclairé sur les défis d'innovation scientifique. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre PharmaMinds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. A très bientôt !
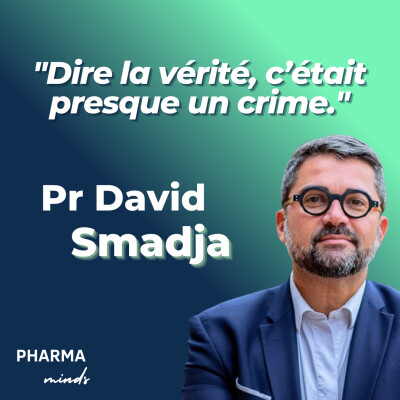

![[EXTRAIT] Automatiser pour mieux soigner : quand la robotisation sécurise la chaîne du médicament cover](https://image.ausha.co/yBNPltZFC58R9pR2DhKoekWs8fek6IpQb5oE8shf_400x400.jpeg)
![[EXTRAIT] Hydroxychloroquine : pourquoi la science n’est pas une opinion cover](https://image.ausha.co/7t207nA3WKOOLr1j3nsslMedWRKSE6r5RnCmjBqR_400x400.jpeg)
