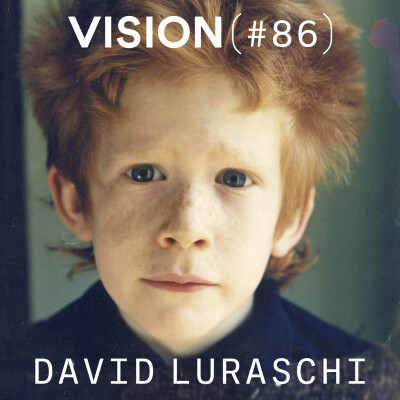Speaker #0La scène qui, pour moi, dans le film, représente d'une certaine manière un peu mon rapport au cinéma, c'est celle où Tuda est assise sur le lit de sa chambre d'hôtel à Casa et qu'elle répète une haïta. Et on est dans un moment très fragile de la fiction et assez écrit. Elle est dans sa solitude, on est dans son intime avec elle, et d'un seul coup, il y a l'appel à la prière qui résonne, pour de vrai, dehors. Et là, je me retrouve devant un choix auquel j'ai été confronté finalement assez souvent dans mon cinéma, savoir qu'est-ce que je fais du réel. Est-ce que je le transforme ? Est-ce que je m'en empare ? Est-ce que je le mets à distance ? pour arrêter, recommencer, retourner la scène et rester dans la fiction. Et finalement, je décide de continuer. Et l'actrice, connaissant mon cinéma et sentant ce que j'attendais, Nisrine, elle aussi s'en empare et essaie de trouver sa tonalité. D'abord, de lutter contre l'appel à la prière en continuant à chanter, ce qui est hautement subversif, parce que dans l'islam, quand l'appel à la prière retentit, il faut s'arrêter de tout faire, mais en général, surtout de chanter. et de lutter et puis à un moment de rencontrer la prière dans la tonalité et de rebondir dessus et de joindre les deux, de créer un lien avec le sacré à travers la musique. Et c'est très très beau. Et moi qui ai toujours fait du cinéma très emprunt du réel, en tout cas partant du réel pour raconter une histoire, je trouve que d'un point de vue en tout cas symbolique, cette scène pourrait être attachée à ce rapport au cinéma. Parce que le cinéma a toujours été des choix, acteur professionnel, acteur non professionnel, des situations extrêmement réalistes, fictionalisées, etc. Qu'on voit dans Alizawa, qu'on voit dans Oéfort, qu'on voit dans certains de mes films. Je ne la refais pas du tout, parce que j'ai l'arme aux yeux. Je trouve que la proposition de Nisrine est tellement belle, tellement juste, inattendue, surprenante et en même temps, me percute au cœur. que je me dis que ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. D'abord, il me faut un peu de temps pour m'en remettre, et puis ensuite, on passe à autre chose. Mon cinéma est fait de ça, c'est-à-dire est fait de plans ou de scènes que je refais 90 fois ou que je ne fais qu'une fois. C'est vrai que je peux m'obstiner, m'acharner pendant très longtemps, mais je peux aussi, à un moment, avoir un truc qu'on... Donc j'ai le sentiment d'avoir touché du doigt. Je dis bien le sentiment. Et puis, une fois que c'est fait, il ne faut pas essayer d'être dans la reproduction, d'aller chercher mieux ou autre chose. Si on l'a, on l'a. Je m'appelle Nabil Ayoush. Je fais des films. J'ai commencé à réaliser mon premier court-métrage. 92, ça s'appelait les pierres bleues du désert. A l'époque j'habitais à Paris et j'étais à la recherche d'un jeune marocain de 14-15 ans pour interpréter le héros du film et une amie comédienne qui vient de mourir d'ailleurs me conseille d'aller en banlieue parisienne à Trappes. Moi je m'étais extirpé du 9-5, du Val d'Oise pour aller à Paris et puis là... Je redescends à Ezeveline et j'arrive à Trappes pour assister à un match d'impro et je rencontre ce gamin dont elle m'avait parlé, qui ne s'appelait jamais Debouze, qui avait 14-15 ans et j'ai un coup de foudre. Et donc je l'entraîne avec moi dans une reconquête identitaire, d'une identité qu'on ne m'avait jamais apprise, qui est ma part de Maroc. Et ce qui est beau, c'est que ça passe par l'œil de la caméra. par aussi une descente profonde en apnée dans les territoires sauvages d'un Maroc que l'IOT appelait le Maroc inutile à l'époque qui est pour moi le plus beau et le Maroc des campagnes des montagnes où on va très très peu souvent il se trouve aussi que c'était sa région d'origine sa famille donc on va à Tiznit taroudante, afraoute, des villes qui ne vous disent probablement rien, mais en tout cas qui sont des villes qui m'attirent. Et cette reconquête identitaire, elle s'opère petit à petit avec une âme marocaine, un ADN marocain que j'apprends à connaître dans sa diversité, à aimer, et qui m'inspire encore aujourd'hui profondément. Donc je décide quelques années plus tard de m'installer à Casablanca. Et de tourner mon deuxième long métrage, mon premier s'appelle Mektoub, c'est un road movie policier, un peu dans la même veine que les Pervélus du désert, c'est vraiment une traversée du pays, à travers un couple dont le regard se transforme au fur et à mesure qu'ils font cette traversée, le regard sur l'un et l'autre, à l'intérieur du couple, mais le regard également sur le pays, donc un couple un peu déconnecté aussi. Et le deuxième, c'est Alisa Wang, des enfants de la rue. le film fondateur de ma relation avec ce pays, puisque c'est là où je me suis posé, j'ai posé mes valises, je ne savais pas pour combien de temps à l'époque, et là, ça fait 25 ans, j'y suis encore. Je n'ai pas au début le sentiment que l'image va forcément être la voie d'expression pour moi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin d'une voie d'expression. Ce qui m'y amène à ce besoin viscéral, c'est le sentiment de n'appartenir à aucun groupe, aucune communauté, aucun sous-ensemble. C'est le fait de grandir à Sarcelles, dans une ville très communautariste, où je suis moitié français, moitié marocain, moitié juif, moitié musulman, école laïque, républicaine, et me sentir un petit peu... perdu parce qu'à cet âge là c'est compliqué et on porte ça un peu comme un fardeau là où ensuite on comprend que c'est une richesse et là le truc qui me sauve c'est le forum des Cholèdes, c'est cet MJC qui existait à l'époque qui malheureusement a été fermé en 99 l'année où j'ai quitté la France pour aller au Maroc et avec la promesse des autorités qu'elle allait rouvrir et elle n'a jamais rouvert Et là, dans cet MJC, c'est des fenêtres sur le monde qui s'ouvrent sur moi, c'est un point de vue politique, un regard qui s'est construit à travers les arts, la pratique et l'exposition aux œuvres, notamment aux films. La pratique, c'est la chorale, le théâtre, les claquettes, tout ça, des mondes parallèles qui s'ouvrent. Et la confrontation aux œuvres, c'est... pas au Forum des Cholettes, c'est dans une annexe de la MJC qui se trouve dans le vieux Sarcelles, parce qu'il y avait le Sarcelles qu'on appelait Sarcelles-Lochère, le Sarcelles nouveau, date des années 60, et puis il y avait le vieux Sarcelles, qui est le village d'origine, là-bas il y avait une annexe et il passait des films, des cycles souvent, de cinéma. Et comme à l'époque on faisait partie de ce qu'on appelait la banlieue rouge, il y avait souvent des mères communistes et c'était le cas à l'époque à Sarcelles. Les cycles de cinéma qui passaient, c'était Eisenstein, Chaplin, Buster Keaton parfois, je me rappelle quand on voulait amuser aussi les foules. Mais en tout cas, c'est un cinéma très conscientisé, ouvrier, militant, sur des problématiques liées au travail, liées à l'engagement social, liées souvent d'ailleurs à des immigrés européens qui étaient arrivés aux Etats-Unis, portés par toutes ces thématiques. Et donc je m'éveille au monde et au cinéma à travers ces cycles cinématographiques, sans savoir véritablement quel impact ça aurait sur moi, jusqu'au moment où ma mère se remarie et il y a une forme d'élévation sociale, on est sorti de notre banlieue pour aller à la capitale. Et là je suis monté, je suis arrivé dans le quartier latin et là je découvre le grand monde, les lumières de la ville de Paris, un peu comme Touda, vous voyez, de son village à son mot, jusqu'à Casa, la ville lumière, mais à moi c'était Paris. Les lumières, on les voyait à Sarcelles, parce qu'on n'est pas très loin, on est à 20 km, mais comme d'hab, on a l'impression que c'est tout près, qu'on peut les toucher du doigt, mais en fait, c'est très très compliqué, parce qu'on sait quand on y va, et puis à minuit, les trains s'arrêtent, arrive Gare du Nord, c'est terminé, donc il faut dormir sur le quai en attendant 5h30, train du lendemain, et donc c'était tout inéquipé d'aller à Paris. Donc au moment où on s'y installe, pour moi, c'est quand même une vraie bascule. Et là, je commence... à m'ennuyer profondément dans mes études. Et à un moment, une copine, dans le lycée catholique où je passais mon bac, la recroix Saint-Léon, qui en terminale me dit Je prends des cours de théâtre avec une nana super qui s'appelle Sarah Boréo, viens voir, accompagne-moi un jour parce que tu verras, c'est génial. Et donc, comme j'avais fréquenté cet MJC et déjà pris des cours de théâtre à Sarcelles, je me dis Pourquoi pas, on va prolonger le truc. Et là, je rencontre cette femme. qui est mort il y a quelques années, mais effectivement assez exceptionnel, et qui me dit, il faut vraiment que tu guérisses des blessures, et pour ça, il n'y a pas de choix, il faut que tu montes sur une scène. Et donc j'ai fait l'acteur pendant trois ans, avec Sarah, puis ensuite avec Michel Granval, un récipient dans le cinquième, et j'ai essayé d'aller au-delà de toute pudeur, et de me raconter à travers le jeu. Et je me suis assez vite rendu compte que d'abord, J'avais trop de pudeur pour me mettre à nu et que la scène de théâtre était trop pétriquée par rapport à ces envies de grands espaces et de conquêtes identitaires qu'on ne m'avait jamais apprises dont je vous parlais. Donc à un moment, il se trouve que parallèlement je faisais des stages sur des tournages de pubs, parce que mon père avait une agence de pubs, et je tirais les cabs, je portais les caisses, j'amenais les cafés, enfin je voyais comment se passait un tournage, j'étais assistant d'assistant. Et puis je passe un jour au Hall, devant une expo d'un mec qui s'appelle Jean Véram. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jean Véram, c'est un artiste qui peint des bouts de désert dans le monde, des rochers dans le désert. Et puis je rentre dans cette expo, et puis déjà en moi germait l'idée de raconter une histoire en lien avec ces questionnements identitaires. Et là, je vois d'immenses bouts de déserts peints en bleu partout dans le monde, et notamment au Maroc, à Tafraout. Et je dis au mec de l'expo, mais ça c'est vrai ou c'est des trucs... Il me dit non, non, c'est vrai, ça existe. Je lui dis, il faut que j'aille voir ça. Donc je prends l'avion, je vais au Maroc, je vais à Tafraout, et je vois effectivement, bim, ce immense rocher blanc bleu. Et là, je me mets à écrire ce court-métrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune et mon père est retourné vivre au Maroc. Moi je suis resté vivre avec ma mère en France, qui est française donc, et j'allais au Maroc trois fois par an en fait pour les vacances, pour aller voir mon père. Ça signifie que quand vous grandissez en France avec un prénom comme le mien et que quand on vous dit t'es quoi et tu réponds je suis français, mais non t'es pas français, tu t'appelles Nabil, t'es quoi ? Bah mon père est marocain. Et c'est comment le Maroc ? et que vous n'êtes pas capable de répondre, parce que la seule chose que vous connaissez, c'est que Casablanca est un peu faise, la ville d'origine de mes parents, il y a un moment où ces questions, elles résonnent et vous vous rendez compte que vous êtes vraiment à moitié marocain. Et donc, vous avez envie de savoir C'est comment le Maroc ? Et comme mes voyages pendant les vacances ne me faisaient pas sortir des circuits des grandes villes, je me suis dit qu'il y a une autre manière d'en sortir et d'apprendre comment c'est le Maroc et comment... ça a pu phosphorer en moi intérieurement, inconsciemment pendant toutes ces années, c'est le cinéma, c'est l'œil de la caméra. C'est aller à la rencontre de ces lieux et de ces personnes, parce qu'assez vite ma première passion c'est devenu l'être humain, à travers l'œil de la caméra et apprendre à raconter des histoires à travers ces personnes qui se trouvent en plus, intuitivement rejoint mon sentiment de marginalisation. dans la société, du fait que j'habitais là où j'habitais à Sarcelles et de me sentir un peu un outsider un peu partout, en tout cas vu comme quelqu'un d'un peu différent on va dire. Et donc j'ai eu une propension et un attrait très rapidement, très fort aussi pour des gens un peu à la marge, cette fois-ci au Maroc, qu'on veut cacher, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. C'est vraiment cette rencontre entre un imaginaire collectif très puissant au Maroc, mais qui ne passe pas par le cinéma. qui passe par la tradition orale, les contes, les histoires qu'on raconte sur les places publiques, les fêtes foraines avec les danseurs, les danseuses. La musique, la danse a un rôle très important dans la société marocaine. C'est la profondeur historique. de tous ces récits épiques qui ont construit un des États-nations les plus anciens du monde, avec plein de cultures différentes et d'influences différentes, confronté à ce médium qui est le cinéma, qui est un art nouveau, qui est un art que j'ai donc appris à regarder quand j'étais gamin, et qui m'a donné des influences occidentales. Donc comment avec ces influences-là, parce que je n'ai pas grandi avec le cinéma égyptien ou arabe ou autre, Comment, avec ces influences-là, j'arrive dans ce pays que je ne connais pas, je rencontre cette tradition, cet inconscient populaire-là, et les deux se mélangent et donnent naissance à des films forcément singuliers et propres à ce parcours de vie et à ces rencontres d'influence. Et surtout avec un sentiment que, parce que je n'ai pas grandi au Maroc, parce que je n'ai pas grandi à l'ère de Hassan II, parce que les années... plomb, une ère politique très dure, vraiment à beaucoup de mes collègues, avec ce sentiment aussi très fort que je garde en moi, que je peux escalader n'importe quelle montagne, et que je peux raconter n'importe quel récit. C'est-à-dire dans une inconscience totale des tabous sociétaux, politiques, religieux ou autres. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on a pu souvent me le reprocher aux parents, dire mais attends, toi, tu as des films, des sujets qu'on ne veut pas entendre, et comment tu te tu te permets ça, etc. Et je n'ai jamais été capable pendant longtemps de répondre à cette question. Moi, c'est quelque chose de très naturel. Là où, pour mes collègues, ayant grandi sous le joug de ces années de plomb, c'était des réflexes absolument impossibles. Vous voyez ? Il y avait une forme d'autocensure terrible. Moi, je n'ai pas connu l'autocensure. J'ai connu une autocensure de l'intime, pendant un moment, jusqu'à ce que ça sorte et jusqu'à ce que... Voilà, j'étais incapable de me raconter. Mais à partir du moment... où j'ai été capable de franchir le pas et de me raconter, pour moi, le grand monde, il devait se raconter aussi, à travers ce prisme de lecture, sans tabou, sans frein. Il y a quelque chose qui se révèle à travers ce premier court-métrage, oui. Et en même temps, pas du tout à ce moment-là la certitude que ça y est, j'ai définitivement trouvé ma voie. Non, je suis encore complètement dans le questionnement, à la fois sur ma voie d'expression, je fais encore des allers-retours avec le théâtre et le spectacle vivant, et sur aussi l'espace géographique dans lequel je vais pouvoir m'exprimer. Donc, ce n'est pas avant, mais après ce court-métrage. que je fais un deuxième court métrage qui est une espèce d'exercice de style tourné dans un studio au Maroc où vraiment je vais aller chercher le travail avec la caméra et les acteurs et un troisième court métrage, cette fois-ci à Paris avec des acteurs français Jamel refait une apparition dedans mais le rôle principal c'est essentiellement un acteur qui s'appelle Pascal Demolon je sais pas si vous voyez Donc à ce moment-là, je me dis, ça se trouve, je vais faire du cinéma. Et ça se trouve, je vais faire du cinéma au Maroc. Mais ça se trouve, je vais en faire en France aussi ou ailleurs. Donc je n'ai pas encore cet ancrage. Ça, on est en 1994. Et c'est vraiment après avoir tourné Mektoub en 1996-1997 que je me dis, non, ce pays, je l'aime vraiment. il m'inspire terriblement et je vais faire un deuxième long métrage qui va se passer là-bas avec des enfants de la rue parce qu'entre temps j'ai rencontré une pédiatre qui dirigeait une fondation qui travaille avec les enfants de la rue et qui m'a dit à partir du moment où ton regard est juste et tu les prends pas comme des victimes oui je vais t'aider on va le faire mais il faut que tu passes deux ans dans la rue et j'ai dit banco c'est exactement ce que je compte faire ne pas les prendre pour des victimes mais comme des enfants comme les autres qui ont des rêves... Mais voilà, la vie a fait que. Et donc, j'ai passé deux ans dans la rue, matin, midi et soir, à Casa, à Meknes, à Fès, à Marrakech, à Tangier. Et pour ça, il fallait que je sois au Maroc. Donc, j'ai déménagé. Ce dont je me rends compte au fur et à mesure que je commence à faire du cinéma, c'est l'aspect anthropologique de mon travail. C'est ce par quoi j'ai commencé au début avec les Pires Bleues, avec Mektoub, avec Alizawa, etc. qui se prolonge chaque fois, c'est-à-dire une nécessité de connaître l'humain, de rencontrer la problématique sous tous ses contours, d'entendre, d'écouter des témoignages, d'aller à rencontrer des lieux également, et de comprendre toute la dimension sociologique du sujet. Et ensuite de faire rentrer la mise en scène. et ensuite de faire entrer le cinéma. Quand je fais Les Chevaux de Dieu, d'abord, avant de faire Les Chevaux de Dieu, je tourne des documentaires pour le microcrédit, des fondations de microcrédit à Sidney Moorman, donc dans cette banlieue de Casa. d'où sont partis les terroristes qui ont commis les attentats du 16 mai 2003 au milieu des années 90 95, 96 je fais des docus là-bas dans les bidonvilles de Sidney Moorman. Je retourne à Sidney Moorman en 99 pour tourner les 10 premières minutes d'Alizawa je sais pas si vous avez vu le film, au début du film il y a un gamin qui prend une pierre et qui meurt, c'est vraiment ce qui lance l'histoire du film et c'est sur la colline la plus haute de Gaza et elle est à Sidney Moorman Et trois ans plus tard, il y a les attentats du 16 mai 2003 qui sont un véritable traumatisme pour nous, pour le Maroc, parce que ça touche justement à notre diversité culturelle et ça va aller taper des lieux juifs, chrétiens, enfin vraiment des lieux qui... Et là, c'est un choc pour moi parce que je me dis mais je connais ce quartier par cœur et ça, je ne l'ai pas vu venir. Donc je fais un documentaire sur les victimes des attentats du 16 mai, ceux qui ont perdu un proche, une vie, un bras, je vais à la rencontre et je fais un docu de 15-20 minutes. Et il me faut 7 ans, 8 ans pour digérer et comprendre, donc un chemin de vie où j'habitais au Maroc, digérer et comprendre qu'en fait les victimes dans cette histoire, elles sont des deux côtés. C'est pas simplement les gens qui sont morts ou qui ont perdu un proche, c'est aussi des jeunes qu'on a embrigadés, et là où l'État a cessé de faire son travail, des intégristes sont venus et ont fini le job, comme on dit. Alors on remplit le cerveau des marchands de rêve. et en brigadier au point où ils ont été commettre des réparables, c'est-à-dire tuer des innocents et se faire sauter avec eux. Et là je me dis, ok, j'ai besoin de comprendre comment un enfant de 10 ans peut se transformer en bombe humaine. Et donc je plante ma tente à Cédy Moumen, et là je fais un travail avec les jeunes du quartier, un peu comme des éducateurs, je vais écouter ces jeunes dans les assos... peu d'assos qui existent à l'époque, on va jouer au foot, je traverse les bidonvilles, je vais à la rencontre des gens et comme j'avais grandi à Sarcelles, j'avais les codes donc je me sentais très en sécurité là-bas. Et je leur demande de me raconter les récits de leurs camarades parce qu'ils connaissaient tous un ou plusieurs kamikazes et voilà comment ça s'est passé, comment ils ont pu se transformer. Et là ils me racontent leur réalité, leur quotidien, ils m'amènent dans les lieux et puis tu vois là avant il y avait un... terrain de sport, maintenant ils l'ont rasé, ils ont construit une barre d'immeubles, là il y avait un local où on faisait du théâtre, ce truc-là n'existait plus à partir de telle année, et là je refais le fil des événements, et à un moment je me dis ok, maintenant je vais écrire. Et entre-temps je lis un roman qui raconte l'histoire que j'ai envie de raconter, donc avec Jamel Belmahi, le scénariste, je lui dis écoute, on va arrêter l'écriture du scénario, parce que... Ça y est, on est plein, toi et moi, et je l'avais lui aussi envoyé là-bas. Il se trouve que ce roman raconte déjà cette histoire, donc on va l'adapter. C'est un roman écrit par Mahi Binbin qui s'appelle Les étoiles de Sidney Mouman qui raconte comment des gamins que l'État a oublié, que l'école a oublié, que le système de santé a oublié, que les parents et la famille ont oublié, à un moment se retrouvent rattrapés par des types qui viennent leur promettre un avenir meilleur ailleurs. Et cet ailleurs c'est l'au-delà. Il se trouve qu'il y a... Après ce travail sociologique, anthropologique, à un moment il y a un scénario qui s'écrit et une manière d'aborder l'histoire que je veux raconter. Et cette manière me donne une distance par rapport au réel que je choisis d'avoir. Et en fonction de la distance que je choisis d'avoir, je vais soit aller vers une écriture très réaliste, caméra à épaules, portée, fragile, type Much Loved ou type Haut et Fort, ou je vais au contraire décider de m'excirper de ce réel pour m'y appuyer, certes, mais raconter une fiction totale. qui peut être d'ailleurs avec des comédiens professionnels ou même non professionnels. Cheval de Dieu, les quatre héros sont des acteurs non professionnels. Il se trouve qu'ils sont devenus pour certains entre temps des acteurs professionnels, mais ils n'avaient jamais joué de leur vie, c'était des gamins de CD-MOMEN. Mais là, je prends un peu de recul, un peu de distance par rapport au réel, je fais un pas de côté et là je décide de remettre du cinéma et de la mise en scène, comme dans Touda par exemple. avant tout, qui est un film character driven comme disent les Américains, mais qui est un film avant tout de mise en scène, comme peut l'être Les Chevaux de Dieu ou comme peut l'être Asia ou Alizawa à une autre échelle, mais en tout cas c'est vraiment un film de mise en scène Je fais pas des films sur des sujets je l'ai jamais fait Je fais des films, encore une fois, sur des personnages, des rencontres avec des personnages, des rencontres avec des lieux parfois, mais souvent des personnages. Je ne me réveille pas un matin en me disant allez, je vais parler de la prostitution, des enfants de la rue jamais. Jamais, j'en ai pas conscience en plus, et j'ai pas envie d'en avoir conscience. Je veux au contraire faire tout, sauf du cinéma à thème, ou du cinéma sur des sujets. Après, il se trouve que je suis parfois rattrapé par ça, et... Malheureusement parfois les sujets prennent le pas sur ce que je veux raconter mais c'est pas mon désir de cinéma et je cherche au contraire à m'en extirper. Et Much Loved c'est pareil, c'est-à-dire qu'un jour il y a mon directeur de casting qui m'appelle, je sortais des chevaux de Dieu et qui me dit il y a quatre filles à Marrakech qui m'ont appelé et qui veulent te parler. De quoi elles veulent me parler ? Écoute, c'est des prostituées, elles disent qu'elles veulent parler à quelqu'un et que tu es la seule personne à qui elles peuvent parler. Alors, elles avaient vu Les Chevaux de Dieu, visiblement, Alizawa, et mon cinéma devait les intéresser pour une raison ou une autre, et elles devaient se sentir à une proximité avec la manière dont je traitais mes sujets, j'en sais rien. Donc je prends ma voiture, je vais à Marrakech, et je passe deux jours à les écouter et à pleurer, par les récits de vie qu'elles me racontent, et en rentrant à Gaza, sur la route du retour. J'ai une espèce de rage, de boule qui monte dans le ventre et je me dis qu'il n'y a absolument rien d'autre que je puisse faire à part raconter leur histoire. C'est vraiment comme une envie de chier, il faut que ça sorte. C'est aussi bête que ça. C'est qu'à un moment, la rencontre avec ces personnes, ces personnages, souvent, parce que mon cinéma est un cinéma, encore une fois, qui parle de rencontre et du réel, est à l'origine la naissance d'une envie de fiction, d'écriture. Et quand ça atteint un moment où ça va déborder, il faut que ça sorte. Le processus d'écriture se met en place, bien sûr, Par contre, le processus de travail sur le réel, en prise avec le réel, continue. Il ne s'arrête pas. Les deux se font en parallèle. Everybody Loves You, ça part d'une rencontre, pas de rencontre aussi précise que sur Much Loved, de rencontre d'abord avec des Ausha que j'ai mises en scène en 1999 au spectacle d'ouverture du temps du Maroc en France Ausha de Versailles, devant des centaines de personnes, j'éteins toutes les lumières et je commence ce spectacle dans la salle des batailles, deux Ausha qui sont chacune, je ne sais pas si vous connaissez la salle des batailles, c'est 110 mètres, c'est un couloir. Il y en a une qui est à chacune un bout du couloir et tout est éteint. Et ça commence par un cri, une haïta. Et puis un grand silence, les invités se demandent ce qui se passe. Et puis ensuite il y a une deuxième haïta. Et puis la scène centrale s'éclaire et le spectacle démarre. Ça c'est ma première rencontre avec les Ausha. Et puis ensuite, elles hantent mes films. Les chevaux de Dieu, la maman d'un des protagonistes est une Ausha, ce qui l'oblige à fuir le bidonville à cause du regard des autres. Arasia se termine avec une scène chez les riches où Nishirah se fait malmener. Donc c'est des femmes que j'observe à distance depuis de nombreuses années et avec une espèce d'admiration très forte pour ce qu'elles ont apporté au récit collectif marocain et en même temps un sentiment d'injustice tout aussi fort sur le traitement qui leur est réservé aujourd'hui et donc la promesse. que je me fais un jour de faire un film qui sera consacré à l'une d'entre elles. Et quand je sors d'Adam, le premier long métrage de Mariam, je revois Nisrine que j'ai connue dix ans avant. Je la revois transformée, je la revois aussi puissante qu'elle est, sans concession. Je me dis, et Mariam me le dit aussi très vite, que ça peut être qu'elle qui va interpréter Sorin. J'avais cette connaissance des Ausha déjà, et puis je rencontre beaucoup d'autres Ausha, et j'entends leurs histoires intimes, leurs récits, et je trouve aussi des liens entre les unes et les autres, et à partir de là, il y a une histoire qui commence à se former, et qu'on démarre, Mariam et moi, en écriture, oui, assez rapidement, en parallèle de ces rencontres. D'abord, il y a cette envie de retour aux sources, parce que depuis Mektoub, depuis ce qui m'a amené à m'installer au Maroc, j'ai été bar tourné dans ce Maroc profond. J'ai fait un cinéma emprunt d'urbanité. Et beaucoup Casa, comme vous dites, Marrakech dans Much Love, mais sinon beaucoup Casa, qui est la ville où je vis et qui est la ville qui me passionne chaque jour. Et là, j'ai eu une envie de me faire un shoot de Maroc profond très fort, qui est remonté, de me rappeler pourquoi j'aimais ce pays et pourquoi j'avais décidé d'y poser mes bagages, et donc de commencer l'histoire là-bas, avant qu'elle arrive à Casa, et de refaire, comme je disais, un peu le chemin que j'ai fait dans ma vraie vie, de mon petit bled, de ma petite banlieue à Casa, à la ville lumière, c'était Paris. Donc il y a ce retour aux origines, et puis il y a aussi une volonté de faire du personnage de Touda un personnage très influencé par la nature. Parce que la nature, le rapport aux saisons, à la pluie, on vit au rythme de ça au Maroc. Le Maroc est un pays agricole. Et donc j'ai décidé de filmer ce rapport à la nature qui fait partie des vraies respirations de Touda dans sa vie, au moment où elle reprend sa respiration avant de retourner dans le tambour de la machine à laver, mais de la filmer dans un temps vrai, véritable, et donc en l'occurrence de tourner en un an, en quatre fois, interrompant chaque fois le tournage pour attendre la saison d'après. Je voulais que dans le film, on puisse percevoir et ressentir. ce rapport, cette nature qui se transforme. Mes équipes n'y ont pas cru au début. Ils m'ont dit, ce n'est pas possible. Ce que tu nous décris là, ce n'est pas possible. Techniquement, on n'y arrivera pas. Je leur ai dit, ce n'est pas une histoire technique. Je ne cherche pas. l'exploit technique. L'exploit technique au cinéma ne m'intéresse pas. Au contraire, il me fait fuir. Ce que je cherche, c'est à pas briser l'émotion de mon actrice. Et là, il y a huit minutes pendant lesquelles on va vivre une espèce de parabole de ce qu'elle traverse dans le film. Sauf que la redescente dans l'ascenseur, je veux qu'elle traverse tous ces sentiments-là dans leur profondeur. Donc si elle n'a pas vécu... tout ce chemin avant dans le plan, elle ne pourra pas me le donner. Donc si je dis cut toutes les 30 secondes pour passer au plan suivant, ça n'arrivera pas. Comprenez ça. Ok, on comprend, on t'accompagne, mais ça va être très compliqué. Et c'était très compliqué parce qu'on démarre sur un gros plan de portière dans la rue, et puis elle sort, et puis elle se retrouve dans le hall de l'hôtel, et puis dans ce couloir qui l'amène à l'ascenseur, et là-haut, une trentaine d'étages plus haut, de nouveau... pied d'un escalier qu'elle doit grimper, puis backstage, et puis sur une scène où elle chante deux chansons, et puis ensuite elle doit refaire le chemin à l'inverse. Donc c'était six plateaux différents, c'était 80 techniciens, 150 figurants, et on n'avait qu'une nuit pour la tournée, parce qu'il n'y avait que cette nuit-là où la tour pouvait nous permettre de tourner. Donc on a répété pendant trois mois sur des scènes de théâtre, on est allé avec l'équipe technique pour repérer les lieux, pour changer les cabines d'ascenseur, pour essayer de trouver un chemin. On a emprunté tous les chemins de la tour, c'est la tour infernale, pour arriver à trouver le bon chemin. Et le jour même, on est arrivé, il était midi, on devait tourner à 18h et commencer à tourner vers 19h. Et chaque fois qu'on faisait une prise, il y avait évidemment, j'ai envie de dire, un truc qui ne marchait pas. Parce que ça ne peut pas marcher du début à la fin. C'est pas possible. Il y a toujours soit un truc technique, un signal qui ne passe plus d'un étage à l'autre. un truc de son, une perche qui rentre dans le truc, de figurants qui évidemment ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, ou d'acteurs secondaires qui ont un lien avec l'actrice qui n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire avec son texte, ou qui est mal positionné, ou de caméras, d'axes, de cadrages, ou d'actrices, parce que ce n'est pas un robot non plus, donc il y a des fois où ça ne marche pas même. À minuit, on s'arrête pour faire un pause repas et on devait avoir fait 5-6 prises ou 7 prises, je ne sais plus. Et je me dis qu'effectivement, ils avaient raison. Ça n'est pas possible. Je ne l'ai pas. Je crois qu'il n'y a aucune prise, on est arrivé au bout. C'est après la pause dîner qu'on commence à faire des prises en entier et arriver au bout. Non, non, c'est costaud. Et je me dis, bon, on va essayer, mais sinon, on revient demain et puis on le découpe. Je vais pleurer toute la nuit, mais on le découpe. Et puis on reprend et là on réessaye, on réessaye et on n'y arrive pas. On y arrive plus, mais il y a toujours un truc qui ne va pas. Et les dernières prises, on se rapproche. Et puis il est 6h ou 6h30 du matin, on a une journée de 18h déjà dans les pattes. Et là, on se retrouve dehors et il commence à pleuvoir. Et j'ai dit à l'équipe, on a un parapluie pour l'actrice, pour donner un portier. On joue la pluie, quoi. On tourne parce que là, il commence à pleuvoir de plus en plus. Et puis on tourne et elle sort du taxi, une goutte qui tombe sur sa joue, elle se relève, elle regarde le ciel, et elle rentre, et là, ça devient opératique. Je me retrouve comme un chorégraphe, avec un truc que j'ai mis en place, un ballet où tout trouve sa place, naturellement, chacun, chacune, avec l'énergie du désespoir et la fatigue, et non, évidemment, et le sentiment qui commence à faire jour, et qui commence à pleuvoir, et que c'est la dernière prise. Et il y a le miracle qui s'opère. Et quand elle monte sur scène, je commence à y croire très très fort. Et là, quand on redescend à l'ascenseur, je me dis que ça va être puissant. Je ne sais pas comment, mais ça va être puissant. Et c'est là où elle traverse toutes ces expressions. Et là, je me dis ça y est, le film doit s'arrêter là. On rentre chez nous. Le processus de création est illisible. Illisible. J'aimerais vous dire, oui, mais en même temps, des fois, au contraire, je me dis il ne faut surtout pas que je reprenne ce qui existe dans le réel, il faut que je m'en nourrisse, mais il faut que ça passe par 36 000 tamis pour que ça m'intéresse et que ça intéresse la fiction. Mais il arrive aussi, parfois, certainement, je n'ai pas d'exemple en tête, que, bien sûr, en ayant côtoyé pendant deux ans le réel, Tous ces récits de vie, j'en tire des mots, des phrases, des moments, des situations. Mais j'ai l'impression quand même que pour que ça marche, cette histoire et cette envie de cinéma, pour qu'elle perdure et pour qu'elle ne s'assèche pas, il y a une distance qui est nécessaire dans le processus. J'ai l'impression que sinon ce serait trop simple. Voilà, sinon je ferais du documentaire et je me contenterais de retranscrire le réel tel qu'il est. J'ai l'impression que ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie de continuer, c'est d'être nourri. par ces personnes, que je rencontre, mais à un moment d'être capable de m'isoler, seul ou avec ma femme, avec Mariam, et de m'enfermer dans ma solitude, ou dans notre solitude à deux, et de se dire maintenant on écrit, maintenant on y va. Cette volonté de créer quelque chose de singulier en tout cas, et qui me ressemble surtout. Sinon ça me... J'ai l'impression d'être en permanence rattrapé par qui je suis, par mon parcours, et que c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc c'est de naïvement ou inconsciemment laisser les rencontres et le réel se faire rattraper par mon histoire personnelle, par mes angoisses, par ce qui me hante, par ce qui... me bouleverse, parce qu'il me choque, parce qu'il m'inspire, parce que ça a jalonné une vie et un parcours. Voilà, donc il faut qu'Infine, oui, il faut que ça ressemble à rien, que ce soit unique.