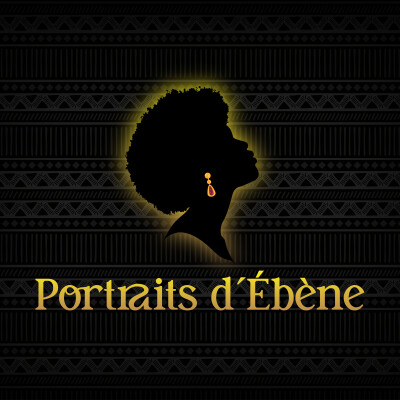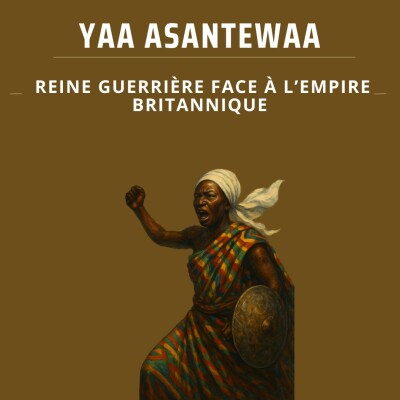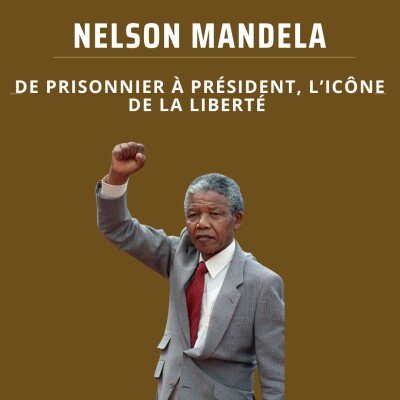Speaker #07 août 1970, une alerte se déclenche dans tout le pays. Sur les panneaux d'affichage, dans les journaux, aux infos télévisées, un seul visage, celui d'une femme recherchée par le FBI, Angela Davis. Mille ans révolutionnaire, communiste, accusée de complicité de meurtre. Pour les autorités, elle est une criminelle, une menace pour l'ordre établi. Mais pour des milliers de militants aux Etats-Unis et à travers le monde, elle est une figure de la résistance, un symbole de la lutte contre l'oppression raciale, et sociale. La traque commence. Les agents fédéraux fouillent les motels, quadrillent les campus, interrogent ses proches. Angela Davis, elle, est en fuite. Elle sait ce qui l'attend si elle tombe entre les mains du gouvernement. Elle sait qu'ils veulent faire d'elle un exemple. La peur, elle l'a connue toute sa vie. Mais la peur n'a jamais eu raison d'elle. Parce que Angela Davis ne s'est jamais cachée. Elle s'est toujours battue. Mais avant de comprendre comment cette brillante intellectuelle est devenue l'ennemi public numéro 1, Il faut revenir dix ans en arrière, dans une Amérique en pleine mutation, où le rêve d'égalité se heurte encore à la brutalité du racisme institutionnalisé. Mais avant de plonger dans son histoire, je me dois de remercier tous ceux qui s'abonnent et qui suivent la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela me fait vraiment plaisir. Alors si connaître l'histoire des héros noirs qui ont marqué notre histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et partager les épisodes. C'est grâce à vous que je continue à faire vivre ces récits. Angela Davis naît le 26 janvier 1944 à Birmingham, en Alabama, un des États les plus racistes du Sud. Son quartier, surnommé Dynamite Hill, est régulièrement la cible d'attentats du Ku Klux Klan. Des bombes explosent, des maisons brûlent, des familles noires vivent dans la terreur. Dès son plus jeune âge, Angela est confrontée à la brutalité du racisme. Les bombes qui explosent dans son quartier ne sont pas seulement des menaces abstraites, elles sont une réalité brutale qui rythme son quotidien. Son père garde une arme en permanence pour protéger sa famille. Sa mère, elle, lui enseigne la force du savoir et de l'organisation politique. La ségrégation est omniprésente. Les écoles, les transports, les commerces, les espaces publics sont rigoureusement divisés entre blancs et noirs. Angela comprend vite qu'elle appartient à une classe de citoyens considérée comme inférieure. Mais elle ne l'accepte pas. Dans ce climat oppressant, elle se distingue très tôt par son intelligence et son envie d'apprendre. Elle dévore les livres que sa mère lui apporte et développe une conscience politique précoce. Elle pose des questions, elle observe, elle analyse. Pourquoi certains privilèges sont réservés aux Blancs ? Pourquoi la police est plus prompte à réprimer qu'à protéger les Noirs ? Pourquoi tant de silence face à l'injustice ? Malgré l'hostilité qui l'entoure, Angela excelle dans ses études. Elle est déterminée à s'instruire, non seulement pour elle, mais aussi pour lutter contre l'oppression. Son ambition ? Comprendre le système pour mieux le démanteler. À 14 ans, elle quitte Birmingham pour étudier à New York grâce à une bourse. Son départ est un tournant. Dans le Nord, la ségrégation est moins visible, mais le racisme reste latent. Elle intègre une école progressiste où elle rencontre de jeunes blancs engagés, des intellectuels juifs, des militants communistes. Pour la première fois, elle est entourée de personnes qui réfléchissent à un changement social radical. C'est dans ce contexte qu'Angela découvre les idées marxistes et la lutte des classes. Elle se rend compte que l'oppression des Noirs... ne peut pas être comprise sans analyser les inégalités économiques et le capitalisme. Pour elle, la pauvreté et l'exploitation sont intrinsèquement liées au racisme. Après le lycée, Angela poursuit ses études à la Sorbonne à Paris, puis en Allemagne, à l'université de Francfort. En France, elle assiste au débat sur la décolonisation et prend conscience des parallèles entre la condition des Noirs américains et celle des peuples colonisés. Elle observe comment la France traite ses immigrés, Africains et Maghrébins, et y voit un écho aux luttes menées aux États-Unis. Mais une chose la hante. Pendant qu'elle est en Europe, les Noirs continuent de se battre aux États-Unis. Le mouvement des droits civiques prend de l'ampleur. Martin Luther King marche au Washington. Malcolm X prône l'autodéfense. Les ghettos s'embrasent. Angela sait qu'elle doit rentrer. Son destin est là-bas, aux côtés de ceux qui luttent. Lorsqu'Angela revient aux États-Unis, le pays est en pleine ébullition. Les tensions raciales les manifestations contre la guerre du Vietnam et l'essor des mouvements révolutionnaires transforment la société américaine. Les Noirs continuent de lutter pour leurs droits, mais la violence policière et la répression gouvernementale s'intensifient. Les assassinats de Malcolm X en 1965 et Martin Luther King en 1968 laissent un vide immense. Angela décide de s'engager pleinement. A l'université de Californie, elle poursuit des recherches sur la philosophie politique et enseigne la pensée marxiste. Mais son engagement ne se limite pas aux salles de classe. Rapidement, elle rejoint le Chelou Mumba Club, une branche du parti communiste américain, et se rapproche des Black Panthers, convaincus que seule une révolution radicale pourra changer la condition des Noirs aux États-Unis. À ses yeux, les Black Panthers ne sont pas qu'un simple mouvement militant. Ils incarnent un espoir concret pour la communauté noire, à travers des programmes sociaux et une lutte active contre les... brutalité policière. Contrairement au mouvement non-violent prôné par Martin Luther King, les Black Panthers défendent l'autodéfense armée comme un droit fondamental face aux violences perpétrées contre les Noirs. Elles adhèrent pleinement à leur vision. Résister ne signifie pas uniquement marcher pacifiquement, mais aussi reposter aux attaques de l'État. D'ailleurs, le programme des Black Panthers inclut des initiatives sociales inédites comme donner des petits déjeuners gratuits aux enfants des quartiers pauvres, ouvrir des cliniques de sein gratuites pour les personnes noires n'ayant pas accès aux hôpitaux et organiser des patrouilles armées qui surveillent les interventions policières pour empêcher les abus. Angela Davis devient une figure publique de ce combat, prenant la parole lors de nombreux rassemblements pour dénoncer l'injustice raciale. Le racisme institutionnel et la pauvreté organisée par le système capitaliste, elle met en avant une critique structurée de la société américaine alliant une réflexion philosophique à un militantisme de terrain. Son activisme ne passe pas inaperçu. Les services de renseignement américains, dirigés par le FBI, la placent sous haute surveillance. Le gouvernement, et en particulier le gouverneur de Californie, Ronald Reagan, la considère comme une menace pour la stabilité de l'État. En 1969, sous sa pression, Angela Davis est renvoyée de son poste à l'Université de Californie. Officiellement, sa participation au Parti communiste est incompatible avec ses fonctions. Officieusement, son influence grandissante inquiète les autorités. Mais être réduite au silence ne fait que renforcer sa détermination. Angela riposte en poursuivant son engagement militant. Elle multiplie les conférences, rencontre les figures influentes du mouvement révolutionnaire et renforce son implication dans la lutte contre le système carcéral qu'elle perçoit comme une extension moderne de l'esclavage. En effet, pour elle, le système carcéral repose comme un outil de contrôle des Noirs et des pauvres, tout comme l'esclavage l'était autrefois. Après l'abolition, les Noirs ont été maintenus dans une servitude légale par des lois discriminatoires comme les Black Codes ou la ségrégation Jim Crow. À ses yeux, la criminalisation de la pauvreté et l'incarcération massive des Noirs reproduisent cette logique d'exclusion et d'exploitation. En effet, les prisonniers Noirs sont surreprésentés et contraints à un travail forcé quasi gratuit, profitant aux grandes entreprises et à l'État. En d'autres termes, les prisons remplacent les plantations. Elles privent de liberté, exploitent la main-d'œuvre et maintiennent une hiérarchie raciale. sous couvert de justice pénale. L'année 1970 va marquer un tournant. Un événement tragique va propulser Angela Davis sur le devant de la scène mondiale et faire d'elle l'ennemi public numéro un du gouvernement américain. Alors que les tensions raciales et politiques atteignent un sommet aux États-Unis durant l'année 1970, Angela Davis s'engage dans un combat qui va bouleverser sa vie. Elle milite activement pour la libération des Frères de Soledad. Trois détenus noirs accusés du meurtre d'un gardien de prison en Californie. Parmi eux se trouve George Jackson, un intellectuel et militant révolutionnaire proche des Black Panthers. George Jackson et ses compagnons ont été condamnés sur des bases fragiles, dans un climat de racisme et de répression. Angela voit en leur incarcération un exemple flagrant de l'instrumentalisation du système judiciaire pour briser les figures militantes noires. Elle organise des conférences, des manifestations. et des levées de fonds pour leur défense. Mais en s'opposant publiquement à l'État, elle devient une cible. Le 7 août 1970, Jonathan Jackson, le jeune frère de George, âgé alors de 17 ans, tente une action radicale. Il fait irruption dans une salle d'audience du tribunal et prend plusieurs otages, dont un juge, et exige la libération des frères de Soledad. Mais l'opération tourne au carnage. Une filiade éclate. Jonathan Jackson et plusieurs personnes sont tuées. Quelques jours après la fusillade, Le FBI annonce qu'Angela Davis est directement impliquée. Une des armes utilisées était à son nom. L'État de Californie l'accuse de conspiration, d'enlèvement et de meurtre. Sans attendre, elle prend la fuite, consciente que les chances d'un procès équitable sont minces dans un climat aussi hostile. La réaction du gouvernement est fulgurante. Le FBI la place sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Une chasse à l'homme est lancée à travers tout le pays. Ronald Reagan, alors gouverneur de Californie, Et le président Richard Nixon déclare qu'elle doit être jugée et condamnée. Angela devient le symbole de la répression publique, mais aussi un emblème de la résistance mondiale. Après plus de deux mois de cavale, elle est arrêtée le 13 octobre 1970 dans un hôtel de New York. Elle est placée en détention provisoire et risque la peine de mort. Mais sa détention provoque une onde de choc internationale. Partout dans le monde, des milliers de personnes se mobilisent pour exiger sa libération. Le mouvement Free Angela naît et traverse les frontières. Des intellectuels et des artistes s'engagent. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dénoncent une persécution politique. John Lennon et Yoko Ono écrivent une chanson en son honneur. Des manifestations éclatent à Paris, Londres, Accra, Moscou, même aux États-Unis, des figures emblématiques comme Aretha Franklin ou les Rolling Stones prennent position pour elle. Après 16 mois de détention, elle comparaît devant la justice en 1972. Le procès est extrêmement médiatisé. Le procureur tente de la dépeindre comme une instigatrice de la prise d'otage, mais aucune preuve ne démontre qu'elle a participé activement au complot. Son équipe de défense... constituée d'avocats militants, démontre les accusations une par une. Le 4 juin 1972, après 13 heures de délibération, elle est acquittée de toutes les charges. Angela ressort libre, mais profondément changée. Elle sait que son combat ne fait que commencer. Après son acutement, elle aurait pu choisir de se faire discrète. Mais au contraire, elle redouble d'efforts pour dénoncer les injustices et approfondir ses combats. Désormais, elle n'est plus seulement une militante, mais une figure emblématique du militantisme mondial. Elle est d'ailleurs l'une des premières penseuses à mettre en avant un concept clé, l'intersectionnalité. Pour elle, les oppressions ne sont pas séparées. Le racisme, le sexisme, l'exploitation économique sont interconnectés et doivent être combattus ensemble. Une femme noire, par exemple, subit à la fois de la discrimination raciale et de la domination patriarcale. Il est donc insuffisant. de lutter contre le sexisme sans prendre en compte le racisme ou de lutter contre le racisme sans analyser les inégalités économiques. Cette vision influe profondément les luttes féministes, antiracistes et sociales à travers le monde. Elle est reprise par des universitaires, des activistes et des mouvements sociaux dans les années qui suivent. Elle poursuit aussi son engagement contre le complexe industriel carcéral. Selon elle, les prisons n'améliorent pas la société, elles perpétuent les inégalités. Elles ne sont pas là pour réhabiliter les détenus. mais pour maintenir un ordre social injuste. C'est pourquoi elle milite pour l'abolition des prisons et l'adoption d'alternatives basées sur une justice réparatrice. Son combat ne se limite plus aux États-Unis. Elle voyage à travers le monde, soutenant les luttes anti-apartheid en Afrique du Sud, les combats pour les droits des femmes en Amérique latine, les mouvements révolutionnaires contre l'apérialisme. Son engagement fait d'elle une cible permanente des gouvernements occidentaux, mais aussi une source d'inspiration pour des générations de militants. En plus de son activisme, Angela Davis devient une universitaire de renom. Elle enseigne dans plusieurs universités et publie des ouvrages fondamentaux sur les liens entre le racisme et le système pénal, le féminisme noir et l'exploitation capitaliste des minorités. Son livre « Femmes, races et classes » devient une référence incontournable, notamment pour les nouvelles générations de féministes et de militants antiracistes. Angela Davis n'est pas seulement une militante du passé. Son héritage continue d'influencer les luttes modernes, du mouvement Black Lives Matter au combat féministe et anticapitaliste à travers le monde. Sa pensée et son engagement ont laissé une empreinte indélébile et son travail inspire encore aujourd'hui de nombreuses générations de militants et d'intellectuels. Elle est aussi pionnière du féminisme noir, un courant qui dénonce l'exclusion des femmes noires dans le féminisme traditionnel, souvent dominé par des préoccupations des femmes blanches de classe moyenne. Elle rappelle que les oppressions s'entrecroisent et que les luttes pour l'égalité doivent inclure toutes les femmes en tenant compte des spécificités raciales et économiques. Angela Davis nous rappelle une vérité essentielle. La justice ne se donne pas, elle se prend. Son parcours nous enseigne que la lutte ne s'arrête jamais, qu'elle doit être renouvelée et portée par chaque génération. À travers son engagement, elle nous pousse à interroger nos propres actions. Que faisons-nous aujourd'hui pour combattre les injustices ? Sommes-nous prêts à remettre en question les systèmes qui nous entourent ? Comment pouvons-nous agir pour un monde plus juste et équitable ? Angela Davis nous a ouvert la voie. La question est désormais entre nos mains. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Angela Davis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Ensemble, célébrons les étals noirs qui ont marqué notre histoire. A bientôt sur Portrait des Bains. Sous-titrage