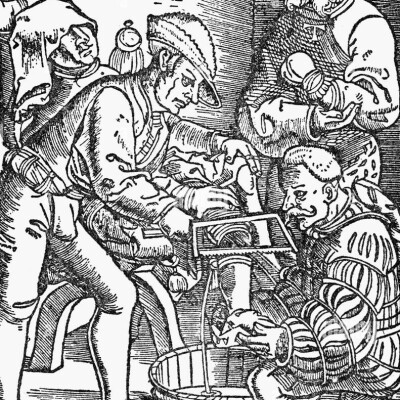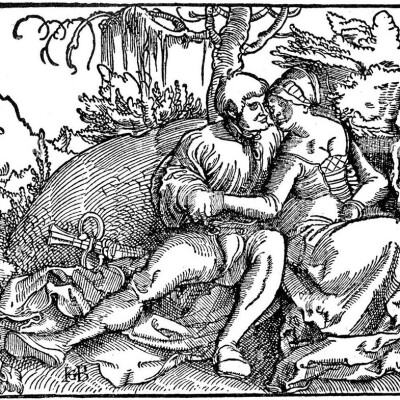- Speaker #0
Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on ouvre un dossier vraiment particulier tiré des archives du consistoire de Genève en plein XVIe siècle.
- Speaker #1
Oui, bonjour.
- Speaker #0
Une histoire de conflit conjugal, mais un conflit qui bute sur une réalité physique, on pourrait dire. Quasi anatomique.
- Speaker #1
Tout à fait. On va se plonger dans l'affaire qui a opposé Estiena Costel et Jean Cugnard, ça se passe entre 1562 et 1564, et nos sources... principales, ce sont vraiment les registres du consistoire. Ces procès-verbaux, ils nous transportent au cœur des discussions de l'époque. On a aussi complété avec des éléments sur la médecine, la société genevoise sous Calvin pour mieux comprendre le contexte.
- Speaker #0
D'accord. L'objectif, c'est donc de comprendre ce drame personnel, bien sûr, mais aussi de voir comment les autorités religieuses et civiles de cette Genève réformée ont géré une situation aussi intime. Et puis, il y a cette suggestion médicale assez, enfin on en reparlera, mais disons inattendue.
- Speaker #1
Oui, c'est une plongée assez fascinante, je trouve, dans les mentalités d'une époque où tout est lié. Le religieux, le médical, le social, c'est très imbriqué.
- Speaker #0
Alors justement, pour bien comprendre, plantons le décor. Genève, milieu du XVIe siècle, c'est la cité de Calvin, en pleine réforme. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des gens ?
- Speaker #1
Ça change beaucoup de choses. Ça implique une structure sociale et morale très, très encadrée. Et au centre de ça, il y a le consistoire.
- Speaker #0
Le fameux consistoire.
- Speaker #1
Oui, et ce n'est pas juste une assemblée religieuse. C'est vraiment une institution qui veille sur les mœurs publiques et privées. Les registres le montrent bien. Il intervient partout. Disputes de voisinage, questions de foi. Et bien sûr, ce qui nous intéresse ici, les conflits familiaux, les relations entre époux.
- Speaker #0
D'accord. Et pour comprendre notre affaire, justement, Comment est-ce qu'on voyait le corps féminin, la sexualité, à cette période ? C'était quoi les idées dominantes ?
- Speaker #1
Alors, on hérite encore énormément des idées antiques, surtout de Gallien. Il y a cette idée persistante du « sexe unique » , un peu étrange aujourd'hui.
- Speaker #0
C'est-à-dire ?
- Speaker #1
C'est-à-dire que les organes féminins sont vus comme une version, disons, intérieure et inversée des organes masculins. Et le corps de la femme est considéré comme plus froid et plus humide. Et cette vision, elle influence directement la façon dont on comprend certains problèmes physiques.
- Speaker #0
Comme la capacité d'avoir des rapports sexuels, par exemple.
- Speaker #1
Exactement.
- Speaker #0
Ce que le droit de l'époque, le droit canon, appelait l'impotentia coendi, l'impuissance à l'acte sexuel chez la femme, on l'attribuait souvent à une cause très concrète, physique. Une obstruction ou, ce qui semble être le cas ici, une étroitesse jugée anormale. Parfois, on trouve le terme archétitudo.
- Speaker #1
Archétitudo, d'accord. Mais c'est aussi une période où la médecine... commence à changer un peu, non ? Avec des gens comme Vézal, les dissections...
- Speaker #0
Oui, tout à fait. L'observation directe commence à ébranler un peu les anciennes théories. Mais ça se fait très très lentement. Les idées de Galien restent quand même très présentes. Et puis, il y a un autre point crucial. L'importance de la consommation du mariage.
- Speaker #1
Ah oui, ça c'est fondamental. C'est hériter du droit canon. Le fait d'avoir eu un rapport sexuel complet, c'est ce qui valide vraiment le mariage. Et la sexualité, de manière générale, n'est vue comme légitime que dans ce cadre précis du mariage et, idéalement, pour la procréation. C'est la morale chrétienne dominante de l'époque.
- Speaker #0
C'est dans ce contexte donc que s'inscrit l'histoire d'Estiena et Jean. Qui sont-ils plus précisément ?
- Speaker #1
Alors Jean Cunard, c'est un artisan. Il est chapelier et Estiena Costel, elle, est fille d'un aubergiste assez connu à Genève, Guillaume Costel. Ils tiennent une auberge appelée les Trois Cailles. Il se retrouve une première fois devant le consistoire en juillet 1562.
- Speaker #0
Et ces gens qui lancent la procédure, qu'est-ce qui lui reprofe exactement ?
- Speaker #1
Plusieurs choses en fait. Il la trouve désobéissante, il l'accuse de mal gérer l'argent, elle travaille aussi, elle vend des chapeaux, et même de vouloir le ruiner. Mais le point central, le cœur de sa plainte, c'est qu'elle, je cite les registres, ne veuille coucher avec lui ni faire devoir de femme.
- Speaker #0
Donc il affirme que le mariage n'a jamais été consommé ?
- Speaker #1
C'est ça. Et du coup, il demande la séparation.
- Speaker #0
C'est une accusation très, très sérieuse à l'époque. Et Estiana, comment elle réagit ?
- Speaker #1
Elle admet certaines choses. Par exemple, oui, elle a jeté de la viande, mais elle dit que c'est parce qu'elle était véreuse. Elle admet aussi s'être réfugiée chez sa mère. Et surtout, elle confirme la non-consommation du mariage. Ça, elle ne le nie pas. Mais elle réfute les accusations de mauvaise gestion.
- Speaker #0
Et le consistoire, quelle est sa première réaction ?
- Speaker #1
Plutôt classique au début, il sermonne les deux époux. Estiena est rappelée à l'ordre, elle doit faire son débouvoir envers son mari de jour et de nuit. Jean aussi doit bien la traiter. Et fait intéressant, on interdit à la mère d'Estiena de l'héberger ou de se mêler de leurs affaires.
- Speaker #0
On sent déjà une tension familiale autour et il y a déjà une petite piste médicale qui apparaît, c'est ça ?
- Speaker #1
Oui, c'est un détail qui a son importance. La mère d'Estiena avoue qu'elle a déjà fait examiner sa fille par un barbier ou soit chirurgien.
- Speaker #0
Ah oui, pour quelles raisons ?
- Speaker #1
Pour comprendre pourquoi elle n'est faisouette sans de pouvoir, pourquoi elle ne pouvait pas avoir de relation. Mais ce praticien apparemment n'a rien su qu'on doit être. Il n'a rien trouvé d'anormal.
- Speaker #0
Donc cette première intervention du consistoire, ça ne règle rien en fait. Le conflit s'enlise.
- Speaker #1
Pas du tout. Ça va durer des mois, cette histoire. Ça va empoisonner leur vie et occuper les autorités. Dès septembre 1562, Jean est de retour devant le consistoire. La situation n'a pas changé. Estiena refuse toujours les rapports. Selon le procès verbal, elle aurait même dit des choses assez dures, comme quoi elle coucherait plus tôt avec un chien qu'avec lui. Mais surtout, elle maintient qu'elle ne saurait pas avoir sa compagnie. C'est intéressant, elle ne dit pas « je ne veux pas » , mais « je ne peux pas » .
- Speaker #0
Et là, les autorités commencent à perdre patience, j'imagine.
- Speaker #1
Oui, le ton monte. Estièna est privée de la Seine.
- Speaker #0
Ce qui est une sanction très forte.
- Speaker #1
Très forte, oui. C'est le sacrement central, la communion protestante. C'est une sanction spirituelle, mais aussi sociale. Et l'affaire est renvoyée devant le Conseil. Il faut bien distinguer, hein. le consistoire, c'est la discipline morale et ecclésiastique, le conseil, c'est l'autorité civile judiciaire de Genel.
- Speaker #0
Et le consistoire suggère même d'aller plus loin.
- Speaker #1
Oui, il suggère au conseil d'envisager l'emprisonnement pour la contraindre à obéir à son mari.
- Speaker #0
Et devant le conseil, Étienne maintient sa position ou elle change un peu ?
- Speaker #1
Elle nuance un peu. Elle se dit prête à vivre avec lui, à cohabiter, mais elle répète qu'elle est physiquement incapable d'avoir des rapports. Face à cette situation bloquée, et peut-être cette contradiction apparente, le Conseil ordonne un premier examen médical officiel d'Étienne A.
- Speaker #0
Mais le conflit continue de s'aggraver dans les mois qui suivent, c'est ça ?
- Speaker #1
Et perplexe. Cette fois, il ordonne un examen médical des deux époux, pour savoir auquel il tient, comme ils disent.
- Speaker #0
On veut savoir d'où vient le problème, en gros.
- Speaker #1
C'est ça. Et en décembre, nouvelles accusations de violence contre Jean, même après qu'un voisin influent soit intervenu. Estiana de son côté se fait réprimander pour avoir insulté son mari, l'avoir traité de larron. La situation est tellement mauvaise que les deux finissent par être excommuniés, privés de la scène et renvoyés une fois de plus devant le conseil.
- Speaker #0
On sent vraiment l'impasse totale et l'exaspération des autorités. Et on arrive à ce moment-clé, cet examen de fin décembre 1562.
- Speaker #1
Oui, c'est le tournant d'FR. Le 31 décembre, un des magistrats les plus importants, le syndic Chevalier, fait son rapport au conseil. Il transmet les conclusions de l'examen d'Estiena, et cette fois l'examen a été fait par des sages-femmes, des matrones expérimentées, et leur verdict est direct, très clair.
- Speaker #0
Qu'est-ce qu'elles disent ?
- Speaker #1
Elles la trouvent, je cite encore, « fort étroite et comme inhabile » .
- Speaker #0
Fort étroite, c'est précis. Et il y a ce détail assez cru qui rapportait aussi ?
- Speaker #1
Oui, un détail qui rend la chose très concrète. Le rapport précise « mémé, quand on lui a mis le petit doigt, elle ne la peut souffrir » .
- Speaker #0
Waouh ! C'est presque clinique.
- Speaker #1
C'est ça. Et ça change tout. Pour les magistrats, là, ce n'est plus une question de mauvaise volonté ou de désobéissance. C'est une impossibilité physique, objective, constatée. Et ça correspond exactement à cette notion d'artitudo dont on parlait tout à l'heure.
- Speaker #0
Ce diagnostic médical, ça doit forcément influencer la suite. Quelle est la réaction de Calvin lui-même ? On lui demande son avis, j'imagine.
- Speaker #1
Oui, son avis est sollicité et rapporté au Conseil dès le lendemain, le 1er janvier 1563. Et il est très pragmatique en fait. Pour Calvin, c'est simple. Si le mari et la femme ne peuvent avoir compagnon ensemble, s'il y a une impossibilité physique avérée, eh bien ce n'est pas mariage. Le lien n'est pas complet, pas réel.
- Speaker #0
Donc pour lui, la conclusion logique, c'est l'annulation pure et simple.
- Speaker #1
Exactement. Sa conclusion, c'est que tel mariage doit être déclaré nul. Et cette position, finalement, elle n'est pas si révolutionnaire. Elle s'inscrit dans une certaine continuité avec le droit canon médiéval qui reconnaissait déjà l'impotentia coendi, l'impuissance, comme un motif d'annulation du mariage.
- Speaker #0
Bon, on pourrait se dire que l'affaire est entendue, là. On a un diagnostic médical clair, on a l'avis du grand réformateur Calvin qui va dans le sens de l'annulation. Logiquement, le Conseil devrait suivre.
- Speaker #1
Logiquement, oui. Mais c'est là que ça devient vraiment surprenant.
- Speaker #0
Ah !
- Speaker #1
Le même jour, ce 1er janvier 1563, le Conseil prend une décision complètement inattendue. Il décide qu'avant d'annuler, il faut explorer une autre piste. Il propose de consulter, encore avec les médecins et chirurgiens, s'il y aura moyen de lui faire autre ouverture que celle de nature, comme aucun dit ce qu'il se peut le faire artificiellement.
- Speaker #0
Attends, faire autre ouverture que celle de nature ? Une ouverture artificielle ? Mais c'est… il suggère une opération chirurgicale pour corriger cette étroitesse ? Au XVIe siècle ?
- Speaker #1
C'est exactement ça. Une suggestion de chirurgie gynécologique en quelque sorte.
- Speaker #0
Mais c'est incroyable. Ça paraît extrêmement audacieux, voire carrément dangereux pour l'époque.
- Speaker #1
C'est très audacieux, oui. Il faut se replacer dans le contexte de la chirurgie du XVIe siècle. L'anesthésie, c'est quasi inexistante ou alors très rudimentaire.
- Speaker #0
Et les infections ? J'imagine même pas.
- Speaker #1
Le risque d'infection est énorme. On est des siècles avant Pasteur et Lister. Même si des chirurgiens comme Ambroise Paré font des progrès sur les ligatures, la cautérisation, ça reste très risqué. Et maîtriser les saignements, c'est un autre défi majeur.
- Speaker #0
Et qui aurait pu faire ça ? C'était qui les chirurgiens de l'époque ? Et est-ce qu'on connaît ce genre d'opération ?
- Speaker #1
Alors, c'était souvent les barbiers chirurgiens. C'était un corps de métier un peu à part distinct des médecins formés à l'université. Quant à ce type précis d'intervention, une chirurgie pour agrandir ou créer une ouverture vaginale fonctionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve décrit couramment dans les grands traités chirurgicaux de l'époque qui nous sont parvenus. Elle qui accrouque à un médecin à Ambley, un peu plus tardif, mentionne bien l'excision du clitoris dans certains cas, mais pas ce genre d'opération reconstructrice ou d'agrandissement. Donc oui. Ça semble vraiment une proposition qui sort de l'ordinaire.
- Speaker #0
On imagine la réaction de Jean Cunard, le mari. Lui qui se plaignait de ne pas pouvoir consumer le mariage, qu'est-ce qu'il dit de cette idée de faire opérer sa femme ?
- Speaker #1
Son rejet est…
- Speaker #0
Total.
- Speaker #1
Catégorique. Quand l'idée est évoquée, de nouveau, en mars 1563, devant le consistoire, il refuse net. Il dit, et c'est assez fort, qu'il ne voudrait pas une femme qui aurait été maniée par les chirurgiens et barbiers.
- Speaker #0
Maniée. Le mot est dur, on sent le dégoût presque.
- Speaker #1
Oui, un dégoût manifeste. Ça montre bien comment une telle intervention était perçue, hyper invasive, sans doute dégradante, touchant à l'intégrité la plus intime du corps féminin.
- Speaker #0
On comprend sa réaction, effectivement. Mais le Conseil, lui, il en reste là. Il abandonne l'idée face au refus du mari.
- Speaker #1
Eh bien, non. Et c'est ça qui est peut-être le plus étonnant dans cette histoire. Malgré le refus très clair de Jean, le Conseil persiste et signe. Toujours en mars 1563, il ordonne qu'Astiana soit quand même examinée par des chirurgiens. Et si eux, les experts, jugent l'opération faisable et pertinente, alors elle devra être pratiquée. Le terme utilisé dans les registres, c'est « l'accourtir » . Ça suggère une idée de correction, d'ajustement.
- Speaker #0
Ils ordonnent l'opération ?
- Speaker #1
Ils ordonnent l'examen en vue de l'opération. Et si c'est jugé possible, oui. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que l'opération devra se faire au frais. de Jean Cugnard.
- Speaker #0
C'est hallucinant. Une intervention de l'autorité civile aussi directe dans l'intimité physique contre l'avis du mari et en lui faisant payer en plus. Est-ce que cette opération a eu lieu finalement ?
- Speaker #1
Rien dans les archives ne permet de le penser. Tout en dit que non. L'idée peut être jugée trop radicale ou simplement irréalisable par les chirurgiens qui ont été consultés, si tant est qu'il l'ait été, elle semble avoir été abandonnée en cours de route.
- Speaker #0
D'accord. Et l'histoire du couple, elle se termine là ? Ou ça continue encore après ?
- Speaker #1
Ah non, ça continue. Les conflits reprennent de plus belles. En 1563, il y a même une nouvelle affaire. Estiana est accusée d'avoir flirté avec un serviteur.
- Speaker #0
Encore une accusation ?
- Speaker #1
Oui, des voisins les auraient vus se jouer et s'accoler. Elle, elle admet une certaine familiarité, peut-être un peu arrosée lors d'une fête, mais elle nie tout forfait, toute faute grave. L'affaire est classée, faute de preuves suffisantes, mais on leur interdit de se revoir, à elle et au serviteur.
- Speaker #0
Et quelle est l'issue finale pour ce couple ? On sait comment ça se termine.
- Speaker #1
On les retrouve encore en train de se disputer devant le consistoire en mai 1564. Jean se plaint qu'elle jouait hockey, il lui a donné une gifle, un soufflet. Ils sont encore une fois réprimandés. Mais, retournement de situation, peu après, en juin 1564, ils sont réadmis ensemble à la Seine.
- Speaker #0
Ah bon ?
- Speaker #1
Oui, ce qui laisse penser qu'il y a eu une forme de réconciliation. Au moins en apparence suffisante pour que l'église lève l'excommunication.
- Speaker #0
Et après ça ?
- Speaker #1
Après ça, silence radio dans les registres concernant leur couple. La toute dernière mention qui pourrait les concerner date de novembre 1566, où on apprend que Jean Cunard, toujours chapelier, perd un enfant.
- Speaker #0
Mais on ne sait pas si c'est un enfant qu'il a eu avec Estiena.
- Speaker #1
Exactement, on ne sait pas si cet enfant était d'elle, ni même s'ils étaient encore mariés à ce moment-là. La fin de leur histoire reste un peu floue. Et cette fameuse opération géologique, elle, semble s'être complètement évaporée des débats.
- Speaker #0
Bon, si on essaie de résumer un peu cette affaire complexe et assez incroyable, on part d'un conflit conjugal, somme toute privé,
- Speaker #1
au départ, oui,
- Speaker #0
qui devient public à cause de l'intervention systématique du consistoire dans cette Genève très réformée. Le cœur du problème, c'est une réalité physique très spécifique, cette étroitesse d'esthéna, qui est documentée de manière assez crue par les sages-femmes.
- Speaker #1
Tout à fait. Et face à ce constat, on a l'avis très clair, très pragmatique de Calvin, Si l'union physique est impossible, le mariage n'est pas valide, il est nul. Ce que la nature, selon eux, n'avait pas permis.
- Speaker #0
C'est une histoire qui nous offre vraiment une fenêtre unique sur les mentalités du XVIe siècle. Le poids écrasant du mariage, la vision de la sexualité, du corps féminin, les interactions très complexes entre la religion, le droit, et puis une médecine qui cherche encore ses marques.
- Speaker #1
Oui, ça nous renonce beaucoup l'image parfois un peu simpliste ou monolithique qu'on peut avoir de cette époque et de la société calviniste.
- Speaker #0
Absolument. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour terminer notre discussion d'aujourd'hui.
- Speaker #1
Oui, une question qui reste ouverte.
- Speaker #0
Qu'est-ce qui a bien pu pousser le Conseil de Genève, cette instance civile, très soucieuse pourtant de l'ordre moral calviniste, à imaginer une solution chirurgicale aussi risquée, aussi invasive, et dont le succès était plus qu'incertain ? Pourquoi ne pas simplement avoir suivi l'avis de Calvin sur la nullité, qui semblait pourtant découler assez logiquement du constat médical et même d'une certaine tradition juridique ?
- Speaker #1
que cette suggestion un peu folle révèle de leurs priorités profondes ? Est-ce que c'était une volonté acharnée de sauver l'institution du mariage à tout prix, quitte à intervenir directement sur le corps ? Une conception du corps féminin comme étant modifiable, réparable par l'artifice humain ? Ou peut-être une tentative presque promettéenne pour l'époque de repousser les limites de ce que l'homme pouvait faire face à un défaut de la nature ?
- Speaker #0
Tant de pistes de réflexion, effectivement, que cette affaire vraiment singulière d'Estinia et Jean nous invite à explorer. C'est fascinant !
- Speaker #1
Absolument fascinant !