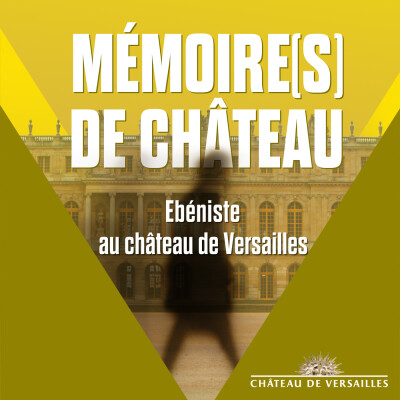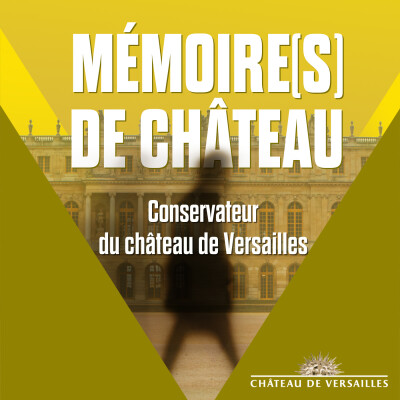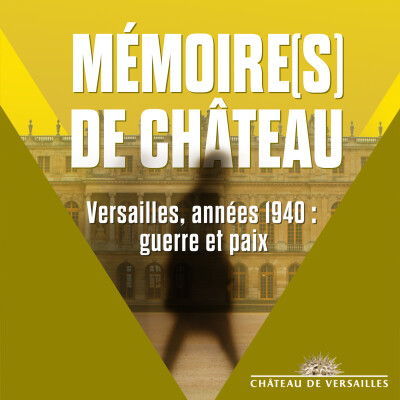- Speaker #0
Le château de Versailles présente Mémoires de château.
- Speaker #1
Je m'appelle Michel Tigréa, je suis né le 6 avril 1932 à Versailles. Mon père était breton et est venu travailler dans les musées après la guerre de 14. Donc j'ai vécu toute mon enfance à Trianon, au château. Je connaissais le château comme ma page. J'ai vu le château complètement sans boiserie. Mais j'allais au château pratiquement tous les 15 jours. J'essayais de dessiner des meubles. J'ai tout de suite été attiré par le château.
- Speaker #2
Je m'appelle Éric Demeyer. Je suis donc jeune retraité depuis un an et demi. J'ai rempli mes fonctions de responsable d'atelier depuis tout au début janvier 2003 jusqu'à juillet 2023. J'ai travaillé dix ans comme chargée de restauration et ensuite j'ai eu en charge l'atelier de restauration et d'ébénisterie, donc aux ateliers muséographiques au sein de la conservation.
- Speaker #1
J'ai eu un parcours professionnel très difficile au départ. Scolairement, j'étais bon, je faisais de la musique, j'étais bon étant tout jeune gosse. Et puis nous sommes partis brusquement en 1939 à l'Exode. Et ensuite, ça a été une catastrophe complète. Je suis tombé malade, j'ai eu des gros problèmes de sinusite, des problèmes osseux. J'ai manqué l'école et j'ai aussi fait de l'école bisonnière un peu. Je n'aimais pas l'école du tout. Et là, j'ai perdu, j'ai tout abandonné. Je n'ai jamais appris l'algèbre. J'étais vraiment très bon en dessin, très bon en histoire de l'art, très bon en rédaction. Mais j'avais un défaut terrible. L'orthographe m'était complètement inconnu. Ensuite, il fallait choisir un métier. Je voulais être dessinateur, soit de mode, soit d'affiche, etc. Mais mon niveau scolaire n'était pas suffisant. J'avais un tonton qui était chef menuisier dans les biscuits nantais et qui avait monté un atelier de menuiserie et de menuiserie. Et j'avais été passer chez lui au début, fin 1945, un stage d'une semaine avec lui. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a mis sur les rangs parce qu'il était gentil avec moi, il m'a donné du travail. On a fait les plafonds des premiers moulins de Barbatre. Il m'a donné l'envie de prendre l'ébénisterie. Donc j'ai passé l'examen et on m'a choisi pour l'ébénisterie.
- Speaker #2
J'ai eu le problème en étant, on va dire, petit, d'être dyslexique. Et ça, je l'ai appris après. On était considéré comme échec scolaire, en fait. Donc voilà, on m'a dit, lui, il ira travailler une matière dans un lycée professionnel. Donc moi, j'avais qu'une idée en tête. Il n'y avait que le matériau, le bois, le bois, le bois. Pour moi, c'était chaud, c'était propre. c'était... J'ai toujours été très bricoleur quand j'étais gamin. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un très bon maître d'apprentissage à l'école. Et ensuite, je me suis toujours, toujours, toujours, au cours de ma carrière, grâce à ma curiosité, à mon envie d'apprendre, j'ai toujours essayé d'être le meilleur, donner le meilleur de moi-même. Et d'avoir toujours un contact avec... Ce qui était quand même la source de mon métier, c'est-à-dire l'ébénisterie. Et l'ébénisterie était dans les châteaux. Et dans les châteaux, il fallait y accéder. C'était ça mon objectif.
- Speaker #1
Aimer un ébénisterie, c'est venu tout doucement. Dans l'atelier où j'étais, il faisait fabrication et restauration. Et on m'a mis tout de suite à un genre de restauration qui était l'entretien des meubles dans les familles. Après la guerre, les meubles étaient tellement malades qu'il fallait les remettre en état. Donc on allait faire du bricolage, on passait huit jours, la gamelle, le train à six heures. Très très dur, 54 heures par semaine. Plus des cours en alternance, qui nous permet d'apprendre le dessin Oui. qui était important pour l'atelier pour pouvoir faire du neuf. En neuf, je fais des postes de radio, j'ai fait des copies dans le meuble ancien. Et après, je me suis mis à la restauration. Mais comme j'étais meilleur en restauration, le patron m'a préparé de me mettre carrément à la restauration. Et pendant un an, je n'ai fait que de la restauration. Tous les meubles qui étaient restaurés, je les décapais, je les préparais. Et j'ai appris à débuter les voies. Nous travaillions uniquement la main. C'est-à-dire que j'étais épais comme un poireau. Je n'avais pas de force. J'étais malade. J'avais une maladie que j'avais attrapée. Une grande sinusite aussi. Il fallait que je scie, je sciais des plateaux à la scie à fendre. On sciait les plateaux, on préparait tous les livres en bois, ils étaient faits à la main. On dégauchissait à la varlope, au riflage, j'ai appris le travail à la main.
- Speaker #2
J'ai obtenu un diplôme d'aménisterie, ensuite j'ai fait un parcours dans le privé où j'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai passé un concours pour rejoindre l'administration, donc j'ai travaillé, j'étais l'ébéniste qui s'occupait de... de la restauration et de l'entretien d'immobilier au palais de la Cour des Comptes. Et puis mon souhait en fait a toujours été de travailler pour le patrimoine. Je voulais m'inscrire parmi tous ces gens qui sauvegardent pour le bien commun, pour une espèce de mission patrimoniale. Cela me tenait à cœur, donc pour y arriver j'ai dû préparer. Entre 35 et 40 ans, j'ai dû préparer les concours pour entrer dans ce qu'on appelle la direction des musées de France. Je suis repartie à l'école et à la réussite de ce concours, j'avais le choix de me faire un concours. choix entre le Louvre et Versailles, et je pouvais enfin toucher les meubles qui figuraient dans les livres quand j'étais étudiant, et c'est comme ça que je suis rentrée à Versailles, en me remettant en cause, puisque à 40 ans, j'intégrais une équipe à l'atelier, et je... Je m'adaptais et je redécouvrais un autre monde, je redécouvrais un autre métier. Et toujours en étant impressionné, motivé par le lieu qui me fascinait quand même.
- Speaker #1
Je suis au Chénet, je fais mon apprentissage, je pars à l'armée. Alors je connaissais très très bien monsieur... Mauricio Beaupré, parce que étant jeune, j'avais fait du scoutisme à Versailles. Je le rencontrais sur l'allée de Trianon, on faisait des fois le chemin en route, etc. Puis il nous a beaucoup aidés au point de vue péquinier. Au retour de service militaire, je suis embauché dans une maison, je fais des postes de radio. Et ensuite, j'ai travaillé un mois sur un bateau, faire l'agencement intérieur. Je ne pouvais plus tenir dans cette boîte, c'était infernal. J'ai arrêté de travailler, j'ai rencontré M. Lerichaud-Bopré qui me dit « Écoutez, pourquoi vous ne rentrez pas au château ? On vous prend comme gardien et on vous met à l'entretien. » C'était en 1953 qu'il m'a proposé ça. Et je n'ai pas donné suite. Donc, M. Mauricio Beaupré décède au cours d'un voyage au Canada en 1953. Et M. Van Der Kjem, qui a des appuis, de forts appuis politiques, devient le conservateur du château de Versailles. Il souhaite à tout prix monter un atelier. Il voulait, il avait dans l'esprit, de rendre au musée, au Versailles, un aspect des châteaux anciens, des meubles anciens, etc. Il y avait à ce moment-là, au château de Versailles, des ateliers d'entretien. Ces ateliers étaient chargés de mettre le charbon dans les chauffages centrales qui existaient au château, d'accrocher les tableaux, de transporter les statues, enfin de devenir les hommes de peine. M. Van Der Kjem a regroupé ces gens-là et m'a proposé de rentrer. Bon, il avait tellement été gentil avec moi que je suis rentré au château.
- Speaker #2
Mon premier souvenir de Versailles, ça va faire un peu rire, mais bon je n'ai pas honte, c'était il y a 50 ans, c'est-à-dire j'avais 12 ans, c'était la télévision noir et blanc, c'était Angélique, marquise des anges dans la galerie des glaces. Il n'y a pas une femme au monde qui n'ait rêvé d'être Angélique.
- Speaker #1
Il n'y a pas un homme au monde qui n'ait rêvé d'Angélique.
- Speaker #2
Et puis tout ce qui en dégageait autour, l'esprit 18ème. Voilà les mystères de Versailles. J'étais très intéressée par l'histoire de France depuis tout petit. C'était une des matières qui vraiment m'intéressait, parce que j'estimais que l'histoire de France était une série, en fait pas une série, mais pouvait être source d'histoires, d'inspiration, pour les plus grandes histoires, tout simplement.
- Speaker #1
Lorsque je suis rentré au château de Versailles en 1954, tout le château de Versailles était dans un état lamentable. Les couvertures, les boiseries, etc. Je me suis installé dans un atelier. À côté de cet atelier, ils ont monté ce qu'on appelait une sapine. Une sapine, c'était un échafaudage de bois qui permettait aux charpentiers de monter sur le toit et au couvreur. Ils m'ont vu travailler par la fenêtre. Ils voyaient que j'étais en train de travailler sur du mobilier intéressant. Je suis devenu copain avec eux. Ils se trouvaient que c'était des compagnons. C'était des compagnons du devoir. Rapidement, ils m'ont proposé de rentrer aux compagnons du devoir. Et ça m'intéressait, ça m'intéressait, mais ils ne prenaient pas les hommes mariés. Je m'étais marié entre-temps. J'ai donc travaillé pendant deux ans au cadre, montage des cadres, montage des clages avec clé, préparation à la dorure. En 1956, je passe le concours de... d'ouvriers professionnels en première catégorie et je commence à m'occuper des ateliers de menuiserie, des ministéries et puis j'ai préparé l'exposition de Marie-Antoinette et monsieur Van Der Kem m'avait donné l'autorisation d'aller une fois par semaine dans les archives. J'ai continué à apprendre avec monsieur Paulet qui était peintre et là j'ai commencé à aimer le métier et la révélation s'est faite Merci. En 1957, à un moment qui dépassait complètement mes connaissances, le bureau du roi qui était au Louvre devait venir à Versailles, pour la venue de la reine d'Angleterre. Trois jours avant le constat d'état, Van Der Kamp arrive à la maison, il me dit « j'ai un problème, vous allez aller en mission au Louvre, vous faites le constat d'état du bureau » . Je dis « monsieur, moi je ne le connais pas, je l'ai regardé, on n'a pas le droit de le toucher, on n'a pas le droit de l'ouvrir » . Je ne connais pas le bureau. Ça peut être facile, je suis arrivé au Louvre. Celui qui démontait le bureau, qui était Féton, un ébéniste connu qui travaillait pour les musées, a refusé que je fasse le rapport. J'ai quand même fait le rapport. J'ai vu le bureau complètement démonté. J'ai vu la mécanique, j'ai vu les transformations de la mécanique. Et je me suis rendu compte, moi qui avais lu les livres sur le bureau du roi, j'avais tout lu sur le bureau du roi, que contrairement à ce qui était écrit, que le bureau s'ouvrait d'une manière automatique, il ne s'ouvrait pas d'une manière automatique. On voyait la transformation. Donc, pour moi, c'était une découverte impensable. Ce bureau m'a donné l'envie, j'ai dit, il faut que je devienne restaurateur.
- Speaker #2
Mes missions consistaient donc à prendre soin du mobilier, des objets d'art et ensuite en tant que responsable de la coordination entre mon équipe, les conservateurs sur les chantiers de grande envergure. sur des missions plus personnelles, individuelles. Concrètement, le quotidien, c'est répondre aux besoins qu'ont les conservateurs, puisque chaque conservateur, chacun dans sa spécialité. à des objectifs et à besoin de collaborateurs. Et nous, nous faisions partie de la partie art décoratif. Donc le mobilier, ça passe par les meubles, bien sûr, les cadres et quelques petits objets de valeur. Donc c'est tout un processus, un protocole qui consiste à examiner le mobilier, l'œuvre. Ce sont des objets qui ont servi au roi, au reine, au prince, la cheminée ensuite. tout un cycle de traitement pour arriver au rapport de restauration et ensuite aux préconisations sur si l'objet est fragile ou pas, avec bien sûr la responsabilité en termes d'exigence déontologique et surtout ce dialogue avec les conservateurs pour avoir cette cohésion et prendre soin de la matière et de la respecter surtout.
- Speaker #1
En 1961, je prends la direction de tous les ateliers sur ordre de M. Van Der Kem, les ateliers qui existaient alors, c'est-à-dire la menuiserie, l'ébénisterie, la tapisserie et la dorure. En 1962, le général de Gaulle souhaitait remettre le Grand Trianon en état totalement pour recevoir des autres étrangers. Pour ce faire, le mobilier national a été convoqué et le musée du Louvre a pensé envoyer ses ouvriers. Van Der Klem a refusé et j'ai pris la direction des travaux des médicteries et de médicteries au Grand Trianon. Lorsqu'on a fini de travailler au Grand Trianon, entre temps j'avais travaillé pour la Mananterne pour arranger le logement, pour mettre à jour le logement du ministre. Et il avait fallu avoir une série de sièges qu'on avait de boulard au château, il avait voulu avoir cette série de sièges. Et Van Der Klem a refusé, Van Der Klem m'a dit vous vous débrouillez, vous les faites. J'ai donc fait une série de sièges pour André Malraux, mais quels sont des sièges qui ont été inventoriés pour le château ? Des copies de Boulard, dont j'ai les photos, des belles copies. Et nous avons fait les travaux, et Malraux venait à l'atelier souvent nous voir, et nous avait demandé un jour, qu'est-ce que vous désirez ? On lui a carrément demandé, on voudrait pouvoir devenir restaurateur d'État. Et Malraux avait fait un concours spécialement pour nous. Donc je suis devenu restaurateur. C'est en 1966, presque aussitôt, qu'on a été nommé. Et je suis chargé de tous les ateliers de Versailles, aussi bien les restaurateurs que les OP. OP, c'est les ouvriers professionnels, et les restaurateurs. À un moment donné, nous étions 15 à l'atelier, tout confondu.
- Speaker #2
Alors ce sont les meubles qui appartiennent bien sûr aux collections. Alors il y a différentes valeurs on va dire, les valeurs reconnues comme trésors nationaux et puis d'autres qui appartiennent à une importance un peu moindre sur le plan historique. Alors en termes de style, c'est Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, bien sûr les influences Marie-Antoinette. même de Pompadour. Ensuite, il y a eu le Grand Trianon avec Napoléon. Il y a eu l'épisode de Louis-Philippe quand il a créé le musée. Donc, ça va de Louis XIV jusqu'à Napoléon III. Ça peut être bien sûr des armoires pour ranger, des tables pour travailler, pour manger, des chaises pour s'asseoir. Et puis, tous les petits meubles. qui sont apparus au cours du XVIIIe comme le bonheur du jour. C'était un petit bureau qui était destiné à la lecture et à l'écriture, et aussi au rangement. Donc c'était un petit bureau surmonté d'un gradin. Il pouvait être en pente, sous Louis XV et droit sous Louis XVI, mais il avait donc une fonction polyvalente, travailler, ranger et écrire. Alors les meubles sont en bois, le terme ébéniste vient du terme ébène, et les meubles que nous avons surtout à Versailles, ce sont des meubles plaqués, c'est-à-dire recouverts d'une seconde peau avec des matériaux précieux. Alors ça peut être bien sûr des bois précieux, ça peut être aussi remplacé par de la lac de Chine, de la dorure magnifique, de la sculpture. Vous avez de la marqueterie, incrustée d'ivoire, de nacre, de laiton, des cailles de tortue. Moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir travailler à Versailles sur des meubles sur lesquels j'étudiais dans les livres quand j'étais étudiant. Et quelle a été ma fierté lorsque j'avais entre les mains ce genre de mobilier, ce genre d'objet. Les raisons qui nous poussent donc à avoir en charge ce mobilier, c'est déjà avant tout emmené, dirigé et décidé par les conservateurs qui ont eux un programme de travaux de restauration. ça peut être par exemple, des chantiers qui durent plusieurs années. C'est-à-dire, restaurer pour remobler le hameau de la Reine, le Grand Trianon, des entités comme des salles emblématiques comme les appartements de Madame Dubarry, Marie-Antoinette, les filles de Louis XV, le Dauphin, et ainsi de suite. Donc, les meubles sont inscrits dans... tout ce qui figure dans la typologie des arts décoratifs, car Versailles, c'est un musée, mais aussi un château, dans lequel on vécu sous l'ancien régime des rois et des reines. Et de ce fait, nous devons restaurer du sol au plafond. Dans ce contexte de remeublement, parce qu'on parle de remeublement, les conservateurs retrouvent, rachètent, restituent, en fait... du mobilier. Alors ce mobilier peut être avoir été fragilisé, il a pu être dégradé, altéré. Alors soit c'est des altérations naturelles, soit des dégradations dues à l'usage humain. Mais voilà, ce sont soit des interventions de conservation quand l'objet n'est pas très abîmé, on va dire, ou alors des restaurations fondamentales quand le meuble a été on va dire, entre guillemets, toute proportion gardée, oubliée et donc dégradée.
- Speaker #1
Monsieur Van Der Kem voulait remettre la chambre de la reine à l'état du 18e siècle. Il y avait un lit, il y avait une balustrade qui ne collait pas du tout à l'époque. Donc des recherches avaient déjà été faites par l'architecture et les musées du temps de monsieur Romero Chaubeau-Pré. L'architecte n'était plus là, donc un nouvel architecte, monsieur Saleté. a pris la direction et ils ont convenu avec monsieur Van Der Kijm que je prendrais la charge entière de la balustrade. C'est une balustrade pour séparer la pièce en deux, qui fermait la nuit, qui séparait les chambres du roi, de la reine, du personnel qui pouvait être là. Cette balustrade est une balustrade qui est toute sculptée, qui sera à corps de boiserie extérieure, avec des portillons, et on n'avait aucun document. On a repris toutes les recherches. Il a fallu retourner en bibliothèque. J'ai eu une carte de lecteur pour aller à la Bibliothèque nationale. Et ça a été le début de recherche complète. D'abord, savoir qui était celui qui avait fait la balustrade, on ne savait pas. Je commence donc les recherches à partir de 1963 pour la structure générale, c'est-à-dire un montage en mode. des bénisteries et non de menuiseries. Les travaux effectifs à l'atelier commencent en 1969 et vont durer jusqu'en 1980. Il a fallu fabriquer en premier une maquette complète, c'est-à-dire une maquette en contreplaqué de l'ensemble. Les gabarits des balustres. Nous avons fait une grande, grande maquette complète et les conseillers généraux, les conservateurs généraux se sont réunis pour voir si le principe était adopté. Il a fallu adopter le principe. Les plans ont été regardés avec l'architecte et les travaux sont commencés après cette maquette.
- Speaker #2
Mon rapport avec Michel Tigréa, au départ, je ne le connaissais pas puisque une génération nous séparait. Je l'ai connu parce que son fantôme était encore dans Versailles. Comme tout restaurateur, comme tous ceux qui ont travaillé au château, on y laisse des traces. Et nous, on a l'avantage, en tant que travailleurs, on va dire manuels, on a la chance de laisser des traces matérielles. On me parlait souvent de lui, il a restauré ça, il a fait ci, il a fait ça. Nous avions besoin de démonter la grande balustrade de la chambre de la reine et nous n'avions aucun indice concernant son démontage puisqu'elle était dorée et que tout était recouvert. Donc... Pour justement le respect de la matière, j'ai préféré prendre les précautions. Et voilà, donc je me suis renseignée et on m'a dit, eh bien le seul qui peut te renseigner, c'est celui qui l'a fabriqué. Et c'est donc Michel Tigréa. Et donc, il m'a très très bien accueilli. Ça a été une belle rencontre. Je l'ai invité à passer une journée au château. Il est venu avec ses plantes, de la grande balustrade. qu'il avait réalisé. J'en ai profité, moi, pour inviter ses anciens apprentis. Donc, une journée enrichissante, parce que Michel Tigréa est avant tout une mémoire vivante. Donc, je le questionnais sur... C'était très, très enrichissant. Et nous avons fini, ça c'était le moment, pour moi, le plus important. Nous avons fini devant cette... fameuse balustrade dorée et sculptée de la chambre de la reine qui nous a en quelque sorte réunis. On a pris une photo. Cette photo représente en fait cinq générations sur 60 ans, on va dire, de transmission. C'était génial.
- Speaker #1
J'ai toujours vécu comme un compagnon. J'avais ça dans la peau. J'ai vécu avec eux. J'étais tous connu. Ils m'ont adopté. Je savais comment tout se passait. Et finalement, je suis rentré. Dans les années 66, je suis rentré comme ça, je suis passé à Spirant et puis j'ai attendu 1974 pour passer. Compagnons, ils sont venus me chercher, ils me sont venus me chercher, j'étais en train de travailler sur la balustrade de la Rennes un soir. On était en train de tracer la chambre de la Rennes au sol. Un monsieur s'est avancé et il m'a demandé, il m'a parlé, je faisais un tracé de raccord en géométrie. Il m'a dit vous faites comme ça, j'ai dit oui. On me dit il y a des principes mieux que ça. Je lui ai dit, je connais celui-là, c'est celui que j'ai appris à l'école. Il m'a dit, vous connaissez M. Tigrin ? J'ai dit, c'est moi, j'ai besoin de vous parler. En fait, ils m'ont coopté pour que je rentre chez les compagnons. Il a fallu que je fasse un chef-d'oeuvre. Ce chef-d'oeuvre comme j'étais restaurateur Il n'accepte pas les restaurateurs Il a fallu que je fasse une pièce seule, sans modèle. Il fallait que je fasse tout ce qu'un restaurateur peut faire en neuf. Le cuir, les bronzes, la gravure et la marqueterie. J'ai fait un petit bureau, une réduction de bureau, en me mettant sur les idées du bureau Louis XV.
- Speaker #2
Et donc moi, ma carrière à Versailles a été d'améliorer, d'améliorer, de m'améliorer. Et ensuite, quand j'ai pris en charge l'atelier, c'était aussi toujours dans le cadre dans mon métier, je le répète, mais surtout aussi d'améliorer la montée en compétence de mes collègues, en organisant des formations collectives au sein de l'atelier, et aussi en tant qu'assistant à la sécurité et à la prévention, c'est-à-dire... toutes les conditions de travail de mes collègues directs, mais aussi de tous les ateliers muséographiques. J'ai changé toutes les machines à bois pour avoir des machines plus précises, plus silencieuses, qui correspondent et qui répondent surtout aux normes actuelles de sécurité. Je pense avoir contribué à suivre le vent de modernité. concernant mon métier de restaurateur, sur le plan de la réflexion, de l'approche, des techniques, l'utilisation des produits, et ainsi de suite. Oui, c'est ça, c'est l'amélioration dans toute sa globalité, on va dire, sur le plan humain, professionnel, sécuritaire, collectif.
- Speaker #1
En 1989, je prachève des ateliers des services de restaurant des œuvres d'art à la direction des musées de France. Je pars en retraite en 1992. Le château de Versailles, pour moi, représente ma maison. Elle a été ma jeunesse, elle a été mon adolescence, puis elle a été mon métier. Et une forme de liberté dans le métier de restaurateur. Je rêve, château, je rêve de mes chantiers. La chose la plus importante, c'est la transmission, l'humilité et respecter la déontologie du métier. Versailles m'habite à un tel point que je ne mets plus les pieds au château. J'ai mal quand je mets les pieds.
- Speaker #2
Versailles représente pour moi toujours ce fabuleux château, une fierté, la fierté déjà de la France. et que ça s'inscrit surtout dans une histoire de France incroyable, et de faire partie de cette histoire de France, en général, et dans cette histoire du château en particulier, va donner vraiment de la fierté et de la satisfaction. D'y avoir travaillé 20 ans, je peux dire que je dois y penser tous les jours, encore maintenant, après un an et demi, après mon départ.
- Speaker #0
Mémoire de château, une série de podcasts proposés par le château de Versailles. Sur une idée de Claire Bonnotte-Kellil, collaboratrice scientifique au château de Versailles, et de Nejma Zegaoula, chef de projet audiovisuel au château de Versailles. Écriture, prise de son et montage, Louise Réjean. Réalisation, musique et design sonore, Opixido. Mémoire de château se décline aussi en vidéo. Retrouvez tous les épisodes de la série et les contenus complémentaires sur le site officiel du Château de Versailles. Les podcasts du Château de Versailles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, dans l'application mobile du Château et sur châteauversailles.fr.