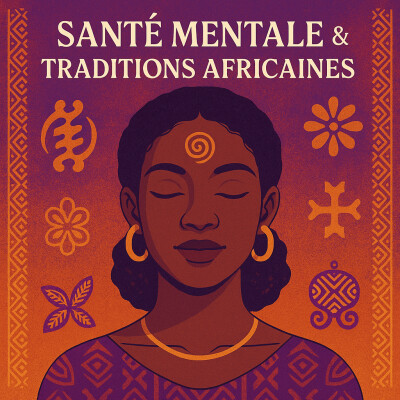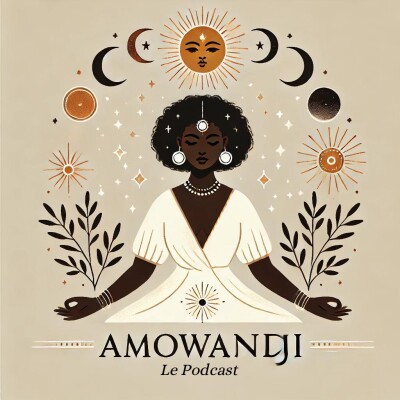Speaker #0Bonjour, j'espère que tu te portes bien parce que dans ce nouvel épisode, on va continuer sur le thème de la santé mentale dans la communauté afro, avec un point de vue très souvent mis de côté qui est celui du traitement de la santé mentale dans nos traditions africaines. Dans la première partie, si tu t'en rappelles, je parle bien évidemment de la santé mentale dans notre communauté. Pourquoi est-ce un sujet tabou ? les difficultés et je propose également quelques solutions avec des sources chiffrées, puisque plusieurs jeunes de notre communauté risquent de souffrir davantage de problèmes de santé mentale.
Et au passage, si tu n'as pas écouté la première partie, mets cet épisode en pause et va tout de suite l'écouter. Donc pour faire cette deuxième partie, j'ai eu l'aide d'un ami que j'avais déjà cité, Mabaya Lembo, qui est chercheur géographe, membre du réseau africain des jeunes chercheurs en géographie, RAJECSTER, et co-fondateur du magazine Rê-naissance. Donc il m'a recommandé ce livre qui s'intitule « Maladie mentale et thérapie traditionnelle en Afrique noire » de François Laplantine, écrit en 1976. Tu me diras de quoi parle ce livre exactement ? Eh bien, pour te résumer brièvement, François Laplantine est un chercheur anthropologue français qui a mené une enquête de terrain, notamment en Côte d'Ivoire, dans les années 70, où il s'interroge sur le traitement et la guérison des maladies mentales. Il cherche donc à savoir comment les sociétés africaines conçoivent-elles les troubles mentaux et comment les soignent-elles. Il ouvre ce sujet pour que le lecteur occidental, le lecteur blanc de surcroît, ait une autre façon de comprendre la folie, la maladie mentale et que la médecine africaine n'est pas une science archaïque. La plantine dit en pages 1 et 2, j'ouvre les guillemets, je cite, « Né de l'étude de la maladie mentale dans une société de Côte d'Ivoire, jaillit la conviction qu'il existe en Afrique des connaissances et des pratiques psychiatriques absolument originales qui ne doivent rien au savoir médical de l'Occident et qui sont simultanément la célébration d'un culte. » Les recherches de M. Laplantine nous permettent de comprendre que, dans nos sociocultures africaines, la maladie mentale n'est pas toujours vue comme un simple dysfonctionnement psychique. Elle peut être aussi le signe d'un déséquilibre spirituel, d'un conflit avec les ancêtres ou alors d'un interdit transgressé.
Toujours selon Laplantine, elle forme un système cohérent, ancré dans la culture et la communauté. Il interroge également la frontière entre médecine et superstition, tout en valorisant la fonction sociale de ces croyances. Par ailleurs, les guérisseurs sont vus comme des thérapeutes de l'âme. Face à ces troubles psychologiques, ce ne sont pas les hôpitaux psychiatriques qui interviennent en premier lieu, mais les thérapeutes traditionnels qu'on appelle communément les nganga. Ils soulignent l'importance des nganga. guérisseurs traditionnels, tradipraticiens, enfin c'est des docteurs, pour moi ce sont des médecins, des docteurs. Notamment quand la médecine moderne échoue, donc Laplantine, met en avant l'utilité, la nécessité des nganga.
Le nganga n'a pas que le rôle de diagnostic et de thérapeute d'ailleurs, parce qu'il ne soigne pas que le corps, mais il va au-delà du corps, en soignant aussi l'esprit par le biais de sa parole qui est puissante. Car, la plantine dit en page 51, en Afrique tout commence et tout finit par la parole. Les docteurs, nganga, de nos sociocultures, procèdent à des rituels de rééquilibrage, utilisent des objets symboliques et convoquent des forces invisibles pour rétablir l'ordre. C'est une thérapie collective, orale et sacrée, qui replace la personne malade dans un tissu social et spirituel. En page 7 du même livre, Il dit que chez les Baoulés, On domestique parfois la maladie. Elle est accueillie, écoutée, interrogée. On lui trouve un lieu, un nom, une fonction au sein du groupe. Ainsi, elle cesse d'être brute et violente et devient un élément du discours communautaire. Il évoque aussi le fait que l'on ne guérit pas simplement une personne, mais on tente de rétablir l'harmonie entre l'individu, ses ancêtres et les forces invisibles. Le rituel thérapeutique se présente alors comme un acte symbolique dont l'efficacité repose sur le sens commun accordé par tous ses participants, propos que vous pouvez retrouver en pages 4 et 5 du livre.
Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces pratiques ? de ces thérapies. Que reste-t-il ? Que font nos gangas ? Dans les diasporas afrodescendantes, ce lien au sacré reste quand même présent, même si l'écrasante majorité est soit de confession chrétienne ou de confession musulmane. Même si on consulte un psychologue ou un psychiatre, beaucoup de personnes cherchent aussi un équilibre à travers la spiritualité, les religions, les cercles de parole, etc.
Et si finalement, le soin de l'âme passait par un retour vers notre héritage ? Et si nos ancêtres détenaient eux aussi une forme de psychologie, mais racontée autrement ? C'est ce dont je suis intimement convaincue, puisqu'il suffit de creuser un peu plus sa tradition pour en savoir un peu plus d'ailleurs.
Je vais conclure. Pour moi, ce que je retiens de ce livre, c'est qu'il jette un regard critique et respectueux sur les savoirs thérapeutiques africains. Il les replace dans une logique culturelle propre, éloignée du regard médical occidental qui est très dominant.
Pour Laplantine, l'un des grands malentendus vient justement du regard colonial et occidental. qui a volontairement dénigré cette science ancestrale comme irrationnelle, folklorique, voire dangereuse. Mais en réalité, elles répondent à d'autres logiques, d'autres paradigmes, d'autres besoins, où l'individu ne se soigne pas seul, mais à travers le groupe, les ancêtres et les rituels. En fait, la guérison est communautaire, puisque moi je crois sincèrement que ce n'est pas l'individu qui fait la communauté, mais la communauté qui fait l'individu. Si une personne est malade, c'est la communauté qui risque d'en pâtir. Et si la personne est en bonne santé et guérie, c'est la communauté qui est guérie.
La santé mentale dans la communauté afro ne peut pas être comprise sans que l'on se tourne vers notre propre culture. Les chinois ont leur propre médecine. Ainsi que les indiens par exemple. Mais nous, nous allons malheureusement toujours prendre chez les autres alors que notre culture est très riche. Encore une fois, il faut avoir l'esprit de curiosité et de chercher. Ce que nous appelons aujourd'hui thérapie alternative, nos ancêtres l'ont expérimenté bien avant.
Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie sur la santé mentale dans la communauté afro-descendante. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter. Partage cet épisode autour de toi. Un commentaire, 5 étoiles, pourquoi pas. Et n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux.
C'était Amowandji, le podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode. Kwaeri ! ça veut dire au revoir en Kiswahili.
Merci à toi.