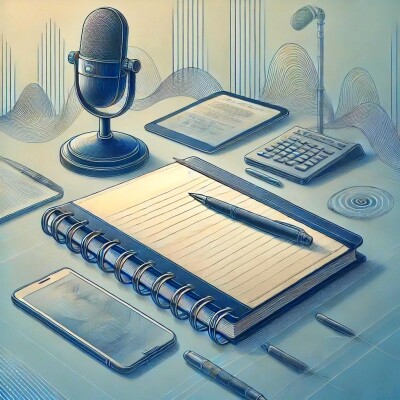Speaker #0Carnet de bord du Mediatrainer, une série de podcasts pour parler de la communication et de la prise de parole médiatique à travers le regard d'un Mediatrainer, pour partager analyse, réflexion et éléments de méthode. Dans cet épisode, on va parler des footballeurs et à travers eux d'un enjeu oratoire un peu particulier et je trouve un peu tabou, celui de l'adaptation sociale du discours lorsque des orateurs doivent prendre la parole dans des cercles ou des environnements socioculturels. auxquels ils n'appartiennent pas ou, du moins, ne se sentent pas appartenir. En la matière, les choses sont toujours très relatives. Alors, pour commencer, cet épisode est l'occasion pour moi, d'abord, de partager mon expérience dans le monde du football et l'occasion aussi, au passage, de remercier ceux qui ont bien voulu éclairer ma lanterne sur le fonctionnement de ce milieu clos au moment où je cherchais à y travailler et ceux aussi qui m'ont fait confiance. Je suis intervenu entre 2018 et 2020 au sein de l'OL Academy, c'est-à-dire le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, avec mon excellent associé à l'époque, Anaïs Coque, que je salue au passage, pour des séances de media training auprès de ce qu'on pourrait appeler les pré-pros, c'est-à-dire les jeunes en formation, sur le point, s'ils en avaient le niveau requis, de signer en équipe professionnelle ou du moins de jouer dans le monde du football professionnel. Pour ça, je veux remercier Jean-François Villiers, qui a dirigé à l'époque le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, et qui nous a ouvert ses portes, ainsi que d'ailleurs l'excellent Philippe Bruet, journaliste qui était aux origines de l'émission Jour de Foot sur Canal+, à la grande époque, et qui est officier à l'Olympique Lyonnais, notamment pour OLTV, ainsi que pour le média training des joueurs pros. Je veux aussi dire un grand merci d'ailleurs au passage à Samba Diawara, qui est, au moment où j'enregistre ce podcast, l'entraîneur du stade de Reims en Ligue 1. et qui, avec son frère Fousseni, qui est également footballeur professionnel et international malien, ont tous les deux pris le temps de m'expliquer la logique et le fonctionnement du foot professionnel de l'intérieur. Anecdote amusante, lorsque j'ai rencontré les deux footballeurs par l'intermédiaire de Sadia, le troisième frangin de cette talentueuse fratrie puisque Sadia est producteur dans le cinéma, je sentais bien qu'il pensait que j'étais d'abord venu pour leur gratter les 0-6 de quelques vedettes du ballon. Il a fallu une après-midi d'échanges et de discussions pour qu'ils arrivent à croire que ce qui m'intéressait d'abord, c'était avant tout de comprendre ce qui fait que tant de joueurs professionnels fassent des sorties de route communicationnelles aussi régulièrement. L'idée pour moi était de comprendre s'il n'y avait pas quelque chose à faire en amont, lorsque l'argent et la gloire n'ont pas encore totalement corrompu les esprits, et si, au niveau de la formation initiale des footeux, on ne pouvait pas mettre en place quelques garde-fous stratégiques en matière de discours public et médiatique. Alors ça, c'est, je crois, une réflexion qui était partagée du côté de l'Olympique lyonnais, qui, dans son centre de formation, avait mis en place une série de modules pour justement faire travailler les jeunes espoirs sur certains enjeux extra-footballistiques. Alors j'y reviendrai, mais je dois d'abord vous dire qu'elle a été aussi le déclencheur de cet épisode particulièrement, au-delà de son intérêt sur le plan du media training et de la réflexion autour du discours. Cet été, avec les Jeux Olympiques et l'enthousiasme immense que cet événement a suscité, on a vu émerger des figures comme Léon Marchand ou les Frères Lebrun. Ces sportifs, invités dans tous les médias, semblaient naturels, sincères, joyeux et ont créé un effet de contraste assez violent avec l'image des footballeurs. D'ailleurs, dans les médias spécialisés, dans le foot notamment, on a vu quelques articles fleurir sur le mode A, si les footballeurs pouvaient s'inspirer des athlètes olympiques. Dans ce... Ce contraste, l'agacement que peut provoquer le discours souvent insipide et bancal des footballeurs quand il ne s'agit pas de leurs excès et de leurs dérapages, a soudain paru encore plus coupable en regard de la sympathie qu'évoquait nos Olympiens. Je pense que cet épisode a été salutaire et j'espère qu'il laissera des traces dans l'esprit de quelques-uns dans le milieu du football et qu'il a permis de faire comprendre, si besoin en était encore, que la communication des sportifs professionnels. et des footballeurs en particulier, n'est pas une coquetterie optionnelle. Il y a toutefois dans les commentaires de l'été 2024 et des Jeux Olympiques des biais qui m'ont profondément agacé. Alors je ne veux pas faire de ce podcast une tribune, donc je vais le dire de façon un peu rapide, mais mon agacement, qui est partagé d'ailleurs de manière silencieuse par beaucoup, tenait au fait qu'on comparait la qualité médiatique de sportifs dans la lumière pendant 15 jours à l'occasion d'un événement qui avait tout de festif et de positif. à celles de footballeurs comme Kylian Mbappé qui, depuis 10 ans, sont scrutés et commentés 24h sur 24. J'attendrai de voir les frères Lebrun, par exemple, sous une telle pression médiatique sur une aussi longue période, pour me permettre de faire des comparaisons qui, en l'état, sont à mon avis à la fois malhonnêtes, politiquement biaisés pour beaucoup et intellectuellement complètement bancales. Qu'on n'aime pas les footballeurs, ça peut se comprendre, mais je vous en conjure, ne sacrifiez pas votre esprit sur l'autel de vos ressentiments, cela ne produit jamais rien de bon. A bon entendeur. Dans ce fatrat de commentaires, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de vous partager mon expérience dans ce milieu du football et peut-être d'apporter quelques pistes de réflexion sur le discours médiatique des footeux et surtout ce qu'ils racontent de la dimension sociale et culturelle du discours. Les footballeurs, on va pas se mentir, ça fait un bail que tout le monde les prend pour des cons. Ce n'est pas l'épisode du bus en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2010, pas plus que les tournures de phrases créatives de Franck Ribéry. Ou encore les coups tordus de Benzema qui ont fait naître cette déconsidération assez française à l'endroit des footballeurs professionnels. Si l'on remonte dans le temps, on se souviendra, par exemple, parmi d'autres, des marionnettes des guignols de l'info de Canal+, celles de Jean-Pierre Papin, de Didier Deschamps, ou même de Platini, toutes très attachantes mais complètement débiles. De manière plus générale, le foot en France n'a pas une bonne image. C'est un sport de beauf, comme on dit, mais comme en France on n'est pas à une contradiction près, c'est aussi le sport le plus populaire. C'est aussi parce qu'il est populaire, mais désormais extrêmement financiarisé, qu'il suscite encore plus de débats, de passions et aussi toujours plus de ressentiments. Ce qui m'intéresse en tant que médiatraineur, c'est de comprendre comment les individus peuvent faire évoluer leur discours, quels que soient les affres et les dérives du milieu dans lequel ils évoluent. J'ai pris conscience de choses assez simples, mais fondamentales je crois, en travaillant à l'Olympique Lyonnais et au sein de l'OL Academy. Pour la faire simple, l'observateur qui découvre le monde de la formation de haut niveau en foot peut être interpellé par plusieurs éléments. D'abord, l'organisation quasiment militaire des journées pour les jeunes. Ensuite, le culte de l'idée de performance qui imbibe jusqu'au langage même de ces jeunes qui ont entre 15 et 17 ans. Et puis enfin, un rapport assez vertical avec l'institution qui les forme, et en même temps, une grande camaraderie et une franche proximité avec tous les membres du staff. Alors sur le plan de la formation des joueurs eux-mêmes, sur une promotion d'une vingtaine de jeunes par exemple, seuls quelques-uns sortiront réellement en professionnels. le plus gros de la troupe d'ailleurs dans les échelons intermédiaires du football professionnel et une infime minorité percera à haut niveau. La sélection est donc très rude et les jeunes le savent et ce qui est curieux c'est qu'on sent à la fois une grande immaturité sur certains plans, ce sont des jeunes qui sont turbulents, rigolards et impertinents et en même temps une extrême maturité sur d'autres plans et notamment sur le comportement sportif. Pour l'observateur non averti ça peut être assez étonnant. L'engagement extrême de ces jeunes pour leur sport les rend le plus efficaces possible sur un terrain, mais par contre tend à rigidifier leur esprit lorsque celui-ci est mobilisé dans d'autres champs que le football. Et ça, en fait, ça arrive dans bien d'autres domaines. Je pense notamment aux ingénieurs, aux scientifiques de manière générale, qui, parce qu'ils ont souvent des esprits conditionnés à l'efficience dans leur discipline, leur domaine, perdent parfois la plasticité nécessaire pour exprimer leur expertise de façon plus ouverte. plus créative ou même la vulgariser et notamment face aux caméras. Alors pour en revenir à nos footballeurs, les plus talentueux d'un centre de formation peuvent se retrouver très vite dans le viseur de grands clubs européens alors même qu'ils sont toujours en formation et ces clubs n'hésitent pas à tenter de débaucher ses pépites au nez et à la barbe du club concurrent. Alors quand ils sont très bons certains jeunes comprennent aussi très vite qu'ils deviennent l'objet d'enjeux qui les dépassent. financiers ou même politiques d'une certaine manière et qu'ils sont tiraillés entre la reconnaissance pour le club formateur et les lumières des grands clubs qui les font rêver depuis tout petit. Pour certains, les sélections dans les équipes nationales de jeunes leur donnent aussi un avant goût du poids que cela représente de porter les couleurs de leur pays et si la fierté est réelle, la prudence est de mise et le langage se fait discret pour ne pas faire de vagues. Enfin quand vous êtes en formation à ce niveau, presque professionnel, vous passez votre vie dans un milieu clos. Le football est réputé pour être un environnement extrêmement hermétique. Pour les jeunes, c'est évidemment un facteur d'appauvrissement intellectuel, mais il faut cependant saluer les initiatives prises par de nombreux clubs, particulièrement en France, pour ajouter à leur formation sportive des éléments d'ouverture sur les enjeux de citoyenneté, par exemple. J'ai pu le voir à Lyon, où Jean-François Bulliez a fait un travail très important à ce niveau-là, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres clubs en France. Pour le média trainer, la question est assez simple. Comment aider des jeunes, dans ce contexte si particulier, à développer leur discours pour à la fois valoriser leur image de marque, qui va très vite devenir un enjeu central dans leur carrière, tout en restant dans une forme de maîtrise importante dans un environnement aussi sensible que le football professionnel ? Avant même de parler des médias, il faut parler de l'entourage des clubs, les sponsors, les partenaires, les dirigeants, tout un maillage d'interlocutions qui n'ont d'ailleurs rien de propre au foot. mais qui pour des gamins qui n'auront pas été préparés sont de réels défis. Alors quand on arrive en haut du panier, là où les caméras apparaissent plus régulièrement, ça peut devenir parfois très compliqué. Si vous ajoutez à cela la caisse de résonance des réseaux sociaux, où chaque joueur sait qu'il peut désormais être livré en pâture aux sélectionneurs de dimanche assis dans leur canapé, et vous avez des gamins de 18-19 ans qui doivent à la fois gérer la passion parfois malsaine des fans, le ressentiment social aussi que les revenus supposés qu'ils touchent génèrent, et en plus l'impitoyable sélection sportive. Dans un tel contexte, comment s'étonner que la plupart des jeunes professionnels optent pour le mutisme et la prudence quand il s'agit de prendre la parole ? Du côté du grand public, qui voit ou entend les fouteux dans les médias, c'est guère plus indulgent. Comme les footballeurs sont payés largement au-dessus de la moyenne, même à des niveaux plutôt subalternes, pour en plus, comble de l'indécence, faire le métier qui les fait rêver depuis tout jeune, n'en jetez plus, à la première langue qui fourche, à la première formule maladroite, il s'agira pour le Pékin lambda. de les brocarder avec la sévérité d'un recteur d'académie. Dans ce contexte, le gros de la troupe se cantonne à des messages pauvres et des expressions plates et sans saveur. C'est ici que se forgent les éléments de langage caricaturaux défouteux. L'importance est les trois points, et autre l'importance est le collectif. Il existe bien entendu des exceptions, mais c'est en observant ces exceptions qu'on souligne la règle. En France, on a une grande exception en matière de communication, c'est Kylian Mbappé. On comprend en creux, quand on observe son parcours, que l'attention de son entourage, Pour tout le parasportif, et notamment pour la communication, on sans doute était d'une grande utilité et formé le sportif à garder la maîtrise de son discours, tout en lui permettant de développer progressivement une grande adaptation au contexte et à ses enjeux. Peu de footballeurs ont produit des discours aussi incarnés, maîtrisés dans le contenu et la formulation, et cherchant à s'appuyer sur ce qu'on va appeler des valeurs ou des convictions. En France, et dans un registre un peu différent, Et à un niveau vaguement comparable, il faut remonter à sans doute, je dirais, Éric Cantona pour retrouver un tel niveau de maîtrise du discours, ou même plus récemment à un Thierry Henry. Pour le reste, et jusqu'à récemment, on avait deux écoles. Ceux qui ne disent rien et enfilent des perles en attendant que le rage passe, et ceux qu'on entend surtout pour leur bourde ou leur dérapage. Alors est-ce que les bourdes sont de la communication ou est-ce qu'elles deviennent un objet de communication parce que ce sont des bourdes ? Ça c'est une autre question. On observe cependant un progrès général depuis, je dirais, le milieu des années 2010. Le rôle des réseaux sociaux, et surtout des réels, depuis Snapchat jusqu'à TikTok, est assez impressionnant. Les plateformes ont agi comme une sorte de catalyseur d'une parole plus déliée, bien que totalement formatée. A force de se filmer pour leur propre communauté, sans avoir à trop s'adapter à des cénacles qu'ils ne connaissent pas, les footballeurs se sont en quelque sorte auto-médiatraînés. Alors cela va. Pas sans risque, puisqu'on a vu certains, comme Serge Aurier à l'époque au Paris Saint-Germain, insulter Laurent Blanc, son entraîneur de l'époque, lors d'un live sur le réseau Periscope. Tant qu'il s'adresse à des communautés captives, les jeunes en particulier, les footballeurs n'ont pas trop à s'adapter et ils maîtrisent naturellement les codes des plateformes. En revanche, dès qu'il faut sortir en conférence de presse, là on retrouve encore trop souvent des paroles trop rigides, des récitations ineptes et des adaptations désastreuses. En gros, et malgré de réels progrès en général, le problème des footballeurs reste le même et les conseils à leur donner sont à mon avis moins rhétoriques que psychologiques. Ce qui est en jeu ici ne concerne pas que les footballeurs d'ailleurs. Dans mon parcours de médiatraineur et de coach, j'ai croisé bien des profils ayant vécu des trajectoires sociales particulières qui leur imposaient des adaptations profondes et parfois complexes. Les footballeurs ne sont pas de mauvais communicants par nature et justement, ce qui ne fonctionne pas dans la plupart des cas, C'est le curseur d'adaptation de la posture. Lorsqu'il ne s'adapte pas du tout et qu'il parle en public ou dans les médias comme dans le vestiaire, il heurte les publics et qu'il les prenne pour des sauvages. C'est de plus en plus rare cela dit et c'est heureux. Mais à l'autre bout, lorsqu'il s'adapte trop, lorsqu'il cherche de manière forcée à bien parler comme il imagine qu'on parle bien en dehors du milieu du football, alors il ressemble à des caricatures de Monsieur Jourdain. A mon sens, la clé pour eux est moins la maîtrise des techniques oratoires qu'une forme de stratégie personnelle. d'adaptation pour ce n'est juste et vrai. Tenter de s'adapter, c'est paradoxalement la meilleure manière d'être authentique. C'est un des paradoxes que j'évoque souvent dans ce podcast. Alors, attention, c'est vraiment être soi dans une situation à laquelle on s'adapte vraiment. C'est en quelque sorte montrer au public à qui on s'adresse qu'on comprend la situation dans laquelle on s'exprime et qu'on y trouve naturellement sa place, sans artifice ni dissonance. S'adapter requiert beaucoup de lucidité et de détermination psychologique. Ce n'est pas donné à tout le monde, et pour ça le médiatraineur, à défaut de médiatraining à proprement parler, peut être un excellent sparring partner pour entraîner la capacité d'adaptation. Le reste, la technique, viendra avec la confiance précisément aussi parce que ces athlètes sont habitués à la notion de performance. Mais pour être performant, il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Et sur ce plan, celui de la communication, les jeunes footballeurs... bolleurs sont sans doute encore trop peu épaulés. Dans ce podcast, j'essaye pour chaque épisode de partager des expériences avec des publics particuliers ou sur des enjeux précis. Dans cet épisode, le sujet est donc l'adaptation au code des environnements dans lesquels on doit s'exprimer. Quand on pense à ce sujet, on imagine assez facilement le profil d'une personne issue de milieux populaires accédant à des fonctions professionnelles la projetant dans un environnement social différent. C'est assez classique, et quand je parle des footballeurs, c'est ce que j'évoque en fait. Ils sont souvent issus de territoires défavorisés, de la ruralité au quartier populaire, en passant par toutes les diagonales du vide que la France peut compter. On leur demande avant tout d'être surperformants sur les terrains, et quand ils finissent par exploser et devenir de grands joueurs, ils découvrent qu'ils doivent s'adresser à des publics qui ne sont plus seulement leurs coéquipiers ou leurs staffs de leur équipe. Des publics qui par ailleurs projettent sur eux la passion mais aussi les ressentiments que ce sport engendre. Si la communication des footballeurs est souvent mauvaise et par là même agaçante pour les publics, la déconsidération en retour est souvent aussi excessive. Ce n'est toutefois pas au public de s'adapter mais aux émetteurs, en l'occurrence aux footballeurs. Le cas des footballeurs n'est pas un cas unique. Vous l'aurez peut-être vécu vous-même, le fait par exemple de passer d'une fonction support à un rôle de manager dans le monde de l'entreprise. ou d'un statut de militant à celui d'élu en politique peut exercer une pression sur votre discours précisément parce qu'il interroge votre capacité d'adaptation, notamment sociale. En l'occurrence, vouloir compenser cette pression par une approche technique purement oratoire est une erreur. Le premier pas vers la maîtrise d'un discours dans un environnement pour lequel vous ne maîtrisez pas les codes, c'est de comprendre la place que vous y avez, votre légitimité et vos responsabilités, ce qui vous appartient et ce qui s'impose à vous. Et toujours prendre les deux en compte, et pas seulement votre singularité. Ça, ce serait une autre erreur nourrie, pour le coup, par les impasses du développement personnel. J'ai conscience qu'il s'agit là d'un sujet qui s'éloigne du media training à proprement parler, mais comme j'ai souvent croisé la route de ces profils, dans le foot comme ailleurs, à des moments où ils devaient s'exprimer dans les médias, j'ai pu mesurer la difficulté de travailler sur le discours sans cette réflexion sur l'adaptation au préalable. En fin de compte, la question de l'adaptation du discours dépasse largement le cadre des footballeurs. C'est un enjeu qui touche toutes celles et ceux qui doivent évoluer dans des environnements dont ils ne maîtrisent pas immédiatement les codes. Pour les joueurs de football, comme pour d'autres profils en transition sociale ou professionnelle, la clé ce n'est pas de réciter des formules creuses ou de se travestir dans un rôle qui sonne faux. Non, la clé c'est de trouver la posture juste, celle qui permet d'être compris sans se renier. La communication ce n'est pas une question de technique pure, c'est une affaire de lucidité et d'ajustement. Et au final, ce n'est pas tant bien parler quiconque. mais parler vrai, au bon endroit et au bon moment. C'était le quatrième épisode de Carnet de bord du Mediatrainer, je suis Julien Crosse et je vous dis à très bientôt.