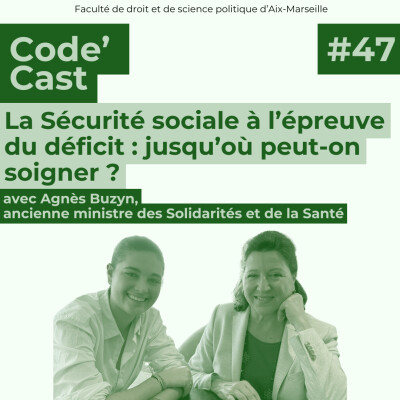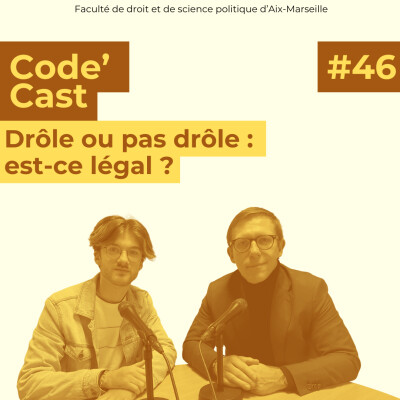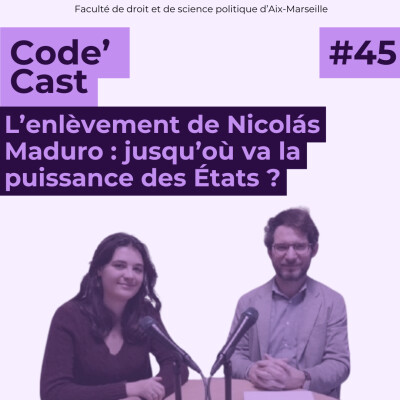- Speaker #0
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CodeCast. Aujourd'hui, nous allons dépoussiérer un pan de l'histoire de la faculté de droit d'Aix et remonter jusqu'à l'automne 1900. C'est à cette date que la faculté de droit d'Aix se féminise et accueille ses premières étudiantes. Pour aborder ce sujet, nous avons la chance d'accueillir Mme Sarah Ferrand, doctorante rattachée contractuelle au Centre d'études et de recherche d'histoire, des idées et des institutions politiques d'Ex-Marseille Université et au Centre d'histoire du droit et d'anthropologie juridique de l'Université libre de Bruxelles et aussi également chargée d'enseignement. Sarah, pourrais-tu te présenter rapidement et nous parler de ton parcours et de tes recherches ?
- Speaker #1
Bonjour Virginie. Bonjour à tous, je remercie l'équipe du Codecast de m'accueillir aujourd'hui et pour l'invitation qu'ils m'ont fait. Alors tout d'abord j'ai commencé par une licence en droit que j'ai effectuée à l'Université de Toulon avant de rejoindre le master en histoire du droit et des idées politiques à Aix-Marseille Université. Je suis actuellement en quatrième année de doctorat que j'effectue en co-tutelle entre Aix-Marseille et l'Université libre de Bruxelles et je suis sous la direction des professeurs François Kouastana et Jérôme Debrouwer. Mes recherches, elles portent sur la question du droit des femmes au... tournant des 19 et des 20e siècle à la fois en France, en Belgique et en Suisse. Et plus précisément j'analyse les revendications formulées par les mouvements féministes de ces époques et sur comment ces hommes et ces femmes se sont engagés pour œuvrer à l'amélioration de la condition civile de la mère et de l'épouse. Mais également je m'intéresse à leur entrée dans l'espace public qui se traduit par l'accès à l'instruction, à l'ensemble des carrières notamment supérieures. les questions de l'égalité de rémunération, ainsi que le bénéfice des droits politiques. Et c'est lors de mon intervention au colloque sur René Cassin que je me suis intéressée aux premières étudiantes de la faculté d'Aix.
- Speaker #0
Merci beaucoup, c'est passionnant de voir à quel point la diversité des recherches éclaire notre compréhension du monde d'aujourd'hui. Comme tu me l'indiquais enregistrement, ce n'est que très récemment, à l'échelle de l'histoire, que les facultés de droit en France ont accueilli sur leur banc des étudiantes. A quand cela remonte-t-il et est-ce que tu peux nous en dire davantage ?
- Speaker #1
Alors tout d'abord, il faut faire un petit retour en arrière. Car en effet, le frein principal de l'accès des femmes à l'université, c'est l'absence d'enseignement secondaire féminin public, et ce avant la loi Camissé du 21 décembre 1880. Malgré ce frein, on a quand même des femmes qui vont tenter de conquérir les diplômes universitaires, et ça débute avec Julie-Victoire Daubier en 1861, qui sera la première bachelière en lettres. C'est une femme âgée de 37 ans et elle conquérira ce diplôme à l'université de Lyon. Ensuite, la première femme qui obtient une licence, c'est en sciences, en mathématiques exactement, ça intervient en 1868. Progressivement, toutes les études vont se féminiser et les premières étudiantes en droit n'interviendront et n'arriveront que deux décennies plus tard, au cours de la période 1880. D'une part, une roumaine, La Sarmisa Bilchescu, suivie d'une Françaisne, Jeanne Chauvin, le nom est peut-être plus évocateur. Il faut bien voir qu'à cette époque, les femmes qui entrent dans l'enseignement supérieur ont dû lutter avec les préjugés de leur époque. On a par exemple opposé à Sarmisa Bilchescu que les femmes n'entrent pas à l'école de droit de Paris. Il a fallu que le conseil facultaire statue avant qu'elle ne soit autorisée à suivre des études. au sein de cette même faculté de droit de Paris. Mais on voit progressivement que les positions des professeurs vont se libéraliser. Tout simplement parce que le professeur de droit civil Charles Bedan, qui a refusé que Sarmisa Bilchescu suive les cours à l'université de Paris, va en fait diriger la thèse de doctorat de Jeanne Chauvin, et ensuite admettre dans son cours de droit que, sans être un partisan du mouvement féministe, on peut estimer qu'il y a dans la loi et la pratique Quelque chose à modifier malgré tout.
- Speaker #0
C'est vraiment passionnant de connaître tout ça. Est-ce qu'on connaît l'identité des premières étudiantes à la faculté de droit d'Aix ? Et comment as-tu retrouvé leurs traces ?
- Speaker #1
Alors, pour répondre déjà à la question de leurs traces, c'est en consultant en réalité les registres d'inscription de la faculté de droit d'Aix, qui sont conservés aux archives départementales de Marseille, que j'ai remonté leurs traces. C'est là que j'ai trouvé tout d'abord Marguerite Hinnard, qui est en fait la première femme à s'inscrire à la faculté de droit d'ex, et ce le 15 novembre 1900. Pourquoi je précise cette date ? Tout simplement parce que deux jours auparavant est votée au Sénat la loi qui autorise les femmes munies du diplôme de licence à obtenir le titre et à exercer la profession d'avocat. Donc ce n'est pas un hasard des dates à mon sens. Ensuite je me suis intéressée à la féminisation de la faculté, une fois que j'avais retrouvé cette pionnière. Et j'ai trouvé le nom de Marie-Thérèse Hinnard pour l'année 1906-1907. Et en consultant les registres d'état civil, j'ai pu établir qu'elles étaient sœurs. Sachant que Marie-Thérèse, elle est née des deux, même si elle s'inscrit après Marguerite. Concernant Marie-Thérèse, si elle s'inscrit effectivement à la faculté de droit d'Aix, elle terminera ses études à l'université de Lyon, dont est déjà diplômée son frère aîné, Gabriel. Marguerite, elle, elle effectuera l'intégralité de son cursus. à la faculté de droit d'Aix. Elle est même très bien intégrée dans le milieu étudiantin de l'époque, puisqu'en fait, elle est membre de l'association générale des étudiants d'Aix, et elle participe à la rédaction de la revue La Provence Universitaire, qui est d'ailleurs, dont les ouvrages sont conservés sur Odyssée, donc dans la bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. Et dans cette revue, on apprend qu'elle prêtera serment devant la cour d'appel de Nîmes, et s'inscrira au barreau d'Avignon dès 1906. Sa sœur, quant à elle, prêtera serment devant la cour d'appel d'Aix en 1910. Ça ne sera pas la première, mais la deuxième femme à prêter serment devant celle-ci, et s'inscrira au barreau de Marseille, où en fait elle rejoint sa sœur aînée. Euh, sa sœur cadette, excusez-moi. Concernant leur carrière, Marguerite poursuivra sa carrière jusqu'à son décès prématuré en 1924. Elle est à peine âgée de 40 ans. Tandis que sa sœur, elle se mariera en 1930, donc elle exercera sous un autre nom, maître Bruel-Inard, du nom... de son mari, et elle deviendra en 1951 la doyenne d'âge des avocates de France à près de 78 ans. Une grande longévité dans la profession. Autre point qu'il est important de rappeler, ce sont toutes les deux des féministes engagées. Et comment se traduit leur engagement ? Par le biais de conférences qu'elles effectuent, à la fois sur le droit des femmes, le féminisme, la femme à travers les âges et les carrières féminines. Cet engagement débute très tôt, une petite anecdote, en 1906, Marguerite, qui est alors inscrite à la Conférence des avocats, défendra le droit pour les femmes d'être inscrites au tableau de l'ordre des avocats, mais également le droit d'être nommée bâtonnière. Autre revendication qu'elles vont défendre, l'accès pour les femmes aux différentes carrières juridiques, et notamment l'accès à la magistrature. Enfin, ce sont des suffragettes actives. Marie-Thérèse est par exemple interrogée dans un panel à la suite du vote du décret du 21 avril 1944 pris par le général de Gaulle, et elle déclarera que le droit de vote est pour la femme un nouveau pas vers son émancipation totale.
- Speaker #0
Peut-on dire que leur inscription était une victoire du mouvement féministe de l'époque ou c'est simplement une relecture contemporaine ?
- Speaker #1
Il ne s'agit pas d'une relecture contemporaine, puisque les sœurs Inard, si elles ont été effectivement de véritables féministes, Elles ont été surtout les bénéficiaires directs d'un certain nombre de revendications féministes qui ont abouti. Je pense à l'accès à l'enseignement supérieur, mais également à la profession d'avocat. Il faut bien comprendre que la majorité, sinon la totalité des droits obtenus par les femmes, elles procèdent vraiment de l'activité des réseaux féministes de la seconde moitié du XIXe siècle. En fait, sans l'engagement de ces femmes et de ces hommes, puisque le terme de féministe se décline également au masculin, la conquête des droits des femmes aurait été plus longue, voire même impossible. Il ne faut vraiment pas sous-estimer qu'il y a un phénomène véritablement d'élaboration du droit par le bas, et que ce n'est jamais un octroi généreux de la part des parlementaires de ces droits, qui à cette époque, je le rappelle, sont tous des hommes. Et cette réflexion elle vaut par exemple pour le décret du 21 avril 1944, qui par le général de Gaulle, c'est vraiment une conquête de ce droit de vote qui a... étaient entamées sous la Deuxième République, soit un siècle plus tôt.
- Speaker #0
D'accord, et autrefois aussi, les femmes étaient donc, comme tu dis, peu nombreuses à fréquenter l'université, tandis qu'aujourd'hui, elles constituent une majorité des étudiantes dans les amphithéâtres. Est-ce que tu disposes de statistiques qui illustrent cette féminisation ? Et cette évolution se reflète-t-elle également dans les métiers du droit et au poste à responsabilité ?
- Speaker #1
Alors... Pour répondre à la question, je vais refaire un petit rappel historique, puisque toutes les carrières juridiques, il faut bien le comprendre, ne s'ouvrent pas aux femmes. à la même époque. Celle d'avocat, comme j'ai pu le rappeler, c'est à partir de 1900. Celle de commissaire priseur, c'est déjà plus tardif, 1924. Si on accueille les premiers agrégés et professeurs de droit autour des décennies 1930-1940, il faut bien voir que la majorité des carrières juridiques s'ouvrent après l'obtention du droit de vote. C'est le cas pour la profession de greffier, de magistrat, de notaire, d'avoué ou d'huissier. A propos des statistiques... plus actuelle, c'est véritablement autour des années 1980 qu'on assiste à une véritable féminisation des professions juridiques et judiciaires. Progressivement, les études de droit deviennent féminines, tout simplement parce que les femmes représentent plus de 60% des effectifs au sein des facultés de droit. Mais il faut bien voir que ça ne se traduit pas nécessairement dans toutes les carrières juridiques, puisque dans certaines, et là je parle de 2019, en 2019, on compte dans certaines professions moins de 30% des femmes. en leur sein. Par exemple, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation notamment. Et pour avoir consulté les statistiques de la mission égalité femmes-hommes d'ex-Marseille Université qui sont effectuées sur la période 2016-2022, c'est le même constat. Une surreprésentation des femmes au sein de la population étudiante en licence et en master, ça tend à devenir paritaire à partir de l'entrée en doctorat. Mais... Au sein de la profession d'enseignant-chercheur, les femmes demeurent malgré tout sous-représentées. C'est moins le cas à propos de celles qui ont le titre de maître de conférence. Par contre, le titre de professeur d'université est encore largement masculin.
- Speaker #0
Merci infiniment Sarah pour tous ces précieux éclairages et recherches. L'étude de l'histoire du droit est non seulement indispensable, mais c'est aussi une source d'inspiration et de compréhension profonde. Elle nous rappelle... Aussi de ne jamais sous-estimer l'importance cruciale de l'accès à l'instruction des femmes encore inaccessibles ou rendues inaccessibles dans certaines régions du monde à l'heure actuelle. Nous espérons que cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à nous faire vos retours. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous. Au revoir.