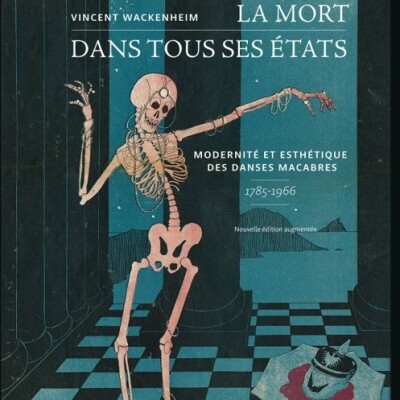Marie GillesBonjour, je m'appelle Marie Gilles, je suis designer et artiste, passionnée par les cimetières et l'art macabre. Je parcours inlassablement la Bretagne pour en découvrir les lieux et les curiosités les plus insolites. En septembre 2023, j'ai eu l'honneur d'animer une visite guidée de l'ossuaire de Saint-Fiacre dans les Côtes d'Armor, lors du vingtième congrès international de l'association Danses Macabres d'Europe, dont je suis membre. Saint-Fiacre est une commune de 220 habitants. Son église date du quinzième siècle et a été reconstruite à la fin du dix-neuvième siècle. Le portail de la façade sud et l'ossuaire sont classés Monuments historiques depuis 1915. L'ossuaire, quant à lui, date du XVIe siècle. Il abrite huit boîtes à chef, exposées sur une étagère. Le mot « chef » désigne, dans ce contexte, la tête d'un mort. Ces boîtes à crâne sont exceptionnelles, car elles font partie des tout derniers exemplaires que l'on peut encore observer en Bretagne. Un mot sur le contexte historique : en France, l'usage des boîtes à chef est identifié du quinzième siècle au début du vingtième siècle. Quand la place venait à manquer dans les cimetières, les tombes étaient vidées et les ossements déplacés dans l'ossuaire. Cette « translation des ossements » avait lieu tous les 5 ou 10 ans, ou à plus lointaine échéance encore. Parmi les ossements recueillis dans les tombes, la famille de chaque défunt était autorisée à en recueillir le crâne. C'est une pratique qui avait été officialisée par un décret datant de 1805. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques des boîtes à crâne. Le crâne ainsi prélevé était parfois rangé dans un petit coffret en bois peint. Ce coffret était généralement percé d'une ouverture décorative de plusieurs centimètres, laissant apercevoir le crâne. Cette ouverture a souvent pris la forme d'un cœur, qui peut être inversé. Mais il peut aussi s'agir d'une forme ronde ou ovale. La boîte est aussi recouverte d'un toit, lui-même parfois surmonté d'une croix, à l'image d'une petite chapelle. Les boîtes à crâne étaient en règle générale individuelles, bien qu'un très rare exemplaire de boîte à chef triple existe à Plouzélambre, dans les Côtes d'Armor : elle réunit trois crânes issues d'une même famille. Les boîtes à chef conservées dans les ossuaires permettaient ainsi aux vivants de prier pour l'âme de défunts qui avaient eu en général une certaine influence au sein de leur paroisse. Cependant, il semble que cet usage se soit peu à peu démocratisé au fil des siècles. La répartition géographique des boîtes à crâne est également intéressante. En Bretagne, l'usage des boîtes à crâne est une spécificité de la Basse-Bretagne, c'est-à-dire la partie occidentale et bretonnante de la Bretagne, qui regroupe le Léon, le Trégor, la Cornouaille et le Vannetais. En Haute-Bretagne, c'est-à-dire la partie orientale et gallèse de la Bretagne, il n'existe a priori plus de boîtes à crâne aujourd'hui. On a pu croire qu'elle n'y avait même jamais existé, bien que le département d'Ille-et-Vilaine ait pu abriter des ossuaires, ainsi que des greniers à ossements. À la fin du dix-neuvième siècle, Théophile Ducrocq a affirmé, dans un ouvrage intitulé « Des ossuaires et des boîtes à crâne de la Bretagne armoricaine », que l'usage des boîtes à crâne était, je cite, « inconnu » dans le département d'Ille-et-Vilaine. Lors de mes recherches initiales sur le sujet, j'ai moi-même fait chou blanc. Cela m'a amené à relayer l'information donnée par Théophile Ducrocq dans l'article que j'ai écrit et qui a été publié dans le bulletin numéro 75 de l'association Danses Macabres d'Europe, publié en juillet 2023. Cependant, depuis, j'ai découvert à Brest, au Centre de recherche bretonne et celtique, que l'usage des boîtes à crâne a bel et bien existé en Haute-Bretagne. En effet, le folkloriste Paul Sébillot a mentionné leur existence à Saint-Briac, en Ile-et-Vilaine, en 1885, dans son livre « Coutumes populaires de la Haute-Bretagne ». Il a même précisé que ces boîtes étaient, je cite, « ornées de filets bleus », un détail que je n'ai trouvé mentionné nulle part ailleurs pour l'instant. Mais revenons-en à la Basse-Bretagne. Comme je le disais, les boîtes-reliquaires de Saint-Fiacre font partie des toutes dernières boîtes à crâne encore visibles dans la région. On en trouve une vingtaine dans les Côtes d'Armor. Outre la boîte qui contient le chef de Lézobré, visible à la chapelle Kermaria-an-Iskuit de Plouha, il en subsiste notamment six à La Méaugon, et deux autres à Lanloup. Ce sont deux communes situées à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Fiacre. Dans le Finistère, on peut observer 31 boîtes à crâne à Saint-Pol-de-Léon dans la cathédrale Saint-Paul-Aurélien. Elles sont rangées au sein d'un grand enfeu surnommé avec poésie « les Étagères de la nuit ». Ces boîtes à crâne-là sont datées du seizième au dix-neuvième siècle. Les boîtes à crâne sont singulières, mais elles ne sont pas uniques à la Bretagne. Cette coutume funéraire a aussi existé en Lorraine. On peut encore en voir quelques-unes dans l'ossuaire de Marville, dans la Meuse. Il y en avait beaucoup plus, mais hélas, elles ont été victimes de profanations et de vols. Sur les boîtes à crânes de Marville, on trouve des ouvertures en forme d'étoile, de fleur, de rosace, de trèfle, de croix, et certaines à contours polylobés. Néanmoins, si l'on met en perspective les boîtes à crânes qui subsistent, et les archives iconographiques dont on dispose, les boîtes à crânes de Saint-Fiacre présentent une certaine diversité décorative, que ce soit les ouvertures ou les formes des châsses, mais aussi leurs couleurs, ainsi que les symboles et les inscriptions qu'elles présentent. Par exemple, les boîtes à chef de Saint-Fiacre sont d'une facture bien plus simple que celles conservées à Saint-Pol-de-Léon. En effet, deux d'entre elles sont décorées avec des larmes peintes. Aucun autre symbole ou décor macabre n'est à signaler, en tout cas pas sur les faces visibles. Il est fréquent de trouver des larmes peintes sur les boîtes à crâne, que ce soit en Bretagne ou à Marville. Mais certaines boîtes sont décorées elles-mêmes avec des crânes, avec ou sans os entrecroisés, comme à Saint-Pol-de-Léon et à Marville. Certaines boîtes à chef présentent aussi des sabliers, parfois sculptés dans le bois. On peut en voir un exemplaire à Saint-Pol-de-Léon, à proximité de la boîte à crâne contenant le chef de Mgr Nebout de La Brousse, soixante-deuxième évêque du Léon, mort en 1701. Une boîte à crâne de La Méaugon, quant à elle, présente un calice sculpté. Par ailleurs, ces petits coffres se distinguent par des couleurs différentes, qui s'éloignent de l'usage chromatique observé dans le Léon. Il y a bien évidemment une signification à ces couleurs. Ainsi, selon la tradition basse bretonne rapportée par Anatole Le Braz dans son célèbre livre « La Légende de la mort », à chaque tranche d'âge correspondait une couleur différente : noir pour les défunts d'âge mûr, blanc pour les enfants et bleu pour les jeunes-filles. Toutefois, ce symbolisme chromatique a pu différer selon les paroisses ou les zones géographiques. En effet, à Saint-Fiacre, on trouve par exemple deux boîtes de couleur blanche qui contiennent le crâne d'adultes : j'ai nommé Joseph-Marie Simon, décédé en 1886 âgé de 71 ans, et Maryvonne Simon, décédée en 1882 à 70 ans. Chaque boîte à chef présente une courte épitaphe peinte à la main. L'épitaphe indique le nom du défunt ou de la défunte, parfois précédé par la mention « Chef de » ou « Ci-gît ». La surface pour écrire étant limitée, les épitaphes s'appuient souvent sur l'abréviation phonétique « D. C. D. » (décédé). Sont également indiqués l'âge de la personne. Certaines boîtes à crânes peuvent aussi indiquer la date de naissance du défunt, son statut social ou sa profession, ainsi que certains liens familiaux. Enfin, à Saint-Pol-de-Léon et à Marville, certaines épitaphes contiennent aussi une courte prière. En matière de crânes bretons, on cite souvent le décollement du chef du peintre et illustrateur Yan’ Dargent, réalisé selon ses dernières volontés dans le cimetière de Saint-Servais dans le Finistère en 1907. Son crâne est toujours conservé aujourd'hui dans une châsse en zinc. Il y repose aux côtés de plusieurs de ses proches. Mais c'est à Saint-Fiacre que se trouve la boîte à crâne bretonne la plus récente, à ma connaissance du moins : celle de François-Henri Pourhiet, décédé en 1909 à l'âge de 35 ans. À Saint-Fiacre, la date de la boîte la plus ancienne est difficile à déterminer avec exactitude, car certaines inscriptions sont manquantes ou ont été effacées par le temps. Mais d'autres boîtes à chef qui y sont conservées sont datées 1866, 1867, 1882 et 1886. Pour conclure, les boîtes à crâne ne sont qu'un aspect des us et coutumes qui constituent l'histoire de la mort en Bretagne et en Lorraine. En effet, les rites de la mort s'expriment de multiples manières, par les prières, les messes pour les défunts, les sermons édifiants, les processions dans les cimetières, l'aspersion d'eau bénite sur les restes humains, les veillées ou les bougies allumées. Les chapelles funéraires et les ossuaires, décorés de peintures ou de sculptures macabres, étaient les lieux où le dialogue entre les vivants et les morts prenait tout son sens. Si vous souhaitez en savoir plus à propos des boîtes à crâne en Bretagne et en Lorraine, je vous renvoie à l'article que j'ai eu l'honneur de publier en juillet 2023 dans le bulletin n°75 de l'association Danses Macabres d'Europe. Vous pouvez aussi retrouver un article consacré aux boîtes à crâne bretonnes sur mon blog lalunemauve.fr. Merci pour votre attention.