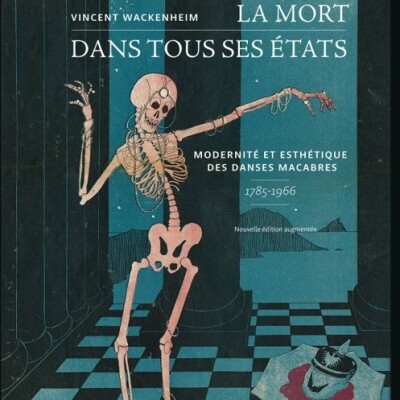NarratriceAlors ce rite de proëlla qui est propre à l'île d'Ouessant, en réalité il est bien connu et il est décrit par de nombreux auteurs. Il s'agit d'une cérémonie d'obsèques qui est organisée en l'absence du corps du défunt, celui-ci généralement perdu en mer. Depuis le XVIIe siècle, en effet, les hommes d'Ouessant s'engagent dans la marine marchande, dans la marine royale, dans la marine militaire, rarement pour la pêche, et partent pour des trajets au long cours, alors qu'à cette époque la navigation est peu sûre et que les nouvelles mettent beaucoup de temps à circuler. Donc à l'occasion d'un décès en mer, par naufrage, maladie ou accident, et dans l'incapacité de ramener le corps, l'annonce du décès finit par arriver à plus ou moins longue échéance sur l'île. La cérémonie se déroule alors sensiblement de la même manière du XVIIIe siècle au XXe siècle. Françoise Perron décrit la succession des événements dans son ouvrage « Ouessant l'île sentinelle ». L'annonce du décès d'un marin arrive à Ouessant, elle est communiquée d'abord aux autorités civiles et religieuses. Le soir, quand toute la famille est rassemblée, une délégation se présente à la porte de la maison alors qu'on entend le glas sonner au loin. La seule vue du groupe nocturne fait immédiatement prendre conscience du décès. Le drame est confirmé alors par la formule qui est immuable, qui donne le prénom de la veuve : « Marie-Jeanne, il y a proëlla chez toi ce soir ». Alors le rituel commence. La nouvelle se répand de maison en maison, souvent de la bouche des enfants : « il y a proëlla chez un tel ». On ramène de l'église, la croix de procession, qui est placée dans la maison du défunt devant la fenêtre, bien visible de l'extérieur. Sur la table est étendu un drap blanc, sont disposés deux chandeliers et une assiette d'eau bénite. Au milieu de la table, deux bancs de tissu amidonnés et blancs, qui proviennent de la coiffe d’Ouessant, sont disposés en croix. Au centre est placée une petite croix. Au XVIIIe siècle, elle est en osier ou en bois, et plus tard en cire. Elle représente et personnifie le corps du défunt. La veillée se déroule alors toute la nuit sans la présence du clergé. Au matin, le prêtre se présente à la porte. Le cortège quitte ensuite la maison endeuillée pour l'église. Le parrain, s'il est encore vivant, porte en tête de procession un coussin sur lequel est placée la croix de proëlla. Dans l'église, la croix est déposée sur le catafalque, comme aurait été placé le corps, et les funérailles se déroulent normalement. A l'issue de la cérémonie, la pratique varie selon les périodes. Au XVIIIe siècle, les croix sont directement enterrées au cimetière dans un endroit réservé à cet usage. Vers 1850, elles sont déposées dans une urne. Elle existe toujours dans l'église et a été classée monument historique en 1983. Et elles sont plus tard, à leur tour, enterrées au cimetière. En 1968, après la construction d'une nouvelle église, l'abbé Jacques Picard fait édifier au centre du cimetière un petit mausolée portant la mention « Ici nous déposons les croix de proëlla en mémoire de nos marins qui meurent loin de leur pays, dans les guerres, les maladies et les naufrages ». Cet édifice existe toujours. Les premières traces de la cérémonie remontent à 1734, la dernière se déroule en 1958. Et comme l'image vaut mieux que des paroles, et qu'un film vaut mieux que des images, la Cinémathèque de Bretagne m’a confié trois extraits de films. La Cinémathèque de Bretagne a pour mission de collecter des films amateurs, et on a pu voir quelques séquences de proëlla filmées. Ici en 1947, la scène se passe à l'intérieur d'un habitat de Ouessant – on reconnaît bien le style de maison ouessantine. La table dressée au milieu de la croix de proëlla, les chandeliers. On a filmé le mausolée, on voit donc la table dressée, la façon est identique. On voit la croix de procession de l'église derrière, près de la fenêtre. On a rajouté une photo, mis la croix. Et ensuite dans l'église, le prêtre bénit la croix de proëlla et il va la placer ensuite dans l'urne. Le troisième extrait qui reprend un peu la même séquence à l'église, c'est le prêtre qui tient l'urne et qui refait le geste de remettre la croix de proëlla. Ce sont des films qui sont assez impressionnants. Je vais vous parler du rituel qui est décrit par les sources anciennes et les savants, puis dans le grand public, puis le rapport avec l'Église. Alors un des premiers textes évoquant Ouessant, c'est celui du père Julien Maunoir qui se rend sur l'île en 1641 et 1642, mais dans son récit aucune allusion n'est faite au rituel de proëella. Le premier auteur à citer la proëlla est l'amiral Antoine-Jean-Marie Thévenard qui l'évoque dans « Mémoires relatifs à la Marine », en l'an XII (sic), et la description qu'il en donne laisse entendre qu'il s'agit là d'une pratique déjà relativement ancienne. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le proëlla est découverte par les folkloristes bretons qui font le voyage à Ouessant. Donc ici, vous avez le journal « L'Océan », c'est l’un des premiers textes scientifiques, on va dire, consacré à un article en 1869. D'autres personnes évoquent le thème comme l'archiviste Le Men dans la « Revue celtique » en 1870. Luzel également, dans la « Revue de France ». Luzel avance l'étymologie latine de « procella », après avoir remarqué que les Ouessantins suppriment souvent des consonnes dans leur prononciation. Le mot signifie « orage », donc la proposition se tient. Mais cette hypothèse sera contestée ensuite par les celtisants. En 1895, Anatole Le Braz reprend le thème en une longue description lors du congrès de Quimper de l'Association bretonne. Dans sa présentation, il émet à son tour une hypothèse étymologique. Le mot pourrait venir d'une corruption d'un hymne funéraire latin comme « Pro illâ animâ ». Cette hypothèse est contestée par une enquête du Molénais Joseph Cuillandre, professeur au lycée de Quimper, et il publie en 1921 dans les « Annales de Bretagne » une longue étude suite à une enquête sur place. Il conteste l'orthographe du mot même, gravé sur la plaque de l'édicule. Selon lui, le mot est d'origine bretonne et non latine. Il conviendrait de prononcer « bro-ella », puriel « bro-ella-nou ». Et il précise qu'il y a tout lieu de croire que ce mot est formé du mot « bro- » le pays, avec l'adjonction d'un suffixe en « ella » comme il s'en trouve dans nombre de verbes en breton, la formule signifiant alors « bro-ella », ramené au pays, rapatrié. Malgré le bien fondé de ces hypothèses, l'habitude de prononcer « pro-ella » avec un p est confortée par l'écriture dans certains registres paroissiaux et la plaque de marbre du cimetière, et s'est ensuite bien ancrée et est restée dans les usages. Le mot dans sa forme celtisée est cependant repris dans la « Semaine religieuse » en 1923 lors d'un compte-rendu de mission. Le chroniqueur précise que lors de cette mission, on a retiré 113 croix de « broella » dans l'urne reliquaire de l'église. Elles s'y trouvaient depuis la dernière mission, 15 ans plus tôt. Donc le chiffre indique, si on fait une moyenne, que l'on peut arriver à sept obsèques par an par proëlla à cette période. Ouessant n'est pas le seul lieu touché par les marins perdus en mer, les obsèques sans corps ; mais il est le seul à avoir développé à ce point le rite avec une croix de substitution. Joseph Cuillandre précise que ces enterrements se sont déroulés à l'île voisine de Molène, donc sans la croix, de même à l'île de Sein : Charles Le Goffic y décrit un petit peu le même genre d'obsèques, mais sans la croix. D'autre part, sur le continent, les folkloristes et les voyageurs citent divers exemples proches. Par exemple, le long des murs de l'église de Perros-Hamon, indique Sébillot, sont placées des plaques de bois portant des mentions comme « François Foury, perdu en mer ». À Trégastel, ajoute-t-il, se trouvent des fosses vides pour les marins perdus en mer. En 1910, Alphonse de Châteaubriant décrit ces cimetières de marins et raconte le proëlla ouessantin. À Collioure également, au milieu du XIXe siècle, des veillées mortuaires sont organisées autour d'un lit vide. Mais dans tous ces cas de funérailles, en l'absence du corps, elles se déroulent toutes sans la charge symbolique d'une croix, de la croix de proëlla. Le répertoire populaire n'oublie pas les proëllas, s'alimentant souvent sur des faits divers ayant frappé les esprits. Les croix sont citées dans une gwerz de la fin du XIXe siècle, à la suite d'une collecte initiée par l'abbé Perrot pour constituer un « barzaz Bro Leon », un recueil de chants du pays de Léon. En 1906, Madame Noré de Ouessant adresse des cahiers manuscrits de chants qu'elle chantait dans son enfance. Parmi eux, « Guers eur vag collet », la complainte du bateau perdu. Elle évoque le naufrage du Saint-Jean survenu en 1876 entre l'aber Ildut et Ouessant, qui a provoqué la mort d'une vingtaine de personnes, essentiellement des femmes qui étaient parties acheter des porcelets sur le continent. Les strophes 40 et 41 décrivent l'enterrement. Voilà, en français : « Allons maintenant à l'église d'Ouessant / Là, tout le monde pleure / En voyant sur les tréteaux funèbres / Quatorze croix de proëlla alignées / Les sept cercueils sur un rang / Ô, mon Dieu, quel déchirement ! ». Le registre des sépultures d’Ouessant pour 1878 comporte en effet trace de ce naufrage et réserve un certain nombre de places laissées en blanc dans les actes de décès, dans l'éventualité de retrouver ensuite ultérieurement des corps. La proëlla aussi est connue au-delà de l'île, grâce au travail des folkloristes et des ethnologues. Et puis petit à petit, comme ça, cette image va se développer progressivement. Le sujet est peu traité par les peintres. Un seul tableau est exposé au Salon et représente une scène proche, très ressemblante. Au Salon des artistes français en 1904, la « Dépêche de Brest » évoque un tableau de Gaston Fanty-Lescure, mais le journaliste décrit ainsi une sorte de bénédiction au foyer domestique d'une croix de cire posée sur une table. Une photographie de ce tableau est toujours conservée au Musée de Bretagne. En 1912, André Savignon reçoit le prix Goncourt pour les « Filles de la pluie, scènes de la vie ouessantine ». L'auteur est natif de Tarbes, suit des études à Saint-François-Xavier à Vannes, suivant les affectations d'un père militaire. Et, après un divorce difficile, le journaliste se retire quelques temps à Ouessant, d'où il rapportera un carnet de notes et des observations. L'ouvrage décrit en une série de tableaux divers aspects de la vie ouessantine, et en suivant le fil rouge de la cohabitation entre des militaires du contingent qui sont stationnés sur l'île, et les femmes de Ouessant qui sont décrites comme étant de mœurs légères. Alors le clergé local reçoit fraîchement l’ouvrage. Dans la chronique des lectures de « L'Écho paroissial de Brest », le Goncourt est classé parmi les « romans mauvais et dangereux ». Le livre n'est pas non plus un succès d'édition, puisque 8000 exemplaires se vendent dans la période de publication. Mais il connaît ensuite une vingtaine de rééditions, certaines illustrées. Objet de bibliophilie, il contribue à placer au long du XXe siècle l'île d'Ouessant et aussi ses proëllas, qui sont évoquées dans le roman, au cœur d'une Bretagne mystique et romancée. Peut-être reste encore la réédition des « Filles de la pluie » en 1934, illustrée par Mathurin Méheut, qui ravive l'intérêt. Cette même année, l'écrivain catholique Yvonne Pagniez publie dans « La Revue des Deux Mondes » un long article sur Ouessant. Elle évoque le proëlla dans son chapitre « Un cimetière de marins », un « lieu incomparable de rêverie et de silence », et dit-elle, « comme si, d'avoir enfermé ces amulettes dans un coin de l'île, entre les cloisons de pierre arrachées à son sol, on y ramenait aussi les âmes des morts ». « La Croix » de 12 novembre 1936 développe en un long article, illustré par une gravure sur bois tourmentée, le rituel du proëlla. s« Le Breton s'attendrit surtout à la pensée des “âmes errantes”, des âmes de noyés, dont certains affirment avoir reconnu, au coin d'une ruelle, le visage angoissé », précise l'auteur dans une veine romantique. Dans l'article, on précise que le coffret, l'urne, comportait 13 croix en 1933, au moment de la dernière mission. En 1953, Henri Queffélec publie « Un homme d’Ouessant ». Le roman se situe à la fin du XVIIIe siècle et évoque les hommes revenus de la guerre d'indépendance des Amériques. Le proëlla est cité au début du roman, sans explication ; alors peut-être que l'auteur estime-t-il que, désormais, le rituel est suffisamment connu, et ne nécessite plus de longs développements. Il tourne autour de l'Amérique et de la guerre aux Amériques. Il dit : « Oui donc, les proëllas avaient bien augmenté ». Le même Henri Queffélec préface en 1954 le recueil illustré de l'Ardéchois Jean Chièze, qui est consacré à Ouessant, ses paysages et ses traditions ; et, parmi elles, une gravure représentant la scène de proëlla dans l'intérieur traditionnel du logis ouessantin, une rare représentation artistique du rite. L'Église (vis-à-vis) de la proëlla, comment se place-t-elle ? Quelle est l'attitude de l'institution face à ces traditions qui demeurent populaires ? Si le rituel est bien ancré dans les habitudes, il n'est cependant pas ordinaire. La croix incarne véritablement le disparu et les obsèques par proëlla signifient le retour sur l'île de l'âme du défunt, désormais en paix. Mais comme souvent pour ce type de pratique, les archives sont rares. Quasiment aucun document ne fait directement allusion au rituel ; sa fréquence est difficilement chiffrable, et le mot n'apparaît que rarement dans les actes de catholicité. Les registres de catholicité nous renseignent cependant sur divers aspects. La première cérémonie de proëlla serait donc attestée en 1734. Françoise Perron indique que l'on peut lire sur la page de garde du registre : « Il y a, sur le cahier de 1733 cinq reports pour 1734, savoir : un de baptême, deux de sépulture, deux de mariage et un de proëlla. » La page en question n'est pas numérisée sur le site des archives, je ne l'ai pas vue. Le rituel était-il antérieur ? L'absence de registre conservé ne permet pas de le savoir. Le mot n'apparaît pas sur les registres des années 1697-98, qui sont les seules années conservées que j'ai consultées. Le mot « proëlla » n'est généralement pas mentionné dans l'acte lui-même. En effet, les statuts synodaux détaillent les formules à mentionner dans les registres paroissiaux en fonction de divers cas particuliers. Le proëlla ne figure pas parmi ces cas prévus. Donc le noter en toutes lettres, en quelque sorte, n'est donc pas conforme à la règle. Vingt ans plus tard, cependant, l'abbé Jacques Hubac utilisr le mot, alors qu'il est fraîchement nommé à Ouessant. « Ce jour, cinquième juillet mil sept cent cinquante et trois nous avons chanté le service, dit pro illâ pour le repos de l'âme de Michel Stéphant, fils de deffunt Paul Stéphant et de Marie Cozan, âgé d'environ vingt et quatre ans, mort il y a environ cinq mois dans le vaisseau du Roy le Protais ». Le même jour, lors du même office « dit pro illâ », obsèques d'un Jean Lénoret, « mort il y a environ un an sur le vaisseau de la compagnie des Indes Le Bristol ». Le lendemain, 6 juillet, un autre proëlla pour Louis Pennec , « mort il y a environ trois mois dans le vaisseau du Roy Le Protais ». Mais deux ans plus tard, il signe d'autres actes de même nature, sans indiquer le mot de proëlla. De façon générale, la formule consacrée devient, par exemple, en 1861 : « Nous avons chanté un service pour Joseph Colin, fils de François et de Marguerite Malgorn, mort aux Isles sur le vesseau du Roy nommé le Fleur de Lys ». Au XIXe siècle, le mot n'apparaît plus guère dans les registres. Certains recteurs l'emploient cependant avec parcimonie. Nous avons procédé à un sondage de 1859 à 1870. Le 27 janvier 1863, par exemple, est mentionné : « Proëlla pour le repos de l'âme de Jean Mazeas, époux d'Émilie Mazeas, décédé le 12 juillet au Mexique ». Ici, par exception, la personne n'est pas perdue en mer, mais décédée lors de la guerre du Mexique. Suivent alors une dizaine de mentions de proëlla dans les registres, puis à nouveau plus rien : on dit « Nous avons chanté un service d'enterrement le corps absent » pour Yves-Marie Levenez. Progressivement, le clergé tente de normaliser le rituel en l'insérant dans les habitudes de l'Église catholique. Dans les registres, peu de traces écrites, le rituel apparaît en creux mais sans être véritablement nommé. La croix d'osier est remplacée par la croix de cire provenant de la sacristie et bénite. Le produit est sophistiqué. Son aspect peut rappeler certains ex-votos chrétiens et présente aussi un caractère éphémère plus puissant que le bois ou l'osier. C'est intéressant parce qu'avec cette croix, on est à cheval, on touche presque au patrimoine immatériel parce que voilà un objet qui est destiné à ne pas durer dans le temps. Le cheminement de la croix aussi évolue au fil du temps. Elle est enterrée directement dans les premiers récits. Elle est ensuite placée dans l'urne puis déposée dans le mausolée après 1868. Certains auteurs y voient une séculture à deux degrés rappelant la pratique des ossuaires, des enclos paroissiaux. Le corps est inhumé dans l'église avant d'être déplacé dans l'ossuaire le temps venu. Au XXe siècle, le nombre d'enterrements par poëlla diminue sensiblement. Alors il est difficile de chiffrer avec précision. Certains textes de presse nous renseignent au gré des missions en 1923, 1933 et 1945. De 1908 à 1923, 113 croix se trouvent dans l'urne. Dans la décade suivante, 13 croix sont retirées de l'urne, qui est à nouveau vidée en 1945. La cérémonie de translation n'avait pu avoir lieu depuis la déclaration de guerre et d'occupation. Les croix de proëlla étaient nombreuses, sans précision chiffrée. Puis leur nombre baisse considérablement. L'urne est vide entre 1955 et 1958. Incontestablement, les progrès des navires, la connaissance des fonds marins, la technologie, les moyens de communication par radio font perdre le sens de ce rituel au cours du siècle, particulièrement dans la seconde moitié. Le dernier proëlla se déroule à l'occasion d'un fait divers. L'abbé Michel Stéphan, né à Ouessant en 1930, est depuis 1955 vicaire à Kerity-Penmarc’h. Le 19 août 1958, il se jette en mer pour secourir des enfants de la garderie dont il a la charge, et il se noie. Son corps est retrouvé dix jours plus tard, le 29 août, devant la chapelle de Tronoën. Le registre d'Ouessant indique alors « Mort accidentelle. Proëlla le samedi 30 août 1958 », tandis que celui de Kerity-Penmarc’h indique pour le lendemain : « A reçu les honneurs des funérailles chrétiennes dans l'église de Kerity et a été inhumé au cimetière d'Ouessant ». Donc deux actes de sépulture pour la même personne. En 1958, l'abbé Guéguené, curé de la paroisse, rend un rapport à l'évêque à l'occasion d'une visite pastorale. L'époque est aux enquêtes de sociologie religieuse. Il décrit alors l'état religieux de la paroisse. Il dit ceci : « Dans la situation religieuse de la paroisse, un autre point que révèle de plus en plus l'étude sociologique est l'évolution de la “structure mentale”. L'insécurité dans tous les domaines qui était, naguère encore, un facteur dominant de notre psychologie, a presque totalement disparu. Notre urne de proëlla est vide depuis trois ans. » Sans doute, à l'issue de ce rapport circonstancié et de l'affaire de Penmarc’h, l'évêque auxiliaire Mgr Favé décide alors que le temps est venu de mettre fin à cette pratique ancienne lors d'une visite pastorale en juin 1962, mais aucune archive ne nous le confirme. Mais le proëlla s'efface alors du paysage religieux, aussi discrètement qu'il était apparu. Merci.