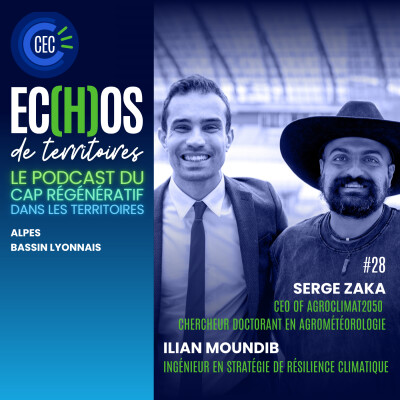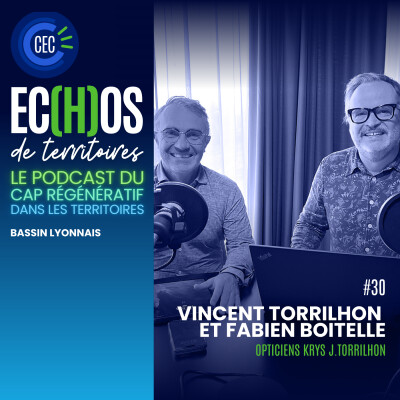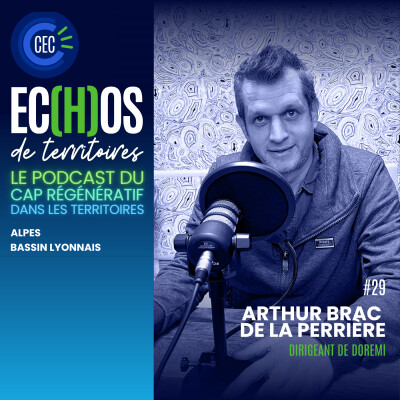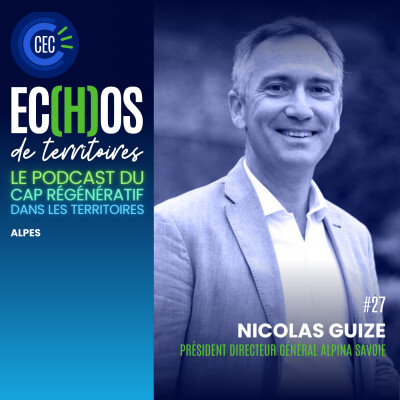- SG
Bienvenue dans Échos de Territoires, le podcast inspirant de la Convention des Entreprises pour le Climat, qui donne la parole aux acteurs engagés Alpes et bassin lyonnais. Je suis Stéphane Gonzalez, je suis alumni de la promotion 2023 et aujourd'hui je vous propose un épisode un peu particulier que nous enregistrons à l'occasion du Journée alumni. La Journée Alumni c'est un moment pour se retrouver, c'est un moment pour partager et continuer à apprendre, à naviguer dans un mode en transformation, dans l'incertitude j'allais dire. Et ce matin, et cet après-mid, on a eu une première conférence assez marquante qui s'intitule « Dérives et risques, regards croisés » de Serge Zaka et Ilian Moundib. Parce qu'on est bien clair, aujourd'hui on ne traverse pas une crise passagère, mais bien une dérive. Je pense que ce serait intéressant aussi de parler de dérive, pourquoi pas crise et dérive. Alors ce matin on a parlé de polycrise, mais voilà. Parce que l'avenir ne sera pas linéaire, il va être fait de ruptures, d'ajustements. Et donc l'idée du podcast c'est vraiment de prolonger toute cette réflexion et de se dire comment on accepte le monde qui est en mouvement, et comment on fait l'entrée d'une force. Deux invités un peu exceptionnels. Alors j'ai un peu la pression, parce que quand même vous êtes des pointures. En démarrant, vous avez dit le cow-boy et le mec en costard. Donc d'un côté, à ma droite, j'ai Serge Zaka, qui est agronome, agroclimatologue, chasseur d'orages, c'est un peu ce qui a fait ta réputation aussi, cartographe passionné des dérèglements agricoles. Serge, il regarde les nuages, si je fais un peu poétiquement, les sols, les cultures. Il chasse les orages pour mieux comprendre le climat, donc Serge, bonjour.
- SZ
Bonjour à tous.
- SG
Bon, je vous propose qu'on se tutoie, on est entre nous. Et puis, Ilian Moundib, qui est quand même le régional de l'étape, parce qu'il a quand même fait une centrale à Lyon.
- IM
Pas loin, pas loin. J'ai aussi une vie en banlieue parisienne, je ne peux pas leur dire que je suis lyonnais.
- SG
Mince. Bon, ingénieur de la résilience, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau. Et Ilian, il est plutôt à traquer les fragilités invisibles, celles des organisations, des territoires, les modèles économiques. Donc, Ilian, bonjour.
- IM
Bonjour Stéphane.
- SG
Donc il y en a un qui parle agriculture, l'autre qui parle adaptation. Finalement, tout ça, ça fait sens. Et en fait, vous parlez de la même chose. C'est notre manière de rester vivant dans un monde qui change, pour de bon. Ça, on est bien d'accord. La question, elle est un peu vertigineuse. C'est comment on transforme la dérive en trajectoire. Ça m'a fait penser au Titanic, quand j'ai commencé à bosser sur tous vos sujets. Où je me suis dit, bah oui, ma brave Simone, si je plagie un peu Paul Verri, le futur, c'est plus ce que c'était. Tout fout le camp. Donc... Je vous propose qu'on échange tous les trois. Promis, je ne parle plus après. Déjà, dans un premier temps, comment ça va ? Comment se passe ce duo ?
- SZ
Plutôt bien.
- IM
C'est marrant. Il y a un petit décalage dans les perceptions, mais on est très complémentaires. Moi, des visions plus conceptuelles, plus théoriques. Et lui, c'est une flopée d'exemples tous plus passionnants les uns que les autres. Très bon duo à refaire.
- SG
Faites gaffe, parce que les duos, des fois, ça s'engueule après. Au moins, c'est vrai que le ton est bon.
- IM
Ah, il n'est pas compliqué, t'inquiète. Tu sais que si tu veux, on vient, nous, tous les deux, de quartiers populaires différents. Lui, plutôt de la ruralité et moi, des quartiers. On s'entend bien, tout va bien.
- SZ
Attends, j'ai grandi à Versailles. Moi, on ne peut pas parler de quartiers populaires. Oui, mais c'est bon, c'est bon.
- IM
Oui, mais tu es maintenant.
- SZ
Je me suis enfui, oui, de Versailles ! Je me suis enfui pour revenir à la ruralité.
- SG
Personne ne te voit, mais tu as le chapeau. Exactement,
- SZ
on a aussi une différence de style. Et une différence de vocabulaire. Je sais pas si t'as remarqué Ilian mais j'ai un vocabulaire plus simple.
- SG
C'est un vocabulaire très complexe. C'est pour dire qu'on ne comprend rien à ce que je dis, c'est pas mal.
- SZ
Ça va commencer à chambrer.
- SG
Il faut se concentrer. Bon alors, allez, je vous recadre. Pour remettre les gens qui n'ont pas eu la chance d'assister à la conférence, et puis pour prendre un peu les devants, c'était quoi le sujet du matin et c'est quoi le sujet de l'après-midi ?
- IM
L'objectif, c'était de doter un peu la question de l'adaptation d'une vision systémique. Elle en manque cruellement, moi je trouve, puisque finalement, on est toujours dans une approche un peu technocratique. Quand on a une entreprise et qu'on essaye de faire de l'adaptation ou qu'on essaye de traiter la question de la dérive écologique. On accumule les diagnostics. On est un peu comme si on était chez le médecin. On sait qu'on est malade, mais on va accumuler les diagnostics sur toutes les dimensions de la maladie. Donc on sait qu'il y a trop d'émissions de gaz à effet de serre. On sait que ça nous rend vulnérables, notamment aux fluctuations des prix des énergies fossiles. Et donc on va faire un plan de décarbonation. À côté, on sait qu'il va falloir, qu'on est touché par la pénurie hydrique. Donc on va faire un plan de sobriété hydrique. On sait qu'on a un impact fort sur la biodiversité, on va faire un plan de gestion, de diminution des impacts sur la biodiversité. On sait qu'il va falloir qu'on circularise nos chaînes de valeur, on fait un plan de circularité. Une fois qu'on a eu nos quatre plans, on s'est dit « Ah putain, mais le sujet, il est encore plus compliqué que ça. Donc, on va faire un plan d'adaptation aux vagues de chaleur, après un plan sur les inondations, après un plan pour machin. Et on se retrouve dans une situation où, au final, tous ces plans-là, ça devient des à-côtés du vrai plan de développement économique, ce qui crée énormément de frustration et de dissonance cognitive dans les entreprises. Et nous, le propos qu'on a essayé d'articuler aujourd'hui, c'est un propos qui essaye de donner une dimension systémique à l'adaptation pour sortir de tous ces plans sectoriels et lui donner un aspect de bifurcation réelle et d'organisation de la robustesse, de la résilience et de l'antifragilité. Et avec Serge, on a parcouru énormément d'exemples que lui connaît beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire sur les productions agricoles, sur les arbres également, et montrer que le futur va être fait de ruptures et qu'on doit anticiper les ruptures et donc à avoir des politiques, des formes d'adaptation dans les entreprises qui mettent en lien la robustesse, la résilience et l'antifragilité.
- SZ
Ce qui est intéressant dans le discours d'Ilian aussi, et c'est là où je me retrouve, c'est que par un vocabulaire plus complexe que le mien, il va dire qu'on a divisé les métiers en plusieurs petits groupes : agronomes, climatologues, urbanistes, et ces groupes de métiers ne parlent pas entre eux. Et justement, à côté, en exemple, on a un agroclimatologue, c'est mon travail, où je rejoins justement à la fois les diagnostics et les anticipations, et puis les résiliences qu'il peut y avoir sur un territoire agricole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ramène du concret dans des notions qui sont peut-être parfois floues pour des chefs d'entreprise, sur la nourriture. En fait, ça nous rassemble. La nourriture, ça concerne tout le monde. Qu'on soit ouvrier, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, ça concerne tout le monde. Et donc, de donner des exemples sur l'huile d'olive, de donner des exemples sur la tomate, de donner des exemples sur le chêne vert dans les prairies, de la vache laitière, ça donne du concret au changement climatique. Et ça impacte plus, parce que quand ça impacte ce qu'on voit, ce qu'on mange, ce qu'on vit, et ce qu'on peut comprendre, eh bien, on peut mieux agir derrière.
- SG
Oui, et puis la systémie, moi, j'ai bien aimé la remarque sur l'alimentation. Je la prends souvent. Vous savez, dans les boîtes, quand on parle de RSE, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Souvent, on dit, il n'y a qu'à donner des cours de cuisine aux salariés. Je pense que cet exemple-là, il est intéressant à dérouler.
- SZ
C'est un très bel exemple. Parce que quand vous êtes en dehors d'un... Vous voyez un problème, le problème de l'impact des canicules ou d'une sécheresse sur la croissance du maïs, du blé ou de l'agriculture en général. Vous le voyez aux infos d'accord et après vous allez au supermarché vous avez tout ce qu'il faut Et vous ne comprenez pas forcément le problème agricole parce que votre supermarché est plein. Alors que si vous vous repenchez sur le problème par les cours de cuisine, ça veut dire que vous vous ramenez vers la production agricole en travaillant la matière première, couper une tomate ou éplucher un concombre par exemple, et bien ça vous remet en lien avec l'agriculture. Et en vous remettant en lien avec l'agriculture, vous allez comprendre pourquoi votre producteur local n'a plus de potiron sur l'étalage. Pourquoi il y a moins de tomates cette année ? Pourquoi elles sont plus chères ? Ça vous remet du concret sur le changement climatique. Et c'est ce que je veux, c'est que les gens comprennent que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui se passe autre part, à quelqu'un d'autre, ou dans d'autres filières économiques que la nôtre. Mais ça concerne aussi tout le monde au quotidien, sur notre journée au quotidien.
- SG
Par contre, vous avez parlé aussi de la dualité qui existe de plus en plus entre la ruralité et les gens urbains que nous sommes, finalement. parce que l'alimentation pour un urbain, ça ne représente rien. Tu l'as dit, c'est Uber, c'est le gars qui te livre. Et du coup, c'est aussi intéressant de reconnecter, moi je pense, la ville et la campagne. L'alimentation est un bon moyen.
- SZ
Alors on a un espèce de retour en ce moment de la ville à la campagne, les jardins partagés, la végétalisation. On a une reprise en main de notre alimentation, tout en ayant en parallèle des multinationales qui font exactement l'inverse, qui tirent de l'autre côté en nous rendant presque addicts à certains produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé, notamment au travers des problèmes du sucre. Ça, vous le connaissez tous. Et donc, moi, au travers de cette dissonance cognitive entre ville-campagne, même si je ne pense pas qu'il faut trop différencier les personnes, c'est juste qu'ils ne vivent pas dans le même environnement. Moi, par exemple, je ne comprends pas le métro, les gens qui vont au travail au quotidien. Enfin, chacun vit dans un milieu, mais je pense que si on se réunit, on peut se comprendre. Et ça, c'est mon objectif. C'est de comprendre au travers du changement climatique qu'on peut se réunir face à cette thématique qu'est l'alimentation.
- SG
Et du coup, là, je m'adresse plus à Ilian, sur l'organisation. Parce que là, aujourd'hui, vous vous adressez à des dirigeants, des chefs d'entreprise. Alors, il n'y a pas que des chefs d'entreprise. Il y a aussi des responsables de collectivité. Alors, il n'y a pas d'élus, malheureusement. Enfin, il y en a, mais ils sont très peu nombreux. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ce public-là, ce matin ?
- IM
Ce que j'avais envie de transmettre, moi, c'est fondamentalement des considérations qui permettent de sortir de l'impuissance. Serge est très exemple concret, moi je suis plutôt concept. Moi je suis persuadé qu'en fait, quand on ressent de l'éco-anxiété, C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, mais il nous manque des lunettes pour, en fait, quand on ressent des anxiétés, on est en train de regarder le soleil directement. Si on met des lunettes d'analyse, c'est-à-dire certains concepts, on est capable de mieux interpréter, moins souffrir en regardant et se donner des possibilités émancipatrices. Aujourd'hui, les sujets climat, et ça fait un moment qu'ils le sont, je trouve que le diagnostic commence à être bien partagé. Mais sur les solutions, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et on les met en particulier toutes sur le même plan. Moi, avant de me mettre dans ces sujets-là, c'est-à-dire à la fin de mes études de physique en 2018, je ne venais pas du tout d'un milieu qui s'intéressait à ces sujets-là. Moi, le milieu plutôt de quartier, etc. Et il y avait les problèmes du quotidien à gérer. Et quand tu as les problèmes du quotidien à gérer, les problèmes écologiques paraissent un petit peu comme des gens qui vont aborder une question par la moralité et qui ne vont pas être en mesure de participer à la satisfaction des besoins. Et le lien que je veux faire avec l'adaptation, c'est de lier la protection des communs à la capacité d'assurer les besoins. Aujourd'hui, en réalité, le changement climatique et la dérive écologique, elle va amputer les gens de leur capacité à accéder à leurs besoins vitaux de plus en plus parce que ça va détruire des réseaux collectifs, parce qu'on va avoir de plus en plus de destruction sur les productions alimentaires, etc. Le dépassement des frontières planétaires, il nous place en zone de fluctuation, en zone d'incertitude. On dit que la polycrise, qui est en fait l'hybridation de cette dérive écologique avec les crises géopolitiques, sociales, technologiques, elle va créer une synchronisation des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'on a créé des systèmes hyper performants, hyper optimisés et l'hyper-optimisation, elle fragilise. Et quand on fragilise quelque chose, tu peux gérer cette fragilité quand tu es dans un climat stable avec un accès quasi illimité aux ressources matérielles, agricoles, etc. Mais dès que tu dépasses cette zone-là, toutes tes fragilités, elles peuvent devenir des ruptures. Et comment on fait du coup pour gérer ça ? Il faut identifier ces fragilités et il faut créer de la robustesse. C'est-à-dire qu'il faut fondamentalement revenir sur toute l'uniformisation, faire de la diversification, apporter de la lenteur dans tous nos modèles d'affaires, dans nos façons d'organiser la société, créer de la redondance dans tout ce qu'on arrive à réaliser et fondamentalement créer de la sous-optimalité. Et l'image que j'aime bien, moi, pour bien faire comprendre ça, c'est qu'on ne peut pas y arriver que en étant focus sur les sujets climat, environnement, etc. L'image que j'aime bien, c'est, je ne sais pas si vous avez joué à Zelda. Dans les derniers Zelda tu peux aller directement au boss final, tu peux aller voir Ganon donc tu es au tout début du jeu tu vas voir Ganon. Tu vas te faire massacrer tu n'as pas le niveau ce qu'ils vont t'inviter à faire les développeurs du jeu c'est d'aller explorer d'autres champs, d'explorer d'autres parties de la carte et pour ouvrir les cartes il faut que tu ailles sur des tours qui t'illuminent toute la zone. Et moi je pense qu'il faut faire ça aujourd'hui on est focus sur aller sur Ganon tout de suite et se dire ça ne marche pas mais en fait on est trop faible parce qu'on n'a pas vu ce qu'il va falloir organiser en termes d'entraide, de robustesse. On n'a pas trouvé nos déjà-là. Pour moi, il y a trois types de déjà-là. Il y a les déjà-là du futur, c'est les utopies, etc., un peu décroissance, les théories du donut, etc. On a les déjà-là du présent, les concepts qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en application, la robustesse, la résilience, des choses comme ça. Et on a ceux qui nous manquent: les déjà-là du passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres temps de l'histoire quand il y a eu des ruptures. Et un des déjà-là du passé extrêmement puissant qu'on a, c'est l'histoire de la sécurité sociale en particulier. Et en fait, une fois qu'on aura parcouru notre carte de Zelda et qu'on aura trouvé, lié tous nos déjà-là, on sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus prêt, beaucoup plus organisé pour aller voir le boss final, aller voir Ganon. Moi, je pense que c'est ça le travail que j'essaye de mener actuellement, que ce soit avec les élus, avec les citoyens, citoyennes, les chefs d'entreprise. Essayer d'aller voir ces autres parties de la carte que leur quotidien ne permet pas d'aller voir.
- SG
Tu les invites à faire le pas de côté, c'est ça ?
- IM
À s'entraîner pour battre le boss final.
- SG
Mais c'est pareil, du côté de l'agriculture, il y a beaucoup de pas de côté à faire, non ? Pour changer aussi les façons de penser.
- SZ
Oui, il y a énormément de pas de côté à faire. Il y a, on parlait d'uniformisation, d'hyperspécialisation d'un milieu productif dans un contexte donné climatique. En agriculture, on a le même problème. En réalité, c'est qu'on a simplifié nos paysages, réduit les rotations, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes cultures dans les mêmes régions agricoles. Et donc, c'était hyper spécialisé, ça produisait hyper bien, et on ne peut pas le dire le contraire, parce qu'on avait des problématiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il fallait absolument trouver des solutions pour éviter la famine. On a hyper spécialisé l'agriculture, et simplifié les paysages, et simplifié tous les processus, et accéléré tout, même accéléré la course de l'eau sur le continent, et la ramener à la mer le plus rapidement possible. Du coup, finalement, quand le climat évolue, tout ce qu'on a mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale ne peut plus être valable, puisque ce n'est plus dans les mêmes conditions climatiques. Et je suis là pour rappeler que cette uniformisation n'est pas sans conséquence sur les rendements. Que, par exemple, si on a une vague de chaleur qui arrive en Andalousie, où il n'y a que des oliviers de la même variété, forcément, on aura des pertes de rendement très conséquentes, parce qu'il n'y a pas de redondance dans les productions et le paysage. Donc voilà, c'est de ramener des exemples assez concrets sur l'alimentation. Et pourquoi je suis là ? Parce que c'est aussi pour répondre à ta question. Moi, j'ai l'habitude d'intervenir dans le milieu agricole. Je vois des agriculteurs toute la journée. Le ministère de l'Agriculture, je les vois toutes les semaines. Et donc, je suis très spécialisé dans la bouffe, la nourriture, ce qu'on produit, et les paysages, et même les forêts. Je considère que par le biais de ce qui nous réunit, donc la nourriture, ça concerne tout le monde, je le rappelle, on peut faire des petits aussi. Toutes les personnes qui sont présentes. Là, on est 200. dans la pièce. C'est conséquent. Ces personnes-là, on va leur proposer, on va leur apprendre une nouvelle vision sur le changement climatique, une nouvelle vision de solution, une nouvelle vision d'anticipation, une nouvelle vision aussi de la solidarité qu'on peut avoir entre les entreprises qui ne se ressemblent pas forcément pour justement diffuser plus rapidement la parole scientifique.
- SG
Justement, vous qui voyez les choses, vous voyez plein de publics différents, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance quand même ? Parce que quand on s'intéresse au sujet, on a l'impression d'un peu ramer tout seul. Donc rassurez-moi, est-ce qu'il y a des choses qui avancent quand même ?
- IM
Il faut, pour répondre à cette question, comprendre ce qui nous arrive dans la tête. En gros, ce qui nous arrive dans la tête, c'est ce que font les médias en permanence, c'est-à-dire faire ce qui fait vendre, c'est-à-dire envoyer des stimuli anxiogènes et qui font réagir. Par exemple, dès qu'on va vouloir traiter une information dans les médias, on va faire un débat. Donc on va faire débattre le bourreau pendant cinq minutes et la victime pendant cinq minutes, d'accord ? Et ça, ça fait de l'audience, c'est bien, mais ça ne permet pas. En gros, ça ne permet pas de se forger une opinion en réalité, et donc on marche sur stimuli anxiogènes, sur stimuli anxiogènes, sur stimuli anxiogènes. À force de prendre ces stimuli anxiogènes, on va vouloir refermer nos œillères qu'on avait vues, d'accord ? Ou on se dit « putain, mais il n'y a absolument rien qui avance, c'est une catastrophe » . Sauf que ça, c'est une vision qui est faite pour entretenir une vision du monde où tout le monde devient un peu misanthrope, c'est-à-dire n'aime pas les... Enfin, une aversion pour l'humanité. Alors que si on regarde, en fait, ce qui se passe concrètement à plein d'endroits, on est déjà en train de construire les déjà-là de l'entraide. Je vais donner un exemple avec ma sécurité sociale pour revenir sur un déjà-là du passé. La sécurité sociale, elle naît d'un effondrement. Celui de la Seconde Guerre mondiale. Elle naît en 1945 avec le Conseil national de la résistance. Et c'est un ministre qui s'appelle Ambroise Croizat, ministre du Travail, qui va la mettre en œuvre. Il était savoyard Ambroise Croizat, il était dans la CGT, métallurgiste de Savoie et dans sa caisse syndicale, il collectait ce qu'on appelle des cotisations sociales, donc une partie du salaire des gens, des ouvriers, pour en fait faire un élément qui va permettre de financer la retraite, les temps d'inactivité, les maladies, la santé, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était en compétition avant 1945 avec deux autres formes de gestion du financement du modèle de soins, c'était la charité chrétienne et c'était ce qu'on appelle les mutuelles, les mutualistes. En 1945, Croizat va généraliser ce qu'il avait organisé dans son syndicat à l'intégralité de la société française sous la forme d'une sécurité sociale. Il veut, par ses mots, créer une tranquillité sociale, une absence de peur du lendemain. Aujourd'hui, on n'a aucune institution qui nous permet de nous prémunir en partie contre la peur du lendemain. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va généraliser la sécurité sociale, et c'est peut-être le moment le plus important du podcast, ou en tout cas de ce développement-là, c'est que c'est un service public non étatique. La sécurité sociale, en 1945, n'est pas gérée par l'État français. La sécurité sociale n'est pas gérée par De Gaulle. Elle est gérée par les assurés eux-mêmes. Et en 1945, tu as des élections pour les membres de la sécurité sociale, et c'est 75 % des syndicats, des représentants des travailleurs, qui vont gérer, avec 25 % du patronat, le taux de cotisation. Les soins qu'on va élaborer, etc., qu'on va rembourser ou pas. Si je fais un anachronisme, c'est lui qui gère l'âge de la retraite, pas l'État français. Et fondamentalement, avec ce moment-là, on a la naissance de ce qu'on appelle la démocratie sociale française, mot galvaudé qui ne veut plus rien dire, c'est ça la démocratie sociale française. C'est-à-dire qu'on a un État planificateur-stratège, mais qu'on a aussi une forme d'auto-organisation sur des secteurs de l'entraide et de forme, en fait, d'auto-gestion là-dessus. Et cette sécurité sociale, elle est extraordinaire parce qu'elle part en fait... de déjà-là de l'entraide qu'on va généraliser après une période de crise. Et du coup, par exemple, ce qu'on pourrait regarder, et ça c'est une des institutions les plus épanouissantes, ce qui fait le plus de plaisir à entendre, c'est... Quand on pense à la généralisation de la sécurité sociale, aujourd'hui il y a énormément de collectifs qui essayent de travailler une sécurité sociale de l'alimentation. Ça existe à Lyon, on a un député qui vient en fait de ce monde-là, Boris Tavernier. Et en fait l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation dans sa version nationale, c'est qu'on aurait chacun, chacune, 100 euros par personne et par mois sur une carte vitale de sécurité sociale d'alimentation qu'on ne pourrait dépenser que sur une alimentation conventionnée. Comme ta carte vitale tu peux la dépenser chez des médecins qui sont conventionnés. Si tu as envie d'aller voir un médecin non conventionné, tu peux, mais ça ne sera pas remboursé par la Sécu. On pourrait faire pareil. Et comment on choisirait le conventionnement des productions alimentaires ? On ferait des conventions citoyennes de l'alimentation, par exemple de Lyon, où on choisirait les critères qui permettent à chacune, chacun, d'accéder à ces formes d'alimentation. On pourrait choisir des critères de sobriété hydrique, des critères de localité, des critères d'empreinte carbone, des critères de biodiversité, de régénération des sols, etc. Et quand tu fais cette dynamique-là, tu te rends compte que... Il va falloir qu'on le travaille là maintenant pour expérimenter ce qui marche, ce qui marche pas, et que ça soit prêt au moment où il y a une catastrophe, qui permette de généraliser ça. C'est construire une forme d'hégémonie culturelle, si je reprends un peu le vocabulaire d'Antonio Gramsci. Mais cet élément-là, cette sécurité sociale de l'alimentation, elle permet de sortir les producteurs marginaux de la marginalité, de se réapproprier une forme d'auto-organisation, d'accord, sur les questions alimentaires, et de placer philosophiquement, institutionnellement, la question de l'alimentation comme un besoin, et comme un droit, et pas quelque chose qui découle d'une partie de ton salaire. C'est un droit à l'alimentation, comme tu as le droit à la santé. Une fois qu'on a mis le pied dans la porte là-dedans, on peut penser sécurité sociale du logement, on peut penser sécurité sociale du risque climatique, on peut penser sécurité sociale de la sobriété hydrique, etc.
- SG
C'était ma question, tu me l'as même coupé sous les pieds, j'ai trouvé que vous aviez eu la dent dure, entre guillemets. sur le politique, quand tu as démarré sur, de toute façon, le 4 degrés, on y va, on va se le marketer, comme ça, c'est voilà, et en même temps, c'est clair, et en même temps, est-ce que justement, la solution, c'est pas des nouvelles formes de solidarité ? Et du coup, c'est un peu ce que tu viens de dire. Peut-être Serge, là-dessus, tu peux peut-être rebondir.
- SZ
Alors, il faut savoir que le milieu agricole est un milieu où on est fortement impacté par le changement climatique. C'est le milieu économique où on est le plus impacté par le changement climatique, avec bien sûr les forêts. Le blé, le maïs, les vaches laitières, les tomates sont sensibles aux sécheresses et aux canicules. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Donc forcément, ça fait déjà très longtemps qu'on réfléchit sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut une nouvelle génétique de maïs plus résistant ? Est-ce qu'il faut mettre des tomates sous serre pour les protéger ? Il y a des formes d'adaptation qui sont plus ou moins des maladaptations. Est-ce qu'il faut irriguer derrière ? Ou c'est la seule solution ?
- SG
Je rebondis sur maladaptation. Parce que quand même, tu vois, tu en as parlé, mais quand même, le monde agricole, on ne le sent pas forcément très uni. Politiquement, c'est quand même très tendu. On voit bien, les politiques, s'écharpe.
- SZ
Ce n'est pas vrai sur le terrain et c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en réalité, le milieu agricole, ça fait 25 ans qu'il est uni face au changement climatique et qu'il essaye au mieux, dans l'économie qu'il a, d'en trouver des solutions. Alors j'ai bien dit dans l'économie qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment d'aide étatique ou d'aide politique pour investir dans les adaptations nécessaires. Elles sont beaucoup plus coûteuses et dépassent le milieu agricole. Tu prends par exemple l'arrivée d'une nouvelle filière, d'adapter sur le territoire de la clémentine, de la pistache, de l'olive. Et bien derrière, l'agriculteur, le plus simple, c'est planter et récolter. Parce que le plus complexe, même si c'est déjà complexe, je le rappelle, de cultiver, mais le plus complexe, c'est qui achète, qui vend, qui transforme, qui stocke, quelle AOC, quelle IGP, quelle économie nationale, régionale. Les consommateurs, est-ce qu'ils vont accepter le produit ? Tout ça, ce n'est pas l'agriculteur qui peut le mettre en place. Donc il doit y avoir une espèce de forme de solidarité entre le milieu agricole et ce qui l'entoure. Parce que souvent on oppose conventionnel, bio, c'est pour ça que je te disais ça. Mais en réalité sur le terrain, ce n'est pas le cas. Je suis désolé, moi quand je fais des conférences, il y a des conventionnels et des bio dans la salle et ils ne se tapent pas dessus comme on pourrait le voir dans les médias. Et je pense que les médias prennent ce qui fait sensation, c'est-à-dire ce qui représente parfois une minorité des agriculteurs. Entre la FNSEA, la coordination rurale, ils se battent contre la même chose, contre le changement climatique du moins. Après, sur tout ce qui est pesticides, ce n'est pas du tout mon domaine. Sur le changement climatique, en tout cas, ils sont plutôt unis parce qu'ils sont d'accord sur ces différents sujets. Il faut faire attention à ce qu'on voit dans les médias, qui est là pour faire aussi un peu sensationnel, un peu du clic, et la réalité de terrain. Il faut faire attention en disant que les agriculteurs sont des immobilistes et qu'ils attendent que les choses passent et qu'ils attendent les frais publics pour arriver. Non, ce n'est pas le cas. Il y a plein d'agriculteurs qui, depuis 20 ans, réfléchissent sur leur sol, sur leur terroir, sur leur adaptation de date de semis, leurs variétés. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on retrouve forcément dans les médias. Alors, je ne suis pas en train d'avoir un discours rassurant non plus, puisque derrière, ça ne va pas assez vite. Qu'on soit d'accord, la part d'agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols, une forme d'agriculture qui travaille moins les sols, qui fait remonter le taux de matière organique des sols. Donc ce sont des techniques biologiques, on va dire, pour résister aux fortes chaleurs, aux sécheresses et aux excès d'eau, donc pas mal d'éléments climatiques du futur. On n'est que 3-5%. Par contre, les agriculteurs dans le conventionnel qui s'intéressent à l'agriculture de conservation des sols, qui vont récupérer une forme de non-labour, de semis directs, donc semés sans forcément labourer. De couverture végétale, donc avoir une couverture entre deux cultures pour éviter que le sol soit nu. Donc du végétal, des fleurs, de l'orge, du blé qu'on ne va pas récolter, mais c'est juste pour que quelque chose pousse sur le sol. Eh bien, c'est plus complexe. Il y a une porosité entre ces différentes formes d'agriculture, des personnes qui vont s'inspirer du bio, mais qui sont conventionnelles, des personnes du conventionnel qui vont s'inspirer pour le bio. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit à la télévision.
- SG
Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, je rajouterais que tu sais que nous, moi, je suis à St Genis Laval, on a des agriculteurs ont planté des olives.
- SZ
Des olives, et j'espère que ce n'est pas qu'un seul, c'est plusieurs.
- SG
Ils ont démarré, mais pour corroborer ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais des amants, tu parlais des clémentines. Et en effet, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, c'est un peu de rebondir sur le récit. Parce que je pense qu'il y a une histoire de récit aussi, d'imaginaire. Et quand on parle de dérive, on peut se dire, on n'a pas de carte, on parle dans tous les sens. En fait si on emmène les gens dans une vision et dans quelque chose qui paraît désirable, je pense qu'on arrivera à les rassembler. Je pense que tu as raison sur l'agriculture.
- SZ
Sur les oliviers, je rebondis sur les oliviers. Est-ce qu'ils ont eu une aide de l'État ou une volonté d'être là de le faire ? Non, ils l'ont fait d'eux-mêmes, sur leur fonds-preuve. Donc ils ont pris un risque économique, ils ont pris des terres. Au lieu de faire une culture qui est rentable actuellement, ils ont décidé de planter des oliviers pour l'avenir. Un olivier, je le rappelle que c'est plus de 100 ans de vie. Donc c'est presque un investissement pour nos enfants, en réalité, qu'ils ont fait. Derrière, est-ce qu'on a eu le cap de le faire ? Non. C'est-à-dire que politiquement parlant, il nous manque un leader. Déjà qu'on n'a pas de politique actuellement, mais il nous manque un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire on va vers ce cap des nouvelles filières, nous allons investir une bonne partie de votre matière génétique, donc les arbres, l'État va le payer, on va pendant cinq années assurer vos arrières par rapport aux pertes de rendement pour qu'après on s'installe. C'est la transition et cette transition ne peut pas être payée par le milieu agricole dans l'État économique actuel et ce cap-là doit être géré pour moi par soit les entreprises intermédiaires ou soit les politiques.
- SG
Serge, ministre de l'Agriculture. Ilian, tu hochais de la tête là ?
- IM
Moi je pense pas qu'on a besoin de leaders, on a besoin de plus de démocratie parce que c'est dangereux d'avoir des leaders maximaux qui reprennent le truc, etc. Ça veut dire quoi avoir plus de démocratie ? Ça veut dire reprendre cette idée d'autogestion par la sécurité sociale. Mais ça veut pas dire auto-organisation sans aucune aide. Il faut effectivement du pouvoir institutionnel qui emploie les citoyens là-dedans. Il y avait cette phrase de Jaurès qui disait que la Révolution française avait fait le citoyen roi dans la cité et serf dans l'entreprise. Aujourd'hui, on manque énormément de droits dans la démocratie au travail, c'est-à-dire que ça doit être les salariés en partie eux-mêmes qui doivent pouvoir décider des orientations stratégiques qui sont prises par leurs entreprises. Parce que si je reprends un peu les exemples du monde agricole, on a quand même des syndicats qui ne vont pas tirer du tout dans le même sens. On en a deux, la coordination rurale et la FNSEA, qui sont... Là, pour maintenir un modèle d'agriculture française assez productiviste et surtout qui a pour objectif d'exporter pour réimporter ensuite les denrées alimentaires qu'on va manger derrière. Ça, c'est un modèle agricole qui est daté maintenant et qui doit être repensé, pour moi, vers l a sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire française qu'on avait et qu'on a perdue, et dans ce cadre-là, des syndicats comme la Confédération Paysanne ont des approches qui sont beaucoup plus intéressantes, parce qu'en fait, il y a ce côté-là systémique. Si on est dans l'impératif de produire pour maximiser le rendement et donc pour être plus compétitif sur les marchés, mais de fait, on va être dans l'obligation d'aller... avec encore des pesticides, avec encore des engrais, etc. Alors que si on restructure sur les besoins d'un territoire, qu'on réoriente notre agriculture vers des besoins de sécurité et de souveraineté alimentaire des territoires, là, en fait, on peut emmener tout le système. Et ça, ça ne se fera qu'en empouvoirant les citoyens, en leur redonnant de nouveaux droits démocratiques, des droits de contrôle dans leurs entreprises, des droits de contrôle dans les façons dont les... dans le monde agricole aussi. Et alors, si on peut peut-être poursuivre sur la question leader, il y a une question de planification. Ça, c'est absolument certain. Et c'est dans la tradition française, la planification. C'est ça qui nous a sorti, qui a reconstruit la France en 1945. C'est-à-dire des grandes orientations stratégiques qu'on doit prendre et l'État qui entraîne tout un secteur privé pour les suivre. Et ça, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on en manque.
- SZ
C'est ça que je pensais en disant leader, c'est planification.
- SG
Après, c'est marrant parce que votre duo fonctionne bien. C'est un très terrain, tu vois, j'ai posé une question sur l'agriculture, mais tout le monde veut aller dans le même sens, et toi, à l'inverse, tu as structuré d'un côté la FNSEA, la Confédération Paysanne. C'est assez marrant, le discours que vous avez, qui je pense va dans le même sens, mais qui n'est pas la même approche. Il y en a un qui est plus terrain et l'autre qui est plus concept. C'est vrai. Bon bref, là, c'était assez bien du tout. C'était intéressant d'interroger. Et en plus, vous vous parlez, vous ne vous engueulez pas. on va s'expliquer après du coup avant de terminer j'ai revu un film qui s'appelle Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et j'ai pensé un peu à vous parce que à un moment au début le narrateur dit "les temps sont durs pour les rêveurs" et quand on fait votre job ou quand on a pris conscience de tout ça on fait comment encore pour rêver un futur désirable ?
- SZ
J'ai une réponse. J'ai une réponse, Ilian, si tu veux. Moi, je suis chasseur d'orages aussi. C'est-à-dire que moi, mon rêve, quand je rêve, c'est de me déconnecter un petit peu aussi de cette anxiété qu'on peut avoir sur le terrain, même si je reçois moins d'anxiété que la plupart des personnes, parce que je travaille sur les solutions. Donc ça atténue un petit peu cette anxiété. Moi, c'est de regarder le ciel. C'est-à-dire que de revenir à, on va dire, l'état un peu primitif de l'être humain. Je dors dans les champs, je regarde le ciel entre deux conférences, je chasse l'orage, je fais de la photographie des éléments climatiques. Et je dors, j'ai un petit camion emménagé. Je suis en dehors des villes, je suis en dehors de la vitesse, en dehors du bruit. Et je me retrouve en fait en dehors du milieu urbain et dans mon milieu à moi qui est le milieu des oiseaux, des animaux, des champs, des pâtures. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à rêver. Et je pense que je peux inviter tout le monde à le faire, parce que moi quand je pars en chasse à l'orage, je pars un, deux, trois jours parfois, je pars et c'est tout. C'est-à-dire que je ne sais pas où je dors, je ne sais pas ce que je mange, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas à quelle heure je commence, je ne sais pas à quelle heure je termine, je ne sais rien. Je pars là où les prévisions mènent, que j'ai faites pour, du coup, photographier les orages, et derrière, mon objectif c'est juste de faire une photo. C'est pas de poster sur Instagram je ne sais pas quoi, mon repas ou de prévoir une nuit d'hôtel je ne sais où, de réserver un truc sur la fourchette pour manger. Non, c'est juste d'être là. Et si je mange une boîte de conserve de maïs, je mange juste une boîte de conserve de maïs. C'est tout. Voilà, donc j'invite les gens qui travaillent et qui veulent se déconnecter, qui veulent rêver à juste prendre les clés, prendre la voiture ou partir à pied et partir. Sans se dire, je vais aller là, j'ai un rendez-vous ici. Si vous êtes en ville et que vous n'avez pas l'occasion, vous n'avez pas de voiture, Allez marcher et partez tout droit.
- IM
Sobriété, temps long.
- SZ
Tout droit, vous regardez un peu autour de vous, faites un tour dans la ville. Et c'est là où vous allez rêver, c'est là où vous allez vous reconnecter avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Parce qu'en fait, on ne rêve plus, parce qu'on n'est ni connecté avec nous-mêmes, mais encore moins... connecté avec ce qui nous entoure, du moins en dehors des villes.
- SG
C'est un peu de philosophie. Il a fait un peu de posé, de philosophie.
- IM
Moi aussi, je pense qu'il y a des besoins d'avoir des passions et des sas de déconnexion. Moi, c'est beaucoup plus terre à terre, mais peut-être original aussi. Terrain à terrain. C'est aussi un terrain. Moi, je suis footballeur, donc j'en fais quatre fois par semaine. D'accord. Il y a de l'herbe aussi. C'est aussi un carré vert. Et moi, ça me permet, j'en ai absolument besoin parce que c'est un sas de décompression, que moi, j'ai besoin de ce seuil de compétition un peu intense pour ne pas justement être dans des compétitions dans le reste de ma vie, donc dans des choses beaucoup plus d'entraide et de bienveillance. Mais il faut un sas de décompression. Et moi, ça me permet aussi de rester connecté aux gens de là où je viens, en fait, puisque quand tu vas avec des fouteux, c'est des métiers qui sont souvent assez précaires, beaucoup plus précaires en tout cas que ceux qu'on peut retrouver dans les conventions citoyennes, les conventions des entreprises pour le climat. Et ça permet du coup de se connecter à un milieu qui a ses galères et pour comprendre ses affects également. Pour la question du rêve, moi je pense que rêver, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, la seule façon de se libérer de cette forme d'anxiété, c'est d'être dans l'action. D'être dans les luttes concrètes, d'être dans les transformations concrètes. Chacun a sa place, il faut un gradient de radicalité, je pense, et chacun est capable, chacun, chacune, est capable de trouver sa place dans ce gradient-là. Il y a aussi des questions sociales sur le temps disponible, est-ce qu'on a la force de faire telle ou telle chose, etc. Je pense qu'il y a être dans l'action concrète et ne jamais arrêter d'apprendre. Plus on apprend des choses... Je pense qu'énormément de gens, quand ils rentrent dans les conventions des entreprises pour le climat, ils ont un espèce de déclic parce qu'effectivement, émotionnellement, ils ont ressenti quelque chose, mais que ça leur aura ouvert une porte à la connaissance. Ils se sont dit « Ah, mais ça, je ne savais pas, pourquoi je ne savais pas, etc. Je vais regarder ça, et puis je vais regarder ça, et puis je vais écouter lui, et puis je me suis fait des copains, etc. » C 'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça, les luttes concrètes et les phénomènes d'apprentissage permettent de reconstruire des collectifs. et quand on est dans un collectif, en fait, on souffre beaucoup moins d'éco-anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est quelque chose de solitaire, c'est dans ta tête. Alors que fondamentalement, une fois que tu fais du collectif, tu fais des choses avec les autres, tu peux t'en émanciper de ça et tu peux avoir du pouvoir d'agir et du pouvoir réellement citoyen, de t'organiser autour de besoins communs, de te réapproprier le pouvoir que cette République est censée te donner en réalité.
- SG
Ma dernière question, être utopique, ce n'est pas aussi un acte de résistance quand même ?
- SZ
Je ne suis pas utopique.
- IM
Moi, je ne suis pas utopiste non plus. j'aime pas trop ça. Pourquoi l'utopie j'aime pas trop ça parce que c'est des longues considérations historiques mais être utopiste souvent malheureusement, c'est être déconnecté du concret je pense que il faut voir le déjà là du futur ça c'est utopiste. Si ça n'a pas tracé la main entre les deux mais il faut passer de l'utopie au concret et donc paver en fait le chemin entre les déjà là du passé et notre sécu, ce qu'on veut arriver et les concepts qu'on a aujourd'hui et les actes qu'on pose. Et si je termine avec un peu de philosophie, moi je suis un fan absolu de Camus, et Camus, dans le Mythe de Sisyphe, il explique, il n'y a qu'une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. Pourquoi il va dire ça ? Il va donner en fait une perspective sur la notion de l'absurde. Il va définir l'absurde comme étant un choc de sens. Je suis dans le métro le matin, et je me dis, mais pourquoi je vais au travail là ? À quoi ça peut bien pouvoir servir ? Et il va donner trois réponses à l'absurde. Il écrit ça aussi en sortie de seconde guerre mondiale. Première réponse le suicide il dit que c'est pas la bonne solution donc on passe. Deuxième réponse la religion c'est à dire tu vas te réinventer un sens dans un éternel etc ça convient pas à Camus et la solution qu'il va donner il faut lire le livre donc il faut couper le podcast si vous voulez pas être spoilé mais la solution qu'il va donner c'est qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe il a voulu éviter la mort et il a été condamné par les dieux à pousser son rocher jusqu'au haut d'une colline et quand il est en haut d'une colline, le rocher va dégringoler et jusqu'à la fin de l'éternité, il va devoir pousser ce rocher. Et Camus dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer, il faut qu'on reconstruise le sens par les actes qu'on pose. Ça n'a aucun sens de pousser le rocher, mais on va ressentir des choses quand on va pousser le rocher. Au début, quand c'est tout en bas, ça va être dur, c'est de la tristesse etc et quand on est tout en haut on se dit on est presque arrivé, on a fait un chemin, on a créé quelque chose et bien c'est ça exactement ce qu'il faut faire c'est à dire fondamentalement être un émetteur de sens pour les autres et nous par nos actes qu'on pose par ce qu'on va lire, par ce qu'on va regarder qu'on reconstruise du sens concret au monde. Être un émetteur de sens et les émetteurs de sens attirent les autres émettrices et les émetteurs de sens et donc dans le mythe de Sisyphe il faudrait même imaginer plusieurs Sisyphe à pousser le rocher, et du coup sauter cet aspect solitaire, mais toujours avec la dimension que la vie, c'est des moments où le rocher est tout en haut, des moments où il est tout en bas, mais à chaque instant, c'est en étant émettrice, émetteur de sens, et en rencontrant des émettrices et des émetteurs de sens, qu'on réintègre en fait de l'émancipation et qu'on arrive à vaincre l'absurde en réalité.
- SG
Voilà. Maintenant, pour les gens qui ont écouté, vous avez quatre heures pour me faire une dissertation. Merci en tous les cas. Utopie, moi, Serge,ça m'intéresse de t'entendre.
- SZ
J'ai l'impression d'être complètement illettré en parlant. Moi, je ne lis pas de livres, j'assume. C'est que des articles scientifiques et des éléments comme ça. Mais je n'ai pas lu de livres, sauf ceux qui étaient obligatoires à l'école. Et je pense que s'il y avait ChatGPT, j'aurais fait une synthèse sur ChatGPT à l'époque. Alors moi, non, je ne suis pas utopiste parce que je suis dans les campagnes et dans le quotidien des agriculteurs tous les jours, et je les vois faire les modifications. Et on parle en fait d'un ensemble de solutions qu'on a en commun sur le sol, sur les arbres, sur les haies, sur... sur les adaptations génétiques, sur l'irrigation. C'est ça, c'est du terre à terre, c'est du concret. Et donc, je ne suis pas utopique parce que je vois le changement. Je ne suis pas d'accord qu'il soit assez rapide, mais je ne suis pas utopique sur le fait qu'on peut le changer, on peut le faire. Et donc, pour moi, l'utopie, c'est de se dire qu'on ne peut pas y arriver.
- SG
Ah, dans ce sens-là. OK.
- IM
C'est bien ça.
- SZ
Écoutez, messieurs,
- SG
on va finir là-dessus. Je trouve que vous avez été plutôt pas trop bavards, corrects, concrets. Moi aussi, j'ai été assez sobre. En tous les cas, merci. Merci. Parce qu'on comprend aussi que la résilience, ce n'est pas qu'une affaire technique. Ce n'est pas qu'une affaire non plus de plan d'action. C'est aussi un état d'esprit. Donc, il faut s'adapter, composer avec l'instable. Il faut tisser des liens, nourrir des liens. Et nous, les humains, finalement, c'est ça qui nous tient.
- IM
Faire société, faire collectif.
- SG
Voilà, exactement.
- IM
Faire ensemble.
- SG
Et se faire confiance. Et si on se fait confiance, en effet, on pourra s'en sortir. En tout cas, merci, Iliane. Merci, Serge. Je finis toujours par une citation. Alors, j'ai cherché un truc de Desproges, mais je finirai par une citation que vous avez donnée sur le film La haine, finalement. C'est le gars qui tombe du 41ème étage à chaque étage et qui dit "tout va bien jusqu'ici tout va bien". En fait l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et bien merci beaucoup, à bientôt.