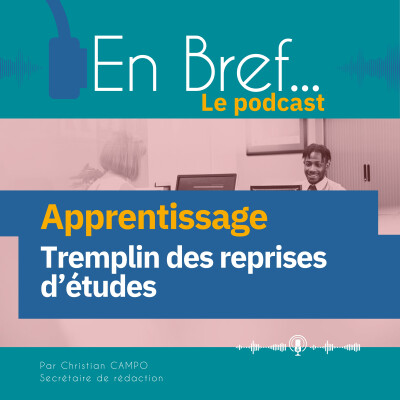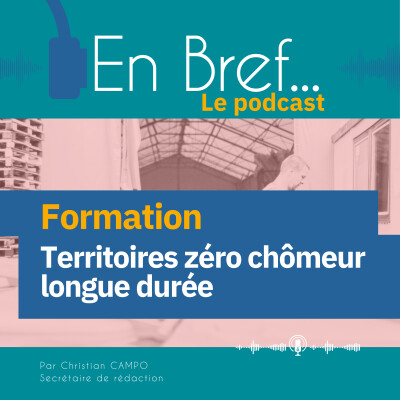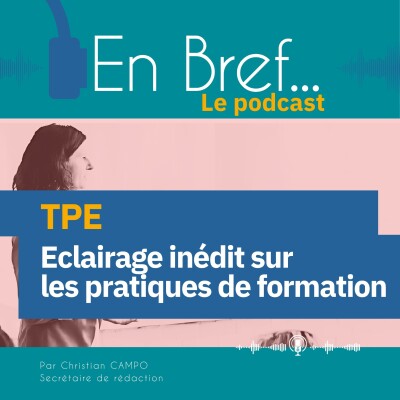Description
🌎 La mise en œuvre du Contrat d’engagement jeune (CEJ) marque une évolution majeure des politiques d’insertion des 16-25 ans sans emploi ni formation, en plaçant au centre du dispositif un quota d’activités hebdomadaires à réaliser. Si cette obligation vise à intensifier l’accompagnement et à responsabiliser les jeunes, elle génère sur le terrain des adaptations, voire des contournements, modifiant profondément les pratiques des conseillères et l’expérience vécue par les jeunes. Cette nouvelle étude du Céreq s’appuie sur une enquête qualitative menée dans onze territoires. Elle documente la genèse, les effets et les tensions du dispositif, entre logique de contrôle, soutien individualisé et redéfinition des missions des conseillères.
🎙️Christian CAMPO, secrétaire de rédaction au Céreq, nous partage en quelques minutes les principaux résultats de cette analyse et ce qu'il faut en retenir.
📘 La publication complète est à retrouver sur : https://www.cereq.fr/contrat-engagement-jeune-politique-jeunesse-rsa
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.