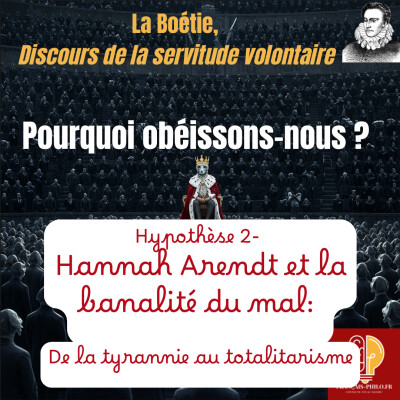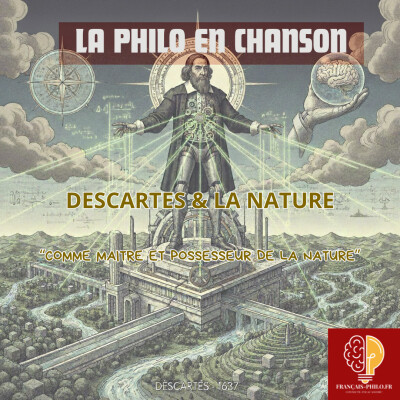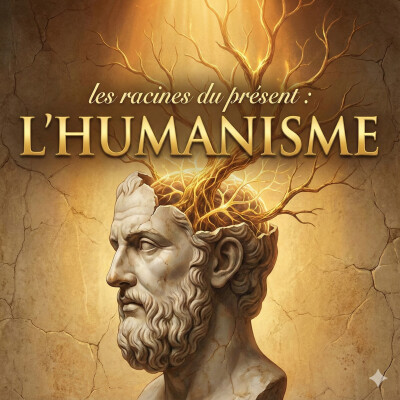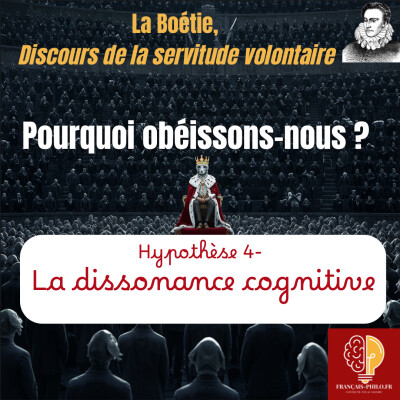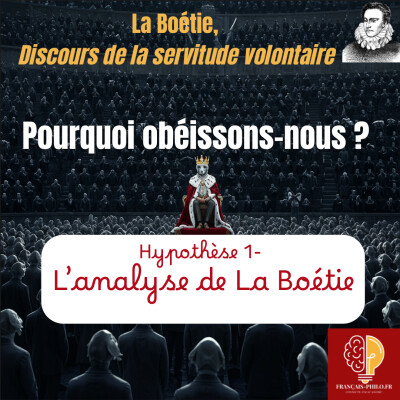Speaker #0Et si le pouvoir le plus écrasant ne tenait qu'à un fil, et que ce fil, c'était nous ? C'est la question que se posent deux penseurs à quatre siècles d'intervalle. D'un côté, au XVIe, un jeune homme de 18 ans, Étienne de la Boétie, nous lance un défi. Le tyran n'est rien sans nous. C'est notre propre consentement, notre servitude volontaire qui lui donne sa force, et la solution qu'il nous propose. Elle est radicale, elle paraît simple. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Quatre siècles plus tard, une autre voix s'élève face à une horreur inédite. C'est la voix d'une philosophe reconnue, Anna Arendt. Elle a vu naître une machine bien plus terrifiante que le simple tyran, le totalitarisme. Pour Arendt, le jeu a changé. Le pouvoir ne se contente plus d'exiger notre obéissance. Non, il veut s'infiltrer dans nos vies, dans nos pensées. s'immiscer jusque dans l'intimité des consciences. Parce que son but, c'est la réalisation fanatique d'une idéologie qui prétend incarner les lois suprahumaines et inéluctables de la nature dans le cas du nazisme, avec la lutte des races, et de l'histoire dans le cas du stalinisme. Et face à ce monstre qui vise à refaire l'humanité, ou à la détruire plutôt, un simple non ne suffit plus. Alors, comment passe-t-on de la tyrannie à cette domination totale ? Et surtout, pourquoi continuons-nous à nous soumettre ? Donc la question, c'est de savoir comment le tyran de la Boétie, qui tombe si on arrête de le servir, a pu muter en un monstre absolu qu'est le totalitarisme. Pourquoi face à lui, l'obéissance ne suffit-elle plus pour survivre, et même ne plus servir ne suffit plus ? La terreur totalitaire a changé de nature. Elle ne punit plus seulement les opposants. Elle frappe au hasard, visant des innocents, et même ses partisans les plus fidèles. Le but du totalitarisme n'est pas de vous faire obéir. Son but, c'est de transformer le monde pour qu'il colle à son idéologie folle, une prétendue loi de la nature ou de l'histoire. Et pour ça, elle doit sans cesse éliminer des catégories entières de gens déclarés superflus ou nuisibles. Pour Hannah Arendt, le monstre totalitaire n'est pas né de rien. C'est le résultat d'un processus dont les éléments parcourent le XIXe siècle, déjà. Le premier élément, c'est un antisémitisme d'un nouveau genre. Ce n'est plus une simple haine religieuse, mais c'est une idéologie qui prétend tout expliquer, une fausse clé de l'histoire qui rend responsable les juifs de tous les malheurs de l'humanité. Le deuxième élément, c'est l'impérialisme. C'est la soif de conquête sans fin des empires coloniaux et l'idée que le monde est un marché à dévorer sans aucune limite morale. Le troisième élément, c'est le racisme comme justification. Pour dominer les peuples colonisés, on invente Les races de maîtres et les races d'esclaves. Et le modèle est prêt. Enfin, il manque un petit élément très utile, qui est une espèce de liant de tout cela, c'est la bureaucratie. Un pouvoir anonyme où l'on organise un génocide depuis un bureau, sans jamais voir une seule victime. C'est le règne de personnes, pour employer les termes d'Anna Arendt. Pour Arendt, les colonies ont servi de laboratoire. La violence, le racisme, l'administration, la mort parfois, tout a été testé avant d'être rapatrié au cœur de l'Europe. Le monde a changé, bien sûr, entre la Boétie et Anna Arendt. La société structurée de la Boétie s'est effondrée. A la place, après la première guerre mondiale, on a une masse d'individus, souvent déracinés, isolés, seuls, des populations ou des gens qui ont perdu leur place dans le monde et qui vont trouver dans les promesses du totalitarisme un sens. Parce que c'est dans ce vide angoissant que la propagande totalitaire va s'engouffrer. En offrant à cet homme seul une nouvelle famille, une mission, un but. Elle lui murmure « Tu n'es plus seule, tu es l'histoire en marche. » Mais une fois au pouvoir, comment fonctionne la machine totalitaire au quotidien ? Comment fait-elle pour que personne ne puisse s'échapper ? Arendt nous donne deux éléments essentiels de sa mécanique. Une espèce de moteur surpuissant à deux temps. D'un côté l'idéologie, de l'autre la terreur. L'idéologie d'abord. Ici ce n'est plus un mensonge politique, c'est plus pervers que cela. Le but de l'idéologie dans le totalitarisme, ce n'est pas de tromper, c'est de construire une réalité alternative totalement fictive, mais avec une logique interne implacable. C'est comme un jeu vidéo dont on ne pourrait pas sortir. Cette idéologie ne va pas chercher à convaincre avec des faits. Elle aspire l'individu dans sa propre logique jusqu'à le couper du monde réel. Pour Arendt, le citoyen du modèle totalitaire n'est pas le fanatique, c'est celui qui, à la fin, ne sait plus faire la différence entre la vérité et le mensonge. Le deuxième élément essentiel dans le totalitarisme, C'est la terreur. Ce n'est pas un outil pour juste faire peur aux opposants, la terreur du totalitarisme. C'est l'essence même du régime. Son objectif, c'est de détruire l'espace vital de la liberté, l'espace entre les gens. En brisant toute solidarité, toute confiance, elle vous enferme dans ce que Arendt appelle un cercle de fer d'isolement. Et terreur et idéologie s'auto-alimentent dans un cercle vicieux sans fin. Parce que l'idéologie va désigner les ennemis qui ne cadrent pas. avec son monde parfait. Et la terreur va éliminer ses ennemis. Pire, en exterminant un groupe, par exemple les juifs ou les homosexuels ou les tziganes, en ce qui concerne le nazisme, le régime prouve que son idéologie est vraie. Plus la réalité devient un cauchemar, plus les gens se réfugient dans la fiction rassurante de l'idéologie. Ce qui justifie alors encore plus de terreur. C'est une machine qui ne peut pas s'arrêter. Et au cœur de cette machine, il y a son incarnation ultime. Son laboratoire de l'horreur, c'est le camp d'extermination. Pour Arrinte, le camp n'est pas une prison. C'est une expérience scientifique dont la question est peut-on détruire l'humanité chez un être humain ? Peut-on prouver que l'homme n'est qu'un animal que l'on peut rendre totalement superflé ? Pour y arriver, le processus est méthodique, chirurgical. En gros, il y a trois étapes pour anéantir une personne avant même de la tuer. La première, c'est la mort de la personne juridique. D'abord, on vous vole votre nom, vos droits. Vous n'êtes plus un citoyen, vous êtes un numéro tatoué sur votre bras. Deuxième étape, il faut tuer la personne morale. Le système va vous obliger à des choses impossibles, vous rendre complice des pires crimes pour survivre, et va détruire votre conscience. La troisième, c'est la mort de l'individualité. Par la faim, par la torture, par l'humiliation, on efface tout ce qui fait de vous un être humain unique. Ce n'est pas de la cruauté gratuite. C'est l'application finale de l'idéologie. Le camp est l'endroit où le monde fictif du totalitarisme devient la seule, la trosse, la terrible réalité. Mais alors une question demeure. Qui sont les gens capables de faire fonctionner une telle machine à broyer l'humanité ? On s'est rassuré en pensant que c'était des monstres, des sadiques, des fanatiques démoniaques. Enfin, des exceptions dans l'humanité. Or, Lorsqu'entre 1961 et 1962, Anna Arendt assiste au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, Adolf Eichmann qui est l'un des principaux organisateurs de la solution finale, puisqu'il était chargé de la logistique des trains de la mort, eh bien, on découvre que, loin d'être le diable en personne, Eichmann n'est qu'un monsieur tout le monde. Il n'est ni un monstre sanguinaire, ni un idéologue haineux. Il se défend calmement, il dit avoir simplement obéi aux ordres, Il se vante même de son efficacité à résoudre les problèmes de transport et explique qu'il n'a fait que son devoir, lié par son serment au Führer. Face à cette disproportion monstrueuse, puisqu'on a des crimes infinis commis par un homme terrifiant de normalité, par un fonctionnaire médiocre, un bureaucrate zélé, essentiellement soucieux de sa carrière et de satisfaire au désir du Führer. De ce choc, elle va tirer un concept qui fera scandale, la banalité du mal. Alors attention, bien sûr. Banalité du mal n'a jamais voulu dire que les crimes étaient banals. Ils étaient sans précédent et Arendt le précise. Ce qui est banal, ce n'est pas le crime, c'est l'homme. C'est le fait que des crimes extraordinaires, justement, ont été commis par des hommes banals comme s'il s'agissait d'une simple procédure administrative. Le mal, en fait, c'était une simple case à cocher sur un formulaire. Mais comment est-ce possible ? Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la folie, qu'est-ce que c'est ? La réponse d'Arendt... est assez effrayante. C'est, dit-elle, l'absence de pensée. Pensée, pour Arendt, c'est le dialogue silencieux que l'on a avec soi-même. C'est cette petite voix qui demande « Si je fais ça, est-ce que je pourrais encore vivre avec moi-même ? » Eichmann n'avait pas cette voix en lui. Il n'était pas stupide, précise Arendt. Il était vide de pensée. Il ne pensait qu'en termes d'efficacité, de carrière, d'ordre. Et cette absence de pensée n'est pas une excuse. Pour Arendt, c'est le crime originel. qui a permis tous les autres. Là où le tyran de la Boétie s'entourait d'hommes avides, de pouvoir, de richesse, le système totalitaire qu'étudie Arendt, lui, s'entoure d'hommes vides. Alors, si le plus grand danger est l'abdication de la pensée, quel va être le premier acte de résistance ? Eh bien, le premier acte de résistance, ça va être de penser. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Pour Arendt, la résistance ne commence pas dans la rue avec un fusil, mais... dans le silence de notre esprit. Résister, c'est refuser intérieurement de consentir. C'est garder cette conversation avec soi-même, vivante, pour ne jamais avoir à vivre en compagnie d'un meurtrier, soi-même. Et cette pensée solitaire doit ensuite chercher les autres. Elle doit devenir une parole, une action partagée pour retisser le monde que le totalitarisme veut détruire. Et c'est peut-être là, par-delà les siècles, que la pensée d'Anna Arendt rejoint celle d'Étienne de la Boétie. Car quel est le rempart ultime contre la servitude volontaire selon la Boétie ? Au-delà du fait de dire non, c'est l'amitié. Parce que ce lien sacré entre des gens qui se respectent, qui construisent un tous qui préserve la singularité de chacun, C'est une force collective, mais ce n'est pas une fusion, c'est une alliance. La résistance ultime, hier comme aujourd'hui, n'est donc peut-être pas seulement de dire non au pouvoir, c'est d'abord de préserver notre capacité à penser par nous-mêmes, et ensuite de trouver ceux avec qui nous pouvons encore construire un monde commun. Ainsi, à quatre siècles de distance, Anna Arendt et la Boétie se sont penchées sur la même question, pourquoi l'être humain se soumet-il à la domination ? Si leur interrogation est commune, leur réponse diverge profondément. Parce que le monstre qu'ils observent a changé de visage. La distinction la plus nette entre les deux penseurs réside dans le diagnostic qu'ils posent sur le pouvoir et sur ceux qui le servent. Chez la Boétie, nous faisons face à la tyrannie. C'est un pouvoir incarné, personnel, qui repose sur une pyramide de complicité. Le tyran achète ses soutiens en leur distribuant des faveurs et une part du pouvoir. Le complice de la tyrannie est donc un homme à vide. mue par l'ambition et le désir de s'enrichir. La servitude est volontaire, car elle est pour beaucoup un calcul d'intérêt. Chez Hannah Arendt, le mal a muté. Il est devenu totalitarisme, c'est-à-dire une machine bureaucratique, impersonnelle et idéologique qui vise à refaire le monde et l'homme. Le rouage essentiel de cette machine n'est plus l'homme avide, mais l'homme vide. C'est l'Eichmann terrifiant de normalité. le fonctionnaire zélé qui a renoncé à la plus fondamentale des activités humaines, penser. Le passage de la boétie à Arendt est donc le passage d'un mal compréhensible, presque rationnel dans sa cupidité, à un mal radical dont l'horreur réside dans son effroyable superficialité. Et pourtant, malgré cet abîme, les deux penseurs se rejoignent sur un point crucial, le terrain sur lequel la domination prospère et le moyen d'y résister. Tous deux, comprennent que le pouvoir absolu ne peut s'exercer que sur des individus atomisés. La Boétie décrit un tyran qui se méfie des amitiés et sème la discorde. Divisé pour régner, si vous voulez. Arendt fait de la destruction de l'espace entre les hommes l'essence même de la terreur totalitaire. Dans les deux cas, briser les liens humains est la condition première de la soumission. Alors que la résistance relie. Parce que la solution qu'ils esquissent tous les deux est la même. Et il faut penser et recréer du lien. Chez la Boétie, L'antidote à la servitude volontaire est l'amitié. Il ne s'agit pas d'un simple sentiment privé, mais d'un lien politique fondé sur l'estime et la confiance mutuelle, créant une micro-société d'égo que le tyran ne peut pénétrer. Chez Arendt, la résistance ultime, après l'acte intérieur de penser, est l'agir ensemble. C'est la capacité à briser l'isolement forcé pour créer un monde commun par la parole et l'action partagée. En définitive, La Boétie nous offre un avertissement intemporel sur la facilité avec laquelle nous pouvons renoncer à notre liberté, par habitude ou par intérêt. Arendt, quant à elle, nous livre l'autopsie glaçante d'un système qui a rendu cette renonciation presque inévitable, en détruisant la réalité elle-même, l'humanité elle-même. Leur double héritage est un appel à une double vigilance. Contre la tyrannie comme contre le totalitarisme, la première résistance est de préserver notre forteresse intérieure, comme dirait Marc Aurel. par la pensée critique. Et la seconde est de construire des ponts vers les autres par des liens de confiance et de solidarité. Car un peuple d'amis qui pense ne pourra jamais être entièrement asservi. Et la mise en garde et l'analyse de ces deux penseurs a aujourd'hui une résonance très très forte dont nous devrions vraiment nous souvenir.