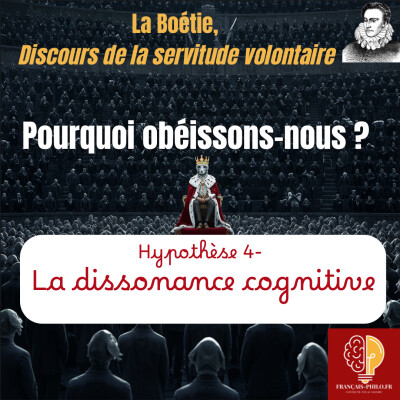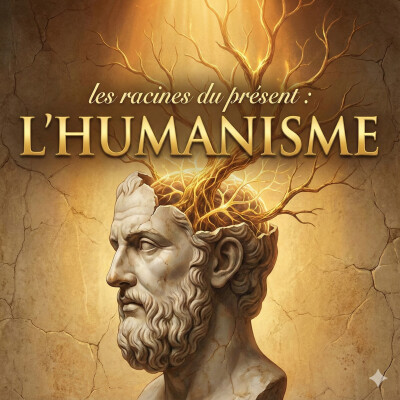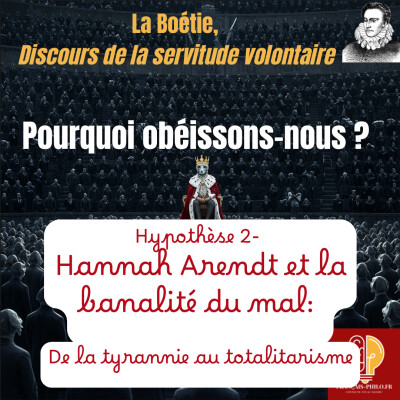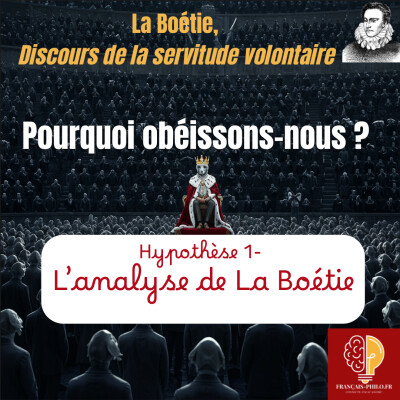Speaker #0L'association oxymorique du titre du discours de la Boétie, servitude volontaire, montre une contradiction, un paradoxe. L'association de ces deux termes en soi est déjà dissonante. En effet, comment peut-on choisir volontairement la soumission qui, elle, suppose une contrainte ? Au XVIe siècle, la Boétie n'avait pas les éléments scientifiques pour l'expliquer. Et pourtant, il affirmait déjà que la raison de cette contradiction... ne se trouvaient pas dans la puissance du tyran. Mais alors où ? Eh bien, grâce à la psychologie sociale et à la psychologie cognitive, on a aujourd'hui une explication tangible de ce qu'il se passe. Cette soumission peut en réalité trouver sa source dans un biais de notre cerveau. Parce que, d'un point de vue purement logique, on peut vraiment se demander pourquoi des millions de personnes obéissent à un seul homme, par exemple, un tyran, ou parfois à des ordres qui vont à l'encontre de nos valeurs. Alors, la première explication qui vient, c'est la peur. Toutes les tyrannies entretiennent la peur. Par exemple, en France, pendant l'occupation allemande, beaucoup ont accepté l'inacceptable parce que se rebeller, refuser, c'était prendre le risque de mourir. Alors oui, bien sûr, cette peur peut jouer. Mais elle n'est pas suffisante, parce qu'en réalité, le processus est plus complexe que cela. Il y a chez l'homme un fondamental désir de liberté. Et beaucoup de philosophes, d'ailleurs, considèrent cet état de liberté comme naturel. Alors, comment ce désir de liberté, si puissant en chacun de nous, peut-il coexister avec l'acte de se soumettre volontairement ? L'une des réponses ou d'explications données au XXe siècle, ce sera la dissonance cognitive. Mais concrètement, qu'est-ce que la dissonance cognitive ? C'est un sentiment qu'on peut tous éprouver, et très fréquemment. C'est une sorte de malaise intérieur, une tension inconfortable à l'intérieur de soi, quand on fait quelque chose qui va... à l'encontre de nos valeurs. Imaginons par exemple que j'ai dans la vie quotidienne une croyance qui est celle d'être une personne raisonnable, qui gère bien son budget, évite les dépenses superflues pour ne pas se retrouver en difficulté. Mais voilà qu'un jour, sur un coup de tête, j'achète le dernier iPhone à un prix exorbitant, en tout cas bien trop cher pour mon budget. Va alors se produire une dissonance en moi, parce que l'action que je viens de faire, acheter ce smartphone, contredit l'image de moi en tant que personne raisonnable. Pour garder ma cohérence interne, je vais devoir réduire cette dissonance. Dans ce cas, je vais devoir par exemple me convaincre que cet achat était absolument nécessaire puisque mon ancien téléphone était trop lent et que je ne pouvais plus travailler correctement. Ou bien que de toute façon, l'ancien allait me lâcher et que ça allait être une catastrophe. Ou encore, minimiser l'importance de la dépense en me disant que finalement, Avec tout ce que je travaille, je méritais bien ce cadeau, etc. Ainsi comme mon cerveau déteste la tension interne, il va essayer de se calmer et il va tout faire pour que les choses redeviennent cohérentes. Ce qui est fou, c'est qu'il se passe la même chose pour l'achat d'un smartphone que pour la servitude. J'ai la conviction d'être un être humain libre. Et pourtant, j'obéis à des choses qui ne sont pas nécessairement dans mes valeurs. Cette opposition va créer cette tension psychologique et elle peut devenir intenable. A la question comment un esprit humain peut-il passer de la certitude d'être libre à l'acceptation de la soumission, la réponse sera la même que pour le smartphone. D'abord, il y a la croyance selon laquelle je suis une personne libre qui mérite cette liberté. Et c'est une croyance profondément ancrée en moi. Ensuite, il y a la réalité de mes actions qui contredisent cette croyance d'être libre, puisque j'obéis aux ordres d'un tyran, je ne me révolte pas, et chaque acte de soumission, petit ou grand, vient percuter de plein fouet cette croyance initiale que j'ai en ma liberté. Donc à ce stade, le conflit intérieur peut être extrêmement douloureux, violent. Comment me voir comme quelqu'un de libre alors que mes actions me prouvent le contraire ? Il va donc falloir que je trouve le moyen de mettre fin à ce conflit intérieur. Pour cela, mon cerveau a deux options. La première consiste à changer l'action et à se révolter, mais ça peut être très difficile et parfois très risqué pour ma vie. L'autre option va paraître, au moins en apparence, beaucoup plus simple. Il va falloir changer ma croyance. C'est quand même ce qui va me demander la moindre résistance psychologique. Et comme c'est plus facile, c'est la plupart du temps vers cela que je vais tendre. Comment changer cette croyance ? Pour retrouver ma cohérence interne, je vais trouver des justifications, des rationalisations et me raconter une histoire. Par exemple, je vais faire en sorte de me convaincre que ce tyran, ça n'en est pas vraiment un, et que finalement, certes, il m'impose des ordres, mais que ces ordres, c'est une assurance de sécurité. Ou bien qu'être guidé finalement me soulage des responsabilités qu'implique ma liberté, etc. Enfin, je vais trouver des avantages à la situation dans laquelle je me trouve. Mon cerveau va réécrire le récit. Et ce qui va apparaître au final, c'est que la volonté de servir, ce n'est pas mon choix. C'est une construction mentale que je fais après, qui vient après l'action. En fait, mon esprit fabrique une justification pour rendre la situation vivable. Et donc, il n'y a pas en réalité de servitude volontaire, puisque je ne choisis pas d'être soumis, mais par contre, je me convainc de l'avoir choisi. En plus, ce mécanisme psychologique n'est pas uniquement individuel. Il se propage chez des milliers et des millions de personnes en même temps. Il devient alors une force redoutable, parce que si la majorité fonctionne selon ce mécanisme, alors la servitude se banalise, devient la norme. On voit ainsi que la Boétie avait raison de penser que la force ne suffit pas à maintenir un tyran au pouvoir, et que cette force ne vient pas de ses policiers, de ses soldats, ni dans l'analyse qu'en fait la Boétie, ni dans les découvertes concernant la dissonance cognitive. C'est ce qui finalement permet à la tyrannie de s'imposer et de se maintenir, parce qu'elle exploite notre besoin vital de cohérence interne, la hantise de contradictions de notre cerveau. au-delà de la servitude volontaire à un tyran, nous sommes remplis de dissonances petites et grandes entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Et il ne faudrait pas oublier que cela façonne nos vies et nos sociétés. Et que ce que nous prenons pour des choix, bien souvent, n'en sont peut-être pas.