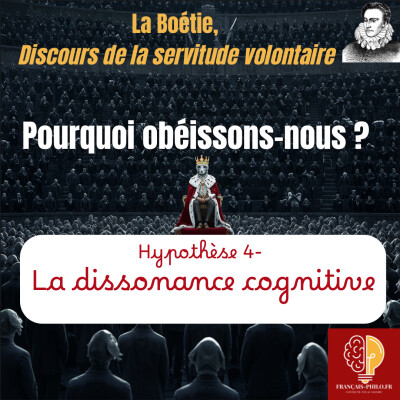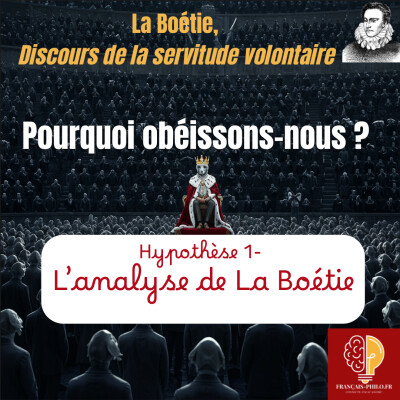Speaker #0Je vous propose aujourd'hui quelques idées clés pour mieux comprendre la notion de nature en philosophie. Qu'est-ce que la nature ? Quelle est la place de l'homme au sein de celle-ci ? Je vous conseille d'ailleurs l'excellente vidéo d'Arte intitulée « L'homme n'est pas unique » . Au XVIIe siècle, Blaise Pascal disait déjà qu'il ne faut pas juger la nature selon nous, mais selon elle. Et il semble que nous l'avons parfois oublié. La définition la plus élémentaire de la nature, c'est de considérer que la nature c'est ce qui préexiste à nous, ce qui existe sans nous, ou pour employer les termes de Marguerite Ursenar, l'écrivaine du XXe siècle, ce que nous n'encombrons pas encore. Effectivement, par définition, ce qui est naturel, ce qui appartient à la nature, n'est pas fabriqué. La nature pousse d'elle-même sans l'intervention humaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas la confondre avec l'agriculture. Au cours des siècles, la vision de la nature a un... C'est un peu modifié, bien sûr. Au XVIIe, Descartes, qui était philosophe mais aussi mathématicien, voyait dans la nature une grande mécanique régie par des lois propres, des lois physiques, mais créées par Dieu. Ces lois étaient considérées par lui comme immuables, et les connaître, d'une certaine façon, c'était devenir comme maître et possesseur de la nature, selon sa célèbre citation. Mais si Descartes donne à l'homme une... place particulière dans cette grande mécanique, à la même époque, on a quelqu'un comme Baruch Spinoza, qui lui considère que la nature et Dieu c'est la même chose, et que l'homme n'est qu'une partie de ce tout, de cette substance, qu'il n'est pas, pour reprendre ses propres termes, un empire dans un empire. Donc que sa place, d'une certaine façon, c'est la même que celle de l'éléphant ou du sol pleureur. Mais nous y reviendrons. Globalement, la plupart des philosophes ont tenté de montrer que l'homme avait des caractéristiques particulières. parmi les espèces qui le rendraient unique. Blaise Pascal, toujours, nous compare par exemple à un roseau, c'est-à-dire à quelque chose de très fragile physiquement. Mais nous sommes, dit-il, l'homme est un roseau pensant. Et donc, malgré sa fragilité, il a cette immense capacité de sa pensée, la conscience de sa finitude, de sa mort, et sa capacité à comprendre l'univers. De même, un peu plus tard, Rousseau, qui est un auteur du XVIIIe, dira lui que L'homme est doté d'une perfectibilité qui va le différencier de l'animal. Rousseau considère que l'animal n'évolue pas, ni en tant qu'individu, ni en tant qu'espèce. Alors que ce qui caractérise précisément l'homme, c'est cette capacité à se perfectionner. Néanmoins, Rousseau annonce déjà que cette perfectibilité a aussi une dimension négative, puisqu'il finit par dire que c'est cela, c'est cette perfectibilité qui nous rend tyrans de nous-mêmes et tyrans de la nature. Parce que cette perfectibilité nous éloigne de notre nature humaine en nous éloignant de la nature. Or, pour lui, l'homme est bon naturellement et c'est la civilisation qui le corrompt. Mais cette notion de nature humaine, elle va être remise en cause, notamment par Jean-Paul Sartre au XXe. Pour lui, la nature humaine n'existe pas. Ce qu'il reconnaît, c'est une condition universelle de l'homme, mais pas une nature. D'où sa célèbre citation « L'existence précède l'essence » . Ce qui signifie que... Pour Sartre, c'est à nous de devenir ce que nous sommes au cours de notre existence, par nos actes, par nos choix, puisque pour lui nous sommes libres, même nous sommes condamnés à être libres puisqu'il n'y a rien d'autre. Et donc si nous sommes libres, nous sommes responsables de ce que nous faisons de nous. Nous en reparlerons quand nous parlerons de la liberté. Ainsi, il est très difficile de différencier chez l'homme ce qui est de l'ordre, de l'instinct et de la nature ou de la culture. Au point que des philosophes comme Merleau-Ponty par exemple, considèrent que nous sommes faits de strates qu'on ne peut pas démêler entre nature et culture. Et que, du coup, d'une certaine façon, notre nature, c'est d'être des êtres de culture. Et donc des êtres portés vers l'évolution, vers la technique. La technique fait partie de la culture. Or, une des choses qui caractérise l'homme, c'est la technique. C'est-à-dire cette capacité qu'il a à modifier son environnement, à l'adapter à ses besoins. Alors que les autres espèces s'adaptent à la nature. L'homme tente d'adapter la nature à lui. Bref, tout le monde n'est pas d'accord, vous l'aurez bien compris. Et si on se place par exemple du point de vue des cyniques, qui sont des philosophes de l'Antiquité, eux sont partisans d'un retour à la nature. Notamment la figure de Diogène de Sinope, qui vivait dans une amphore qui est très connue. Diogène vous aurait dit qu'il faut rejeter les conventions sociales parce qu'elles nous éloignent de la nature, de notre nature, et en poussant un peu le trait, il faudrait vivre comme les animaux. A la même époque, les stoïciens sont moins radicaux, mais ils considèrent aussi que suivre la nature, c'est suivre sa nature. Parce qu'il y a une entité, une sorte de divinité qui a mis un ordre parfait dans le monde. Et cet ordre-là, ce n'est pas à nous de le défaire. Sauf que chez les stoïciens, il y a la volonté de comprendre par la raison cette nature pour la suivre. Et donc il faut la comprendre de manière rationnelle, lui obéir, mais de façon réfléchie, raisonnée. Alors, cette idée des stoïciens de suivre la nature faisait rire Nietzsche, Nietzsche étant un philosophe du XIXe siècle. Parce que pour lui, la nature, c'est le chaos. La nature est injuste, en tout cas elle n'est pas juste. et que Vouloir la suivre pour lui c'est absurde puisque justement notre travail d'homme, si l'on peut dire, c'est de sortir pour lui de cet état de nature, de créer nos propres valeurs et dans le cas de Nietzsche de devenir le surhomme, celui qui s'est libéré de ses chaînes, qui a brisé les idoles au pied d'argile. Toutes ces divergences, ces tensions entre le besoin que nous avons de la nature, le désir que nous avons aussi de la maîtriser nous mènent droit aux problèmes actuels. nous sommes entrés dans ce que certains ont appelé l'ère de l'anthropocène. C'est-à-dire le moment où l'homme, par son activité, est devenu la force dominante qui transforme la nature, le climat, le met en danger et met en danger la biodiversité. Or, cette anthropocène, cette ère anthropocène, certains philosophes ont été très conscients tôt de notre responsabilité. Et particulièrement au XXe siècle, parce que la technique a pris alors un rythme frénétique. et notamment à travers la découverte de l'atome. Je vous rappelle quand même que depuis 1945, l'homme est capable non seulement de s'autodétruire, mais de détruire aussi les autres espèces, et d'un seul coup, avec une seule bombe. Et c'est cette situation qui pose par exemple Hans Jonas, dans les années 60, à écrire un livre qu'il appelle « Principes-Responsabilité » , et dans lequel il montre que nous sommes sur une voie dangereuse, et que nous sommes responsables des générations futures, pas seulement de l'ici à maintenant. Et donc il va poser un impératif moral très fort qui nous met face à nos responsabilités en affirmant que notre devoir est d'offrir aux générations futures une vie authentiquement humaine sur Terre. Mais pour ça, évidemment, il faut respecter la planète. Il ne faut pas la raisonner comme des ailes de guerre et il ne faut pas l'exploiter comme quelque chose qui serait éternellement exploitable. Et c'est sans doute ce que Michel Serres essaye de nous faire comprendre en nous disant qu'il faut que l'homme cesse d'être un parasite pour la planète, et que sa relation à elle change, et qu'il devienne un symbiote. En fait, la relation entre l'homme et la nature doit devenir symbiotique, parce que c'est l'intérêt même de l'homme de respecter la nature dans une relation équilibrée. Et donc lui, il va proposer un contrat naturel. Ce contrat va consister à donner à la nature les mêmes droits que peut avoir un être humain. En fait, il propose de faire de la nature une personne morale, Et donc, ceux qui l'attaquent peuvent être juridiquement condamnés. Aujourd'hui, c'est le cas en Nouvelle-Zélande, en Équateur, en Amazonie, où certains fleuves ont été considérés comme personnes morales. Ainsi, toute l'ambiguïté de l'homme, c'est que c'est un être naturel, mais qui par nature a la capacité d'évoluer, mais aussi de détruire son propre environnement et de se détruire lui-même. Toute la question est donc de savoir comment il peut mettre sa perfectibilité, pour reprendre les mots de Rousseau, au service d'une vie harmonieuse avec la nature, et non au service de la destruction. Dans son propre intérêt. Il va de soi que cette question est particulièrement actuelle, et pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse très satisfaisante. Merci.