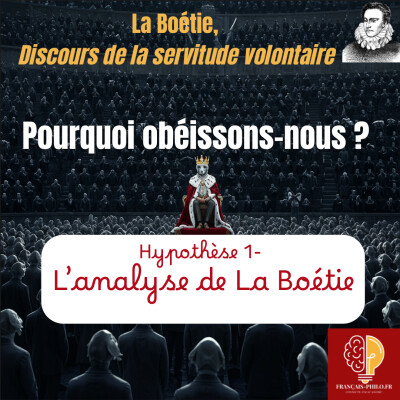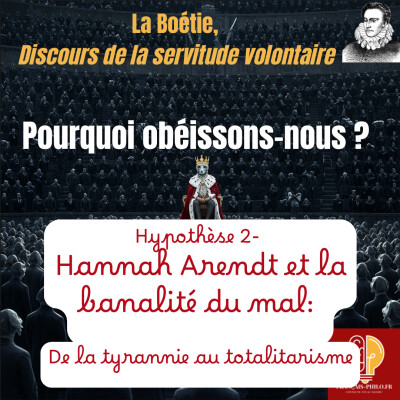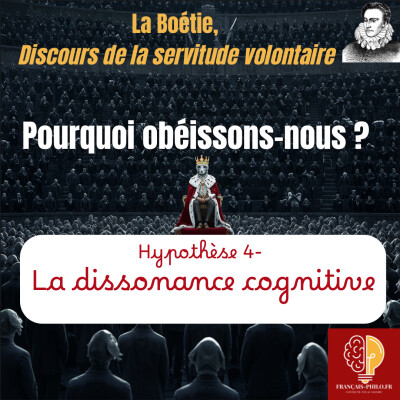Speaker #0Dans le discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie nous met face à une question très dérangeante. Comment un seul homme peut en soumettre des millions ? Il écrit « Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils le veulent bien l'endurer. » et qu'il ne pourrait leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. La Boétie insiste lui-même sur le fait que le tyran n'a que deux yeux, deux mains, un corps comme tout le monde. Alors d'où tire-t-il cette force incroyable pour contrôler des nations entières ? C'est ce paradoxe qu'on va tenter d'analyser, d'abord du point de vue de la Boétie, puis dans les épisodes suivants, nous comparons ces explications aux hypothèses de Hannah Arendt avec la banalité du mal. L'expérience de Milgram aussi sur l'autorité et plus récemment les découvertes en psychologie sur la dissonance cognitive. Mais pour l'instant donc, nous allons nous en tenir à la Boétie. Il insiste sur l'idée que ce n'est pas la force, la contrainte, qui est la cause de la servitude, mais qu'elle repose plutôt sur quelque chose de bien plus subtil, de plus puissant. Pour lui, la servitude en fait n'est pas juste subie, elle est volontaire. Et le peuple choisit bien souvent, sans même s'en apercevoir, de se soumettre. Or, pour la Boétie, si le peuple décidait d'arrêter de servir, le tyran s'effondrerait. « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres » , écrit-il. La Boétie ne souhaite pas de révolution sanglante. Il nous demande simplement de ne plus le soutenir, le tyran donc. « Et vous le verrez, dit-il, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. » Mais précisément, le paradoxe est là. Comment cette servitude peut-elle se maintenir par la volonté ? de ceux qui la subissent. Pour l'auteur du discours, la première raison, et peut-être la plus redoutable, c'est la force de la coutume. La coutume, c'est-à-dire l'habitude. Il écrit Ainsi, Si la première génération est soumise par la force, les générations suivantes naissent dans ce système déjà existant. Donc pour elles, la servitude est la norme, un état normal puisqu'elles n'ont jamais connu autre chose. Et donc elles acceptent leur sort sans même y penser. En effet, comment ceux qui n'ont jamais connu la liberté pourraient-ils la désirer ? En fait, la coutume agit comme un anesthésiant, elle transforme une situation imposée en une réalité normale. Et c'est la première explication proposée par la Boétie. Mais... l'habitude seule ne suffit pas toujours. Il arrive que les peuples asservis se réveillent et se révoltent. Il faut donc entretenir activement le pouvoir pour garder le peuple bien docile. Et le tyran va le faire avec ce que la Boétie appelle les drogues ou drogueries. Les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce, écrit-il, étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. L'objectif du tyran est simple, cultiver la faiblesse, éteindre la moindre étincelle de courage, la moindre envie de se rebeller. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de citoyens forts ni déterminés, mais plutôt des sujets dociles, apathiques, qui ne se soucient que de leur petit plaisir. En fait, il faut ramollir les esprits. Et il écrit, ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituait à servir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits-enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Pour cela, donc, il faut leur donner du pain et des jeux, selon l'expression latine « panem et circenses » formulée par le poète satirique Juvenal dans la 7e 10. C'est une vieille stratégie, consistant à assurer au peuple subsistance et divertissement pour s'attirer, sa bienveillance et maintenir la paix sociale. Et c'est à peu près toujours d'actualité. Pour la Boétie, ces drogues, ces drogueries, sont des appâts qui endorment le peuple. En échange de ces distractions, les gens oublient qu'ils sont asservis. Pire, ils deviennent complices de leur propre servitude. Donc, la coutume endort les esprits, les distractions les paralysent, mais il manque encore un élément essentiel, ce qui fait tenir debout tout ce système, parce que c'est l'architecture même du pouvoir. En fait, le pouvoir du tyran ne vient pas uniquement de sa personne, mais d'un réseau d'une pyramide subtile de complices qui ont tout intérêt à ce que le régime reste en place. Voilà ce qu'écrit la Boétie. Ce ne sont pas les armes qui défendent Tintiron. Mais toujours, on aura peine à le croire d'abord, quoique ce soit l'exacte vérité, quatre ou cinq hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays. Ces six en ont sous eux six cents, qu'ils corrompent autant qu'ils ont corrompu le tyran. Ces six cents en tiennent sous leur dépendance six mille, qu'ils élèvent en dignité. Et qui voudra en dévider le fil verra que, non pas six mille, mais cent mille et des millions, tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui. Donc, on a tout en haut le tyran, juste en dessous il place cinq ou six conseillers, ces hommes de main qui profitent directement de sa cruauté et que la Boétie appelle les tyrannos. Ces tyrannos contrôlent des centaines d'autres individus qui à leur tour en dominent des milliers, voire des millions, et chacun à son petit niveau opprime ceux qui sont en dessous pour garder les miettes de pouvoir que le tyran lui a donné. La coutume, l'abêtissement par les distractions et cette pyramide du pouvoir, ce ne sont pas des éléments séparés. ce sont les éléments nécessaires pour que la servitude ne se brise pas. La coutume, c'est le pilier psychologique, celui qui anesthésie l'envie de liberté. La lâcheté entretenue par les distractions, c'est le pilier comportemental qui paralyse toute volonté de se révolter. Et enfin, la pyramide, c'est le pilier structurel, le ciment de tout l'édifice basé sur un réseau de complicité. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la servitude n'est pas un état passif. C'est un système actif. Un édifice qui doit être maintenu en permanence par le tyran et ses complices. Et à ce sujet, la Boétie écrit encore, « Ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyrannos. » Mais c'est aussi, et c'est là toute l'audace de la Boétie, que ce tyran tient par le consentement du peuple lui-même, même si ce consentement est inconscient. Il écrit « Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt, qui se font malmener, puisqu'ils y s'en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit. et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le jour, qui consente à son mal ou plutôt qui le recherche. Si la Boétie a raison, si la servitude repose sur notre propre volonté, alors la liberté tient à la décision de dire non, d'arrêter d'obéir pour que l'édifice s'effondre. Et les révolutions sanglantes sont inutiles, car sans le consentement des peuples, sans cette servitude volontaire, Les tyrans ne sont rien. On peut lire aussi dans ce discours, donc. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de même que la branche, n'ayant plus de sucre ni d'aliment à sa racine, devient sèche et morte. Il suffit donc de ne plus obéir. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Un conseil donné il y a cinq siècles. Une pensée à méditer qui résonne encore avec une force incroyable aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Hannah Arendt analyse l'obéissance qui aboutit à ce qu'elle appelle la banalité du mal.