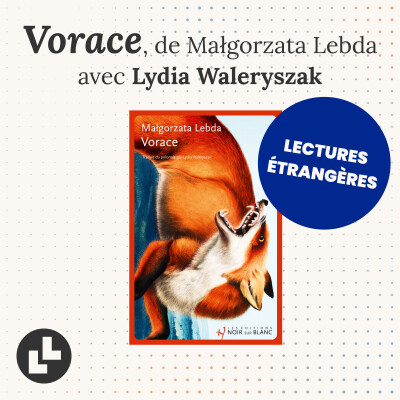- Speaker #0
Chers voyageurs,
- Speaker #1
prochain arrêt, la gare de Brel-Lalue.
- Speaker #0
Dans les années 30, un débat fait rage à l'Académie française. La moissonneuse batteuse doit-elle être féminine ? ou masculine. Conclusion des académiciens, plus passive que le tracteur, la moissonneuse batteuse est assurément féminine. La langue est le reflet de nos projections sociales et penser une langue c'est toujours éclairer un certain rapport au monde. De la même façon que les inégalités sociales et les rapports de force transparaissent dans la manière dont nous utilisons le langage. c'est aussi dans le langage que peuvent se construire de nouvelles formes de solidarité. C'est justement l'un des objets d'étude de Coraline Jortet, l'invité de ce dixième épisode de Langue à langue. Coraline est chercheuse au CNRS et traductrice du chinois. À travers ses recherches, elle explore l'histoire culturelle et politique de l'Asie synophone, au prisme des pratiques linguistiques. Je suis allée la rencontrer chez elle, à Brenn-la-Leu, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles. Coraline m'a servi une tasse bien fumante de Puerh, un thé fermenté de la région du Yunnan, et on a passé trois heures passionnantes à discuter. En vrac, on a parlé des réformes linguistiques en Chine au XXe siècle, de la place de la traduction dans le projet national chinois, du sexisme intrinsèque aux langues et des initiatives contemporaines pour faire évoluer les représentations de genre dans la langue chinoise. On a parlé aussi de l'écriture en caractère, des dangers de l'exotisation des langues et de la poésie hongkongaise. Dans cet épisode, j'espère vous transmettre un peu de la finesse Merci. avec laquelle Coraline a su clarifier ces sujets complexes. J'espère aussi vous donner envie de remettre en question certains de nos a priori sur les langues et les cultures et faire que désormais, on ne vous parle plus chinois lorsqu'on vous parlera du chinois. Je suis Margot Grillier et vous écoutez Langue à langue, épisode 10, poésie, jeux d'enfants et militantisme chinois avec
- Speaker #1
Coraline Jortet.
- Speaker #0
Langue à langue.
- Speaker #1
Bonjour, bienvenue. Là, on se trouve dans mon bureau. C'est une pièce... haute de plafond, avec un sol en bois. Et alors, la petite spécificité, c'est que le tapis qui est là, on est tous les deux, avec mon compagnon, très allergiques aux acariens, donc ce n'est pas un vrai tapis, c'est un tapis de yoga géant, ce qui me permet, sur mes pauses de traduction, de faire bouger le corps, ce qui est toujours précieux. Et donc, c'est... C'est une pièce que j'aime beaucoup. On a emménagé ici récemment parce qu'il y a surtout tous mes livres qui sont pour le moment dans un désordre complet à la suite du déménagement. Ça fait six mois que je voudrais les classer, mais je n'ai pas encore eu le temps. Donc, il y a du français, du chinois, de l'anglais, du japonais, un peu partout, sans que ni tête. Ça fera partie d'une phase prochaine de l'emménagement. Work in progress, comme on dit.
- Speaker #0
Quand on parle du chinois, on entend généralement le mandarin. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Chine concentre une grande diversité linguistique et de nombreux dialectes dérivés de la langue chinoise, dont le mandarin. Si on parle de chinois pour désigner le mandarin, c'est parce que c'est aussi la langue officielle de la Chine depuis 1956. On parle donc de chinois comme on parle de français pour la France, pour désigner la langue d'un état-nation.
- Speaker #1
Le chinois comme langue nationale de la Chine. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident jusqu'au milieu du XXe siècle, parce que quand la Première République de Chine est fondée en 1912, se pose la question tout de suite de quelle langue, de toutes les langues parlées sur le territoire national de la Nouvelle République, doit devenir la langue nationale. Et on se demande brièvement, est-ce que ça va être... Le mandarin, si oui, lequel ? Parce qu'il y a différentes variétés, enfin complètement intercompréhensibles, mais avec des différences malgré tout. Puis il y a évidemment dans le sud le cantonais, le haka, différentes langues, le mongol dans le nord, etc. Alors ce n'est pas des langues, typiquement le manchou, le mongol du tout, qui étaient en contestation pour devenir langue nationale à ce moment-là, mais... les réformateurs de la langue se sont demandés comment est-ce qu'on fait langue nationale, finalement, et une première version qui avait été suggérée aux alentours de 1913, c'est de se dire, on va ajouter au mandarin, une espèce de mandarin de compromis qui aurait des caractéristiques phonologiques de différentes variétés régionales et de différents dialectes, avec on saupoudre un petit peu de... de différents dialectes du Sud. Et puis, on s'est rendu compte très vite que faire une langue nationale qui était la langue maternelle de personne, ça n'allait pas marcher, ne serait-ce que parce qu'il fallait des profs. Cette idée du chinois qui est comme langue nationale de la Chine, oui, en français, ça se dit tout à fait, mais en fait, ça correspond à un choix qui a été fait dans les premières années de la République de Chine en 1912, du mandarin. du nord, celui de la région de Pékin, qui se fige à la fin des années 1920, au début des années 1930.
- Speaker #0
Coraline a grandi en Belgique, dans une petite ville de 10 000 habitants, au milieu des champs de blé et de betterave. Rien ne la prédisposait à apprendre le chinois, si ce n'est son désir d'ailleurs et de découverte. À l'âge de 15 ans, elle s'inscrit à un cours du soir à l'université de Liège. Elle tombe amoureuse de la langue et de ses sonorités. Elle m'explique que, contrairement aux idées reçues, le chinois n'est pas plus difficile à apprendre qu'une autre langue.
- Speaker #1
Le chinois, c'est une langue tonale. C'est-à-dire que chaque syllabe, par exemple, l'exemple très classique, c'est la syllabe ma, M-A, peut se prononcer de cinq manières différentes selon le ton qu'on y met. Ma, ma, ma, ma, ma. Et ça veut dire cinq choses différentes. Et ça, quand on n'a pas l'oreille qui est faite à ça comme francophone, parce que le français a très peu ça, on se dit, oulala, c'est terrible, on va jamais y arriver. Et c'est très déroutant. Mais à l'inverse, là où en français, on peut se prendre la tête avec l'imparfait du subjonctif et mettre des années à savoir comment conjuguer, que sais-je, les participes passés, des formes réflexives, Les reines se sont succédées. Comment accorde-t-on le participe passé succédé ? Question d'examen. Mais en chinois, typiquement, il n'y a pas de conjugaison. Et donc là, tout d'un coup, le verbe nager au présent, c'est yoyong. Au futur, c'est yoyong. Et au passé, c'est yoyong. Alors, il y a des formes pour marquer l'aspect accompli, par exemple. Mais ce n'est pas des conjugaisons. C'est une forme toujours la même.
- Speaker #0
et nous vont déplacer les difficultés sur notre aspect.
- Speaker #1
C'est ça.
- Speaker #0
Après des études de traduction, Coraline effectue un doctorat en études chinoises à l'Université libre de Bruxelles. Elle est aujourd'hui chercheuse au CNRS, spécialiste des croisements entre littérature, traduction et militantisme, dans la première moitié du XXe siècle, en Chine, et plus largement dans l'espace scénophone. Elle étudie par exemple la manière dont les militantes féministes mobilisent la littérature ou la langue comme objet féministe à cette époque-là.
- Speaker #1
On retrouve à l'époque en Chine des débats qu'on a aujourd'hui en France, pour d'autres raisons typiquement. La question du genre et des pronoms. Il faut savoir que jusqu'en 1919, il n'y a pas d'équivalent traductif de il ou elle. en chinois. Et à une époque où on traduit énormément, parce que suite aux défaites de l'Empire Qing lors des guerres de l'opium, va se poser en fait un espèce de réveil national de pourquoi y a-t-il ce retard vis-à-vis des puissances occidentales et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre ? Et cette réponse-là, elle va être scientifique, elle va être militaire, elle va être dans plein de domaines de connaissances et elle va être aussi une réponse de traduction, c'est-à-dire... Pour rattraper ce retard, vont se dire les élites lettrées de la fin de l'Empire, il faut traduire pour absorber ce qu'on peut, en faisant notre tri des connaissances de l'Occident. Et dans ce contexte-là, les catégories grammaticales qui n'existaient pas vont poser problème, parce que si vous traduisez un auteur moderniste où c'est tout le temps « il lève les yeux, elle le regarde, elle soupire, il se l'a » , pronom de troisième personne, il et elle, ça pose problème. Et donc, dans ce cadre-là, à ce moment-là, la fin des années 1910, on invente un nouveau caractère pour marquer le L. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ça pose plein de questions hyper contemporaines qu'on se pose aujourd'hui en France et ailleurs. Typiquement, si tout d'un coup, on dit il et on dit elle pour les hommes et les femmes, Que fait-on des eunuques du palais impérial ? Et quels pronoms on emploie pour parler des eunuques du palais impérial ? Alors, ça paraît bête, mais c'est des choses qui ont fait couler des colonnes et des colonnes d'encre dans la presse périodique de l'époque. Il y a des tas de personnes qui vont dire, notamment les anarchistes, mais tiens, pourquoi alors juste il et elle, et pourquoi pas un masculin, un féminin, un commun et un neutre ? C'est-à-dire un masculin, un féminin, un neutre pour les objets. un peu sur le modèle anglais, mais aussi un commun, soit pour les groupes d'hommes et de femmes, parce qu'il n'y a pas de raison que le masculin l'emporte sur le féminin, ou un commun pour tous les cas où soit la personne n'a pas de genre déterminé, soit elle n'a pas envie de le dire, on ne sait pas, ce genre de choses. Et donc, c'est des débats qui, pendant à peu près 50 ans, vont s'enflammer à intervalles réguliers. Donc c'est intéressant de voir via la traduction comment la traduction pose des questions à l'époque, en 1910, en 1920, qui sont à bien des égards transposées dans les termes de l'époque, les questions qui se posent aujourd'hui sur le genre et la langue.
- Speaker #0
C'est intéressant. Mais alors, ce qui me marque aussi, c'est qu'on a introduit un pronom « elle » , enfin, équivalent. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est un peu parti du principe que tout était masculin et qu'il manquait...
- Speaker #1
Complètement. Et c'est ce que vont dire les féministes de l'époque. D'autant plus qu'en fait, le pronom standard de troisième personne, avant pour dire il et elle, c'était un pronom qui avait la clé de l'être humain, mais pas de l'homme, de l'être humain. Et c'était le pronom de troisième personne.
- Speaker #0
Les clés, ce sont les composantes graphiques des caractères dits chinois. Ces caractères, il faudrait d'ailleurs... plutôt les appeler des synogrammes parce qu'on ne les emploie pas uniquement en Chine, mais aussi à Taïwan ou au Japon, par exemple. La plupart de ces synogrammes sont composés de deux clés, l'une liée au sens et l'autre liée à la prononciation.
- Speaker #1
Sur cette base-là, on crée ce nouveau pronom « elle » où on remplace cette clé de l'être humain par la femme, par la clé de la femme. Et on crée un troisième pronom, le neutre, l'équivalent du « it » de l'anglais. où on remplace la clé de l'être humain par la clé de l'animal. Et là, les féministes vont dire, à l'époque, et d'ailleurs ça va faire des colonnes et des colonnes dans la presse, d'accord, mais si les animaux ont la clé de la vache et les femmes ont la clé de la femme, le fait d'être un être humain est-il l'apanage de l'homme seul ? Et ça va créer des dissensions. Il y a eu des manifestations en 1924, il y a eu des groupements de féministes de Tientin qui ont fait des sit-ins devant le Congrès national pour la promotion de l'éducation nationale. Pour ça, ça a été un sujet politique et un sujet social déjà à l'époque. Donc, ce document-là, en fait, c'est un exemple que j'adore et qui montre bien, en fait, comment les débats qu'on a aujourd'hui autour du sexisme en langue ne sont pas des débats uniquement d'aujourd'hui. Donc, c'est une lettre ouverte qui date de 1952 d'une institutrice du Heilongjiang, ce qui est une région du nord-est, de l'extrême nord-est de la Chine, qui, en fait, écrit... juste avant la simplification de l'écriture, au comité national qui est en charge de la simplification de l'écriture et qui établit en fait avec sa classe une liste de caractères qu'elle trouve gênant et inapproprié pour la Nouvelle République populaire d'enseigner aux enfants parce qu'ils sont sexistes et propose et élabore en fait avec ses élèves une série de graphies alternatives qui résolvent le problème. Alors, il y a celui-là qui est... Mon exemple préféré, sans doute, qui a fait énormément débat dans les années 30, 40, 50, qui est le caractère pour dire viol, qui est trois fois la clé de la femme.
- Speaker #0
Femme,
- Speaker #1
femme, femme. Femme, femme, femme. Égale viol. Égale viol. Elle le remplace, en fait, avec sa classe, par un caractère avec la clé de l'être humain et un caractère qui veut dire faire, faire subir. Enfin, il y a un clé qui veut dire faire subir en disant, mais c'est quelque chose qui peut... arriver à tout le monde. Donc, c'est une manière de l'écrire qui serait beaucoup plus logique et elle déroule comme ça une série d'autres caractères. C'est un exemple que je trouve très intéressant parce que ça aussi, ça contrecarre un peu l'idée parfois qu'on a que les réformes linguistiques ne viennent que d'en haut et n'auraient de légitimité en venant que d'en haut et de montrer que même en 1952... Dans un contexte politique qui est quand même tendu et particulier, comme celui de la nouvelle République populaire de Chine, il y a des initiatives de ce type-là qui ont été vêtues. plus de sexisme intrinsèque à la langue chinoise qu'il y a de sexisme intrinsèque à aucune autre langue de par le monde. C'est une critique qui a longtemps été faite à la langue chinoise, notamment de la part des missionnaires à la fin du XIXe siècle, qui voyaient dans cette question du sexisme dans les caractères une raison de plus de faire du chinois une langue inférieure aux langues occidentales. Et bien sûr, dans cette mesure-là, absolument pas. Non. Maintenant, il y a du sexisme intrinsèque à toutes les langues, entre guillemets, parce que les sociétés dans lesquelles ces langues sont pratiquées sont des sociétés patriarcales et que la langue est un reflet des pratiques sociales et des pratiques de domination et de la manière dont le pouvoir s'exerce en société. Et donc, dans cette mesure-là, oui, mais de la même manière que ça peut se matérialiser en français sous d'autres formes.
- Speaker #0
Bien sûr, l'inclusivité de la langue est toujours un sujet aujourd'hui. Coraline m'a d'ailleurs cité un exemple passionnant à cet égard. Depuis une quinzaine d'années, un nouveau pronom non genré a fait son apparition en Chine, sur Internet et dans les milieux militants.
- Speaker #1
Suite à cette invention du pronom féminin en 1919, dans les deux cas, le pronom masculin comme féminin, aujourd'hui encore, s'ils s'écrivent différemment en caractère, en synogramme, se prononce, pareil, se prononce dans les deux cas, c'est la même prononciation. C'est d'ailleurs un des ressorts, je ne sais pas si vous avez vu le film Everything Everywhere All At Once, qui a fait un tabac à Hollywood il y a quelques années, c'est un des ressorts comiques du film, c'est-à-dire que dans le film, c'est l'histoire d'une famille immigrée chinoise qui vit aux Etats-Unis, et donc la mère travaille en français de Belgique, on dit une oissrette. Donc c'est un pressing. Et à une fille adolescente qui est en couple avec une autre fille. Et la mère accepte mal leur relation et va essayer de parler de la copine de sa fille en disant oui, mais de toute façon, je ne sais pas si c'est il ou elle, parce que de toute façon, c'est un tomboy. Et puis, de toute façon, en mandarin, c'est ta, ta, ta. C'est pareil, ça n'a aucun sens. Et donc, il y a un ressort comique qui se joue là-dessus. Et donc, le il ou le elle, en mandarin aujourd'hui, c'est le même mot, alors c'est... Mais à l'écrit, ça s'écrit différemment. Et donc, il y a des auteurs qui remobilisent ça en écrivant des poèmes. Justement, Huang Gang, que je suis en train de traduire, alors ce n'est pas dans ce recueil-là, mais je vais vous le prendre, le roi Yukuar, elle a sorti un... un poème justement, dont là il y a juste un extrait qui s'appelle « Roy U Khwar » , donc littéralement cuir synophone. Et il y a tout ce jeu, en fait, là je l'avais traduit en anglais dans le cadre d'un colloque qui se tenait en Angleterre, mais où le poème, justement, parle de ça et en fait décompose ici en caractère. Donc c'est « suis-je » « run » « yeah » donc ça c'est le pronom avec l'être humain plus la clé phonétique. suis-je, nuye, nuye, c'est ta au féminin, X. Et en fait, le poème remplace en disant, mais ça peut être aussi, si c'est la clé de l'humain, si c'est la clé de la femme, ça peut être aussi point d'interrogation, on remplace par un X, ou alors suis-je, ta, ta, pour dépasser ces questions-là. Et en fait, c'est un poème qui démonte les caractères qui ont trait au genre petit à petit, et puis alors qui passe une partie de ces mots-là en écriture alphabétique.
- Speaker #0
Tous les pronoms de troisième personne se prononcent en « ta » . L'idée est donc de créer un nouveau pronom dans lequel la clé variable de l'être humain, de la femme ou de l'animal est remplacée par la transcription « ta » en alphabet latin. Grâce à cette graphie, le pronom reste indifférenciable des autres à l'oreille, sans exprimer de genre. Avec de telles innovations linguistiques, il y aurait de quoi être optimiste sur l'évolution de la langue vers plus d'inclusivité. Et pourtant, en réalité, ces initiatives peinent à dépasser les milieux militants, notamment du fait de la complexité en chinois d'encoder de nouveaux caractères.
- Speaker #1
En français, on a les 26 lettres de l'alphabet, on tape au clavier avec ça et tout va bien. Et si on doit créer un nouveau mot, on le crée à partir des 26 lettres. Mais en chinois, si on veut modifier un caractère, surtout dans nos sociétés contemporaines qui sont des sociétés numériques, il faut qu'on puisse l'écrire, il faut qu'ils puissent. S'envoyer par WhatsApp, par WeChat, qui est le WhatsApp en Chine, par Line, qui est le WhatsApp taïwanais et japonais, il faut que ça puisse s'écrire. Et pour ça, il faut que ça puisse être encodé en Unicode.
- Speaker #0
Unicode, c'est le protocole qui permet de standardiser le codage informatique des textes écrits, quelle que soit la langue et le système d'écriture.
- Speaker #1
C'est une vraie question, notamment sur la question de l'écriture et du genre. Parce que tous les pronoms sur lesquels joue Juan Gang dans ce recueil de poésie, ou des tas d'autres caractères qui sont créés par les communautés LGBTQ+, à Taïwan et ailleurs, ce n'est pas forcément des caractères qui existent au sens encodage du terme. Et c'est un travail que j'avais fait, notamment, qui va enfin arriver à terme en 2025, qu'on avait commencé en 2020 avec le... Le comité international Unicode, c'est que j'avais documenté pour ajout en Unicode des pronoms alternatifs et des caractères genrés non standards qui avaient été largement utilisés dans les années 20-30 pour qu'ils puissent. Mais alors ça passe par des normisos et par des commissions qui se réunissent. Ça met cinq ans, c'est un processus de cinq ans pour que ce soit ajouté à Unicode et puis que ça puisse se taper à l'ordinateur, ça paraît tout bête. Concrètement, je vous montre tout de suite la manière dont ça marche. En fait, taper au clavier, que ce soit sur un smartphone ou un ordinateur en chinois, c'est... on tape en pinyin. Donc c'est l'écriture du chinois mandarin en lettres et avec un marquage des tons, qui est cette forme d'accent que vous avez là au-dessus des lettres. Et donc, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure sur le fait que la syllabe ma peut se prononcer de cinq manières différentes, Si tu tapes « ma » , on a le cheval, la particule interrogative. Alors, l'émoji « cheval » , parce qu'on tape aussi des émojis comme ça, la particule interrogative qui se prononce « ma » , le « ma » qui veut dire « maman » , l'émoji de « maman » , le « ma » qui veut dire « pimenter » , le « ma » qui veut dire « injurier » , etc. Et ça, c'est le « ma » du prénom « Marie » . Mais il y en a toute une série. Si on déploie, on est sur un système prédictif informatique qui va d'abord proposer les caractères les plus courants, mais la syllabe MA correspond à tous ces caractères-là. Mais de la même manière, si le caractère n'existe pas, entre guillemets, dans Unicode, parce qu'il ne fait pas partie des normes informatiques, on ne peut pas le taper à l'ordinateur. et donc ça peut être pose question justement pour cette question de néologie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là notamment pour les locuteurs et les locutrices qui inventent des termes non binaires nouveaux ?
- Speaker #0
Oui, c'est bien sûr. En recherche comme en traduction, parler de la Chine, c'est souvent prendre le risque d'exotiser la langue chinoise.
- Speaker #1
Il y a souvent en France une espèce d'a priori de la langue chinoise comme l'autre absolue, et comme cet éternel orient qui est la différence de nous par essence, et qui est quelque chose, je pense, d'assez dangereux, de vouloir ne voir dans la Chine que cette espèce de miroir. de nous-mêmes, qui est le marquage de l'espace de la différence. Alors qu'en fait, il y a des tas de choses qui fonctionnent comme en français, qui sont juste posées autrement et qui permettent... Moi, ce que je préfère faire, c'est de servir de toutes ces tiges-là pour se reposer la question de notre langue, de comment elle fonctionne, mais surtout pas dans une espèce d'exoticisation qui est dangereuse, je pense. Moi, j'aime bien poser la question, en général, à l'envers, qui est un peu théorique et abstraite, mais que je ne trouve pas inintéressante, de finalement, qu'est-ce qu'une langue ? Et pourquoi on conçoit les langues, souvent aujourd'hui, et surtout depuis le XIXe siècle, comme des ensembles clos qui seraient bien délimités ? C'est-à-dire qu'il y aurait le français comme un tout. bien circonscrit, alors qu'il n'est pas forcément, bien sûr, parlé qu'en France, qu'il est parlé dans des tas de pays francophones, soit parce qu'ils sont voisins de la France, soit parce que l'histoire de la colonisation fait que les personnes de ces pays ont appris le français. Mais on a l'impression, quand on parle du français, que le français, c'est une entité et qu'elle a un début et qu'elle a une fin et qu'elle a des frontières bien définies. Et que le chinois, ce serait aussi une entité bien définie. et or Et a fortiori, quand on est traducteur, on se retrouve à vouloir passer de langue à langue avec ce présupposé que c'est des ensembles concrets et circonscrits, là où il y a des tas de situations. Ici en Belgique, on a un petit peu l'habitude où on peut avoir des conversations où on ne sait pas très bien si c'est encore complètement du français, si c'est... du français matiné de Bruxelles, ou du bruxellais matiné de français, ou en fait, de nouveau, qui décide dans bien des situations, et en particulier dans les régions frontalières, je pense à la région frontalière franco-italienne, où se termine le français, où commence l'italien. En fait, ce n'est pas toujours complètement clair non plus. Et parfois, ce qui est frustrant en tant que traducteur francophone qui a grandi dans un français, qui n'est pas le français standard de France, c'est qu'on se retrouve avec, alors c'est un exemple que j'aime beaucoup, avec des mots de français de Belgique qui sont parfois complètement parfaits comme traduction d'un terme en chinois, mais qu'on ne peut pas ou qu'on peut difficilement intégrer à une traduction, ou en tout cas convaincre un éditeur que c'est un choix de traduction valable parce que ça n'existe pas en français standard d'Île-de-France. Alors, mon exemple préféré, c L'adjectif chinois « mon » , qui veut dire « chaud, lourd, humide » , en parlant du temps qu'il fait. Si vous êtes déjà allé en Asie subtropicale, vous avez une idée de cette espèce de chaleur touffue qui vous colle à la peau, qui est un espèce d'enfermement. En français de Belgique, et surtout dans la région de Bruxelles, on a une expression parfaite pour ça, c'est « douf » . C'est un adjectif en quatre lettres, D-O-U-F. En plus, ça marche bien, c'est une seule syllabe. c'est génial mais ça n'existe pas et cette tension là elle est compliquée à résoudre quand on est traducteur qu'on traduit pour des éditeurs parisiens qu'on n'est pas parisien soi-même comme
- Speaker #0
dans tous les épisodes de Langue à Langue j'ai demandé à Coraline de choisir un texte et de me le lire en VO puis en VF pour vous inciter l'espace d'un instant à tendre l'oreille à des sonorités qui vous sont étrangères avant de plonger au cœur des enjeux de traduction. Le texte que Coraline a choisi est un poème de Sisi, une grande dame de la littérature hongkongaise décédée récemment, en 2022. C'est une autrice pratiquement inconnue en France, alors qu'elle a reçu plusieurs grands prix aux Etats-Unis, pour sa poésie notamment.
- Speaker #1
Ce qui est très caractéristique de Sisi, c'est que c'est toujours des textes, en poésie ou en prose d'ailleurs, qui paraissent extrêmement simples et enfantins. Et puis on se rend compte, en la lisant, qu'elle décale des choses et qu'elle pose de manière assez frontale des questions politiques et sociales, mais par le regard de l'enfance et par la naïveté. Et il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Et en plus, j'ai toujours trouvé ces textes très très beaux.
- Speaker #0
L'enfance est un thème récurrent dans l'œuvre de Sissi. D'ailleurs, son nom de plume, Sissi, a une signification bien particulière.
- Speaker #1
Littéralement, caractère par caractère, c'est deux fois le caractère qui veut dire ouest, comme les points cardinaux. Mais en fait, c'est un caractère qu'elle a choisi en tant que poète pour sa dimension graphique, parce que pour elle, il représente une petite fille, si on le prend vraiment au sens complètement littéral du terme, comme un pictogramme, exceptionnellement comme un pictogramme, une petite fille qui joue à la marrelle. C'est que si on prend la forme...
- Speaker #2
Je ne sais pas si je l'ai là.
- Speaker #1
On peut le lire, cette forme-là. C'est ce que ça représentait pour elle. On en revient à ce côté imagé et naïf de l'enfant.
- Speaker #0
Le poème que vous allez entendre s'intitule « Dit, ça se dit » . Coraline l'a traduit en 2022 pour un hors-série de la revue Gentayou. consacré à la littérature hongkongaise contemporaine. Comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur le site langalang.com. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant pour la voir sous les yeux pendant que Coraline le lit, puis pendant qu'elle le commente. Ce poème, il a été écrit en caractère dans un registre de langue écrite qui s'appelle le Shu Ming Yu, qui a la particularité d'être lisible aussi bien en mandarin qu'en cantonais.
- Speaker #1
Finalement, l'écriture chinoise a servi pendant des siècles de scripta franca, comme le latin a pu servir de lingua franca à travers l'Europe. C'est-à-dire que même finalement dans l'Empire Qing, ou même aujourd'hui encore, j'ai vu ça se faire sur des chantiers de construction, quand je vivais en Chine, où on aurait par exemple des travailleurs qui viennent du Nord-Est, et puis des travailleurs qui viennent de régions qui ne parlent pas mandarin, ou qui parlent mandarin avec un très très fort accent. différents, c'est que si les gens ne se comprennent pas, un des réflexes, c'est de tracer les caractères, par exemple, dans la main. Et il y a, même si c'est des langues différentes, comme le chinois ou le japonais, ou comme à l'époque où le coréen s'écrivait encore avec des caractères, ce qui s'appelle une sphère logographique, en fait, où les locuteurs parlaient des langues différentes, mais les caractères permettaient un degré d'intercompréhension. Ici, vous en avez un même texte en caractère, qui peut se lire en mandarin, qui peut se lire avec une prononciation cantonaise, et qui pourrait d'ailleurs se lire, si on avait envie, ce ne serait pas très logique par rapport au contexte d'écriture, mais qui pourrait se lire avec une prononciation taïwanaise. Et donc, c'est intéressant, quand on vient travailler sur la poésie, en particulier en contexte hongkongais, ou pour la poésie, par exemple, qui serait écrite par un poète taïwanais, taïwanophone. ce serait de se dire « Tiens, quels sont les jeux sur les sons que le poète mobilise ? » Par exemple, qu'il existe un mandarin qui n'existe pas en cantonné, mais c'est pour ça. Et donc, c'est vrai que quand j'ai travaillé la traduction de ce poème, je me suis toujours amusée à travailler avec les deux pour voir où étaient les décalages. Alors, vous voyez que, par exemple, « i » qui veut dire « un » , c'est toujours « gâte » . D'accord. Et donc, il y a des choses qui... qui se ressemblent un peu, mais c'est plus différent que le français et l'italien. Je vais vous le lire en mandarin, et puis comme ma prononciation en cantonais est quand même pas terrible, il y a une très très belle version qui a été mise en scène de ce poème, qui est finalement un jeu, on va y revenir, de questions d'enfants, avec une dame et une petite fille, et qui est une très très belle version lue en cantonais avec un... un degré de jeu d'acteur que je ne saurais probablement pas égaler, donc je préfère la laisser telle qu'elle
- Speaker #2
est. Dojo-yu, ke bu koi shuo, yi zhu nimang Ausha,
- Speaker #1
yi shuang da li shui shuo,
- Speaker #2
yi dun xue gao su da, yi mu, a hua jian, ke bu koi shuo, yi duo yu san, yi shu xue hua, yi ping yin he, yi hu lu yu zhou, ke bu koi shuo,
- Speaker #1
yi wei ma yi,
- Speaker #2
yi ming yue zha. Un homme qui est un homme, un homme qui est un homme, est-ce possible de dire
- Speaker #3
Je ne peux pas dire. Un verre de pâtes, un œuf d'œuf,
- Speaker #4
un oeuf de pomme,
- Speaker #3
un œuf de pomme, Un peu de soda de chocolat. Un peu d'eau de Ouhaté.
- Speaker #4
Un peu de sel de cacao. Un peu de riz de plume de plume de fleurs.
- Speaker #1
Dit, ça se dit ? Dit, ça se dit ? Un bout de chou, une part de tarte, une frimousse d'ail, une particule de poivre. Dit, ça se dit ? Un fuselage d'aigle, un jus de cocotier, un crayon de soleil, une manne de giboulé.
- Speaker #2
Dit,
- Speaker #1
ça se dit ? Une brutasse de théier au citron, une épinardée de popaye. Une dégelée de soda à la crème glacée. Une chic note de chicorée. Dit ça se dit ? Une floraison de parapluie. Un blizzard de personnages. Une bouteille de voie lactée. Au couffin de l'univers. Dit ça se dit ? Une impératrice des fourmis. Un calife des cafards. Une coterie de cochons. Une couvée de héros. Dit, ça se dit, une parade de proviseurs, une colonie d'inspecteurs de province, un troupeau de généraux, un poisson épais d'empereur. Dit, ça se dit, un longane au bon oeil et à la barbe du dragon. Longue, longue, longue vie au roi poisson. La raison pour laquelle j'ai choisi le poème, pour continuer un petit peu de dérouler sur ce qui peut poser problème en traduction quand on traduit du chinois. C'est que tout le jeu du poème repose sur une catégorie lexicale qui n'existe pas en français. C'est-à-dire qu'en français, par exemple, on a la catégorie de l'eau. Et on va dire une goutte d'eau, ou un verre d'eau, ou une piscine d'eau. Et ça va être des manières de quantifier le terme eau. C'est quelque chose qui n'existe en français que souvent, pour ce qu'en anglais, on appelle l'uncountable. Donc le sable, les liquides, ce genre de choses. En chinois, et dans d'autres langues d'ailleurs, il y a une catégorie supplémentaire de mots qui se met toujours entre le déterminant et le non commun, qui est ce qu'on appelle un classificateur. Ça veut dire qu'en chinois, on ne peut pas dire une personne. On ne va jamais avoir le nombre. et puis le nom commun. On va toujours avoir l'équivalent entre deux de quand on dit une goutte d'eau, un verre d'eau, un vase d'eau. Pour toutes les catégories de mots. Et donc, par exemple, « jeûne » , une personne, c'est « y » , « y » , c'est un. D'ailleurs, c'est ce caractère-là qui est juste une petite barre qui commence quasiment... Chaque vers du poème, à part le vers qui revient,
- Speaker #2
qui est « krepukhoisho » ,
- Speaker #1
qui veut dire « est-ce que ça se dit ou non ? »
- Speaker #2
« Krepukhoisho » ,
- Speaker #1
que je traduis par « dit, ça se dit » , pour avoir cet effet de répétition. Et alors après, c'est un ceci, un ceci, un cela. Tous les vers. Mais tout le jeu de Sissi, ici, dans ce poème, c'est d'attribuer chaque fois, à chaque nom, la mauvaise catégorie de classificateur. Comme un enfant qui apprendrait à parler et qui dirait, au lieu de dire une goutte d'eau, qui dirait une boutte d'eau ou un bout d'eau, par exemple, au lieu d'une goutte d'eau. Et en fait, l'enfant qui apprend à parler va se tromper chaque fois et va chaque fois employer des classificateurs qui existent, mais qui ne sont pas les bons pour les noms qui sont employés et qui vont, en fait, et c'est tout l'objet du poème, poser la question de nos relations sociales et de ce qu'elles font. Et de, tiens, comment est-ce qu'on conçoit les ensembles de gens, ou les ensembles d'animaux, ou les ensembles de choses, et qu'est-ce que ça fait à la manière dont on pense le collectif, le social, les rapports sociaux. Et donc, c'était tout l'enjeu de ce poème-là, parce qu'à la fois, c'est un poème qui doit être extrêmement naïf, un peu, maman, pourquoi le ciel est bleu ? C'est de ça qu'on part. Et puis, à la fois, par exemple, Un verre que j'adore,
- Speaker #2
c'est le iwe huandi.
- Speaker #1
Ici, on revient sur cette question du jeu sur les tons. Le classificateur normal qui est utilisé pour les personnes de manière polie, pour dire une personne avec un classificateur, mais en la respectant, c'est wei, wei au quatrième ton. C'est le classificateur poli qui a trait aux personnes. Ici, ce qui est génial dans le poème, c'est que l'enfant se trompe et dit iwe. Ouais, au troisième ton, c'est une queue. Et donc, au lieu d'un empereur en le respectant, c'est une queue d'empereur. C'est ça, l'enfant se trompe parce que c'est proche. Parfois, il se trompe aussi parce que c'est pas intuitif, par exemple. Où est-ce qu'il est ? Ici, il inverse, par exemple, pour les parapluies. Comme c'est un groupe de parapluies, il va se tromper et employer. pour plusieurs parapluies le même classificateur qui est employé pour les fleurs dans les bouquets de fleurs. Et d'un point de vue imaginaire, c'est logique. En soi, c'est la même forme. Et donc, c'est un poème qui décale tout le temps de quelle catégorie, qui pose la question de pourquoi on envisage les choses telles qu'elles sont, du point de vue d'un enfant, et puis à la fin avec des questions sociales un peu dures, genre les empereurs, les inspecteurs, tout le pouvoir politique, et le poème se termine. par ce slogan, qui est la manière de dire longue vie, dont on disait longue vie aux empereurs, et dont on scandait longue vie à Mao Zedong pendant la révolution culturelle. Et donc, le poème démarre à partir de choses très naïves, et puis vient poser les hiérarchies sociales. C'est le genre de choses, c'est pour ça que j'aime bien Sissi, c'est des choses qui paraissent naïves, et puis qui, en fait... pose plein plein plein de questions à la fois linguistiques et à la fois politiques tout de suite.
- Speaker #0
J'espère que ce voyage en Chine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. C'était donc le dixième épisode de Langue à langue, avec la traductrice du chinois Coraline Jortet. Je la remercie infiniment de s'être prêtée si généreusement au jeu de l'interview et d'avoir accepté de commenter l'une de ses traductions, dont je vous rappelle le titre. Il s'agit du poème « Dit, ça se dit » de Sissi, paru en français en 2022 dans le hors-série Hong Kong de la revue Zhen Taiyu. Vous pouvez retrouver les extraits en chinois. et en français sur le site langalang.com. La version en cantonais est extraite du documentaire The Inspired Island, My City, réalisé en 2015 par le réalisateur hongkongais Fruit Chan et qui retrace la carrière de Sissi. Langa Lang est un podcast de Margot Grélier, c'est moi. L'identité sonore et graphique sont signées Studio Peel. et le montage-mixage a été réalisé par Nathan Luyer, de la Cabine Rouge. Merci à eux. Merci aussi à Anne Marsalex, qui m'a gentiment logée pendant mon séjour à Bruxelles, et à Christophe Huet, qui nous a mis en relation. Et puis, merci à vous, les auditeurs et auditrices de Langue à Langue. Le podcast prend maintenant une petite pause estivale. Mais restez à l'affût car on se retrouve dans quelques mois pour de nouveaux épisodes. D'ici là, n'hésitez pas à suivre les pages Facebook et Instagram du podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez-nous des petites étoiles et parlez-en à tout le monde autour de vous. À bientôt et comme on dit en chinois, Zaijian !
- Speaker #1
Je pense que j'ai une erreur.