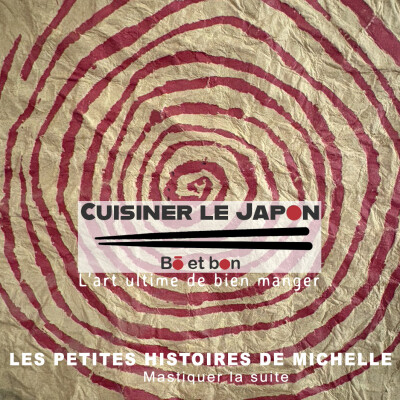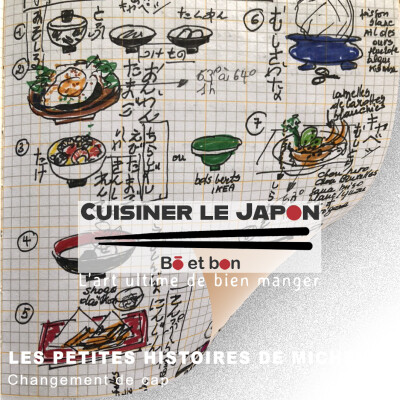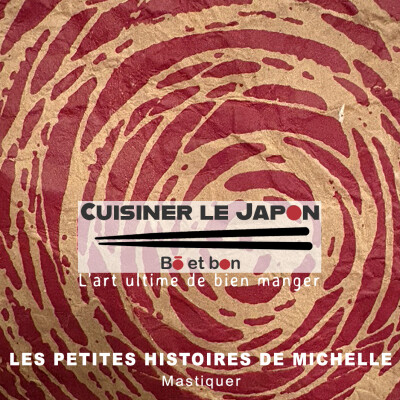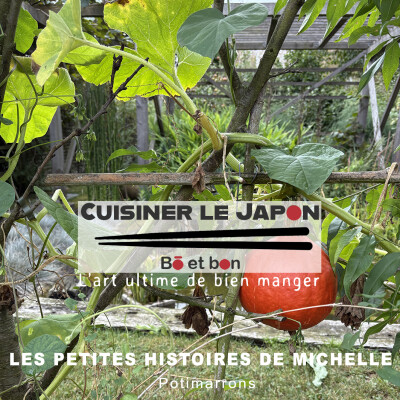Speaker #0Bienvenue dans les petites histoires de Michelle, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon Aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyages et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous ! Dans cet épisode, je vous propose une suite à mon émission concernant la mastication. Il y a quelques jours, j'observais des convives lors d'un brunch. Je mets beaucoup de soin dans la confection du buffet. J'équilibre le menu sur la base de mes connaissances liées au principe de la nourriture japonaise. Je prends soin de la présentation, convoquant les fleurs du jardin, jouant sur une large palette de couleurs. Je varie les découpes de mes légumes et les modes de cuisson pour créer différentes textures. Je calibre mes portions pour que tout le monde soit contenté sans qu'il y ait trop de reste non plus. Pas de gaspillage. Ce jour-là, j'avais deux tablés de huit personnes dans deux salles adjacentes. En passant près de l'une des deux tables, celle où s'étaient retrouvés des amis joyeux de passer un moment ensemble, je n'ai pu m'empêcher de leur faire une remarque. Mais comme elles sont belles les assiettes que vous vous êtes servies ! Chacun avait réinventé une composition personnelle à partir des éléments disposés sur le buffet. J'aurais volontiers pris des photos tant leurs assiettes valorisaient mon propre travail. Quel contraste avec l'assemblée de l'autre salle, une famille qui se regroupait. En les regardant se servir des montagnes, des assiettes débordantes, je me suis dit « Mais c'est pas possible ! Ils se remplissent ! » Peut-être se remplissent-ils pour combler un vide intérieur ? Ou peut-être compensent-ils le vide autour de leur table quand les échanges sont pauvres, quand les tensions sont non dites ? Et que la nourriture devient un refuge, comme s'il était en charge de combler quelque chose d'invisible. Manger devient une manière de remplir une angoisse, un sentiment de solitude, un manque affectif. Quand la conversation ne circule pas, quand les liens ne se tissent pas, on se rabat sur l'assiette qui devient l'activité de substitution. La nourriture devient une métaphore du lien manquant. Manger devient alors une manière d'occuper l'espace, de combler l'absence de mots, d'émotions, de chaleur humaine. C'est le corps qui parle à la place de la parole. C'est ce que l'on peut appeler le remplissage social. Mais ce n'est pas tout. En nous tournant vers les neurosciences, nous apprenons aussi que, devant un buffet, notre cerveau réagit comme celui d'un chasseur-cueilleur tombant sur une carcasse rare ou un arbre couvert de fruits mûrs. Il devait manger vite et beaucoup, car demain, il ne resterait peut-être rien. Le buffet, pour notre cerveau, c'est exactement ça. Une chance unique, éphémère. L'amidale, notre centre émotionnel, envoie une alerte. Ressources précieuses, dépêche-toi ! Le système de récompense s'embrase, la dopamine promet du plaisir immédiat. L'hypothalamus qui régule la faim déclenche même une fausse alerte. Nous croyons avoir faim alors que nous ne faisions que saliver d'envie. Pendant ce temps, la raison, notre cortex préfrontal, tente de garder la main. Mais l'appel de l'abondance est trop fort. Résultat, on se précipite, on remplit, on mange plus que nécessaire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ce vieux programme de survie qui se rejoue malgré nos assiettes pleines et nos frigos garnis. Mon ami, dont il était question lors du précédent épisode sur la mastication, m'avait expliqué que lors d'une investigation dans le cadre d'une thérapie, elle a appris qu'elle serait morte de faim dans une vie intérieure. Cette information a résonné pour elle. Elle dit en avoir porté la trace jusque dans sa mémoire cellulaire. Peut-être est-ce une manière d'expliquer ce réflexe très concret qu'elle a eu longtemps. préparer des sandwichs avant un voyage d'à peine deux heures. « On ne sait jamais » , se disait-elle. Elle ne partait jamais sans. Comme si la peur de manquer était restée tapie quelque part en elle, jusqu'à ce que cette peur soit transmutée grâce à de nouvelles informations envoyées à son cerveau. Et cette peur, consciente ou inconsciente, Nous l'avons presque tous. Certains la tiennent de leur histoire familiale, les privations de guerre, les rationnements, les disettes, d'autres la rejouent sans le savoir, dans la frénésie des buffets. Mais il y a aussi un autre vide, celui de la table silencieuse. Quand la conversation ne circule pas, quand les liens ne se tissent pas, on se rabat sur l'assiette. Manger devient alors une manière d'occuper l'espace, de combler l'absence de mots, d'émotions, de chaleur humaine. C'est le corps qui parle à la place de la parole. C'est ce qu'on peut appeler le remplissage social. On peut avoir faim d'attention, faim de lien, faim de reconnaissance, faim de sens. Quand ces faims invisibles ne trouvent pas de réponse, c'est parfois l'estomac qui prend le relais. La nourriture devient alors une métaphore concrète d'un manque immatériel, un vide émotionnel, que ce soit l'ennui, la solitude, le stress, l'anxiété. La nourriture vient apaiser, occuper, donner une sensation de plénitude. Engloutir produit une gratification immédiate. L'acte de manger stimule la dopamine et les endorphines comme une micro-compensation face à un manque plus profond. Dans ce cas, le corps devient le réceptacle d'un trop-plein émotionnel ou d'un manque. affectif. Et le brunch est une scène qui amplifie ce phénomène. Beaucoup de choix, beaucoup de plats sucrés, salés, incitent à remplir encore et encore. Puis le brunch est censé être convivial, mais si les interactions ne sont pas nourrissantes, alors on se rabat sur l'assiette. Et puis... C'est un moment entre deux, ni petit déjeuner, ni déjeuner, ou les deux à la fois. Il peut traduire à une espèce de flou, une forme de désordre, qui se manifeste aussi dans la manière de manger. Alors, mastiquer, c'est l'inverse du remplissage. C'est ralentir, savourer, écouter son corps. C'est permettre à la satiété de se manifester naturellement avant d'avoir dépassé ses besoins. C'est une manière de dire aux vieux réflexes archaïques « Merci de me protéger, mais je n'ai plus besoin de stocker, tu sais » . La mastication consciente n'est pas seulement une technique de digestion, c'est aussi une façon de réintégrer la nourriture dans une relation vivante avec soi-même, avec ceux qui partagent la table, avec la mémoire collective et même avec ce vide qu'on porte parfois en soi. Alors ? La prochaine fois que vous êtes face à un buffet, demandez-vous « Est-ce mon corps qui a faim ? » ou « Est-ce autre chose que j'essaye de remplir ? » Et si vous laissiez la mastication, vous ramenez doucement vers ce qui compte vraiment, le goût, la rencontre et le plaisir simple d'être juste rassasié. Un nouvel épisode des petites histoires de Michelle vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.