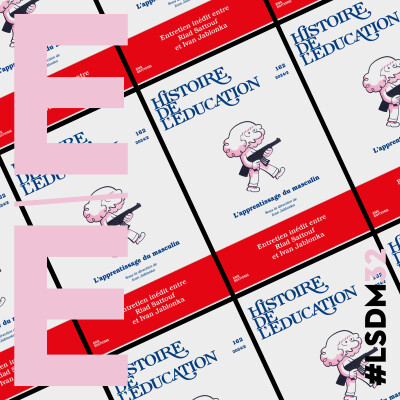#ENS ÉDITIONSAujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Sens des mots, nous recevons l'historienne d'origine américaine, Rebecca Rogers, spécialiste de l'éducation des filles au XIXe siècle. Nous l'invitons à l'occasion de la sortie du dernier numéro de la revue Histoire de l'éducation, dirigé par l'historien et écrivain Yvan Jablonka, un numéro qu'il a souhaité consacrer à la « garçonnité », c'est-à-dire à l'apprentissage du masculin au cours de l'enfance. Dans son article « Chercher l'homme, découvrir la masculinité », la grande historienne Rebecca Rogers, que l'on connaît comme spécialiste de l'histoire des femmes et de l'éducation des filles, fait un pas de côté en s'intéressant, une fois n'est pas coutume, à ce que l'on nomme les « boyhood » et les « manhood studies » en écho aux « girlhood studies », champs d'études dont elle est beaucoup plus familière. Ainsi, c'est à une véritable enquête que l'historienne se livre, une enquête méticuleuse qui prend pour objet quelques revues majeures en histoire de l'éducation, mais aussi des revues spécialisées en histoire du genre. Une enquête enfin qui s'intéresse au boyhood et au manhood studies, c'est-à-dire aux revues portant sur la masculinité. La découverte des masculinités peut-elle permettre de mieux cerner les féminités ? Quelle est la place accordée aux approches historiques dans les revues portant sur la masculinité ? Est-il possible de s'inspirer des travaux en histoire des femmes et du genre pour comprendre l'histoire des hommes ? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, Rebecca Rogers a choisi trois mots : masculinité, revues et boyhood studies.
#REBECCA ROGERSL'histoire de la masculinité, ça ne va pas de soi pour moi, qui est spécialiste du genre, mais qui me suis intéressée à la construction des identités sexuées, où c'est le féminin qui m'intéressait, toujours situé en rapport avec le masculin. Mais je n'avais jamais étudié le réciproque, comment l'identité masculine se forge en rapport avec le féminin. Et la proposition d'Ivan Jablonka de regarder la place de la masculinité dans les revues de genre devenait pour moi l'occasion de me poser de nouvelles questions. Pour être plus concret, il m'a semblé que cette enquête pouvait m'aider à mieux identifier les différents facteurs qui participent à la fabrique du masculin dans l'éducation et ainsi de dénaturaliser l'homme avec un grand « H », comme depuis longtemps les historiennes des femmes ont dénaturalisé la femme. Mes recherches actuelles autour d'un journal de famille écrit par une enseignante et son époux sont aussi pour quelque chose dont cet intérêt est de mieux connaître les travaux sur la masculinité dans l'éducation. Ce journal écrit entre 1835 et 1852 m'a fait découvrir le rôle du père dans l'éducation et la place des réflexions sur le masculin dans le système d'éducation. Ayant surtout travaillé sur des univers non mixtes, le pensionnat ou le couvent féminin, j'avais peu interrogé le rôle des pères ou des fratries dans l'éducation familiale et donc peu pensé à l'évolution des masculinités bourgeoises. En travaillant sur une famille et les dynamiques familiales, je suis obligée de m'intéresser aux masculinités et aux féminités. De me poser de nouvelles questions sur la manière dont un couple enseignant cherche à déjouer les normes de genre, aussi bien du côté masculin que féminin. Ils déplorent par exemple la brutalité tapageuse de leurs garçons aînés et prônent une forme de masculinité domestiquée. Ils vont même jusqu'à donner un nom ambigu du point de vue du sexe à leur deuxième garçon pour que le petit Camille, né en 1844, puisse se fondre dans les groupes de filles du pensionnat. Quant aux filles... elles doivent apprendre à s'approprier le savoir qui, pour eux, n'a pas de sexe. Découvrir la manière dont les historiens de l'éducation ont travaillé les questions de la masculinité m'a semblé une chance pour mieux saisir la dynamique relationnelle des rapports de genre, pour regarder différemment mes propres objets de recherche et notamment de m'interroger sur le rôle de la famille et de l'éducation familiale dans la fabrique du masculin et du féminin. [♫ FOND SONORE ♫] Alors le terrain vient de mon grand plaisir que je prends à enquêter à partir de revues et la numérisation croissante des revues anciennes et contemporaines ouvre, il me semble, beaucoup de pistes pour la recherche. Les revues en sciences humaines et sociales constituent un terrain stimulant car elles nous apprennent beaucoup sur la structuration de la recherche, sur l'histoire des savoirs, sur l'histoire des disciplines, dans des contextes nationaux donnés, même dans notre monde globalisé. Les savoirs sur le genre, la masculinité ou le queer, par exemple, circulent évidemment, mais ils sont opérationnalisés de façon bien différente selon les revues et les pays. Et donc dans cet article, je croise un questionnement sur l'histoire de l'éducation et l'histoire de la masculinité dans des revues en langue française et anglaise. Étant donné l'influence des théorisations de la sociologue australienne Raewyn Connell qui a forgé cette notion de masculinité hégémonique. Alors ma curiosité sur le caractère situé des recherches a donc orienté mon choix de revue. J'ai d'abord voulu voir la masculinité dans les grandes revues en histoire de l'éducation aux États-Unis, en Grande-Bretagne, une revue internationale et puis bien sûr notre revue française Histoire de l'éducation, où il faut bien le reconnaître, la masculinité est presque absente avant ce numéro à part quelques compte-rendus. J'ai procédé par recherche par mots-clés. Masculinité, évidemment, manliness, masculinity, manhood, recensant, auteur, titre et date de publication. Au sein du corpus d'articles retenus, j'ai porté mon attention aux résumés et aux notes de bas de pages pour pouvoir analyser les thématiques traitées et les références épistémologiques mobilisées. Cela m'a permis de voir quelques thématiques porteuses que j'invite les auditeurs et auditrices à découvrir. Le rôle des internats, en particulier le sport dans la construction du gentleman anglais. Le rôle du voyage et des études de langue dans la formation des élites masculines. Ensuite, j'ai voulu voir la place de la masculinité et l'éducation dans les revues d'histoire des femmes et du genre. Et là, ma récolte a été moins riche. Car les analyses sur l'éducation formelle ou informelle sont moins fréquentes, en tout cas dans les revues que j'ai choisies. De fait, les spécialistes de la masculinité ont l'air de se tourner moins vers ces revues, créées, c'est vrai, à l'origine pour traiter des femmes, et du coup, ils se tournent vers les revues sur les masculinités, avec des exceptions, bien sûr. 2017, Peter Hallama, par exemple, dirige un numéro sur les masculinités socialistes, pour une revue d'histoire des femmes et du genre portant sur l'Europe de l'Est et du Sud-Est, Aspasia. Et là, l'éducation est présente sous l'angle de la socialisation et non pas de l'école. L'éditorial insiste sur l'apport de ce qu'il nomme les « critical men's studies » dans l'essor de ce champ de recherche. Et c'est ça qui m'a poussée à vouloir mieux connaître les revues qui se réclament de cette notion-là. [♫ FOND SONORE ♫] Alors j'étais fascinée de découvrir la multiplication de revues sur la masculinité ou la garçonnité en anglais depuis le début des années 90, dans le sillage des premières revues sur les femmes et le genre. 92, création du Journal of Men's Studies. En 2007, si on se déplace vers l'Europe, Norma : International Journal for Masculinity Studies. Et encore en 2014 une revue turque, publiée en anglais, Masculinities, a Journal of Identity and Culture. Pour faire court, ces revues montrent qu'on ne naît pas homme, on le devient. L'ensemble des revues revendiquent leur pluridisciplinarité et progressivement s'affirment dans leurs pages un positionnement épistémologique spécifique, certes au sein des études de genre, mais soucieux d'élaborer un corpus théorique désigné comme les Critical Men's studies qui fait écho aux Critical Race Theory, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, et qui s'insère dans un dialogue plus large autour de l'intersectionnalité. L'histoire est assez peu présente cependant, et ma quête d'articles portant sur des processus d'éducation appréhendés dans une perspective historique n'a pas produit beaucoup de résultats. Là encore, je pense que les historiens de l'éducation qui travaillent sur la masculinité sont sans doute peu enclins à soumettre leurs articles à ces revues où les perspectives contemporaines dominent tellement. Mais au sein de ces revues, Boyhood Studies, fondée en 2007, un an avant la création de Girlhood Studies, m'a semblé le plus intéressant pour mon enquête dans la mesure où la notion de boyhood suggère d'emblée l'idée du passage du temps. On ne reste pas boy. En effet, une historienne de l'éducation, Heather Ellis, est à l'origine d'un numéro dès 2008 sur « Boys, Boyhood and the Construction of Masculinity » qui fait une place non négligeable à l'histoire pour saisir les spécificités de la masculinité chez les jeunes. Le numéro cherche à faire émerger d'autres facteurs que le genre dans la construction de la masculinité, notamment l'âge, l'ethnicité, la classe sociale. Ainsi, conceptualiser boyhood est pensé en rapport avec l'âge adulte, moins qu'en comparaison avec the girlhood. Et c'est cette perspective qui insiste sur la multiplicité et la diversité des masculinités, qui ne délaisse pas le genre mais qui l'intègre dans un arsenal conceptuel plus large, qui m'a semblé intéressant. Pour mes propres recherches, cela m'aide à analyser le journal de famille dont j'ai parlé au début. Je vois par exemple que dans la famille, l'accès au savoir n'a vraiment pas de sexe entre 3 et 12 ans, ce qui ouvre pour ces jeunes des perspectives d'orientation beaucoup moins marquées par des normes de genre. Cela me semble une perspective de recherche fructueuse pour mieux comprendre ces figures de pionnières qui nous paraissent exceptionnelles dans l'histoire, mais qui au fond, peut-être si on s'intéressait davantage à cette période de transition, nous révéleraient d'autres surprises.