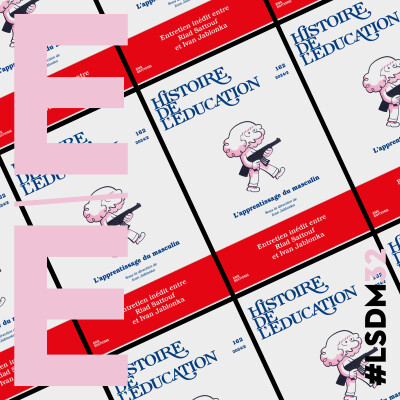Description
Depuis plus d’un demi-siècle, l’agriculture française a vécu de profondes mutations, alors même que les machines et la mécanisation n’ont eu de cesse de gagner du terrain. Tracteurs toujours plus puissants, outils de récolte perfectionnés, dispositifs numériques connectés : à chaque étape de la production, les engins sont devenus incontournables. Mais cette mécanisation, longtemps présentée comme synonyme de progrès, soulève aujourd’hui des interrogations majeures.
Quels effets la mécanisation a-t-elle produit sur la terre, sur le travail des agriculteurs et sur l’économie agricole ? Quelles logiques industrielles sous-tendent cet usage de plus en plus massif des machines dans les fermes ? Le monde agricole est-il aujourd’hui en capacité de relever les défis écologiques face à l’urgence qui s’impose ?
Ces questions sont au cœur de l’ouvrage collectif Comment les machines ont pris la terre. Un ouvrage codirigé par une équipe de sociologues et d’historiens : Sara Angeli Aguiton, Sylvain Brunier, Baptiste Kotras, Céline Pessis et Samuel Pinaud.
À rebours d’une lecture strictement technique, ce livre replace la question de la mécanisation dans un cadre politique, économique mais aussi social. C’est pourquoi nous y parlons aussi des choix publics, des stratégies industrielles, des luttes professionnelles et des résistances paysannes.
Derrière les chiffres de productivité ou la puissance des tracteurs, c’est donc une autre histoire qui se dessine : celle d’une agriculture transformée en profondeur, dont les sols portent les stigmates du tassement et de l’érosion, dont les fermes ploient sous le poids du capital investi, et dont les travailleurs voient leur quotidien remodelé, entre nouvelles pénibilités et perte de savoir-faire.
Pour en discuter, nous recevons aujourd’hui dans le sens des mots Samuel Pinaud, qui porte la voix du collectif. Il a choisi de nous en parler en 3 mots : Terre, Capital et Travail.
Vous entendez au début de cet épisode des extraits issus de :
Présentation approfondie des tracteurs John Deere 9RX : PUISSANCE, PRÉCISION et PERFORMANCES
L'agriculture 2.0 la traite des vaches par des robots, c'est possible !
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.