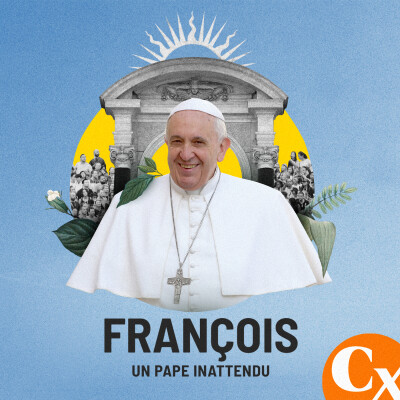- Speaker #0
Enquête d'Orient, sur les routes du christianisme, une série documentaire proposée par La Croix. Épisode 2, le Tour Abidine, une civilisation en équilibre. Cap vers l'Orient chrétien, à l'est de la Turquie. Là où l'aventure du christianisme a commencé, dans le monde ancien des Araméens, dans l'antique et mythique Mésopotamie, cette petite région, baptisée en syriac le Tour Abdin, la montagne des serviteurs de Dieu, a sa géographie singulière, bordée par le Tigre et les montagnes du mont Islo, parsemée de plus de 70 monastères et d'ermitages taillés dans la pierre, tableau immobile sous un soleil ardent. Depuis des millénaires, cette terre de légendes, de traditions et de pèlerinages a lié son destin à l'histoire des communautés chrétiennes.
- Speaker #1
En ce lieu, en cette terre, commença l'une des plus belles aventures du monde chrétien.
- Speaker #0
Extrait de l'ouvrage « Chrétien d'Orient sur la route de la soie » de Sébastien de Courtois, 2007
- Speaker #1
Des hommes, des fous de Dieu, sont venus prier, inventer une nouvelle forme de spiritualité. Loin de tout, loin des villes et des tourments, ils ont vécu la présence divine dans le désert et le dénuement. La terre est rouge, l'air est pur. comme l'étaient les premiers cœurs venus se réfugier ici. Face à moi s'ouvre la longue plaine de Mésopotamie, le territoire des anciennes civilisations. Perses et Romains s'y sont affrontés. À l'ouest, l'ancienne ville de Nizib traçait la frontière des deux empires. Plein sud, c'est la Syrie, et vers le soleil levant surgissent les montagnes kurdes du Hakkari. Le tigre voisin s'écoule tranquillement jusqu'à Bagdad. En ce limesse oriental, le christianisme brilla de tous ses feux.
- Speaker #2
C'est quelque chose, le tour Abdin, qui est bouleversant parce qu'on avait l'impression que l'histoire, finalement, n'avait pas bougé.
- Speaker #0
Gilles Kepel, essayiste, politologue et historien.
- Speaker #2
Le sentiment de vivre il y a mille ans. avec des gestes qui étaient ceux des paysans ou des agriculteurs. Ce lien presque charnel avec la terre était quelque chose qui m'a laissé des images précises et des souvenirs olfactifs.
- Speaker #3
Le rythme de la vie est un rythme qui est au bord des petits ruisseaux, qui nécessite d'aller puiser l'eau, d'aller chercher le bois.
- Speaker #0
Alain Desremeaux. chercheur au CNRS, spécialiste des mondes syriacs.
- Speaker #3
On a la vision d'une vie rurale avec le rythme propre aux saisons. On est accroché à la terre, on aménage les pauvres demeures, on entasse des sacs de blé. C'est la vie des paysans, accrochés à leur terre.
- Speaker #0
Ce qui fait la puissance du tour Abdin, c'est qu'il semble désormais figé dans le temps. Les monastères ont tissé autour d'eux un réseau de communautés vitales, avec les villes et les villages environnants. La langue des monastères demeure le syriac, langue directement issue de l'araméen. Les rites sont les mêmes depuis des millénaires. Tout un monde de traditions est stabilisé dans ces régions. comme figé dans l'éternité.
- Speaker #1
La vie du monastère suit le même cours immuable depuis des siècles. Les cloches sonnent à 5h tous les matins pour la première prière.
- Speaker #0
Extrait du génocide oublié Essai de Sébastien de Courtois de 2002
- Speaker #1
Jusqu'au coucher du soleil, la liturgie rythme les journées. Une poignée de moines s'occupent de la terre, tandis que les nonnes travaillent au jardin. Le soir, nous nous retrouvons autour de grandes tables. Après un dîner frugal, les conversations se poursuivent dans le salon. Les hommes s'assoient sur des banquettes en bois, et au centre de la pièce, un poêle répand une douce chaleur. J'avais devant moi les descendants les plus authentiques de l'église universelle du premier siècle. Comment avaient-ils pu survivre jusqu'à nous ? Eux qui parlent encore la langue du Christ, comment cette tradition, presque deux fois millénaire, s'était-elle préservée des méandres de l'histoire ?
- Speaker #0
Mais ce monde d'éternité vit également avec la peur de disparaître à tout moment. Les menaces et les attaques accompagnent leur histoire et hantent leur mémoire, comme cette sombre année 1915, baptisée l'année du sabre, où les chrétiens d'Orient, également appelés assyro-chaldéens, sont victimes, en même temps que les Arméniens, d'une guerre d'extermination. En trois ans à peine, près de la moitié des 500 000 assyriens est massacrée par les forces ottomanes. alors que le monde entier est engagé dans la Première Guerre mondiale. Le terme de génocide est alors employé pour la première fois de l'histoire pour qualifier l'épisode dramatique qui frappe cette région.
- Speaker #2
Ce qui me frappe dans cette région, c'est que Gilles-Quépel, c'est aussi un lieu de massacre et l'extermination des acéro-caldéens, qui change par rapport au pluralisme ottoman. Là, il s'agit d'éliminer les minorités, de les expulser, puis de prendre leur terre aussi. Et c'est justement là que va naître la notion moderne de ce qu'on appellera ensuite le génocide. Le néologisme est fabriqué en 1940. 1943 par Raphaël Lemkin, à partir d'une réflexion sur l'extermination des Arméniens, avant celle-ci des Assyro-Caldéens par les troupes ottomanes. Et bien sûr, il va après l'appliquer à son propre cas, c'est-à-dire l'extermination des Juifs par les nazis. Mais on oublie qu'en fait, ce sont les massacres des Assyro-Caldéens qui vont créer cette notion moderne du génocide. C'est là que s'est joué, paradoxalement, alors que ça a été... peu relevé jusqu'alors une inflexion de l'histoire contemporaine qui est très forte.
- Speaker #1
Jamais le phénomène du génocide de 1915 n'aurait pu se réaliser avec une telle ampleur, ni même se comprendre, sans considérer les vagues successives de massacres commencées depuis plusieurs décennies.
- Speaker #0
Le génocide oublié, 2002.
- Speaker #1
Les syriacs furent les victimes oubliées et parfois même méprisées de cet horrible bain de sang, précurseur de tous les génocides du XXe siècle. Notre mémoire universelle ne peut se permettre d'ignorer ces événements.
- Speaker #0
Vingt ans plus tard, en 1933, le massacre de Simélé, en Irak, frappe la région, causant la mort de près de 3 000 villageois chrétiens. En 2014, l'histoire se répète à nouveau et dans des proportions inouïes. Daesh lance ses assauts en Irak, forçant les communautés à fuir vers la Turquie. Les yézidis et les syriacs sont ciblés et Mossoul et Erbil assiégés. Sébastien de Courtois, alerté par les communautés locales, décide de se rendre immédiatement sur place avec le photographe de guerre Noël Kidu. En quelques heures à peine, le rendez-vous est pris à Istanbul pour rejoindre l'Irak.
- Speaker #4
De Courtois me prévient, parce qu'il est très bien informé, que ça bouge du côté de Mossoul et compagnie.
- Speaker #0
Noël, qui dû ?
- Speaker #4
Et il me dit, mais moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'y vais. Et je lui dis, Sébastien, tu ne vas pas sans moi, je prends un avion demain matin et je suis à Istanbul demain. demain, en fin de matinée, tout de suite. Et après, on continue ensemble. Donc, on se retrouve à l'aéroport. C'est ce qu'on a fait. On se pose, on prend une bagnole, on va à la frontière, machin, on passe. Et ensuite, on fonce sur Erbil. Et là, on voit déjà toute la population des chrétiens de Caracoche qui ont fui dans la panique. Ceux qui ont pu fuir, malheureusement, tout le monde n'a pas pu fuir. L'État islamique. qui fera absolument toutes les horreurs dont tout le monde a mémoire, j'imagine. C'est-à-dire que je crois que depuis les nazis, on n'avait pas vu de choses aussi terrifiantes. Donc c'est la disparition annoncée des chrétiens du Moyen-Orient.
- Speaker #1
L'ampleur du désastre est colossale. Le bâtiment de l'archevêché syriac catholique de Mossoul a été incendié.
- Speaker #0
Extrait de l'ouvrage « Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions » de Sébastien de Courtois, 2015.
- Speaker #1
La très belle église Saint-Ephraim a été transformée en mosquée après avoir été profanée. L'église de la résurrection à Caracoche a été dynamitée. Le couvent al-Nassar des sœurs chaldéennes de Mossoul a été détruit à son tour. L'église Saint-Thomas aurait même été transformée en centre de torture par l'État islamique. L'histoire est effacée.
- Speaker #4
Dans les grands drames, c'est comme dans les grandes douleurs. Quand, par exemple, sur le front, j'ai vu beaucoup de gens blessés ou tués, si quelqu'un est blessé et qu'il crie très fort, c'est plutôt rassurant. Si il est très gravement touché, il n'a même pas la force de crier. Et là, c'est pareil. Quand les gens sont atteints d'un tel drame, ils n'ont plus de voix. Ils ne disent plus rien. Ils sont abattus. Très peu d'entre eux vont vouloir communiquer sur le moment, sur le choc. Ils parleront plus tard, un peu plus tard. Mais sur le moment, d'abord, ils essayent de se compter. Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce qu'on n'a pas laissé une grand-mère quelque part ? Un oncle ? Un enfant ? Je ne sais pas. Donc, évidemment, souvent, tout le monde n'est pas au complet, donc c'est des drames. Donc, oui, c'est plutôt un grand silence malgré l'accueil.
- Speaker #2
Le Moyen-Orient est dans une situation historique qui est cyclique parce que c'est ce qu'on pourrait appeler la malédiction de la terre sainte.
- Speaker #0
Gilles Kepel.
- Speaker #2
Tout le monde estime qu'elle est à soi et pas à l'autre. Et donc le compromis nécessaire à l'organisation de l'histoire y est plus difficile à réaliser qu'ailleurs. Et les massacres s'en suivent. Et on est donc là dans une volonté de faire signifier à cette malheureuse terre des choses qu'elle-même n'a pas tellement envie de signifier.
- Speaker #0
Les chrétiens d'Orient traversent l'histoire dans une perpétuelle survie. Un petit univers en péril dans un monde oriental hostile. Les assauts violents de l'État islamique de 2014 n'ont pas seulement ravivé les souvenirs douloureux de 1915 ou de 1933, ils ont plus largement réveillé la conscience profonde d'une existence sans garantie. Dans cette longue nuit de souffrance, la légende des dormeurs d'Éphèse continue à habiter les cœurs. comme une lanterne d'espoir.
- Speaker #5
Dans les années 2010, on parlait beaucoup d'un monastère qui pour moi m'évoquait Tibhirine en Algérie, Marmoussa en
- Speaker #0
Syrie. Jean Lebrun, journaliste et historien.
- Speaker #5
Il avait été fondé par un saint qui s'appelait Moïse l'Abyssin dans la nuit des temps, mais il avait été refondé par un jésuite italien, Paolo D'Alolio, s'était passionné par la légende des Dormants d'Éphèse. Les Dormants d'Éphèse, c'était des soldats romains qu'un empereur avait décidé d'isoler dans une caverne en roulant sur eux une pierre, fermant la caverne. Les Dormants d'Éphèse étaient dans le sommeil à ce moment-là et quand ils se sont réveillés, on était, je crois, 192 ans ou 309 ans plus tard. Ils étaient toujours vivants et ils ont reconnu un autre monde que celui qu'ils avaient connu. Paolo Dall'Olio parlait beaucoup de cette légende. Un jour, il est allé voir un des chefs de Daesh pour essayer d'obtenir la libération de prisonniers politiques. Est-ce qu'il a été reçu ? Est-ce qu'il y est allé une fois ? Est-ce qu'il y est allé plusieurs fois ? On ne sait pas. En tout cas, il a disparu. Et Paolo D'Aglio disait, on ne sait pas combien de temps va durer le sommeil, on ne sait pas combien de temps va durer la persécution, peut-être 109 ans, peut-être 309 ans, mais il y aura un réveil. Donc quand je pense moi au massacre de Daesh, je pense aussitôt à cet homme, à sa petite communauté, maintenant dispersée, qu'est-il advenu des membres, qu'est-il advenu des manuscrits, spontanément, mais aussi à l'espérance qu'il exprimait.
- Speaker #0
L'espérance. Les églises se reconstruisent, les diasporas reviennent chaque été dans le Tour Abidine et maintiennent la flamme allumée, malgré tout. De retour à Istanbul, Sébastien de Courtois sent alors naître de nouvelles questions. Existe-t-il ailleurs, dans d'autres coins du monde, d'autres chrétiens d'Orient ? Une nouvelle quête se dessine alors. Remonter le fil du temps, ressusciter des destins lointains, chercher des traces de leurs exils. Une quête qui nous mènera bientôt vers les fantômes des Nestoriens, jusqu'à la Chine. Enquête d'Orient sur les routes du christianisme, une série documentaire d'Ulis Manès et de David Federman proposée par La Croix, avec la participation de Gilles Kepel, Alain Desremeaux, Noël Kidu et Jean Lebrun. Les extraits des ouvrages de Sébastien de Courtois sont interprétés par Pablo Pauly. Enquête et scénario, Ulysse Manès et David Federman. Narration, Ulysse Manès. Suivi de production et du partenariat à La Croix, Célestine Albert-Steward, Sandrine Verdelan et Laurence Chabazon. Réalisation et générique original, David Federman.