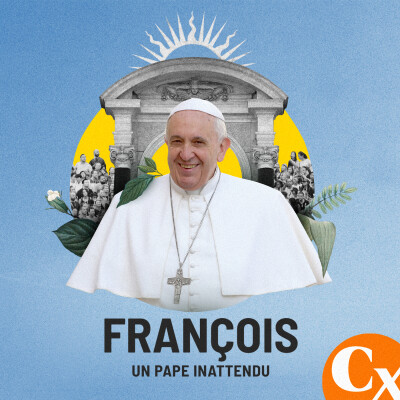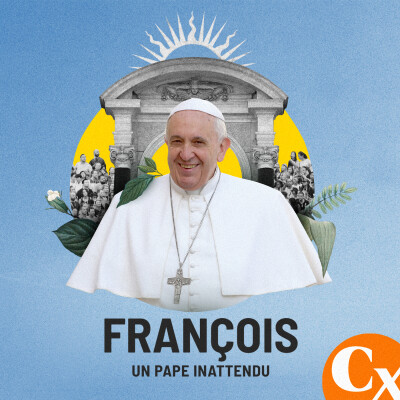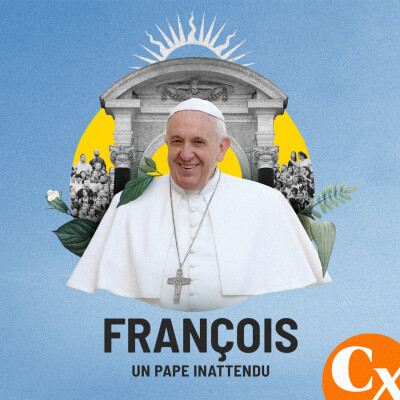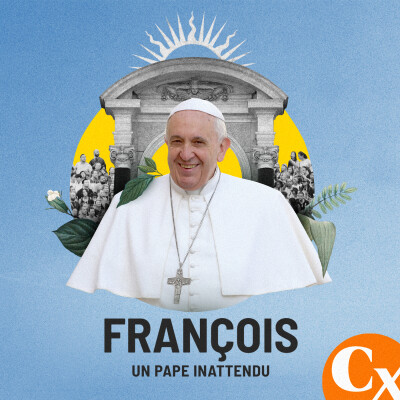Nicolas SenèzeJe suis Nicolas Senez, j'ai été le correspondant de la Croix au Vatican de 2016 à 2020 et j'ai notamment suivi la manière dont le pape François a été confronté à la crise des abus sexuels dans l'Église. En ce mois de janvier 2018, le cinquième voyage du pape François en Amérique latine aura été chahuté, en particulier au Chili, pays marqué par des affaires qui ont éclaboussé jusqu'au sommet de l'Église locale. Un homme surtout suscite les critiques, Juan Barros, l'évêque d'Osorno, au sud du pays. Il est en effet impliqué dans le scandale Caradima, du nom d'un ancien curé d'une paroisse huppée de Santiago, à l'origine de nombreuses vocations, mais qui n'a pas été révélié. mais qui s'est révélé un redoutable prédateur sexuel. Juan Barros avait fait partie du groupe de jeunes dont la vocation a été éveillée par Karadima, et il est accusé d'avoir été témoin d'agression du prêtre. Ce que conteste l'évêque, qui insiste à toutes les cérémonies du pape au Chili, provoquant la colère des victimes. Le 18 janvier, à Iquique, tout au nord du pays, où Mgr Barros a été évêque, le pape lui-même est interpellé par la télévision chilienne, alors qu'il va célébrer la messe. Pris à froid ? François répond de manière véhémente. « Le jour où on m'apportera une preuve contre Mgr Barros, alors on verra. Tout cela est de la calomnie. C'est clair ? » Cette phrase, lancée en direct, suscite l'incompréhension, non seulement chez les victimes, mais chez tous ceux qui, dans l'Église, luttent contre les agressions sexuelles. François comprend assez vite qu'il a dérapé. Et c'est comme cela que la traditionnelle conférence de presse, qui nous donne à chaque vol retour de ses voyages, va se transformer en un moment inédit. Car il était évident que nous, les journalistes qui l'accompagnons, allions l'interroger sur le cas de Juan Barros. Et cela ne manque pas, dès la troisième question d'un confrère chinois. Je dois présenter des excuses, parce que le mot « preuve » a blessé, admettit-il d'emblée, reconnaissant qu'il avait, en quelque sorte, sommé les victimes de présenter un certificat de leur abus. Tous, évidemment, nous sommes assez estomaqués par ces paroles. Jamais un pape ne s'est ainsi excusé. Il y a bien eu des repentances solennelles, mais jamais comme cela devant des journalistes pendant une conférence de presse. Et François continue à s'expliquer. « J'ai voulu traduire un principe légal, et je m'excuse auprès d'elles si je les ai blessées sans le vouloir, répète-t-il. Entendre le pape leur dire en face « apportez-moi une lettre avec la preuve » , c'est une gifle. Et je me rends compte maintenant que mon expression a été malheureuse. » François n'est pas le premier pape confronté aux affaires d'abus dans l'église. Scandalisé par la manière dont l'entourage de Jean-Paul II déconnectait le pape polonais de ses sujets, Benoît XVI avait pris les choses à bras-le-corps. C'est lui qui a mis en place la tolérance zéro contre les agresseurs. C'est aussi lui qui, le premier, rencontrera des victimes dès 2008 en Australie. François continue ce travail, mais se rend compte assez vite des limites de la tolérance zéro. Certes, punir même sévèrement les agresseurs, c'est bien, mais ce serait encore mieux de les arrêter avant leur crime et de ne pas créer les conditions facilitant un passage à l'acte. Mais François est face à une espèce de quadrature du cercle. Décentraliser l'Église, responsabiliser des évêques qui ont souvent eu tendance soit à cacher les problèmes, soit à se défausser sur Rome, ou frapper fort au risque de recentraliser les décisions sur sa seule personne. Changer les choses sur le fond, ou aller vite pour répondre aux cris des victimes. À cet égard, l'affaire chilienne est emblématique et elle contribuera à faire bouger François sur ces sujets. Le Chili est en effet un pays qu'il connaît bien. Jeune jésuite, il y a même été étudiant. Il y nourrit de solides amitiés, notamment avec l'archevêque de Santiago, le cardinal Errazuriz, qui a présidé les évêques d'Amérique latine lors de la conférence d'Aparicida, dont le cardinal Bergoglio fut l'un des grands animateurs. Les deux hommes se connaissent bien, et devenu pape, François demandera à cet ami chilien d'être un des huit cardinaux qui le conseille pour réformer la curie et gouverner l'Église. Une confiance peut être mal placée, car c'est par lui qu'arriveront au pape beaucoup d'informations sur l'église chilienne. Revenons à cette conférence de presse dans l'avion qui ramène le pape du Chili et du Pérou. Après avoir présenté ses excuses aux victimes, François détaille précisément la gestion du cas Juan Barros, l'évêque d'Osorno, symbole de la crise chilienne. Il explique que certains la comprennent. conférence épiscopale, on suggérait qu'il vaudrait mieux qu'il démissionne, prenne une année sabbatique et qu'on voit ensuite quand la tempête serait passée. Il reconnaît même que Mgr Barros lui a présenté sa démission. Il est venu à Rome et j'ai dit non, on ne joue pas avec ça, c'est admettre sa culpabilité. Chaque fois qu'il doit y avoir un coupable, on enquête. L'évêque aurait aussi réitéré son geste quand les fidèles de son nouveau diocèse ont manifesté contre lui au moment de sa nomination, l'empêchant même d'entrer dans sa cathédrale. François a encore refusé. J'ai dit tu y vas. Et il assure qu'il y a eu plusieurs enquêtes sur Barros. Le pape se dit même convaincu que Mgr Barros est innocent, soulignant que les victimes ne sont pas venues apporter d'éléments pour un jugement. Tout cela est trop léger pour être pris en compte. Quelqu'un qui accuse sans éléments, avec opiniâtreté, c'est de la calomnie, martèle-t-il, se disent en néanmoins prêts à entendre tout élément à charge contre Mgr Barros. Face à la bronca, qui enfle encore quand il apparaît que des témoignages accablants sont bien arrivés à Rome, le Vatican annonce finalement que le pape a demandé à l'archevêque de Malte, Mgr Charles Cyclouna, de recueillir le témoignage des victimes au Chili. Ce petit homme rond au visage jovial n'est pas n'importe qui. Il est considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs des abus sexuels dans l'Église. Il est l'homme de la tolérance zéro de Benoît XVI, et l'un de ses plus fin limier, qui a mis au jour les scandales les plus sordides. À l'écoute des victimes, Mgr Chikluna va étaler au grand jour les baffons d'une église chilienne qui n'a jamais voulu remettre en cause son fonctionnement très élitiste. Un ancien séminariste de Santiago m'a raconté combien les jeunes accompagnés par Karadima y formaient un groupe soudé, quasi sectaire, qui se percevait comme une élite voulant refonder l'église chilienne en appuyant fortement sur l'identité du prêtre. Et malheur à ceux qui n'entraient pas dans leur vue, voire s'opposaient à eux, ils étaient souvent forcés de quitter le séminaire. Au fil des ans, ces jeunes ont pris des responsabilités dans l'église chilienne. Et au total, ce sont 57 prêtres devenus curés, vicaires épiscopaux, professeurs ou formateurs de séminaires, et même pour quatre d'entre eux, évêques. C'est cet état d'esprit que François découvre dans les 2300 pages du rapport de Mgr Chicluna. Surtout, le pape se rencontre avec stupeur que certains n'ont pas hésité à lui mentir. Jamais la conférence épiscopale ne lui a dit la vérité, ni le nonce, son représentant sur place. Même le cardinal Errazuriz, son vieil ami, archevêque de Santiago et conseiller, l'a trompé. J'ai commis de graves erreurs dans l'évaluation et la perception de la situation, admettit dans une lettre envoyée aux évêques chiliens le 11 avril. Convoqué à Rome pendant trois jours de franches explications, ceci démissionne en bloc. Le cas de chacun sera étudié. Huit seront démis, deux renvoyés de l'état clérical, et le cardinal Erasuris a été remercié du conseil des cardinaux. Surtout, dans une lettre adressée aux catholiques chiniens, le pape, dans des mots très forts, met en cause la culture de l'abus et le système de couverture qui lui permet de se perpétuer au sein de l'Église. Pour lui, la tolérance zéro prônée par Benoît XVI en matière de pédophilie est nécessaire, mais demeure insuffisante. Il faut passer au jamais plus, en luttant contre le cléricalisme qu'il identifie comme le véritable terreau de cette culture de l'abus. Il décrit finalement un cléricalisme qui peut entraîner des abus d'autorité, mais aussi des abus spirituels et de conscience qui, eux-mêmes, peuvent mener à des agressions sexuelles. Dans l'Église pourtant, tous sont loin d'être convaincus. Les abus sexuels ? Une histoire d'Occidentaux dépravés, mais pas chez moi, pensent beaucoup d'évêques, notamment au Sud. Pour mettre les choses au point, et après la révélation de nouveaux scandales aux Etats-Unis, François réagit en publiant, le 20 août, une lettre au peuple de Dieu. Il y met une nouvelle fois en cause le cléricalisme qui gangrène l'Église. Puis il part en Irlande, visiter une Église parmi les premières frappées par les abus sexuels, mais qui, à l'écoute des victimes, et en collaboration avec laïcs et autorités civiles, a su trouver un second souffle, un modèle qu'il voudrait donner en exemple. Mais là encore, rien ne va se passer comme prévu. Le 25 août, le soir de son arrivée à Dublin, un ancien nonce aux Etats-Unis, Mgr Carlo Maria Vigano, publie un texte au vitriol contre le pape. Il s'en prend avec vigueur à la manière dont a été géré le cas du cardinal Theodore McCarrick, ancien archevêque de Washington, longtemps figure de proue de l'église américaine et qui, au cœur de l'été, a été convaincu de viol sur mineurs. Dans un long témoignage, et alors que François n'a jamais eu aucun rôle dans la carrière de Maccaric, Mgr Vigano accuse le pape de l'avoir couvert et dénonce une idéologie progay à l'œuvre au Vatican. Aux Etats-Unis, toute une presse aux mains des ultraconservateurs s'emballe et s'en prend aux réformes de François. Car pour ses adversaires, il n'y a aucun doute, c'est l'homosexualité la cause des abus, pas le cléricalisme. Le 12 septembre, le Vatican annonce la convocation de tous les présidents de conférences épiscopales à Rome pour parler de la prévention des abus sur les mineurs. En cinq mois, quasiment du jour au lendemain dans le temps du Vatican, un programme est bâti autour d'une équipe resserrée qui identifie bien le maillon faible de l'Église face aux abus, le rôle de l'évêque. Par souci d'une unité voulue comme une uniformité, Jean-Paul II avait affaibli les conférences épiscopales. Or, dans les années 90, devant les premières affaires qui éclatent, les évêques se sont retrouvés démunis, sans rien entre eux et une Rome trop lointaine, pour les aider à comprendre les ressorts psychologiques, sociaux, juridiques de ce qui se jouait. Alors ils ont fait comme ils ont pu, souvent mal, sans souci des victimes et sans accepter de se remettre en cause. Responsabilité, reddition de comptes, transparence, les thèmes des trois journées soulignent l'enjeu de ce sommet qui se tient fin février 2019 au Vatican. L'idée est bien que les évêques soient au clair avec des procédures pourtant établies dès le pontificat de Benoît XVI mais qu'ils ne maîtrisent pas. Et qu'ils comprennent bien qu'il s'agit d'un problème mondial. Pour cela, avant de venir, ils ont été obligés de rencontrer des victimes. Qu'il soit clair pour chacun que des abus sont bien perpétrés chez lui. L'endroit choisi pour ce sommet inédit n'est pas neutre. La salle royale du Vatican, l'ancienne salle du trône des papes, le lieu par excellence du pouvoir dans l'Église. Mais ces jours-là, au lieu d'un trône, ce sont devant les victimes que siègent évêques et cardinaux du monde entier, et jusqu'au pape lui-même qu'on verra, tête baissée, écoutant les terribles témoignages. Un soir en particulier, une femme du cinquantaine d'années racontera son enfance. « J'avais onze ans, lorsqu'un prêtre de ma paroisse a détruit ma vie. » Un témoin me racontera que les évêques en sont sortis grogués. J'ai dû fermer les yeux. Les larmes ont coulé, confie même un participant pour qui il était indispensable d'écouter ce témoignage. En mettant ainsi les victimes au centre, François oblige à ce que Mgr Mark Coleridge, archevêque de Brisbane, en Australie, décrira, dans l'homélie de la messe finale du sommet, comme une révolution copernicienne. Alors que le pouvoir est dangereux, car il peut détruire lorsqu'il est séparé du... du service, il faut bien, explique-t-il, cette révolution copernicienne qui consiste à découvrir que ceux qui ont été abusés ne tournent pas autour de l'Église, mais l'Église autour d'eux. En découvrant cela, nous pouvons commencer à voir avec leurs yeux et entendre entendre avec leurs oreilles. Et une fois nous avons fait cela, le monde et l'Église commencent à être sensiblement différents, conclut-il. En parallèle, neuf interventions, martelées à raison de trois par jour, indiquent clairement aux participants la ligne que François entend suivre pour que les abus soient non seulement punis, mais aussi prévenus, empêchés et dénoncés dans l'Église. Certes, le Vatican a pris le temps d'entendre les objections de ceux qui faisaient valoir les particularités de tel pays ou continent. Un silence qui concerne la dénonciation systématique des agresseurs, pas toujours évidente là où n'existe pas d'état de droit. Mais les différences culturelles ne peuvent être une excuse pour ne pas nous engager dans la protection des mineurs. Mais regarde le père Arturo Sosa, préposé général des jésuites. Le fait qu'il y ait d'importants problèmes de pauvreté, de maladie, de guerre et de violence dans certains pays du Sud ne signifie pas que la question des abus sexuels doit être minimisée ou ignorée, insiste avec autorité la religieuse nigériane Véronika Opénibo. Une réponse africaine et féminine à un argument souvent invoqué par plusieurs évêques du continent pour ne pas faire du sujet une priorité. Pendant ce sommet, d'ailleurs, la parole des femmes aura eu une portée bien plus importante que leur petit nombre, une quinzaine sur 190 participants. Leurs trois conférences auront été parmi les plus fortes, contribuant largement à ce que bien des évêques comprennent les mécanismes qui ont pu conduire l'Église à occulter les abus et prennent conscience de la nécessité d'agir. Alors quels auront été les effets de ce sommet ? Sur le coup, la réponse n'est pas évidente. Le Vatican annonce bien un nouveau renforcement de son arsenal législatif. Mais les mesures assez minces étaient en fait déjà dans les tuyaux avant même le sommet. Dans l'esprit de François pourtant, cette rencontre n'avait pas pour but d'arriver à des mesures spectaculaires, mais bien plutôt de permettre une prise de conscience. Et celle-ci a eu lieu, comme me l'a raconté alors le cardinal Holrich, archevêque de Luxembourg. Les évêques changent. Je sens l'atmosphère de nos partages. J'avais l'impression qu'au début, l'un ou l'autre mettait des barrières, mais elles sont tombées. Le pape est très sage. Il sait très bien qu'on ne peut pas changer l'Église par des ordres venus d'en haut, mais qu'il faut changer le cœur des gens. Alors qu'en est-il plus en profondeur dans l'Église ? Certes, en ce qui concerne les agressions contre les mineurs, les choses sont désormais claires, même si certains, jusqu'au Vatican, semblent effrayés par l'ampleur des crimes passés. Les réactions romaines au rapport français de la SIAZ l'ont montré. Il reste aussi des angles morts, par exemple sur les abus dont sont victimes les majeurs et notamment les religieuses. La question de l'emprise est encore mal comprise, et les crimes restent encore trop souvent envisagés sous l'angle du péché et de la déviance sexuelle, et pas encore assez dans leur dimension systémique. Enfin, la lutte contre le cléricalisme à laquelle appelle François suppose une profonde remise en cause théologique, sur ce qu'est le prêtre, ce qu'est l'Église, la manière d'y vivre l'autorité et dont s'y distribue le pouvoir. Beaucoup n'y sont pas prêts. Il suffit de voir les réactions sur le synode de l'Église allemande dès lors que s'y pose la question de la place des femmes ou de l'ordination d'hommes mariés. et l'avancée en âge du pape, les questions autour d'une éventuelle démission et l'ambiance de fin de règne qu'elle génère n'ont pas non plus aidé à cette vision à long terme souhaitée par François.